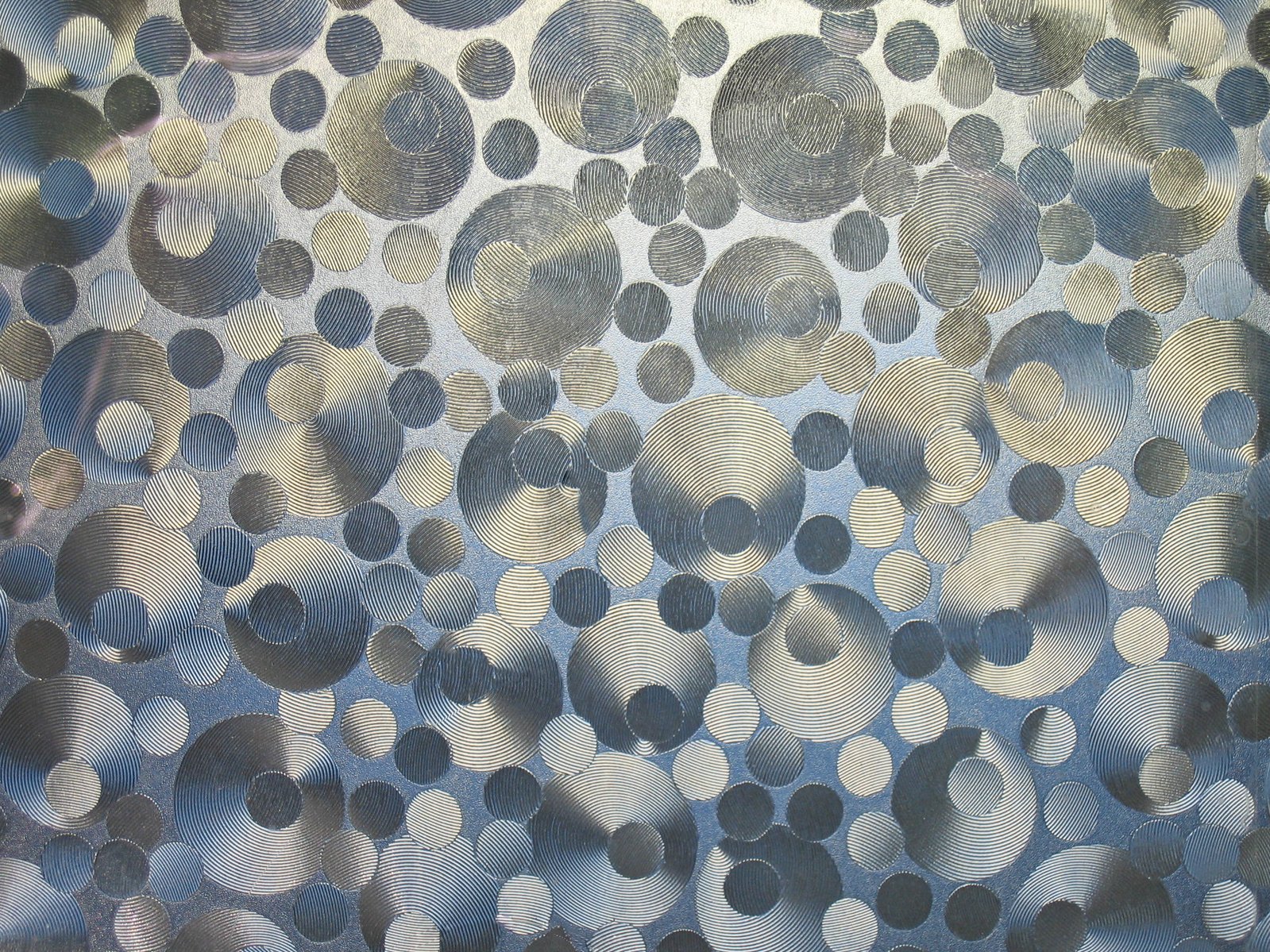Les addictions : une équation à trois inconnues
[box] Benjamin Rolland, Psychiatre, Addictologue, Maître de Conférences à la Faculté de Médecine Lyon Sud, Université de Lyon.
Guillaume Sescousse, Docteur en neurosciences, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, INSERM; chercheur au CNRS.
Mélanie Trouessin, Docteure en philosophie, ENS de Lyon
Présentation
Cet article est tiré d’une conférence grand public qui a eu lieu le vendredi 16 mars 2018 à la médiathèque du Bachut à Lyon, dans le cadre de la Semaine du Cerveau, manifestation nationale coordonnée par la Société des Neurosciences depuis 20 ans dans le but de donner à chacun la possibilité de s’informer, en particulier sur les thèmes touchant au cerveau et aux comportements humains. Le but de cette conférence, modérée par le psychiatre et addictologue Éric Peyron, était de confronter trois points de vue différents à propos d’un phénomène complexe et qui intéresse de plus en plus les chercheurs et le grand public à savoir les conduites addictives. Les trois points de vue convoqués étaient celui de la clinique, à travers l’intervention de Benjamin Rolland, psychiatre, addictologue et professeur des universités à l’université Lyon 1 ; celui des neurosciences, avec celle de Guillaume Sescousse, docteur en neurosciences et chercheur au CNRS ; et enfin, celui de la philosophie, avec ma propre intervention. Docteure en philosophie sur le thème des addictions, je coordonne cet atelier, « penser les addictions » depuis près de deux ans. Il me semblait intéressant de donner un aperçu du dialogue entrepris entre les différentes disciplines, dont cette conférence est un exemple. Ce texte révèle une démarche originale puisqu’il s’agit de retranscrire les interventions de B. Roland et G. Sescousse et d’y ajouter ensuite le texte de mon intervention[1].
B Rolland – L’addiction entre focalisation et acceptabilité sociale
Pour B. Rolland, les addictions sont des troubles de nature biopsychosociale. Si les usages de substances et parfois de développement de comportements à risque ont une origine éminemment sociétale, la biologie propre des individus peut maintenir ces derniers prisonniers de tels usages, voire progressivement les attiser. Benjamin Rolland constate en effet que les usages de substances sont d’abord des rituels sociaux, qui ont lieu dans des cadres et des contextes institutionnalisés, comme le montre l’exemple de la fête de la bière en Allemagne. En outre, l’initiation à ces usages est très souvent liée à des rituels de passages, c’est-à-dire au fait de franchir une étape importante lors de notre vie : l’initiation d’une consommation de substance commence en général à l’adolescence et en groupe, qu’il s’agisse d’une consommation en famille (comme avec l’alcool) ou avec des pairs (par exemple pour le tabac). Étant donné qu’il s’agit souvent pour les adolescents d’être acceptés au sein du groupe, il y a une pression pour commencer ces comportements. B. Rolland insiste sur ce point : les situations où les individus expérimentent seuls un usage sont en général assez rares.
En outre, parmi les individus qui expérimentent les consommations de substance (c’est-à-dire une majorité de personnes), seule une petite partie en aura un usage problématique voire addictif. Il faut donc bien distinguer l’usage d’une substance de l’addiction à celle-ci : un usage peut comporter des risques, être excessif (comme c’est le cas de la consommation d’alcool lors de certaines fêtes ou dans le cadre du binge drinking chez les adolescents) mais « l’usage ne fait pas l’addiction ». Qu’est-ce qui fait l’addiction alors ? Pour B. Rolland, on peut donner deux éléments de réponse fondamentaux.
Le premier est celui de la focalisation : dans l’addiction, la consommation de substance devient l’unique centre d’intérêt des individus, l’activité autour de laquelle ils centrent toute leur existence. Au contraire, même dans des cas d’usages excessifs, celui-ci prend place dans un contexte déterminé, avec des horaires déterminés etc. Dans l’addiction, toute idée de cadre et de limite a disparu et l’addiction envahit progressivement toutes les sphères de vie d’un individu, ce pour quoi B. Rolland compare l’addiction à un « cancer comportemental ». Ainsi, il faut bien se garder de croire qu’une cure de désintoxication ou qu’un médicament (tel que le baclofène, comme cela reviendra dans une question posée par le public) pourraient complètement guérir de l’addiction : il faut également aider les individus à retisser les autres sphères de leur vie, qui ont été atrophiées par la conduite addictive. Il s’agit pour les soignants de les accompagner dans la sortie hors de l’addiction et dans la vie postérieure, sans la béquille addictive : c’est le processus de rétablissement (recovery).
Le deuxième trait distinctif de l’addiction par rapport à de simples usages, même à risque, consiste dans l’acceptabilité sociale : la ritualisation de la plupart des usages de substances, même risqués et excessifs, entraîne une acceptation par la société de ces usages. Au contraire, la consommation devenue addictive sort de ce qui est accepté par la société. Pour illustrer cette notion d’acceptabilité sociale, un membre Alcoolique Anonyme donnait cette image à la fin de la présentation : la personne alcoolo-dépendante est comme celle qui porte un maillot de bain en plein centre-ville. Tandis que cette tenue ne choquerait personne sur les bords de plage, elle est totalement inappropriée lorsque l’on sort de ce contexte. La personne alcoolo-dépendante est, de même, celle qui consomme en dehors des moments adéquats et des rituels institutionnalisés, y compris les excès célébrés par la société.
Une question émerge souvent à propos des addictions : celle de leur origine. Le débat fondamental oppose une origine médicale et une origine sociale : l’addiction est-elle une pathologie du corps, avec des corrélats biologiques ? Ou est-ce que c’est la société qui crée l’addiction par son caractère addictogène ? Tandis que la question de savoir en quoi notre société pourrait être dite addictogène ou addictive sera abordée lors de la troisième intervention, B. Rolland adhère au consensus actuel dans le domaine de la clinique addictologique, selon lequel il n’y a pas de sens à rechercher une origine unique de la condition addictive. Il faudrait plutôt, dans une orientation biopsychosociale, s’intéresser à des pistes d’unification des différentes théories afin de pouvoir comprendre davantage un phénomène aussi multidimensionnel que l’est l’addiction.
D’ailleurs, suggérer que l’addiction relève uniquement de la pathologie cérébrale revient à méconnaître toute la complexité du cerveau humain et son lien avec ce qui l’entoure (l’environnement, les autres individus). B. Rolland adhère à la perspective actuelle en matière de cognition incarnée et sociale ; pour lui, le cerveau est bien un « organe social » et de ce fait, il n’y a pas de sens à opposer le biologique d’un côté et le social de l’autre. Le cerveau est un organe souple qui réagit à l’entourage. De nombreuses études issues des neurosciences cognitives illustrent à quel point le cerveau d’un individu est en résonnance avec celui des autres êtres humains autour de lui. L’exemple caricatural de cela est celui des neurones miroirs. Lorsque nous voyons un individu effectuer une certaine gestuelle, notre cerveau va reproduire les gestes en question comme si notre corps les effectuait réellement. En permanence, le cerveau imite, copie, s’imprègne des gestes et des émotions des autres, et les incorpore à ses propres schémas, ses propres rituels. C’est sans doute ainsi que la culture se transmet et s’incarne dans le biologique, en passant d’un cerveau à l’autre. Les usages de substances et toute leur codification sociale complexe, font bien sûr partie intégrante de ces va-et-vient cognitifs.
Ainsi, l’importance accordée à la connaissance des mécanismes biologiques et neurobiologiques ne doit pas mener à négliger la dimension sociale de l’addiction. Il faut prendre en compte, par exemple, qu’une multiplicité de choses, dans la société, nous pousse à consommer, notamment ces rituels dont B. Rolland parlait au début. Il existe des facteurs de vulnérabilité et facilitant la survenue d’une addiction, comme il existe des facteurs de protection, et une grande partie d’entre eux sont des facteurs sociaux. L’importance du contexte social a d’ailleurs été démontrée dans le cadre de ce phénomène qu’on appelle le rétablissement naturel (maturing out). Au départ mis en évidence au retour du Vietnam des vétérans américains, dont la grande majorité ayant consommé de l’héroïne avait pu « décrocher » sans difficulté à leur retour, ce phénomène n’a en réalité rien d’anecdotique. Pour une grande majorité de personnes touchée par l’addiction, celle-ci peut diminuer naturellement à l’entrée de l’âge adulte, au moment où de nouvelles perspectives apparaissent, telles que former une famille ou avoir de nouvelles responsabilités dans le milieu professionnel.
En définitive, l’insertion des conduites addictives dans un contexte social, avec ses habitudes et ses rituels, a un impact puissant sur le développement des addictions qui entre en résonance avec les vulnérabilités de chacun, à la fois sur le plan psychologique et biologique. L’importance du contexte social est manifeste dans la fixation des frontières entre ce qui est normalement institué et de ce qui va au-delà, dans lequel l’addiction trouve sa place. L’exemple du tabac aujourd’hui, très largement exclu de l’espace public par rapport à une trentaine d’année en arrière, est paradigmatique de cette idée que la caractérisation d’un phénomène comme l’addiction relève à la fois du médical et du normatif. Cette injonction à toujours intégrer les dimensions sociétale et normative ne doit pas mener à l’extrême inverse qui serait de totalement délaisser la dimension pathologique des addictions. La compréhension des addictions comme pathologies médicales a entrepris un élan de déstigmatisation fondamental à l’égard des personnes addictes et a participé à ce que l’on ne conçoive plus les conduites addictives comme relevant de péchés ou de vices.
Guillaume Secousse – L’addiction à la lumière de la neuroimagerie
Le domaine des neurosciences a entériné ce mouvement de déstigmatisation avec la construction d’un modèle de l’addiction comme maladie cérébrale. L’intervenant suivant, Guillaume Sescousse, chercheur en neurosciences et spécialisé en neuroimagerie, nous explique pourquoi on s’intéresse au cerveau lorsque l’on veut mieux comprendre les addictions.
Il revient d’abord sur l’idée selon laquelle la compréhension de l’addiction comme maladie cérébrale a permis de refouler la conceptualisation de l’addiction comme un vice. Il donne la définition de Nora Volkow, représentante du NIDA (National Institute of Drug Abuse) :
« L’addiction est une affection cérébrale chronique, récidivante, caractérisée par la recherche et l’usage compulsifs de drogue, malgré la connaissance de ses conséquences nocives. »[2]
Ce qui est étonnant, c’est que les manuels de diagnostic comme celui du DSM[3] par exemple, ne font jamais mention du cerveau dans les critères qu’ils énoncent (usage même lorsqu’il y a un risque physique, désirs persistants pour diminuer les doses, poursuite de la consommation malgré les conséquences néfastes etc.). Qui plus est, ces critères ne sont ni objectifs ni quantitatifs : comment, en effet, mesurer le besoin impérieux de recourir à une substance ou à un comportement ? Il apparaît donc nécessaire d’étudier le cerveau pour pouvoir construire des critères plus objectifs et quantitatifs du diagnostic des addictions, qui devraient permettre à terme d’améliorer les traitements pharmacologiques. En effet, comme pour les maladies somatiques, c’est à travers une meilleure compréhension des dysfonctionnements cérébraux que l’on pourra proposer de nouvelles pistes thérapeutiques et les ajuster de façon individuelle.
Étant donné la complexité du cerveau humain et des différents circuits cérébraux impliqués dans l’addiction, G. Sescousse se concentre sur un système depuis longtemps étudié dans le domaine des addictions : le système de la récompense. Découvert par hasard par les chercheurs Olds & Milner dans les années 60, ce système est composé d’un ensemble de régions cérébrales telles que le Striatum, qui sont typiquement activées lorsque nous recevons des stimuli plaisants, ou « récompenses ». La principale particularité de ces régions cérébrales est que leur activité est modulée par une molécule bien connue et secrétée par le cerveau : la dopamine.
Une chose importante sur laquelle G. Sescousse insiste est qu’il ne faut pas se contenter de faire de la dopamine la « molécule du plaisir » selon l’idée relativement répandue selon laquelle l’addiction résulterait d’un dérèglement des zones du plaisir. En réalité, la dopamine a plutôt pour fonction de renforcer les comportements, c’est-dire d’encourager leur répétition grâce au sentiment de plaisir, en vue de la survie des individus (récompenses comme la nourriture) et des espèces (sexe). Ces deux types de récompenses sont par excellence ce qu’on appelle des « récompenses naturelles ». Par rapport à elles, les drogues sont appelées des « récompenses artificielles » et libèrent une quantité très importante de dopamine, ce qui permet de comprendre pourquoi l’usage de substances psychoactives peut vite devenir un usage excessif, voire addictif : la libération excessive de dopamine oriente les futurs comportements dans le sens de l’usage de ces substances. Les neuroscientifiques ont tendance à parler de « prise en otage » (hijacking) des régions cérébrales, notamment celles liées à notre survie et à l’apprentissage des comportements, par les substances.
Un travail important pour les neuroscientifiques est de s’intéresser à la mesure de la dopamine dans le cerveau des individus souffrant d’une addiction. Cela est possible grâce aux techniques de neuroimagerie et notamment la technique appelée Tomographie par Émission de Positons (TEP),, qui permet de mesurer la dopamine dans le cerveau en injectant une très faible quantité d’une molécule radioactive qui mime l’action de la dopamine.
Or, les résultats livrés par cette technique peuvent paraître déconcertants : Nora Volkow et son équipe ont été les premiers à démontrer que, de façon peut-être contre-intuitive, les personnes qui souffrent d’addiction sont possèdent moins de récepteurs à la dopamine dans le striatum. L’hypothèse qui a été faite à la suite de ces travaux est la suivante : les individus souffrant d’addiction auraient un seuil trop bas de sensibilité aux récompenses naturelles, et chercheraient à compenser pour ce déficit en se tournant du côté des récompenses artificielles à même d’engendre une forte libération de dopamine, telles que les drogues. Deux faits viennent contrebalancer ces résultats. D’une part, l’implication de la dopamine dans le mécanisme d’action de certaines drogues (en particulier le cannabis) et l’addiction qui y est associée semble très limitée. D’autre part, dans d’autres addictions comme celle aux jeux d’argent, les dernières données de la littérature semble montrer qu’il existe au contraire une hyper-réactivité dopaminergique du système de récompense. Peut-être cela peut-il s’expliquer par le fait qu’il ne faudrait pas à tout prix rechercher des mécanismes neurobiologiques communs à toutes les addictions ?
Ainsi voit-on que, malgré les progrès fulgurants dans le domaine des neurosciences, qui nous permettent maintenant de « voir dans le cerveau vivant », de manière non invasive, de nombreuses questions restent encore à propos des addictions. Un constat peut être fait, qui rejoint celui de l’intervention précédente : il s’agit de renoncer à l’idée d’un modèle intégratif et d’une origine des addictions.
L’intervention que je donnais pour terminer cette conférence rejoint cette idée et examinait simplement une question précise, en lien avec la dimension sociale : « sommes-nous dans une société addictive ? » En voici le texte.
Mélanie Trouessin – Sommes-nous dans une société addictive ?
B. Rolland a parlé de l’approche biopsychosociale et de la mise en évidence d’une dimension souvent négligée jusqu’à récemment : la dimension sociale. Il semble en effet y avoir aujourd’hui de plus en plus d’explications mettant en cause la société dans laquelle nous nous trouvons. Si nous n’adhérons pas à la thèse selon laquelle l’origine de l’addiction serait strictement sociale, nous allons cependant nous concentrer sur le rôle de la société dans l’expansion des addictions. Il est en effet aujourd’hui légion de faire appel à notre « société addictogène » lorsque l’on fait référence aux addictions croissantes. Par exemple, en se demandant, à propos d’un comportement d’achat compulsif, « Pourquoi en arrive-t-on là ? »[4], le sociologue Jean-François Dortier fait justement référence à la société comme cause de l’addiction. Plus précisément, il met en avant deux types de « responsabilités » qui peuvent être imputées à notre société actuelle : d’abord, c’est « l’omniprésence de la publicité » sur différents médias (télévision, internet, dans le métro etc.) et son caractère de plus en plus intrusif. Ensuite, Dortier renvoie au capitalisme de la société, qui tendrait à imposer aux individus des désirs de consommer qui ne sont jamais comblés. Le cycle infini de la consommation serait alimenté par le fait que la très grande majorité des objets de consommation sont jetables ou passent vite de mode.
En bref, un nombre toujours croissant d’explications imputent à notre société la responsabilité d’être à l’origine de l’expansion des addictions. À cet égard, parler de société addictogène (où le suffixe – gène signifie qui entraîne, qui génère) ou addictive revient au même : c’est la société qui provoquerait, qui causerait l’addiction. Plus précisément, c’est le caractère consumériste de notre société, renforcé par la publicité, qui serait à l’origine de l’expansion des conduites addictives.
L’enjeu est souvent le même, dans les discours récents à propos des addictions : étant donné que c’est une pathologie extrêmement stigmatisante pour les individus, on essaie de placer la responsabilité en dehors d’eux, en partie pour le dédouaner. On observe ainsi souvent ce recours à la responsabilisation de la société pour sortir d’un discours moralisateur, comme c’est le cas dans le domaine de la pornographie :
« On est dans une société très addictogène qui pousse aux achats compulsifs, à une sexualité exacerbée. Il y a des images pornographiques partout. On sous-estime la vulnérabilité des gens face à une telle pression »[5]
Certes, l’ambition de chercher des facteurs expliquant l’entrée dans l’addiction hors de l’individu est tout à fait légitime. Mais cette tendance à faire de l’addiction une « pathologie de la modernité », résultat qui plus est de la société de consommation est-elle justifiée ? Plus précisément, si la société est en grande partie responsable de l’expansion du phénomène addictif, est-ce vraiment à cause de son caractère consumériste ? Si ce n’est pas le cas, on peut alors se demander en quel sens l’addiction pourrait être considérée comme une pathologie de la modernité ?
L’hypothèse que je vais essayer de défendre ici est que les raisons pour lesquelles on a tendance à dire que la société est addictive ne sont pas, pour moi, les bonnes. C’est-à-dire que ce n’est pas le caractère consumériste de la société qui déclencherait l’addiction. Je pense que c’est principalement à cause d’un autre trait de la société actuelle que l’on pourrait légitimement la qualifier d’addictive. Parmi les autres caractéristiques de la société souvent citées dans le contexte des addictions, on peut relever : son caractère « hyperstimulant » ou encore le fait que, pour Jean-Pierre Couteron, notre société promeuve « une culture de l’excès et de l’accélération », qui habitue l’enfant aux stimulations incessantes et lui ôte la possibilité d’acquérir les compétences pour pouvoir bien utiliser les « objets potentiellement addictifs »[6] ; le fait que notre société appelle constamment à se dépasser soi-même et à tester ses limites (pour Couteron encore), c’est-à-dire le culte de la performance et de l’effort ; le lien paradoxal des drogues et conduites addictives au « bien vivre » : elles seraient une sorte de facilitateur d’accès à une belle vie, à une existence riche de sens pour le sociologue Patrick Pharo[7].
Toutes ces caractéristiques jouent sans doute un rôle mais, à mon avis, elles constituent, avec le caractère consumériste, plutôt des facteurs aggravants que déclencheurs de l’addiction. J’aimerai développer une hypothèse alternative : on pourrait parler de société addictive dans la mesure où celle-ci suscite une volonté de contrôle sur notre existence et notre personnalité qui peut nécessiter de recourir à des substances ou conduites potentiellement addictives lorsque nous échouons à nous construire comme identité singulière. Principalement, je pense que la société actuelle prône une maîtrise de soi et de notre vie absolue, qui entraîne des frustrations contre lesquelles l’addiction tente de lutter, avant de se retourner contre les personnes, ce pourquoi je parle de l’addiction comme de l’échec d’une stratégie de contrôle.
Avant de revenir sur cette hypothèse alternative et sur la conception des addictions qui lui est sous-jacente, je vais rapidement revenir sur cette idée spontanée et standard selon laquelle nous serions dans une société addictive au sens où le consumériste serait le principal facteur causal des addictions.
L’idée selon laquelle le développement des addictions serait lié au caractère consumériste de notre société est une idée relativement commune. On parle de « société de consommation » pour désigner les désirs insatiables et infinis d’achat qui sont suscités chez les individus (grâce à la publicité notamment). Il s’agit d’entretenir chez les individus le manque, l’idée qu’ils ne possèdent pas tout ce qui pourrait les satisfaire et les rendre heureux afin de stimuler toujours plus l’envie d’acheter, de posséder etc.
Pour de nombreux chercheurs, un tel cadre est propice à l’addiction bien que le cercle infini du manque et du désir s’applique plus spécifiquement à un seul objet. La plupart remarquent que l’étiquette « addiction » est même devenue un outil marketing : on parle de jeux addictifs, de parfums addictifs, de livres addictifs, où le fait qu’on ne puisse se passer de ces objets est explicitement affiché comme un argument de vente.
Un des principaux chercheurs à mettre la société de consommation au centre des explications de l’addiction est le philosophe Bernard Stiegler. Il parle de société addictive au sens de « société dominée par la pulsion »[8], c’est-à-dire une tendance irrépressible à satisfaire un besoin. Au sein de cette société, les « dépendances stérilisantes » (à des objets et à des techniques inutiles) ont pris le pas sur les « dépendances positives » (à l’amour, à la philosophie, à l’art etc.) et sont devenus le principal objet du marché et du marketing. Ces « dépendances stérilisantes » sont négatives parce qu’elles inscrivent les individus dans le même moule, empêchent leur personnalité d’émerger et incitent au conformisme. Par exemple, tout le monde va désirer le même smartphone, va devenir addict aux mêmes jeux etc. En résumé, dans notre société de consommation actuelle, on cherche à susciter des désirs de consommation, à ne jamais les laisser s’éteindre, dans un cycle infini entre manque et satisfaction du désir.
Certes, ce schéma reprend celui des conduites addictives, qui sont par définition infinies et vouées à ne jamais se terminer, mais il semble avant tout coller à l’addiction aux achats, qui devient le paradigme de toute addiction. Par exemple, Thierry Brugvin, docteur en sociologie, explique que l’addiction aux achats peut avant tout se comprendre comme un « besoin de consommer » pour compenser certaines carences psychologiques (par exemple un sentiment d’insécurité enraciné depuis l’enfance, un sentiment de manque d’affection etc.). Comme souvent avec les addictions, il s’agit de remplir pour combler un manque, une lacune :
« Plus les individus se sentent mal aimés, mal reconnus, plus ils ressentent un vide existentiel, un manque de sens profond, plus ils cherchent des béquilles pour répondre à leurs carences affectives et identitaires. »[9]
Les addictions sont ces béquilles, utiles aux individus, et utilisées par le marketing pour susciter la consommation : « Le besoin psychosociologique de possession et de consommation est ainsi renforcé par le marketing capitaliste. »
Certes, il n’apparaît pas absurde de faire jouer un rôle à notre société consumériste dans l’expansion des addictions, au moins parce que les objets à disposition sont toujours plus nombreux et accessibles facilement. Ainsi, il ne s’agit pas de dire que le caractère consumériste de notre société ne fait pas partie des facteurs aggravants ou favorisant l’addiction, mais de suggérer qu’il ne provoque pas véritablement l’addiction. L’argument principal pour cela serait en réalité exactement le même que celui utilisé pour contrer les explications (moins courantes aujourd’hui) se basant quasi exclusivement sur le potentiel addictogène des substances : si c’est la société de consommation qui est à l’origine de l’addiction, alors comment expliquer que la totalité des personnes vivant dans cette même société ne devienne pas addict ? (De la même façon, on pouvait se demander comment expliquer que la totalité des personnes consommant de l’alcool ou jouant au casino ne devienne pas addicte.)
L’hypothèse que je suggère ici est que notre société actuelle pourrait être dite addictive, parce qu’elle se caractérise par le fait d’exhorter les individus à prendre le contrôle sur eux-mêmes, à construire leur identité, parce qu’elle leur fait miroiter tous les possibles de l’existence auxquels on ne peut pas forcément accéder, en un mot, parce que notre société actuelle met une « pression », instaure quasiment une injonction à faire de nous-mêmes une personne extraordinaire, à vivre une vie exemplaire et que le possible constat de l’impossibilité de remplir ce contrat place les individus dans une position d’incertitude, d’échec et de frustration, à l’origine de cette « fatigue d’être soi » pour reprendre les termes du sociologue Ehrenberg. Ce dernier a exactement caractérisé cette pression sociale à réussir socialement et individuellement, c’est-à-dire à se construire soi-même comme une identité singulière. Il explique que ce sont désormais les valeurs de « singularité individuelle » et de « maîtrise de soi » qui « définissent (actuellement) les normes de conduite de chacun[10].
Ce qui est intéressant est qu’il rend compte de deux des pathologies les plus importantes du XXème et du XXIème siècle en référence à cet idéal d’autonomie revendiqué par la société, un idéal qui a émergé tout au long du XIXème siècle avec la quête romantique de son destin et la recherche d’un dépassement de soi. Ehrenberg voit l’addiction et la dépression comme l’avers et le revers de la même médaille, l’injonction à se construire soi-même :
« La dépression et l’addiction dessinent alors l’envers de l’individu de la fin du XXème siècle »[11].
La dépression est le résultat de l’impuissance manifeste à ne pas parvenir à cette autonomie, cette « fatigue d’être soi », cette difficulté dans l’action et dans la capacité à supporter les frustrations. Face à tout ce qui est possible dans la vie actuelle, la dépression survient lorsque l’on voudrait être quelqu’un d’autre, quelqu’un de plus performant, de plus ceci ou de plus cela, c’est-à-dire lorsqu’on ne se satisfait pas de soi-même, lorsqu’on ne parvient pas à maîtriser notre existence afin qu’elle soit la plus belle et la plus intense des existences possibles. Tout ceci est source de vives frustrations. Et l’addiction serait justement pour Ehrenberg un moyen de lutter contre ces frustrations. On pourrait ainsi comprendre les addictions comme une sorte d’automédication :
« Les drogues sont le mode d’action de l’homme qui ne s’est pas encore conquis ou qui s’est perdu, c’est-à-dire qui, incapable d’atteindre l’autonomie, dérive vers une indépendance tant à l’égard de lui-même que de la réalité sociale. Elles sont une manière de se décharger du poids de cette pesante liberté qu’est l’autonomie »[12]
Pour Ehrenberg, la société actuelle est responsable des maux tels que la dépression et l’addiction parce qu’elle fait porter aux individus le fardeau de leurs vies pas assez réussies, pas assez intenses. L’usage des médicaments psychotropes, par exemple, devient nécessaire « pour alléger la charge de la responsabilité quand elle se fait trop lourde ». En résumé pour Ehrenberg :
« L’individu sous perfusion est un aspect de l’entreprenarisation de la vie. L’obsession de gagner, de réussir, d’être quelqu’un et la consommation en masse de médicaments psychotropes sont étroitement liées parce qu’une culture de la conquête est nécessairement une culture de l’anxiété qui en est la face d’ombre. »[13]
Je trouve que l’explication d’Ehrenberg de l’explosion des conduites addictives permet de proposer une piste alternative intéressante à l’idée de société addictive parce que consumériste. D’abord, elle semble plus compatible avec la perspective biopsychosociale actuelle (les facteurs causaux de l’addiction sont à la fois de type sociaux, biologiques et psychologiques) parce que le recours aux addictions est déclenché par l’injonction à l’autonomie par la société mais seulement lorsque celle-ci est au contact de traits psychologiques facteurs de vulnérabilité pour l’addiction (incapacité à supporter la frustration, carences narcissiques etc.).
Elle permet toutefois de nuancer une thèse de type automédication selon laquelle l’addiction serait entièrement un moyen de compenser des fragilités personnelles et narcissiques. Dire que l’addiction est une stratégie de défense face à des traumatismes psychologiques ne permet pas d’envisager la complexité du phénomène et des raisons qui peuvent pousser à y entrer. Je pense que quelque chose de plus large doit être envisagé et il me semble que c’est la référence aux idées d’autonomie et de contrôle qui permet de le faire. Dans ma thèse sur l’addiction comme pathologie de la volonté, j’envisage la nature de l’addiction comme étant l’échec d’une stratégie de contrôle. En quelques mots, cela signifie que l’addiction consiste initialement en une stratégie intentionnelle et volontaire mise en place (parfois de manière inconsciente) pour prendre le contrôle sur un objet alors que tout le reste nous échappe. La société qui nous incite à prendre le contrôle de notre personnalité et de notre existence joue donc un rôle central dans l’initiation d’un tel comportement et c’est en ce sens que l’on pourrait légitimement dire que nous sommes bel et bien dans une société addictive.
À partir du moment où la conduite addictive parvient à remplir cette « fonction de contrôle » dans la vie de l’individu, elle devient chez lui nécessaire et c’est ainsi que l’individu perd la « liberté de s’abstenir » ou de se passer de cette béquille, qui lui permettait (et lui permet encore) de maintenir une part de contrôle sur lui-même et sur son existence. Les addictions les plus sévères sont sans doute ainsi celles où les individus se sentent au départ invulnérables et pensent contrôler la situation. Il y a alors un renversement inconscient qui fait que les individus perdent progressivement le contrôle sur leur conduite. Pour illustrer cette idée selon laquelle l’addiction remplirait une fonction de contrôle, on peut donner des exemples concrets d’addictions. Je m’arrêterai ici sur l’exemple des troubles alimentaires (anorexie et boulimie). Les chercheurs travaillant sur ces troubles s’accordent en général à les inscrire dans le contexte actuel de la recherche de minceur. Cependant, plus que l’idéal de minceur, c’est surtout le projet de contrôle de son propre corps qui semble être véhiculé dans notre société moderne. Dans son ouvrage Le mangeur hypermoderne, le sociologue François Asher explique que la minceur est porteuse d’un projet très concret de « contrôle de son propre corps », « de le fabriquer soi-même » et que ce qui est important dans l’image que l’on veut donner de son corps, c’est l’idée de « maîtrise », l’idée que l’on a choisi son corps :
« Ce qui importe, c’est moins la minceur, qui va de soi en quelque sorte, pour l’instant tout au moins, que la capacité à décider de son corps et à réaliser un projet corporel individuel »[14]
Le sociologue qualifie ensuite l’anorexie de « pathologie de l’individu autonome et maître de lui » et parle de « pathologie de la maîtrise de soi » : elle part du régime comme point de départ, mais avec des limites inatteignables voire inexistantes. Il ne parle pas de ce renversement par rapport à la notion de contrôle mais c’est une hypothèse qu’on retrouve chez la sociologue Muriel Darmon à propos de l’anorexie : la « carrière anorexique » commence le plus souvent – mais pas exclusivement pour Darmon – par un régime, une « prise en main » pour maigrir. S’ensuit l’instauration « volontariste » d’un régime de vie strict où il s’agit de contrôler tout ce que l’on mange (mesurer, compter etc.)[15]. A la fin, les personnes anorexiques n’ont plus besoin de contrôler de manière consciente, et c’est là que se produit le renversement : les personnes perdent le contrôle de leur comportement et la maîtrise rigoureuse de leur corps et de ce qu’elles mangent devient leur seconde nature. On peut voir ce renversement dans les paroles d’une patiente : « Y’a deux moments, celui où … on contrôle tout, et celui où on ne contrôle finalement rien parce que c’est plus fort que nous ». Darmon met donc en évidence cette ambivalence par rapport au contrôle, manifeste dans cette succession du « sentiment de contrôler puis du sentiment d’être contrôlée par un contrôle devenu nature »[16].
En définitive, il existe certaines raisons légitimes pour donner un grand rôle à la société contemporaine dans le développement de plus en plus d’addictions. Mais les raisons auxquelles on fait habituellement référence – notamment le fait que nous soyons dans une société de consommation – ne me semblent pas des facteurs déclencheurs de l’addiction mais plutôt des facteurs qui peuvent aggraver, favoriser l’addiction. Il me semble en effet qu’il existe des raisons plus profondes qui relient notre société moderne à l’addiction et justifient l’appellation de société addictive ou addictogène. Ces raisons peuvent se résumer par l’idée d’injonction à construire et maîtriser notre existence et notre identité véhiculée par la société moderne, injonction qui favorise des situations d’échecs, de frustration, liés au sentiment de ne pas réussir sa vie ou de ne pas réussir assez à être soi-même. Les conduites addictives peuvent être comprises comme des moyens pour remédier à cette situation d’échec et de frustration (elles permettent de reprendre le contrôle au moins sur une partie de notre vie), des moyens dont, au bout d’un moment, les individus perdent le contrôle.
[1] Interventions rassemblées par Mélanie Trouessin.
[2] NIDA (https://www.drugabuse.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drug-abuse-addiction)
[3] Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux.
[4] Dortier Jean-François, « Une société addictive », sur Le Cercle Psy, le magazine de toutes les psychologies, https://le-cercle-psy.scienceshumaines.com/une-societe-addictive_sh_32432, sans date, consulté le 3 avril 2018.
[5]« Le porno, une addiction comme une autre », sur L’Obs, https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-rue69/20140816.RUE5241/le-porno-une-addiction-comme-une-autre.html, sans date, consulté le 3 avril 2018.
[6] Couteron Jean-Pierre, « Société et addiction, Society and addiction », Le sociographe, no 39, 31 octobre 2012, p. 10-16.
[7] Pharo Patrick, « Addictions et éthique de la belle vie », Études, Tome 417, no 10, 1er octobre 2012, p. 329-339.
[8] « Décortiqué – Les addictions selon Bernard Stiegler : de la philosophie au rayon promo | Collectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique & Sciences », https://cortecs.org/materiel/decortique-les-addictions-selon-bernard-stiegler-de-la-philosophie-au-rayon-promo/, sans date, consulté le 3 avril 2018.
[9] Brugvin Thierry, « Les causes psychosociologiques de l’addiction dans une société capitaliste, Summary », Pensée plurielle, no 23, 14 juin 2010, p. 25-35.
[10] Ehrenberg Alain, Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1991. P. 257.
[11] Ehrenberg Alain, La Fatigue d’être soi. Dépression et société, Paris, Odile Jacob, 1998. P. 20.
[12] Ehrenberg Alain, Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1991. P. 259.
[13] Ehrenberg Alain, Le Culte de la performance, Paris, Calmann-Lévy, 1991. P. 259.
[14] Ascher François, Le mangeur hypermoderne : une figure de l’individu éclectique, Paris, Éditions Odile Jacob, 2005. P. 161.
[15] Darmon Muriel, Devenir anorexique : Une approche sociologique, Paris, Éditions La Découverte, 2003. P. 167.
[16] Darmon Muriel, Devenir anorexique : Une approche sociologique, Paris, Éditions La Découverte, 2003. P. 168.