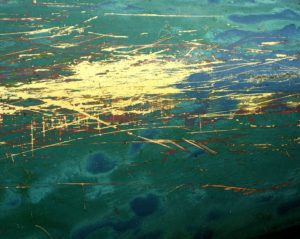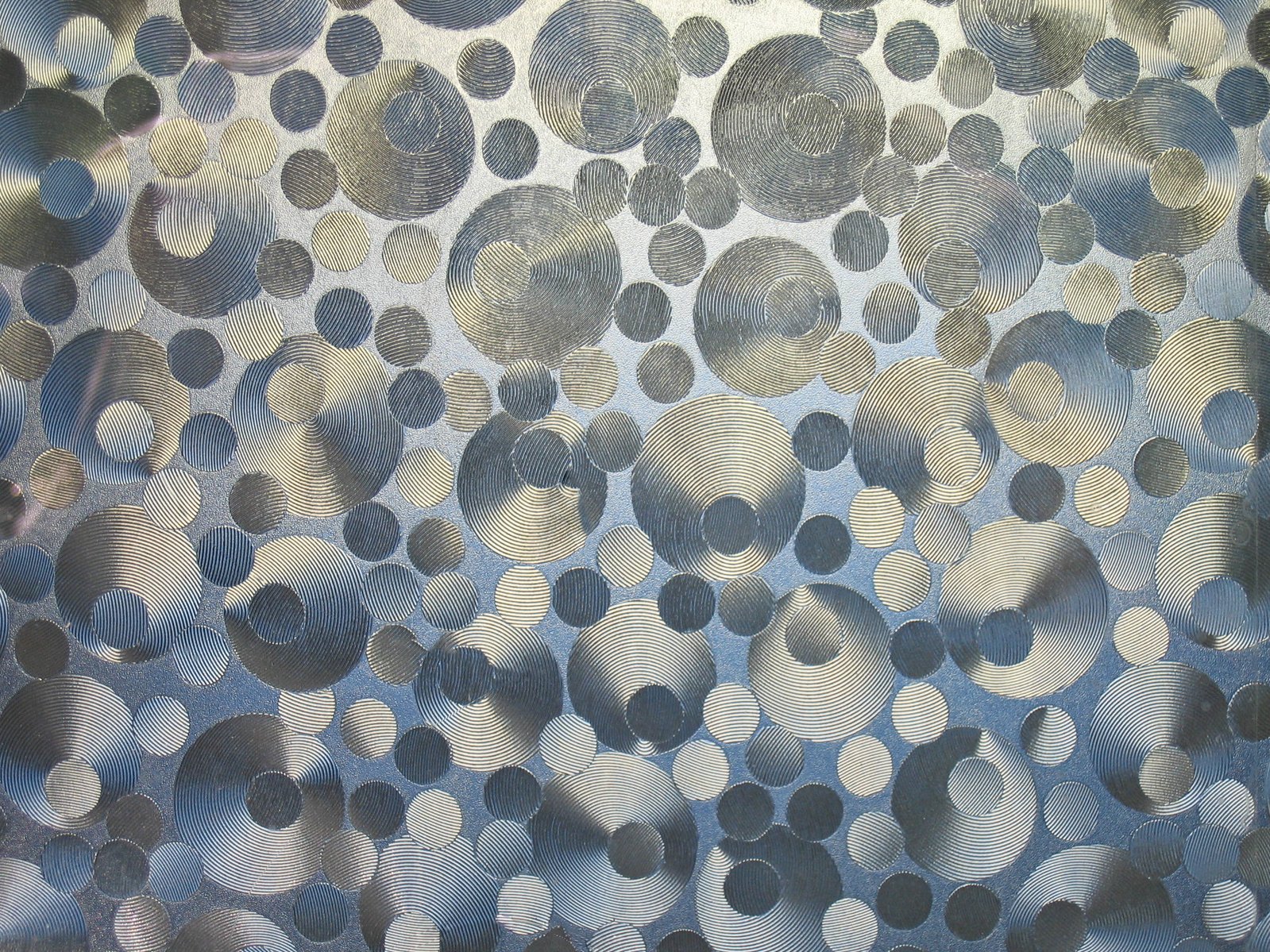Le divertissement pascalien en guise de psychotrope, ou comment se mettre la tête à l’envers
[box] Margaux Dubar, ENS de Lyon
Introduction
Dans sa note « Pascal et le tabac »[1], Michel Le Guern propose une nouvelle lecture d’un fragment des Pensées[2], qui fait souvent l’objet d’un contresens : la pensée 648[3], qui compare la besogne et l’éternuement, doit être comprise comme « un plaidoyer pour le tabac, [qui,] avec son caractère embrouillé et son air de fausse excuse, […] fait penser aux justifications que se cherche tel ou tel fumeur invétéré que nous avons tous rencontré[4]. » Les pliures marquées du manuscrit témoignent d’un long séjour en poche, comme si Pascal avait jeté ses préoccupations sur le papier, pour les exprimer à la prochaine occasion : à la table de jeu ou dans le salon du Duc de Roannez, on a pu lui faire une objection, ou tout simplement un reproche, concernant son habitude de priser le tabac. En effet, le tabac fait éternuer le consommateur quand la prise est trop forte ; c’est une conséquence importune et même douloureuse qu’on accepte, mais pas la fin qu’on vise par cette pratique. Aussi l’éternuement prouve-t-il moins la faiblesse à laquelle cède l’homme dépendant que le plaisir qu’il en attend: « L’usage du tabac semble peu conforme à l’austérité dans laquelle on imagine volontiers Pascal. Cette recherche d’un plaisir encore plus vain que ceux que dénoncent les pages sur le ‘divertissement’ trouve difficilement place dans le portrait idéalisé que nous ont légué la famille Périer et les amis de Port-Royal.[5] »Faudrait-il comprendre que Pascal, moraliste du Grand Siècle et apologète proche des jansénistes, célèbre pour sa sévère condamnation du divertissement humain, se serait lui-même adonné au goût mondain du tabac à priser, au point de ne plus pouvoir s’en passer, et de chercher à s’en excuser, même après avoir renoncé à la société pour mener une vie sobre et studieuse, inspirée par une conversion ? Pourtant, Pascal s’inclut dans la condition humaine déchue qu’il décrit, et n’échappe pas au lot commun : se divertir, inlassablement.
Cette étrange conduite qu’adoptent tous les hommes et qui paraît répondre à un besoin fondamental, par laquelle on enchaîne les activités ou les distractions pour oublier ses malheurs, dissiper ses angoisses et se procurer un peu de joie en ce bas-monde, sonne étrangement familière à l’oreille de l’« addict » d’aujourd’hui. L’addiction se définit comme un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise, qui se caractérise par l’échec répété de son contrôle ainsi que sa persistance en dépit des conséquences négatives. Il est dès lors possible de formuler le problème suivant : dans quelle mesure est-il intéressant d’appréhender le problème de l’addiction à l’aune du concept pascalien de divertissement ? Ce motif phare des Pensées polarise tout un réseau de thèmes complexes et d’analyses riches, susceptibles d’épouser le mouvement de généralisation et l’envergure multidimensionnelle de l’addiction. En effet, l’effervescence de la recherche en addictologie et la propension de notre société à désigner comme addictifs de plus en plus d’objets ou de pratiques nous poussent à rechercher des cadres descriptifs et explicatifs inédits pour cerner, avec toujours plus de pertinence et d’efficacité, la spécificité des problèmes contemporains de dépendance[6]. Le concept pascalien de divertissement présente, en particulier, des points de convergence significatifs avec certains aspects du phénomène addictif, qui permettraient d’en proposer une compréhension renouvelée. Quelles dimensions inaperçues, ou quelles difficultés non résolues de l’expérience de la dépendance, le filtre pascalien du divertissement révèle-t-il ? Cette confrontation du plus célèbre motif des Pensées aux problèmes soulevés par l’addiction doit permettre un gain d’intelligibilité, une conversion du regard, et une pratique enrichie. Il faut toutefois signaler que nous assumons un certain infléchissement notionnel, au sens où, selon Pascal, c’est l’humanité toute entière qui se divertit, tandis que le nombre de sujets addictés constitue aujourd’hui une part réduite – quoique croissante – de la population totale. Comment justifier la valeur opératoire d’une comparaison entre deux constructions intellectuelles rationalisant des comportements humains qui n’ont ni la même portée, ni les mêmes enjeux ? Par une réflexion s’attachant à démontrer l’existence d’une affinité spécifique entre l’expérience de la dépendance et la recherche de divertissement. Nous proposons dès lors l’hypothèse de travail suivante : le vécu de l’addiction peut être compris, dans certains de ses aspects au moins, comme le cas paradigmatique remis au goût du jour de ce que Pascal décrivait comme l’irrésistible propension de l’homme à se divertir[7]. Pour éprouver cette hypothèse, nous reconstituerons un fil argumentatif qui explore les différentes dimensions du concept pascalien de divertissement, décomposées en fonction de leurs rapports avec le phénomène addictif contemporain. Plus précisément, nous nous focaliserons sur deux extraits des Pensées qui présentent ce que nous appelons aujourd’hui des comportements addictifs – chaque saynète polarisant elle-même trois questions pascaliennes intrinsèquement liées au divertissement ou à son envers, l’ennui, et qui s’avèrent pertinentes pour penser la dépendance. D’une part, la mise en suspens du temps qui passe au profit d’une instantanéité de ce qui se vit, les ressorts imaginatifs du déni des malheurs de l’existence et de la perspective de la mort, le bon sens qui émane de ce recours proprement humain au divertissement ; d’autre part, la découverte de ce qui se joue fondamentalement dans l’ennui, le renoncement au bonheur ou l’insatisfaction du désir, et la mise en garde contre ce qui s’avère être, en définitive, un faux-remède.
I. Préambule méthodologique et définitionnel
Avant d’entamer cet itinéraire pascalien du vécu de la dépendance, analysé en fonction de la conceptualité du divertissement, nous souhaitons signaler que nous nous appuierons principalement sur les données et les observations recueillies au cours d’un stage de terrain mené il y a quelques années, à l’ELSA de l’hôpital de la Croix Rousse[8]. Ces matériaux de terrain ont certes été confrontés depuis à quelques lectures théoriques, mais ils constituent toutefois la base empirique sur laquelle notre réflexion croisée se fonde principalement. L’ELSA est une unité clinique réduite, pluridisciplinaire et mobile, qui prend en charge les problèmes de dépendance selon deux modes d’intervention : d’une part, les liaisons, c’est-à-dire les visites dans les autres services pour rencontrer un patient présentant potentiellement un problème d’addiction, par exemple révélé par une pathologie (pancréatite aiguë, pneumothorax, etc.) ou accompagnant une autre maladie (VIH, cancer etc.) ; d’autre part, les consultations au sein de l’équipe pour assurer le suivi des patients qui entrent dans une démarche de soin (réduction de la consommation ou sevrage). Nous avons eu l’occasion d’assister aux consultations des patients auprès de la médecin addictologue, des psychiatres, des infirmiers et de l’assistante sociale : les soignants prenaient le temps de présenter chaque profil, éventuellement de commenter le dossier clinique, et n’hésitaient pas à reprendre l’entretien après coup.
C’est au cours de cette expérience de terrain que de nombreux points de contact nous sont apparus entre le phénomène contemporain de l’addiction, tel qu’on pouvait le reconstituer à travers l’expérience des patients de l’ELSA, et l’anthropologie de la chute, élaborée par Pascal au XVIIème siècle. En effet, les premières liasses des Pensées de Pascal sont consacrées à la description de la condition humaine malheureuse, désordonnée et contradictoire. Les souffrances et les paradoxes des hommes ne sauraient s’expliquer sans l’événement du péché originel, qui les a fait basculer d’un état d’innocence (la première nature) à un état de déchéance (la seconde nature). C’est précisément dans ce cadre théologico-philosophique que Pascal déploie le paradoxe du divertissement, selon lequel l’individu remplit son existence d’amusements et d’occupations pour ne pas penser à ses maux présents ou à sa mort prochaine, mais ce faisant s’oublie lui-même et condamne la voie du salut. Malgré le décalage chronologique, et même si Pascal n’a jamais réfléchi directement au problème des drogues[9], cette pensée du rapport de l’homme au monde et de l’homme dans la société, semble particulièrement pertinente pour concevoir l’addiction comprise aussi bien comme pathologie affectant l’individu moderne, en son sens clinique strict, comme en un sens moral et socio-culturel plus large. Ce qui motive directement le recours à la philosophie pascalienne pour penser le monde moderne marqué par le phénomène addictif, c’est que les Pensées peuvent se lire comme une analyse de la condition humaine caractérisée par la dépendance et la tentation de s’en affranchir : « Description de l’homme. Dépendance, désir d’indépendance, besoins[10]. »
Il convient à présent de préciser ce que Pascal entend exactement par divertissement[11]. Dans l’usage commun de son époque, « prendre du divertissement » ou « faire son divertissement de quelque chose » signifie « plaisir, joie »[12] ou « réjouissance, récréation »[13]. Cette acception courante doit être complétée par un sens plus technique : ce qu’on appelle « divertissement d’effets »[14], dans un registre juridique ou financier, correspond à un détournement de fonds. D’emblée, ce qui intéresse Pascal dans ce mot, ce n’est pas tant cette nécessité de la détente ou de l’amusement, inhérente à la nature de l’homme, que l’infléchissement de cette tendance naturelle au profit d’une captation vicieuse ou de la soustraction d’un bien. Pascal s’appuie sur l’étymologie pour forger le concept proprement dit, en rétablissant un lien plus étroit entre le nom « divertissement » et le verbe « divertir », qui renvoie au latin « divertere » : divertir désigne l’action d’empêcher quelqu’un d’accomplir son dessein ou d’en détourner la trajectoire, et correspond à ce qu’on entend aujourd’hui par « faire diversion »[15]. Cette mise au point lexicale préliminaire permet d’établir d’emblée un rapport entre l’ambivalence du divertissement pascalien et le vécu de l’addiction. Elle a pour premier effet de nuancer la distinction quelque peu artificielle que l’on fait couramment entre le simple usage récréatif ou festif d’une drogue et une dépendance problématique, quand d’une part les doses standards fixées par l’OMS[16] sont dépassées, et lorsque d’autre part le sujet prend conscience de son impuissance à arrêter ou à contrôler sa consommation. S’il n’est pas nécessaire, le basculement qui s’opère relativement souvent de la simple consommation occasionnelle à la dépendance pathologique est plus ou moins rapide selon de multiples facteurs : le potentiel addictogène de la substance, son mode de consommation, l’histoire personnelle et le contexte socio-économique de l’usager, ses antécédents génétiques, etc. Consommer un produit addictif ou s’adonner à une activité compulsive reviendrait au même, selon une théorie neurocognitive : détourner le fonctionnement normal de certains circuits cérébraux. En effet, toutes les substances ou pratiques qui procurent un sentiment de plaisir, de satisfaction ou de soulagement (drogues, sexualité, nourriture, jeux, sports extrêmes, travail intense, voire extase religieuse) agissent sur les mêmes circuits de la récompense dans le système mésolimbique du cerveau. Ces mécanismes de la récompense qui concernent les neurones dopaminergiques, mais aussi d’autres systèmes neuronaux, seraient eux-mêmes à la base de la motivation humaine à rechercher des biens qui conditionnent la reproduction de l’espèce. Le psychotrope remplit donc bien la fonction de divertissement : une subversion de son propre esprit ou « se mettre la tête à l’envers » – la racine grecque « tropein » impulse le même mouvement que l’étymologie latine « divertere ».
II. Courir le lièvre, chasser ses ennuis.
La première saynète proposée à l’étude constitue un des moments forts du fragment intitulé « Divertissement »
D’où vient que cet homme, qui a perdu depuis peu de mois son fils unique et qui, accablé de procès et de querelles, était ce matin si troublé, n’y pense plus maintenant ? Ne vous en étonnez pas, il est tout occupé à voir par où passera ce sanglier que les chiens poursuivent avec tant d’ardeur depuis six heures. L’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit, si on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là[17].
1. Déni et auto-illusion
Poussé par un besoin d’extraversion ou mû par une stratégie d’évitement, le personnage du chasseur qui cède à une pratique compulsive, recherche par là le soulagement, le réconfort, ou l’oubli. Cette saynète examine ici un cas limite : l’homme sur lequel le sort s’acharne et qui essuie des malheurs en cascade. Le divertissement auquel il s’adonne ne désigne plus chez lui une simple distraction, mais bien une consolation urgente.
En effet, dans les Pensées, Pascal rencontre le problème du divertissement alors qu’il réfléchit aux marques de la misère dans la condition humaine : se détourner de soi-même, c’est d’abord oublier ses angoisses, se consoler de ses peines et soulager ses souffrances : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser[18]. » Or pour ne pas s’effondrer sous le poids de ses malheurs, le meilleur moyen est encore de faire diversion par des activités plaisantes, stimulantes ou accaparantes. L’objet qu’elles peuvent procurer n’est qu’un prétexte pour se changer les idées ou se défouler – tout au plus un point focal pour fixer son esprit. Ainsi, « on aime mieux la chasse que la prise »[19] :
(…) ils ne recherchent en cela qu’une occupation violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi et […] c’est pour cela qu’ils se proposent un objet attirant qui les charme et les attire avec ardeur[20].
Il y a un mécanisme assez subtil d’auto-illusion à l’œuvre dans le divertissement, c’est-à-dire ce processus par lequel on nourrit une opinion fausse à l’égard de soi-même ou de sa propre vie, poussé par le désir d’y croire ou par la peur d’admettre la vérité. On pressent indistinctement une angoisse monter et on met en œuvre, par réflexe d’auto-préservation et dans une demi-conscience de ses recours possibles, une stratégie de diversion à l’encontre de soi-même : « Ce lièvre ne nous garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en détournent, mais la chasse nous en garantit[21]. » N’importe qui se ment à soi-même de temps en temps, ponctuellement, quand c’est sans conséquence ou au contraire, en réaction à une crise. Mais si Pascal nous met en garde contre notre penchant irrépressible à nous divertir, c’est que nous faisons de notre existence même un procédé d’auto-illusion.
Le divertissement pascalien comprend ainsi toute activité d’esquive, de substitution ou de compensation, propre aux comportements addictifs. En effet, il est habituel d’expliquer l’usage des drogues par un état de mal-être ou de souffrance, apaisé par l’effet d’évasion ou de sédation du produit. Chez les usagers, le passage d’une consommation modérée ou occasionnelle à une dépendance problématique se produit souvent à la suite d’un épisode malheureux qui plonge le sujet dans une certaine souffrance psychique : par exemple une séparation amoureuse, une brouille familiale, la perte d’un emploi ou d’un logement, un viol, etc., ce que les soignants appellent « un événement de vie ». Plus concrètement, les tableaux de suivi alcoolémique dans lesquels les patients notent leur consommation quotidienne montrent clairement que cette dernière dépend étroitement de leur état psychologique : les épisodes dépressifs et les perturbations émotionnelles entraînent des pics de consommation ; au contraire, la compulsion s’atténue en période d’activité ou de bien-être. L’addiction prend alors des allures d’automédication : l’usager témoigne d’un recours conscient au produit comme tranquillisant ou stimulant.
2. Instant et éternité
Dans la saynète du chasseur malheureux, Pascal insiste également sur le paramètre temporel. Si le divertissement se révèle véritablement efficace, la satisfaction qu’il apporte n’est que ponctuelle : il doit donc être entretenu et renouvelé d’autant plus souvent et avec d’autant plus de frénésie que le sujet est angoissé ou triste. L’existence humaine est rythmée par l’urgence plus ou moins pressante de se procurer du divertissement. Le thème de l’agitation ou de l’inquiétude humaine revient souvent sous la plume de Pascal, qui thématise au fragment 453 la notion d’occupation[22], cette focalisation intense et immédiate de l’esprit sur une pensée à la fois – si possible la plus plaisante et légère possible.
Les témoignages d’usagers révèlent également comment le souci de se procurer de la drogue peut devenir une occupation à plein temps : les réserves s’épuisent vite et les entrevues avec le dealer ponctuent le quotidien. Un des caractères très particuliers du plaisir tiré de la consommation des drogues est son instantanéité : on éprouve une euphorie ou une détente immédiates après la prise – selon le produit consommé, respectivement la cocaïne et l’héroïne. Le reste du temps est consacré à trouver les moyens d’obtenir de quoi soulager sa déprime ou son mal-être. La logique de la répétition qui caractérise les plaisirs échappe à tout contrôle dans le cas d’une consommation envahissante ou d’une pratique compulsive. Ce vécu de la dépendance est appelé « centration », soit l’envahissement de l’existence de l’usager par le produit, ses effets et ses rites d’utilisation. Une patiente de l’ELSA avait employé l’expression « transcender le quotidien » pour décrire l’oubli du temps qui passe et l’enlisement dans l’instant provoqué par sa consommation d’alcool. Les patients dépendants manifestent souvent de grandes difficultés dans leur appréhension du temps et restent figés dans une instantanéité exclusive : leurs repères passés sont flous et toute projection dans le futur, même proche, est hasardeuse ou impossible. L’expérience psychotrope semble condamner l’usager à une temporalité immédiate : le temps devient ponctuel, concentré dans un présent pur et soudain, caractérisé par un contact instantané et superficiel, sans pénétration dans la durée vécue ni appui sur un référentiel chronologique. Pour expliquer le fort taux d’absentéisme aux consultations addictologiques, les soignants soulignent le fait que leurs patients évoluent en général dans une sorte de « bulle temporelle » fixée sur l’immédiat et différente du temps « normal », si bien qu’il leur est difficile d’établir un suivi thérapeutique et psychologique régulier.
Pascal décrit précisément, dans les Pensées, cette recherche de temporalité suspendue inhérente au divertissement, qui agit comme une conduite magique : elle permet d’éviter la question des fins dernières, c’est-à-dire de vivre comme si la mort n’existait pas et d’échapper à la perspective de l’éternité. Celui qui se divertit évite ainsi de se positionner, par ses actes, ses choix et son mode de vie, par rapport au dilemme qui s’impose à tout homme : ou bien la mort est un anéantissement, ou bien il faut se préparer au jugement dernier. Pour Pascal, « il est indubitable que le temps de cette vie n’est qu’un instant, que l’état de la mort est éternel, de quelque nature qu’il puisse être[23]. » Le concept de finitude signifie que l’homme est un être fini, aux facultés limitées et destiné à mourir. Aussi Pascal s’alarme-t-il de la conduite extravagante de « ceux qui vivent sans songer à cette dernière fin de la vie, se laissant conduire à leurs inclinations et à leurs plaisirs sans réflexion et sans inquiétude et comme s’ils pouvaient anéantir l’éternité en détournant leur pensée, ne pensant à se rendre heureux que dans cet instant seulement[24]. » La subversion du temps va donc de pair avec le déni de la mort qui, plus fondamentalement, caractérise aussi bien l’expérience du divertissement que le vécu de l’addiction. En effet, on aurait pu s’attendre à ce que le personnage de la saynète, confronté à la mort de son fils unique, prenne conscience de l’imminence de la mort, quoiqu’il s’attache d’habitude à l’oublier. Au contraire, il répond à ce memento mori par un sursaut de divertissement.
Sans aller jusqu’à soutenir que tous les « addicts » consomment pour oublier qu’ils sont mortels, il est néanmoins possible de récupérer, en un certain sens, cette dimension fondamentale du divertissement qu’est le déni de la mort, pour comprendre le vécu de la dépendance. En effet, la plupart des usagers admettent qu’ils occultent d’une certaine façon les risques mortels attachés à leur mode de vie – ce que Pascal appelle « [se] crever les yeux agréablement »[25]. Il semble a priori impossible d’ignorer les dangers associés à la consommation de certaines substances, grâce aux campagnes d’information et de prévention diffusées aujourd’hui dans les pays développés. Pourtant, illusion de toute-puissance ou refoulement de la peur, chaque individu tend à s’excepter de l’issue fréquente de l’addiction : une mort prématurée, douloureuse et solitaire. Souvent, seule l’expérience immédiate d’une maladie fulgurante (par exemple, une embolie pulmonaire, une pancréatite, etc.) dont on a toutes les chances de mourir en cas de rechute, provoque une prise de conscience sérieuse et un changement de vie radical – qui équivalent à un réflexe de survie.
3. Un pis-aller valable?
Enfin, la saynète sur la chasse permet de révéler une troisième caractéristique essentielle du divertissement : c’est un expédient nécessaire et utile, voire vital à la condition humaine misérable. Il convient cette fois de donner un sens rigoureusement pascalien à la notion de « misère » : ce ne sont pas tant les soucis accidentels et concrets de la vie, le cortège des maux dans toute sa diversité, qui poussent l’homme au divertissement, que sa nature même d’être déchu qui le rend dépendant, soit le malheur universel et essentiel de la condition humaine. Aussi l’idée reçue selon laquelle Pascal condamne le divertissement est-elle fausse, contrairement à ce que certains énoncés véhéments et isolés des Pensées peuvent laisser croire[26]. Il y a bien une disproportion paradoxale du divertissement que Pascal met en scène avec ironie : le futile chasse l’important, l’accessoire occulte l’essentiel – la proie ou la balle font oublier son fils mort et son procès ruineux au père accablé. La causalité défaillante, la logique inconsistante suscitent la surprise, le rire ou l’indignation chez le lecteur. Mais loin de dénoncer ce comportement scandaleux, Pascal s’attache à expliquer ce phénomène surprenant en réhabilitant le bon sens de ceux qu’il implique, parfois sans en avoir conscience, et ne s’excepte pas lui-même du lot commun. Le recours au divertissement est parfaitement adéquat à l’existence humaine issue du péché originel – il s’agit même, à bien des égards, d’une condition de survie. Au lieu de railler avec condescendance la vanité des conduites humaines comme d’autres moralistes de son temps, de suivre « ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bien peu raisonnable » [27], Pascal privilégie une approche anthropologique, qui décrit les mœurs communément critiquées, avant d’expliquer leurs motivations profondes, pour déclencher une prise de conscience de la part de son lecteur. Il ne dit pas ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire, mais se montre attentif au réel et en propose une explication. Il s’agit du mécanisme argumentatif typiquement pascalien de la « raison des effets » : la construction d’un réseau de faits ou d’expériences, structuré autour d’une contradiction qui stimule l’enquête par son absurdité, son incohérence, sa bizarrerie.
Le peuple a les opinions très saines. Par exemple : 1. D’avoir choisi le divertissement, et la chasse plutôt que la prise. Les demi-savants s’en moquent et triomphent à montrer là-dessus la folie du monde. Mais par une raison qu’ils ne pénètrent pas on a raison[28] […]
De même que le divertissement répond à un besoin humain irrépressible et profond qu’on ne saurait condamner purement et simplement, de même, l’addiction à une substance psychoactive ou à une activité compulsive, cliniquement définie par le fait que le sujet concerné tente lui-même de réduire sa consommation ou de mettre fin à son comportement compulsif, mais sans y parvenir, ne doit pas, comme cela a longtemps été le cas, être considérée comme un vice moral ou une faiblesse de caractère, mais bien comme une perte de la liberté de s’abstenir. Le vocabulaire addictologique est à cet égard très révélateur : on ne parle pas d’« alcoolique » mais d’« alcolo-dépendant », on ne dit pas « boire » mais « consommer », pas non plus « rechute » mais « reprise de consommation ». L’addiction est une pathologie socialement stigmatisée, aussi les soignants ont-ils soin d’employer des termes neutres, afin de déculpabiliser le patient qui souhaite entrer dans une démarche de soin : il s’agit de les soigner, pas de leur faire la morale.
III. Miser au jeu, tromper son ennui
Une seconde saynète extraite du même fragment des Pensées peut directement être lue comme un cas d’addiction et révèle d’autres dimensions du divertissement, tout aussi pertinentes et stimulantes pour comprendre le vécu de la dépendance. Alors que dans le cas de la chasse, le divertissement visait surtout à protéger l’homme de la crainte de malheurs possibles et à lui rendre plus supportables les maux présents, l’exemple du jeu d’argent introduit au besoin d’écarter l’ennui, ainsi qu’à la recherche obstinée d’un état ou d’un objet dont l’acquisition ne donnera pas le bonheur.
Tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de choses. Donnez-lui tous les matins l’argent qu’il peut gagner chaque jour, à la charge qu’il ne joue point, vous le rendez malheureux. On dira peut-être que c’est qu’il recherche l’amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien, il ne s’échauffera point et s’y ennuiera : ce n’est donc pas l’amusement seul qu’il recherche, un amusement languissant et sans passion l’ennuiera. Il faut qu’il s’y échauffe, et qu’il se pipe lui-même en s’imaginant qu’il serait heureux de gagner ce qu’il ne voudrait pas qu’on lui donnât à condition de ne point jouer, afin qu’il se forme un sujet de passion et qu’il excite sur cela son désir, sa colère, sa crainte pour l’objet qu’il s’est formé […][29].
1. Ennui
Dans l’entourage du duc de Roannez, Pascal a fréquenté des passionnés du jeu pendant sa période mondaine – nul doute qu’il s’appuie sur sa propre expérience alors qu’il écrit ces lignes pour analyser le paradoxe du divertissement. Comme dans le cas de la chasse, l’essentiel n’est pas le but poursuivi (l’argent) mais bien l’activité elle-même (le jeu), ou, plus significativement, le mécanisme imaginatif qui exalte le désir sur un objet extérieur et détourne l’esprit de ses soucis : « Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses[30]. » Offrez au joueur compulsif le gain escompté sans le jeu, ou proposez-lui le jeu sans le gain, non seulement il se représentera ses maux, mais il sombrera dans le désespoir. Chez Pascal, l’« ennui » est l’envers exact du divertissement, l’état aigu de détresse métaphysique dans lequel on sombre dès qu’on en est privé. Pour éviter de s’abîmer dans cette léthargie morose, l’homme est prêt à tout : l’imagination entretient le désir et confère un sens factice, un enjeu illusoire, à n’importe quelle activité simplement ludique, voire carrément frivole.
L’effet physiologique du divertissement est particulièrement prégnant dans la description pascalienne. Une telle stimulation passionnelle correspond exactement aux effets des différentes drogues, lesquelles interviennent directement dans la genèse des émotions. L’expérience psychotrope repose sur la capacité de certaines molécules chimiques à s’immiscer dans les mécanismes biochimiques de l’activité cérébrale. Les comportements compulsifs (jeu, achat, sport, travail, alimentation, sexualité etc.) ont des effets comparables aux drogues puisqu’ils sont également déclencheurs d’intenses sensations de plaisir, et agissent comme des « analgésiants émotionnels » qui suppriment la perception douloureuse. Le potentiel thérapeutique et hédonique des drogues est particulièrement vaste, mais les usagers en sont pour la plupart très conscients et l’exploitent abondamment. La recherche de sensations fortes est constitutive de l’usage des stupéfiants ou des pratiques compulsives. Ce besoin dévorant d’excitations physiques et d’engagements existentiels, dans tous les cas de shoots neurologiques, semble dissimuler un vertige profond, un manque essentiel. Parmi les patients rencontrés à l’ELSA, une femme au foyer ainsi qu’un commercial au chômage pointaient comme cause de leur addiction cette « oisiveté subie » : l’alcool représentait pour eux un moyen de tromper l’ennui, de chasser la solitude ou de se donner du courage pour entreprendre les tâches du quotidien jugées peu gratifiantes. Leur consommation alcoolique diminuait significativement ou même s’arrêtait complètement lors de périodes épanouissantes pour eux, comme les vacances, qui étaient l’occasion de voyages ou de retrouvailles familiales.
Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passion, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir[31].
Privé du divertissement alors qu’il se découvre dépendant de tous les moyens (substances ou activités) susceptibles de le détourner de ses maux, l’homme prend conscience de l’insignifiance de son être et du vide abyssal de son existence. Incapable, viscéralement, de tout contrôle physique, il sent, dans son corps, monter en lui le désespoir. La description que fait Pascal de l’ennui dans ce fragment correspond exactement au récit que font certains usagers de leur rapport au produit : la sensation d’un vide en soi et autour de soi, le besoin d’ingurgiter des produits jusqu’à ne plus rien pouvoir absorber, de remplir sa vie de pratiques ou de préoccupations diverses jusqu’à ne plus la voir passer.
2. Bonheur et plaisirs
L’appel du néant qui résonne dans l’expérience douloureuse, mais cruciale de l’ennui, est lié au mobile profond du divertissement : la quête du bonheur et la course aux plaisirs. Le concept de divertissement a ultimement, dans les Pensées, une visée métaphysique, et même théologique, au-delà de son ancrage anthropologique et réaliste[32], ce qui est particulièrement prégnant dans l’extrait suivant :
Qu’est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance sinon qu’il y a eu autrefois dans l’homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu’il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l’environne, recherchant des choses absentes le secours qu’il n’obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c’est-à-dire que par Dieu même[33].
Si le divertissement est « tout ce que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux »[34], cela ne signifie pas pour autant que cette pulsion irrépressible qui les pousse vers les biens extérieurs ne les satisfasse complètement[35]. En effet, comment une accumulation d’objets finis et périssables, ou d’occupations limitées et circonstanciées, pourrait-elle combler un manque infini, éprouvé intérieurement ? Cette course du désir, qui se paye d’illusions et se relance indéfiniment par l’imagination, n’engendre que déception, frustration et amertume. Si la quête du bonheur est systématiquement déçue hors la foi selon Pascal, c’est parce que seule une instance authentiquement infinie – en l’occurrence Dieu – serait susceptible de satisfaire le vide creusé en l’homme par le péché originel. Mais ce qui importe pour notre propos, c’est que la situation de l’homme est bel et bien tragique : son désir infini ne saurait être comblé par aucun objet terrestre, et pour autant il ne saurait lui-même renoncer à sa recherche frénétique, quoiqu’il la pressente condamnée par avance à l’échec. La quête essentielle du bonheur éternel et infini dégénère alors en recherche obsessionnelle du plaisir, du bien-être ou de l’apaisement.
Les personnes dépendantes ont aussi fait cette expérience des petits bonheurs ou des grandes jouissances, qui sont devenus des problèmes, voire des calvaires. Les produits ou les pratiques addictives ont cette particularité que l’usage de tels plaisirs ne peut demeurer indéfiniment contrôlé et serein. À un moment de leur parcours, certains usagers se trouvent pris au piège de la dépendance, à une substance ou à une activité compulsive, dont le bilan en termes de satisfactions et de peines est devenu principalement négatif : ils veulent arrêter, mais ne peuvent s’empêcher de recommencer. On peut considérer que le recours à la drogue pour se sentir mieux, régler ses problèmes et goûter au bonheur, est une fausse solution et non un simple pis-aller. Se défoncer – à l’héroïne ou dans un sport extrême – faute de pouvoir aller bien par soi-même, n’est pas une stratégie satisfaisante sur le long terme, à cause du pouvoir addictogène des substances ou des pratiques : il en faut toujours davantage et plus souvent, au détriment de la santé de l’usager, de l’équilibre de son mode de vie, de la patience de son entourage, etc.
3. Un faux remède
Le paradoxe du divertissement permet de bien comprendre ce qu’on appelle le cercle vicieux ou la « spirale infernale » de l’addiction :
La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir, mais le divertissement nous amuse et nous fait arriver insensiblement à la mort[36].
Si le divertissement constitue bien un expédient naturel, et même instinctif pour la condition humaine déchue, il n’est pas bon pour autant qu’on s’y précipite sans réticence et de plein gré. À la rigueur, on pourrait imaginer le cas de celui qui cède au divertissement en toute conscience et en assumant son choix comme le plus raisonnable parmi toutes les possibilités qui lui étaient offertes. Les malheurs l’accablent, l’imminence de la mort l’angoisse et aucun bien ne le satisfait durablement ici-bas : il décide alors d’exalter son quotidien et même de consumer sa vie dans un enchaînement ininterrompu d’occupations et de distractions qui l’empêche de penser à lui et de voir le temps passer. Mais comment concilier cette lucidité extrême avec la solide capacité d’auto-illusion que réclame le mécanisme du divertissement ? D’autant que ce cas-limite se heurte au motif symétrique du divertissement qu’est l’ennui. Cette expérience insoutenable n’en est pas moins profitable à l’homme dans une certaine mesure. En effet, si on a le courage et la force de se laisser aller de temps en temps à l’ennui, dans son existence dédiée au divertissement, on découvre « les qualités essentielles à l’homme »[37]. Ainsi, selon Laurent Thirouin,
l’expérience de l’ennui nous invite à une interrogation sur la satisfaction que tire l’homme de ses occupations. Aucune ne lui appartiendrait en propre, et ne le satisferait de façon intrinsèque, essentiellement. Le plaisir qu’il en ressent est illusoire, comme le prouve la facilité avec laquelle ce plaisir vient à se dissiper[38].
Le plaisir que nous tirons du divertissement est fragile, superficiel et évanescent, fonction d’une attache circonstancielle : il révèle l’incapacité où est l’homme d’arrêter en lui-même son bonheur, d’atteindre un état stable, indépendant du monde extérieur. Dès lors, aussi pénible et troublant que soit cet état normal de l’homme, l’ennui n’est qu’un mal relatif comparé au remède dangereux qu’on lui oppose presque systématiquement: « ‘Mais n’est-ce pas être heureux que de pouvoir être réjoui par le divertissement ?’ – ‘Non. Car il vient d’ailleurs et de dehors et ainsi il est dépendant et partant sujet à être troublé par mille accidents qui font les afflictions inévitables[39].’ » Le divertissement est un palliatif qui apaise l’homme en souffrance, mais le rend en même temps bien plus malade. Non seulement parce qu’il accroit la dépendance de l’homme à des objets extérieurs dont il ne saurait s’assurer la maîtrise, donc augmente l’insécurité et l’incertitude de son existence, mais encore parce qu’il provoque un redoublement de la misère qui pèse sur lui, dans la mesure où sa grandeur ne réside que dans la conscience de sa condition pécheresse[40]. Le divertissement endort notre conscience, nous empêche de nous confronter aux problèmes qui se posent et de prendre les décisions qui nous permettraient d’améliorer notre vie.
Conclusion
Cette relecture des fragments pascaliens consacrés au divertissement à travers le prisme du vécu addictif, a permis de mettre en évidence certains points communs éclairants : la sécrétion d’une bulle temporelle centrée sur l’instant, un mécanisme d’auto-illusion pour se consoler des divers maux de la vie et occulter l’imminence de la mort, le refus de stigmatiser un recours naturel et efficace pour la condition malheureuse de l’homme, l’expérience insupportable mais cruciale de l’ennui, l’aspiration avide au bonheur qui dégénère en course frénétique au plaisir et enfin, le danger que représente un faux remède qui empoisonne l’existence de celui qui ne cherche qu’à apaiser son mal-être.
L’objectif principal de cette comparaison systématique entre un motif clef des Pensées et un phénomène contemporain aigu était d’apporter un éclairage nouveau sur chacun d’eux, et si possible de produire un certain gain d’intelligibilité réciproque, en vertu d’une affinité spécifique déployée entre ces deux questions. Si cette réflexion croisée entre le divertissement pascalien et l’addiction aujourd’hui peut, de surcroît, inspirer aux soignants de nouvelles pistes thérapeutiques, c’est que cette tentative aura été particulièrement féconde. Nous pouvons, pour conclure, citer le cas de cette assistante sociale qui avait suggéré une option de soin en rapport avec le divertissement pascalien[41] : si le patient cherche à oublier ses soucis et à calmer sa souffrance par la consommation d’alcool, pourquoi ne pas mettre en place en consultation, une stratégie personnalisée de détournement de l’addiction par une autre activité récréative servant de substitut. Remplacer un divertissement par un autre, en somme.
[1] M. Le Guern, « Pascal et le tabac », Études sur la vie et les Pensées de Pascal, Paris, Honoré Champion, Champion essais, 2015, p. 25-28. Ce court texte de 1970 lui a été inspiré par la découverte fortuite de la tabatière de Pascal (un objet sobre et élégant qui imite un petit livre et qui porte sa signature) dans un carton de la collection Faugère de la Bibliothèque Mazarine.
[2] B. Pascal, Pensées, Paris, Garnier, Classiques jaunes, « Littératures francophones », 2015 (1670). Je cite les fragments dans l’édition de Philippe Sellier. Le site http://www.penseesdepascal.fr/ renseigne la table de correspondance entre éditions et fournit un accès facile – quoique documenté – au texte.
[3] « L’éternuement absorbe toutes les fonctions de l’âme aussi bien que la besogne, mais on n’en tire pas les mêmes conséquences contre la grandeur de l’homme parce que c’est contre son gré et quoiqu’on se le procure, néanmoins c’est contre son gré qu’on se le procure. Ce n’est pas en vue de la chose même, c’est pour une autre fin. Et ainsi ce n’est pas une marque de la faiblesse de l’homme et de sa servitude sous cette action.
Il n’est pas honteux à l’homme de succomber sous la douleur, et il lui est honteux de succomber sous le plaisir. Ce qui ne vient pas de ce que la douleur nous vient d’ailleurs, et que nous recherchons le plaisir. Car on peut rechercher la douleur et y succomber à dessein sans ce genre de bassesse. D’où vient donc qu’il est glorieux à la raison de succomber sous l’effort de la douleur, et qu’il lui est honteux de succomber sous l’effort du plaisir ? C’est que ce n’est pas la douleur qui nous tente et nous attire ; c’est nous‑mêmes qui volontairement la choisissons et voulons la faire dominer sur nous, de sorte que nous sommes maîtres de la chose, et en cela c’est l’homme qui succombe à soi-même. Mais dans le plaisir c’est l’homme qui succombe au plaisir. Or il n’y a que la maîtrise et l’empire qui fasse la gloire, et que la servitude qui fasse honte. »
[4] M. Le Guern, « Pascal et le tabac », op. cit., p. 28.
[5] Ibid., p. 26. Périer est le nom de famille de la sœur de Pascal, Gilberte, qui a composé une Vie de M. Pascal. Son fils Étienne a recopié et conservé les liasses de papiers laissées par Pascal à sa mort, soit ce que l’on connaît aujourd’hui comme ses Pensées. Les Solitaires de Port-Royal, qui attendaient avec impatience son apologie de la religion chrétienne, ont été très déçus à la découverte du texte.
[6] Par commodité, nous emploierons indifféremment les mots « addiction » et « dépendance » dans la suite de l’article, même si l’addiction constitue à proprement parler un type particulier du phénomène plus général de dépendance. Le terme d’« addiction », qui est une transposition de l’anglais, désigne la dépendance comme pathologie au sens strict, lequel ne doit pas être confondu avec son sens plus courant de dépendance fonctionnelle, qui n’implique ni maladie, ni aliénation, ni souffrance : l’enfance, par exemple. On peut dès lors définir la dépendance spécifique aux drogues, celle qui est d’ordre psychique et neurophysiologique, par différence avec la dépendance en un sens beaucoup plus pratique, qui désigne certaines incapacités, comme la vieillesse ou le handicap. L’addiction peut être définie selon trois traits : besoin compulsif, maintien de l’activité malgré les dommages qu’elle entraîne et enfin, incapacité à s’en tenir à une résolution.
[7] Telle est précisément l’interprétation du concept central des Pensées que Malraux propose dans son célèbre roman La Condition humaine : « ‘Il faut toujours s’intoxiquer : ce pays a l’opium, l’Islam le haschisch, l’Occident la femme… Peut-être l’amour est-il surtout le moyen qu’emploie l’Occidental pour s’affranchir de sa condition d’homme…’ » explique Gisors à Ferral. La scène se situe à la quatrième partie du roman, lors de l’insurrection de Shanghai en 1927. Cf. A. Malraux, La Condition humaine, Paris, Gallimard, Folio plus classique, 2007 (1956), p. 222-223.
[8] L’Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie, dirigée par le Pr. Claude Augustin Normand. J’y ai été accueillie une semaine en avril 2014, dans le cadre du séminaire « Le Terrain des philosophes », organisé à l’ENS de Lyon par Samuel Lézé et Julie Henry pour former les étudiants en sciences humaines à l’observation participante. J’étais alors en Master 2 de philosophie et je cherchais à éprouver l’actualité d’une philosophie classique par une médiation empirique contemporaine.
[9] Même s’il n’y a jamais eu de société sans drogue, il faut admettre qu’excepté l’alcool, les substances psychoactives étaient bien moins nombreuses et d’un accès bien plus limité au XVIIème siècle, en France. On peut toutefois considérer que Pascal s’intéresse au cas de ce qu’on appelle aujourd’hui des activités compulsives ou des « addictions sans drogue », le jeu ou le sport par exemple, comme le montreront les deux saynètes principales examinées dans cet article. Le terme de drogue désigne toute substance susceptible de modifier le fonctionnement du cerveau et donc de provoquer des modifications psychiques et comportementales.
[10] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 113.
[11] D’après M. Le Guern, « Pascal et le divertissement », Études sur la vie et les Pensées de Pascal, op. cit., et P. Magnard, entrée « Divertissement », chapitre « Pascal », in: Jean-Pierre Zarader (éd.), Le Vocabulaire des philosophes, Philosophie classique et moderne (XVIIe-XVIIIe siècle), volume II, Tours, Ellipses, 2002.
[12] P. Richelet, Dictionnaire françois, Genève, 1680.
[13] A. Furetière, Dictionnaire universel, Paris, 1690.
[14] Id. Pascal a pu connaître cette définition quand, entre 1640 et 1647 à Rouen, il aidait son père dans ses fonctions de commissaire député en Normandie, pour y lever l’impôt.
[15] Pascal s’inspire d’ailleurs du chapitre « De la diversion » de Montaigne. Cf. M. de Montaigne, Essais, III, IV, Paris, 1580-1595
[16] L’Organisation Mondiale de la Santé : une consommation alcoolique sera dite normale pour un homme jusqu’à trois unités d’alcool par jour, pour une femme jusqu’à deux unités par jour, avec un jour d’abstinence et un jour possible d’excès jusqu’à quatre unités par semaine.
[17] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 168.
[18] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 166.
[19] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 168.
[20] Id.
[21] Id.
[22] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 453. L’extrait auquel il est fait allusion est un texte rayé, mais il propose une variante intéressante de la saynète précédente, autour du motif du jeu de paume. « Cet homme si affligé de la mort de sa femme et de son fils unique, qui a cette grande querelle qui le tourmente, d’où vient qu’à ce moment il n’est point triste et qu’on le voit si exempt de toutes ces pensées pénibles et inquiétantes ? Il ne faut pas s’en étonner. On vient de lui servir une balle et il faut qu’il la rejette à son compagnon. Il est occupé à la prendre à la chute du toit pour gagner une chasse. Comment voulez-vous qu’il pense à ses affaires, ayant cette autre affaire à manier ? Voilà un soin digne d’occuper cette grande âme et de lui ôter toute autre pensée de l’esprit. » « Chasse », au jeu de paume, se dit de l’endroit où tombe la balle au premier bond.
[23] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 682.
[24] Id.
[25] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 78.
[26] Le début du célèbre fragment 168 intitulé « Divertissement » est éclairant sur ce point : « Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent dans la Cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On n’achète une charge à l’armée, si chère, que parce qu’on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Etc.
Mais quand j’ai pensé de plus près et qu’après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé qu’il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. »
[27] Id.
[28] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 134.
[29] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 168.
[30] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 637.
[31] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 515.
[32] Toutefois, il faut garder à l’esprit l’analyse de Philippe Sellier, selon lequel le divertissement pascalien est une « forme mineure » de l’aversio a Deo augustinien. Dans le traité Du Libre arbitre (II,19), l’homme déchu se détourne (divertit / avertit) de Dieu pour se tourner (convertit) vers les choses périssables. En revanche dans la plupart des fragments des Pensées, c’est avant tout de la condition humaine qu’on se détourne : on se divertit parce qu’on refuse de se voir. Cf. P. Sellier, « Aversio, conversio, divertissement », Pascal et saint Augustin, Paris, Armand Colin, 1970, p. 163-167.
[33] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 181.
[34] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 168.
[35] « Nous sommes pleins de choses qui nous jettent au-dehors. Notre instinct nous fait sentir qu’il faut chercher notre bonheur hors de nous. » Cf. B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 176.
[36] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 33.
[37] B. Pascal, Pensées, op. cit., sous-titre de la liasse V.
[38] L. Thirouin, Chapitre III. « Le cycle du divertissement », Pascal ou le défaut de la méthode, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 128.
[39] B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 165.
[40] « La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de [se] connaître misérable, mais c’est être grand que de connaître qu’on est misérable. » Cf. B. Pascal, Pensées, op. cit., fragment 146.
[41] Nous avons rencontré cette soignante à l’occasion d’un compte-rendu de notre stage à l’ELSA, présenté le 16 avril 2015, auprès des membres du GRAL, le Groupe de Recours en Addictologie Lyonnais.