Penser dans l’après-coup de la modernité (2/2)
[box] Anne Alombert. Doctorante à l’Université Paris Nanterre.
Faute d’eschatologie, la mécanicité et la contingence (…) laissent la pensée en souffrance de finalité. Cette souffrance est l’état postmoderne de la pensée, ce qu’il est convenu d’appeler ces temps-ci sa crise, son malaise ou sa mélancolie.
J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne ».
Nous n’avons pas affaire à la crise de la modernité : nous avons affaire à la nécessité de moderniser les présupposés sur lesquels la modernité est fondée.
A. Gorz, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique.
Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes.
G. Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle ».
Cet ouvrage a pour but de fournir des armes conceptuelles, c’est-à-dire pacifiques, et d’ouvrir des perspectives d’actions fondées sur des arguments rationnels, c’est-à-dire politiques…
B. Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle.
| Remarques préliminaire
Cet article se compose des quatre parties suivantes : I. La déconstruction aux limites de la philosophie II. La déconstruction du concept de sujet III. La déconstruction du concept d’histoire IV. L’avenir de la déconstruction
Il est publié en deux parties : -la première publication (1) comprend l’introduction ainsi que les deux premières parties -la seconde publication (2) comprend les deux dernières parties et la conclusion
|
La première partie de cet article a été publiée précédemment sous le titre « Penser dans l’après-coup de la postmodernité (1) ».
Elle concernait les deux questions suivantes :
I. La déconstruction aux limites de la philosophie
II. La déconstruction du concept de sujet
III. La déconstruction du concept d’histoire.
La critique du concept métaphysique d’histoire
 Il semble en aller de même pour le concept d’histoire : après avoir montré les présupposés métaphysiques dont la notion d’histoire est chargée, tout en soutenant l’impossibilité d’ignorer les questions qu’elle soulève, Derrida esquissera les linéaments d’une nouvelle chaîne conceptuelle de l’histoire, qui devrait permettre de se passer du concept problématique, sans pour autant « neutraliser » la question de l’histoire, comme le font selon lui Lévi-Strauss et Althusser. Mais de même que pour la question du sujet, la restructuration du discours qui devait faire émerger le nouveau concept d’histoire demeure pour Derrida à l’état d’un projet inachevé.
Il semble en aller de même pour le concept d’histoire : après avoir montré les présupposés métaphysiques dont la notion d’histoire est chargée, tout en soutenant l’impossibilité d’ignorer les questions qu’elle soulève, Derrida esquissera les linéaments d’une nouvelle chaîne conceptuelle de l’histoire, qui devrait permettre de se passer du concept problématique, sans pour autant « neutraliser » la question de l’histoire, comme le font selon lui Lévi-Strauss et Althusser. Mais de même que pour la question du sujet, la restructuration du discours qui devait faire émerger le nouveau concept d’histoire demeure pour Derrida à l’état d’un projet inachevé.
Derrida soutient en effet que le concept d’histoire a toujours été « complice d’une métaphysique téléologique et eschatologique », donc paradoxalement « de la philosophie de la présence à laquelle on a cru pouvoir l’opposer »[1] : l’histoire, déterminée comme « histoire du sens se produisant, se développant, s’accomplissant[2] », « unité d’un devenir, tradition de la vérité, ou développement de la science orienté vers l’appropriation d’une vérité dans la présence, vers le savoir dans la conscience de soi », a en fait toujours été pensée comme « le mouvement d’une résomption de l’histoire, comme une dérivation entre deux présences, celle de l’origine (archè) ou de la fin (telos) »[3] . C’est pourquoi Derrida soutient qu’il faut « se méfier » de ce « concept métaphysique d’histoire comme histoire idéale ou téléologique[4] », « bien plus généralement répandu qu’on ne le croit, et certainement bien au-delà des philosophies étiquetées comme ‘idéalistes’ », dans la mesure où il est intrinsèquement lié à un certain nombre de notions problématiques, comme celle de sens, de continuité, ou de vérité[5], dont la signification n’est pas indépendante du phonologocentrisme.
En effet, selon Derrida, le concept d’histoire est solidaire d’une conception linéaire du temps, qui n’est elle-même pas indépendante du système d’écriture linéaire, dans lequel le sens est « asservi à la successivité, à l’ordre du temps logique ou à la temporalité irréversible du son[6] ». Derrida rappelle en effet que la « conception linéaire de la temporalité (homogène, dominée par la forme du maintenant et l’idéal du mouvement continu, droit ou circulaire) » n’est pas indépendante du processus de linéarisation de l’écriture, qui s’est imposé en Occident en refoulant l’écriture mythogrammatique et la pensée symbolique et pluridimensionnelle qui lui était associée[7]. Si le mot même d’histoire « a toujours été associé au schème linaire du déroulement de la présence », penser l’histoire hors de ce schème supposera inévitablement de « se servir d’un autre mot »[8] .
Ainsi, quand on le questionne sur la possibilité d’envisager un concept d’histoire « qui échapperait au ‘schème linéaire’ » en considérant une histoire comme « série pratique, stratifiée, différenciée, contradictoire » sur le modèle de l’histoire monumentale proposée par Sollers, Derrida répond affirmativement : il insiste même sur l’importance de la critique qu’Althusser a proposé du concept hégélien d’histoire, qui visait à montrer qu’il n’existe pas « une histoire générale » mais « des histoires différentes dans leur type, leur rythme, leur mode d’inscription, histoires décalées, différenciées, etc. »[9]. A cela comme à l’idée d’histoire monumentale, Derrida affirme avoir toujours souscrit. Mais il soutient néanmoins la nécessité de poser « un autre type de question » : « à partir de quel noyau sémantique minimal nommera-t-on encore ‘histoires’ ces types d’histoire hétérogènes, irréductibles, etc. ? Comment déterminer ce minimum qu’ils doivent avoir en commun si ce n’est par pure convention ou par pure confusion qu’on leur confère le nom commun d’histoire ? »[10].
En effet, la question se pose de savoir s’il est encore possible d’appeler ‘histoires’ ces histoires différenciées, sans se référer implicitement à la réalité d’une histoire générale. Pourquoi faudrait-il encore utiliser le terme d’histoire, si l’on entend plus désigner ni le déroulement linéaire de faits chronologiques, ni le processus d’accomplissement d’un sens, d’une vérité ou d’un savoir ? La conservation du terme d’histoire risquerait au contraire d’engendrer sa réappropriation par la métaphysique : à partir du moment où la notion d’histoire serait utilisée, la question de l’historicité de cette histoire se posera, et l’on sera dès lors provoqué à répondre par une définition d’essence ou de quiddité, visant à déterminer le système des prédicats essentiels commandant le concept, alors que c’est précisément une telle définition que Derrida a pour but d’éviter[11]. C’est pourquoi il ne cessera d’insister sur l’insuffisance d’une nouvelle conception de l’histoire, mais sur la nécessité d’un « déplacement général de l’organisation » discursive[12], qui permette d’élaborer une « autre chaîne conceptuelle de l’histoire[13] ».
Vers une nouvelle chaîne conceptuelle de « l’histoire »
Néanmoins, si Derrida insiste sur la nécessité d’abandonner le terme d’histoire, ou du moins, de s’en servir avec « des précautions et des guillemets », ce n’est pas pour suggérer un quelconque « refus de l’histoire »[14]. Ce refus du refus de l’histoire apparaît clairement à travers la critique déconstructrice du structuralisme de Lévi-Strauss ou d’Althusser, puisque Derrida attaque précisément les deux auteurs sur cette question. En effet, la critique de l’« anhistoricisme » de Lévi-Strauss ou du « théorétisme » d’Althusser reposent toutes deux sur la même structure argumentative : Derrida reconnaît à chaque fois la légitimité de la critique du concept métaphysique d’histoire, tout en déplorant son abandon ou sa neutralisation par les deux auteurs, là où selon lui, il était précisément nécessaire de produire « un nouveau concept d’histoire[15] ». A croire pouvoir soustraire un certain nombre de choses à l’histoire, Lévi-Strauss et Althusser seraient en fait retombés dans la métaphysique de la présence, dont l’« anhistoricisme » et le « théorétisme » constituent deux symptômes.
Derrida montre en effet que le discours structuraliste de Lévi-Strauss, dans la mesure où il implique d’envisager la structuralité de la structure, conduit bien à rompre avec l’exigence de centre, d’origine ou de fin qui caractérisait la métaphysique occidentale et à envisager « les substitutions, les transformations, les permutations » des structures sans les réinscrire dans une histoire du sens. En ce sens, il implique inévitablement de suspecter le concept d’histoire et la métaphysique eschatologique ou téléologique qu’il implique. Néanmoins, à ne pas poser le problème d’un nouveau concept d’histoire, Lévi-Strauss risque de retomber dans un anhistoricisme métaphysique : Derrida soutient en effet que « le respect de la structuralité, de l’originalité interne de la structure » a conduit l’anthropologue « à neutraliser le temps et l’histoire », à « écarter tous les faits au moment où il veut ressaisir la spécificité essentielle d’une structure », renouant ainsi avec les gestes de Rousseau ou de Husserl. Or, cette mise entre parenthèse de l’histoire et cette essentialisation des structures le conduit à penser l’apparition d’une structure nouvelle sur le modèle de la catastrophe ou de la rupture avec une origine perdue, au lieu de l’inciter à « poser le problème du passage d’une structure à une autre », en produisant une nouvelle conception de l’histoire[16].
De même, si Derrida s’accorde avec la critique de l’historicisme opérée par Althusser et sur sa volonté de soustraire la théorie de l’idéologie à l’histoire au sens classique, il soutient néanmoins que cette rupture légitime avec l’historicisme conduit le discours althussérien à une nouvelle forme de « théorétisme » ou de « scientisme », c’est-à-dire, à une position qui hypostasie la théorie ou la science, ou du moins, réprime un certain nombre de questions à leur propos, ne s’interroge pas sur la valeur qu’elle leur accorde[17]. Contre cette tendance « théorétique » Derrida affirme la nécessité de questionner « généalogiquement » l’idée et la valeur de la théorie, de la science ou de l’objectivité, en se demandant par exemple « d’où vient la valeur d’objectivité ou comment se constitue l’ordre ou l’autorité de la théorie et sa prévalence dans l’histoire de la philosophie[18] ». Poser de telles questions hors d’une perspective historiciste ou empiriste nécessite néanmoins d’accéder à une « dimension de l’historicité plus que transcendantale ou ultra-transcendantale[19] », donc de « penser l’histoire autrement[20] » – bref, d’élaborer un « autre concept » de ce qu’on ne pourra plus dès lors appelé « histoire », et surtout, de produire un nouveau texte qui permettra de poser la question de l’« histoire » de l’essence, sans impliquer celle de l’essence de l’histoire. C’est pourquoi Derrida affirme que cet « autre concept » de ce qu’on ne pourra plus dès lors appeler « histoire » ne peut pas voir le jour au sein d’un discours « purement théorique » « tout entier réglé par l’essence, le sens, ou la vérité »[21], puisqu’il a précisément pour fonction de réinscrire les effets de science et de vérité.
Cependant, là encore, Derrida ne semble pas lui-même produire le discours en question : il est en effet frappant de voir que la nécessité d’un nouveau concept d’histoire, mise au jour par Derrida dès ses premières réflexions sur le structuralisme dans les années 60 (l’article sur Lévi-Strauss date de 1966), sera réaffirmée vingt ans plus tard quasiment dans les mêmes termes (l’entretien sur Althusser date du début des années 1990). Force est de constater que, dans le cas de l’histoire comme dans le cas du sujet, le « déplacement positif » du concept n’a pas été opéré par Derrida, qui semble en être resté à la première phase (renversante) de la déconstruction. Mais de même que pour le concept de sujet, Derrida a néanmoins mis au jour les exigences qui commandent la transformation du concept d’histoire : contrairement à la langue métaphysique qui implique de penser une histoire générale, linéaire et téléologique, le déplacement discursif devrait permettre de penser des « histoires » différenciées dans leurs types, dans leurs rythmes et dans leurs modes d’inscription, d’envisager la transformation des structures à partir d’ « une nouvelle logique de la répétition et de la trace », et de « réinscrire les effets de science et de vérité »[22], dans ce qui ne pourra plus être considéré comme une histoire empirique ni comme une histoire du sens.
IV. L’avenir de la déconstruction.
Les nouvelles questions du sujet et de l’histoire
Qu’il s’agisse du sujet ou de l’histoire, le geste de Derrida semble donc formellement identique : il lui semble nécessaire de renoncer aux concepts et à leur « vieux noms[23] » en raison des présupposés métaphysiques qu’ils transportent, sans pour autant oublier les questions et les problèmes qu’ils soulèvent. Il s’agit au contraire de formuler différemment les problèmes, de poser les questions en d’autres termes, dans un texte restructuré ou réorganisé, qui ne fonctionne plus selon la logique et les catégories oppositionnelles du discours philosophique traditionnel. C’est seulement au sein d’un tel texte que les questions réprimées par les concepts de sujet et d’histoire pourront émerger, hors des présupposés logocentristes ou métaphysiques.
Si l’on suit les conclusions tirées des analyses de Derrida :
-ce texte devra donc permettre de penser un « sujet » réinscrit dans le processus de la vie, qui ouvre à une nouvelle conception de la responsabilité, et de penser une singularité différante de soi et constituée à partir de l’autre ;
-ce texte devra aussi permettre de penser des « histoires » différenciées dans leurs rythmes et dans leurs modes d’inscription, d’envisager le processus de transformation des sociétés à partir d’une nouvelle logique de la répétition, ainsi que de réinscrire « généalogiquement » les « effets de vérité ».
Dans un tel texte néanmoins, les concepts de sujet et d’histoire ne devraient plus apparaître comme tels, puisque les problèmes auront été déplacés.
Il s’agit donc de chercher un texte qui permette :
-de penser ladite différence anthropologique hors d’une opposition entre animalité et humanité ou conscience et vie, et de penser une singularité hors des schèmes de l’identité ou de la présence à soi ;
-de penser les transformations et les évolutions sociales hors des schèmes linéaires ou téléologiques, ainsi que de réinscrire généalogiquement les valeurs de scientificité ou de vérité.
Il semble que le texte de Stiegler permette précisément de remplir ces deux fonctions en produisant la configuration discursive au sein de laquelle les « autres concepts » (non-métaphysiques) de « sujet » et d’« histoire » (dont Derrida a montré la nécessité) peuvent émerger. Le geste de Stiegler consiste à mettre au jour le refoulement de la question de la technique par le discours philosophique, refoulement qui se serait perpétué à travers la pensée dite post-structuraliste (et notamment à travers le discours déconstructeur de Derrida)[24]. Or, il semble que cette réhabilitation du rôle du processus d’extériorisation technique dans la constitution de la « subjectivité », et la réhabilitation du rôle de l’évolution technique dans le processus « historique », sonduisent Stiegler à déconstruire ces notions et à changer la portée des questions du sujet et de l’histoire, qui deviennent ainsi celles de l’individuation psycho-sociale et du double redoublement épokhal. Tentons donc d’expliquer brièvement le sens (ou plutôt la fonction) des notions d’« individuation psycho-sociale » et de « double redoublement épokhal », et de montrer en quoi elles nous semblent permettre de poser les questions de la subjectivité et de l’historicité sans relancer les présupposés qui commandent la métaphysique occidentale.
Du concept de sujet aux questions de la forme technique de la vie et de l’individuation psycho-sociale
Dans le premier tome de La technique et le temps[25], Stiegler s’appuie notamment sur les travaux de Leroi-Gourhan et d’Heidegger, pour penser le rôle de l’extériorisation technique du vivant (la production d’organes artificiels) dans la constitution « du rapport au temps que nous nommons exister ». Il s’agit de montrer que l’intériorité psychique se constitue en retour à partir du processus d’« extériorisation » technique du vivant, qui ouvre de nouvelles possibilités de conservation de la mémoire, à travers la sédimentation des expériences vécues dans la matière inorganique, et leur transmission de génération en génération. S’il ne s’agit plus de poser un « je pense », une conscience ou un rapport à l’être originaire, il n’est pas question pour autant d’affirmer une quelconque continuité homogène entre une animalité et une humanité préalablement séparées, mais bien d’interroger « la spécificité de la temporalité de la vie lorsque celle-ci s’inscrit dans le non-vivant », et qu’un nouveau type d’héritage (non seulement génétique ou biologique) devient possible grâce aux supports techniques, comme accès à un passé non vécu et ouverture d’un avenir improbable. Il ne s’agira donc plus de s’interroger sur une subjectivité séparée du vivant, mais bien de penser l’articulation d’un processus d’individuation psychique (de constitution des fonctions psychiques) au sein d’un processus d’individuation vitale, à travers la défonctionnalisation et la refonctionnalisation des organes biologiques (ou endosomatiques) agencés aux organes artificiels (ou exosomatiques), et la transformation des instincts en pulsions, qui pourront elles-mêmes devenir des désirs grâce à leurs socialisation. En saisissant ladite « subjectivité » comme une forme de vie technique (et du même coup psychique, noétique, désirante), Stiegler semble permettre de rompre avec la coupure traditionnelle qui isole le sujet du vivant, sans pour autant nier les hétérogénéités entre les formes de vie. Il est intéressant de remarquer que ce geste le conduira à repenser la question de la responsabilité de la « forme technique de la vie » à l’égard de « l’univers des vivants en totalité »[26] : comme le suggérait Derrida, le fait de réinscrire ce qui avait été déterminé comme « subjectivité » dans l’évolution du vivant semble impliquer de penser « une responsabilité qui ne s’arrête pas à la détermination du prochain », mais semble concerner « le vivant en général ».
Mais la « forme technique de la vie » ne peut pas seulement être décrite comme un processus d’individuation psychique : elle constitue en fait un processus d’individuation psycho-sociale. Stiegler soutient en effet que l’individuation psychique est toujours du même coup une individuation collective : c’est toujours à travers ses relations avec d’autres individus que l’individu vivant s’individue et évolue psychiquement, en partageant et en transformant des significations. De telles relations sociales entre organismes psycho-somatiques sont médiatisées par des supports techniques (artefacts, objets) qui permettent la sédimentation, la conservation, le partage, la transmission et la transformation des significations, à travers un double processus d’intériorisation et d’extériorisation[27]. Il ne s’agira donc plus de s’interroger sur la présence à soi d’un sujet constituant du sens, mais sur la manière dont un individu psychique se singularise en introduisant une bifurcation dans ces circuits de transindividuation à travers lesquels circulent les significations[28]. La singularité ne sera plus pensée à partir des schèmes de la permanence, de la stabilité, ou de l’identité à soi, mais comme cette capacité à s’individuer (et donc à se transformer, à différer de soi) en individuant (et donc en transformant et en différenciant) les savoirs constitués et les significations collectives métastables. Le geste qui consiste à réinscrire la subjectivité (l’individuation psychique) dans la vie (l’individuation vitale) semble donc aller de pair avec le fait de penser une « singularité différante ». Les questions de la forme technique de la vie et de l’individuation psycho-sociale semblent ainsi se substituer aux problématiques traditionnelles du sujet.
Du concept d’histoire aux questions des chocs techniques et du double redoublement épokhal
Qu’en est-il alors pour la question de l’histoire ? Il semble que ce soit plutôt dans le second tome de La technique et le temps[29], que se joue le déplacement du problème de l’histoire. Stiegler traite alors cette fois plus spécifiquement du rôle de l’évolution technique (« l’histoire du quoi ») dans le devenir historique (« l’histoire du qui »). Ces réflexions semblent le conduire à abandonner ce que Derrida avait décrit comme une conception métaphysique de l’histoire, puisqu’elles l’engagent à penser non plus une histoire linéaire, comme le processus d’accomplissement d’un sens, d’une vérité ou d’un savoir, mais bien une succession de ruptures accidentelles, provoquées par les transformations techniques, qui bouleversent les organisations sociales existantes et ouvrent ainsi la possibilité de nouvelles époques[30]. En s’appuyant sur les travaux de Leroi-Gourhan, Simondon et Gille, Stiegler soutient qu’un changement du système technique constitue toujours un « choc », dans la mesure où il commence par suspendre les programmes socio-ethniques constitués, c’est-à-dire à transformer les rapports à l’espace et au temps, les cardinalités et les calendarités qui régissent une époque, ainsi que l’ensemble des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoir-penser qui la constituent. A partir de ce bouleversement, de nouveaux modes de vies, de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de penser (courants religieux, spirituels, artistiques, scientifiques et politiques) peuvent se reconstituer, à partir du moment où les individus psychiques développent de nouvelles organisations sociales permettant d’adopter leur nouveau milieu technique[31] (et de le transformer par de nouvelles inventions, qui produiront elles-mêmes de nouveaux chocs engendrant de nouvelles époques).
La succession des époques est donc à comprendre à partir d’une logique de l’adoption : les évolutions technologiques ne déterminent pas les individus psychiques et les transformations sociales, la technique n’est pas le moteur d’un quelconque progrès historique, ce sont au contraire les individus psychiques qui peuvent rendre les évolutions techniques nécessaires dans l’après coup, en constituant de nouvelles pratiques et de nouvelles organisations collectives – c’est pourquoi Stiegler parle d’une « histoire accidentelle (…) dont résulterait un devenir-essentiel de l’accident[32] ». Les « accidents » techniques n’ont rien de nécessaire a priori, ils ne peuvent qu’éventuellement être rendus nécessaires a posteriori, selon une logique quasi-causale. Ils ouvrent donc à la fois l’improbabilité d’une nouvelle époque, et le risque d’une absence d’époque, si le second temps ne se produit pas (c’est-à-dire, si de nouvelles organisations sociales et de nouveaux savoirs permettant d’adopter culturellement le système technique ne se développent pas, mais qu’au contraire, les individus psychiques sont mis au service du système technique). C’est cet enchaînement improbable entre les chocs technologiques et leur redoublement par de nouvelles époques que Stiegler nomme le « double redoublement épokhal », et à partir duquel il repense la question de l’histoire. Il s’agit donc bien de penser les transformations des structures et des organisations sociales, non plus en les situant dans une histoire générale et téléologique, mais en envisageant une pluralité d’époques différenciées, qui se constituent toujours de manière imprévisible et inanticipable, mais qui échappent néanmoins à l’alternative de l’accident et de la nécessité, puisqu’elles ont pour fonction de redoubler l’accident technique en en faisant une nécessité psycho-sociale.
Cette théorie du double redoublement épokhal semble ainsi permettre à Stiegler de penser des « histoires différenciées dans leurs types, dans leurs rythmes et dans leurs modes d’inscriptions (…) à partir d’une nouvelle logique de la répétition », comme le suggérait Derrida. Elle semble aussi permettre de penser les conditions techniques d’émergence des valeurs de scientificité et de rationalité, en montrant comment celles-ci supposent l’exactitude de l’enregistrement du passé, rendu possible par l’écriture orthographique[33]. Dans la mesure où il met au jour les conditions rétentionnelles de possibilité et d’émergence des valeurs de science et de vérité – qui supposent l’écriture comme mémoire orthographique – le discours de Stiegler semble répondre à l’exigence de questionnement sur les conditions de possibilité de l’objectivité et de la science, dont Derrida avait montré la nécessité après la déconstruction du concept métaphysique d’histoire[34].
Conclusion
La mise au jour des questions de l’extériorisation technique du vivant et de l’évolution des systèmes techniques semble ainsi conduire Stiegler à déplacer les concepts de sujet et d’histoire, au sein d’une configuration textuelle qui ne relance pas les présupposés à l’œuvre dans la métaphysique de la présence. Là où le travail de Derrida avait révélé l’insuffisance du concept de sujet pour penser hors d’une conception substantielle et anthropocentriste de la singularité, et l’insuffisance du concept d’histoire pour penser hors d’une conception linéaire et téléologique de la temporalité, le travail de Stiegler semble témoigner de l’efficacité des notions d’individuation (vitale, technique, psychique et collective) et de double redoublement épokhal pour répondre à ces nouvelles exigences de pensée. Le geste de Stiegler semble ainsi venir répondre aux interrogations derridiennes, tout en impliquant de nouveaux problèmes. Car comme l’écrivait Deleuze, « rien ne devient obsolète de ce que les grands philosophes ont écrit sur le sujet (ou l’histoire), mais c’est pourquoi, grâce à eux, nous avons d’autres problèmes à découvrir, plutôt que de revenir en arrière, ce qui témoignerait en fait de notre incapacité à les suivre »[35]. Loin de conduire à la liquidation du sujet ou à la fin de l’histoire, la déconstruction des concepts de sujet et d’histoire s’ouvre en fait sur la question des conditions de possibilités techniques[36] et sociales (donc aussi économiques et politiques) de l’émergence des singularités psychiques et collectives, et de la constitution des époques.
Cette transformation des problèmes ne peut se faire qu’au prix d’une transgression de la langue métaphysique et d’une modification de l’économie du discours philosophique, en élaborant une pensée qui ne fonctionne plus sur la base des couples conceptuels et de la logique oppositionnelle qui commande les textes de la tradition. En ce sens, le travail de Stiegler semble bien marquer un écart par rapport aux textes derridiens : si les premiers travaux de Derrida et la plupart des entretiens concernant la déconstruction témoignent bien de la nécessité d’élaborer une pensée transgressant le logocentrisme, ils constituent aussi une profonde mise en question des entreprises scientifiques et philosophiques qui se sont élaborées en son sein : à l’inverse, et dans la mesure où il transforme en profondeur la langue de la métaphysique, le travail de Stiegler semble permettre une reconfiguration des discours philosophiques et scientifiques, ainsi que de leur rapport mutuel. Si les réflexions de Stiegler semblent permettre de répondre à certains de problèmes ouverts dans le texte de Derrida, l’idée d’une continuité entre les deux pensées pourrait se révéler trompeuse, puisque l’enchaînement ne peut se faire qu’au prix de la déconstruction stieglerienne du texte derridien lui-même. Bref, une fois les concepts de « sujet » et d’ « histoire » déconstruits, peut-être ne devrions-nous plus nous interroger sur des rapports entre des « auteurs », ou sur la continuité ou la discontinuité des textes, mais, comme Deleuze nous y engage, sur la transformation des questionnements et des « champs problématiques[37] » dont ces auteurs et ces textes sont les symptômes. Il semblera alors que la déconstruction entreprise par Derrida et la « déconstruction de la déconstruction » poursuivie par Stiegler, dans la mesure où elles ouvrent de nouveaux problèmes et nous « forcent » ainsi à « penser »[38], pourraient permettre de soigner l’ « état de malaise ou de mélancolie[39] » dans lequel la post-modernité avait laissé la pensée.
[1] J. Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », op. cit., p. 425.
[2] J. Derrida, Positions, op. cit., p. 77.
[3] J. Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », op. cit., p. 425.
[4] J. Derrida, Positions, op. cit., p. 77
[5] « Le caractère métaphysique du concept d’histoire n’est pas seulement lié à la linéarité mais à tout un système d’implications (téléologie, eschatologie, accumulation relevante et intériorisante du sens, un certain type de traditionnalité, un certain concept de continuité, de vérité, etc.). », J. Derrida, Positions, op. cit., p. 77.
[6] J. Derrida, De la grammatologie, op. cit.,
[7] « L’écriture au sens étroit – et surtout l’écriture phonétique – sont enracinées dans un passé d’écriture non linéaire. Il a fallu le vaincre et l’on peut, si l’on veut, parler ici de réussite technique : elle assurait une plus grande sécurité et de plus grande possibilité de capitalisation dans un monde dangereux et angoissant. (…) Le modèle énigmatique de la ligne est donc cela même que la philosophie ne pouvait pas voir alors qu’elle avait les yeux ouverts sur le dedans de de sa propre histoire. Cette nuit se défait peu à peu au moment où la linéarité – qui n’est pas la perte ou l’absence mais le refoulement de la pensée symbolique pluri-dimensionnelle – desserre son oppression parce qu’elle commence à stériliser l’économie technique et scientifique qu’elle a longtemps favorisé. » », J. Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 122-123.
[8] « Il est vrai qu’il faudrait alors peut-être se servir d’un autre mot : celui d’histoire a sans doute toujours été associé à un schème linaire du déroulement de la présence, que sa ligne rapporte la présence à soi finale à la présence originaire selon la droite et selon le cercle. », J. Derrida, De la grammatologie, op. cit., p. 122.
[9] J. Derrida, Positions, op. cit., p. 77 et p. 79.
[10] J. Derrida, Positions, op. cit., p. 80. De même, cinq ans auparavant, au colloque de Baltimore, lorsque Jean Hyppolite demande à Derrida s’il est lui aussi à la recherche d’une conception non eschatologique de l’histoire qui envisage la formation de structures à partir de l’occurrence d’événements improbables, comme un processus sans origine et en constante mutation, Derrida répond qu’il est entièrement d’accord avec lui, à part sur le choix des mots utilisés, qui, comme toujours « ne sont pas que des mots ». Voir la discussion entre Hyppolite et Derrida, in The structuralist controversy. The langages of criticism and the sciences of man, R. Macksey et E. Donato (ed.), p. 267.
[11] « Dès qu’on pose la question de l’historicité de l’histoire – et comment l’éviter si on manie un concept pluraliste ou hétérogénéiste de l’histoire ? – on est provoqué à répondre par une définition d’essence, de quiddité, à reconstituer un système de prédicats essentiels, et on est conduit à réaménager le fonds sémantique de la tradition philosophique. », J. Derrida, Positions, op. cit., p. 81.
[12] Ibid., p. 77 et p. 81.
[13] Ibid., p. 78.
[14] « Voilà pourquoi, en bref, je me sers si souvent du mot histoire, mais si souvent aussi avec des guillemets et des précautions qui ont pu laisser croire à un ‘refus de l’histoire’. », ibid., p. 82.
[15] J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 37.
[16] J. Derrida, « La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines », op. cit.
[17] « Je trouvais qu’Althusser soustrayait trop vite un certain nombre de choses à l’histoire, par exemple quand il disait que l’idéologie n’a pas d’histoire. Son théorétisme, le mouvement pour soustraire la Théorie avec un grand T ou la théorie de l’idéologie tout autant que l’idéologie elle-même à l’histoire, me paraissaient problématiques, en tout cas tant qu’un autre concept d’histoire n’était pas produit., J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 37. Voir aussi J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 24-25 et p. 47.
[18] J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 44-45.
[19] J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 37.
[20] « Or, je ne voyais pas chez Althusser le même mouvement, la même sensibilité à cette nécessité de penser l’histoire autrement, et cela me troublait. », J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 37.
[21] J. Derrida, Positions, op. cit., p.
[22] Ibid., p. 78-79.
[23] J. Derrida, Positions, op. cit., p.
[24] B. Stiegler, Etats de choc, op. cit., p.
[25] B. Stiegler, La technique et le temps, t. 1 La faute d’Epiméthée, Paris, Galilée, 1994. Voir en particulier les chapitres 2 et 3 (« Technologie et anthropologie » et « Qui ? Quoi ? L’invention de l’homme »). Nous tentons ici de résumer ces analyses de Stiegler (de manière évidemment trop rapide et lacunaire), afin d’essayer de montrer comment son travail peut permettre de répondre aux questions soulevées par la déconstruction du concept de sujet.
[26] B. Stiegler, Dans la disruption, Paris, Les liens qui libèrent, 2016, p. 329.
[27] Sur la participation au milieu symbolique et l’individuation psychique et collective, voir notamment « I. Participer pour sentir ou l’art de passer à l’acte », in B. Stiegler, De la misère symbolique, Paris, Galilée, 2005.
[28] B. Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au XXIème siècle, op. cit., p. 92-95.
[29] B. Stiegler, La technique et le temps, t. 2 La désorientation, Paris, Galilée, 1994. Voir en particulier les chapitres 1 et 2 (« L’époque orthographique » et « Genèse de la désorientation »). De même que précédemment, nous tentons ici de résumer les analyses de Stiegler (de manière évidemment trop rapide et lacunaire), afin d’essayer de montrer comment son travail peut permettre de répondre aux questions soulevées par la déconstruction du concept d’histoire.
[30] « En passant par Heidegger, je généralisai alors la question de l’épokhè à celle de l’histoire telle qu’elle est constituée par une succession d’époques, où la technique provoque régulièrement, comme changements de systèmes techniques, des bouleversements qui génèrent une activité noétique à partir de laquelle, comme ‘double redoublement épokhal’, une époque à proprement parler se constitue. », B. Stiegler, Dans la disruption, op. cit., p. 73.
[31] « Lorsqu’un système technique engendre une nouvelle époque, l’émergence de nouvelles formes de la pensée se traduit par des courants religieux, spirituels, artistiques, scientifiques et politiques, par des mœurs et des styles, par de nouvelles institutions et de nouvelles organisations sociales, par des changements dans l’éducation, dans le droit, dans les formes du pouvoir, et, bien sûr, dans les fondements mêmes des savoirs – comme savoirs conceptuels aussi bien que comme savoir-faire et comme savoir-vivre. Mais c’est ce qui n’advient que dans un second temps, c’est-à-dire après que l’épokhè techno-logique a eu lieu. », B. Stiegler, Dans la disruption, op. cit., p. 20.
[32] Voir B. Stiegler, La technique et le temps, t. 2 La désorientation, op. cit, chapitre1 « L’époque orthographique », §13 « L’accident de l’Occident ou le paradoxe du supplément ».
[33] Voir B. Stiegler, La technique et le temps, t. 2 La désorientation, op. cit, chapitre1 « L’époque orthographique ».
[34] J. Derrida, Politique et amitié, op. cit., p. 23, p. 26, p. 44.
[35] « Nothing grows obsolete of what the great philosophers have written on the subject, but this is why, thanks to them, we have other problems to discover, rather than make ‘come-backs’, which would only show our incapacity to follow them », G. Deleuze, « A philosophical concept », op. cit., p. 112. Nous traduisons librement.
[36] Il faudrait dire « mnémotechniques » ou « hypomnésiques », et non plus « techniques » à partir du moment où l’on entend plus par « technique » le simple moyen au service d’une fin, mais où l’on comprend l’objet technique comme un support de mémoire et le milieu technique comme un dispositif rétentionnel médiatisant les relations sociales et la circulation des significations entre individus psychiques.
[37] « …we must confront the fileds of problems to which (concepts) are an answer so as to discover by what forces the problems transform themselves and demand the constitution of new concepts ». G. Deleuze, « A philosophical concept », Topoi n°7,1988, p. 111-112.
[38] « Il est évident que des actes de recognition existent et occupent une grande partie de notre vie quotidienne : c’est une table, c’est une bonne, c’est le morceau de cire, bonjour Théétète. Mais qui peut croire que le destin de la pensée s’y joue, et que nous pensions, quand nous reconnaissons ? (…) Le propre du nouveau, c’est-à-dire la différence, est de solliciter dans la pensée des forces qui ne sont pas celles de la recognition (…) Ne comptons pas sur la pensée pour asseoir la nécessité relative de ce qu’elle pense, mais au contraire, sur la contingence d’une rencontre avec ce qui force à penser pour lever et dresser la nécessité absolue d’un acte de penser, d’une passion de penser. » G. Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, p.177-181.
[39] J.-F. Lyotard, « Une fable postmoderne », in Moralités postmodernes, op. cit. p. 93.












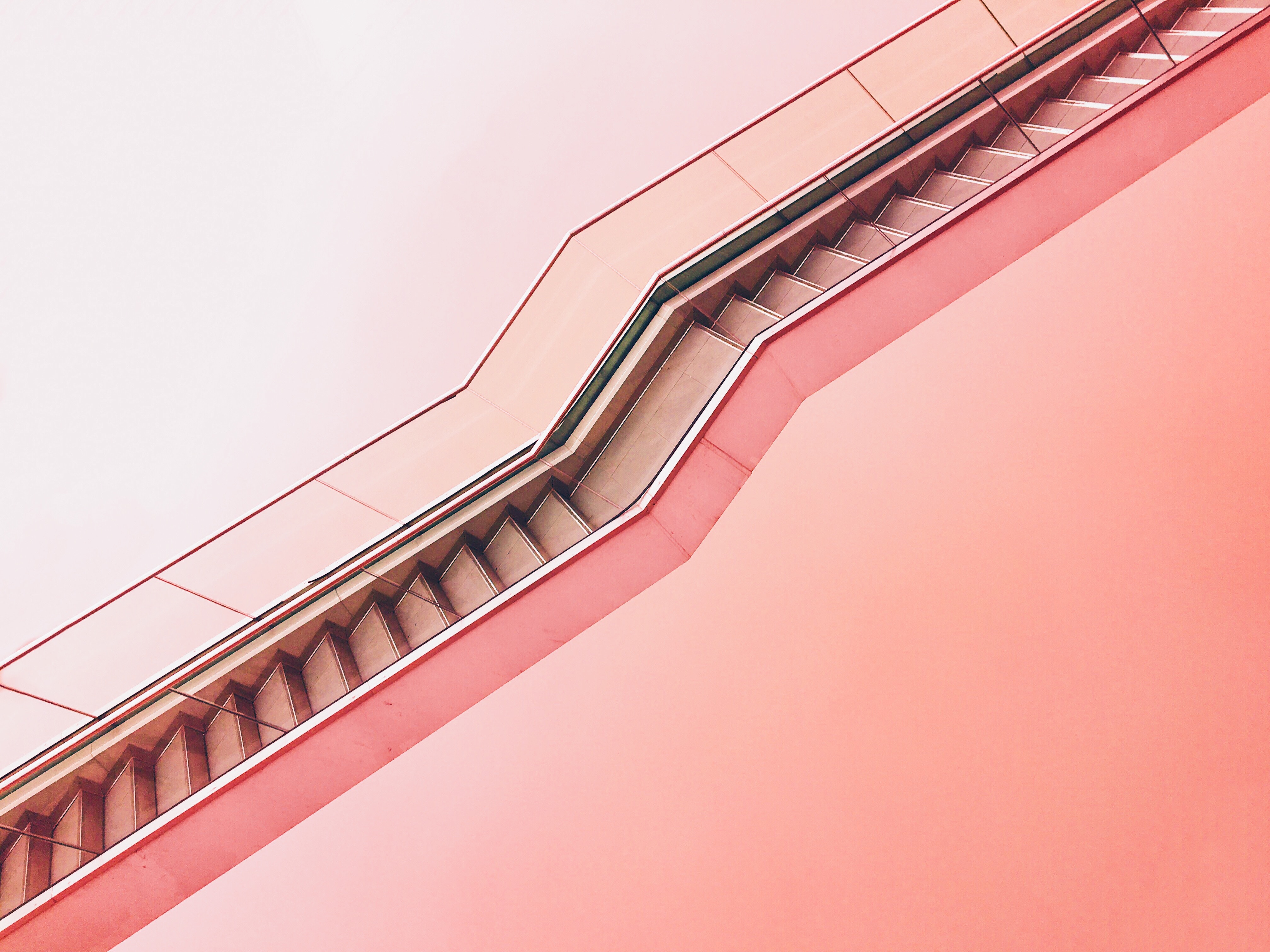


Bonjour,
Peut-être ceci pourrait-il vous intéresser…
https://www.youtube.com/watch?v=kBCDU_PnavQ
Cordialement