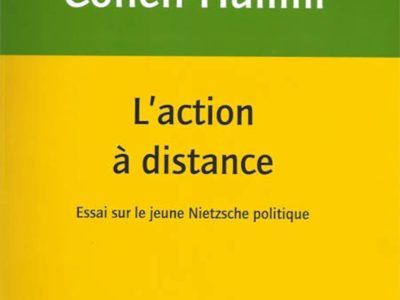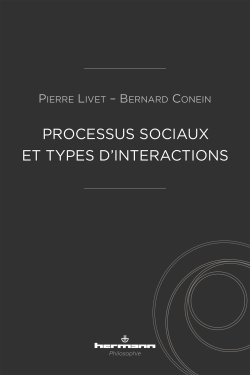Recension – Philosophie Économique : un état des lieux
Marc Goetzmann est doctorant contractuel chargé d’enseignement (DCCE), rattaché au CRHI de l’Université de Nice Sophia Antipolis, membre de l’Université Côté d’Azur.
[learn_more caption= »Informations » state= »open »] Cet article est une recension de l’ouvrage dirigé par Gilles Campagnolo et Jean-Sébastien Gharbi, Philosophie Économique : un état des lieux, Éditions Matériologiques, 2017. Vous pouvez acquérir l’ouvrage en cliquant ici.
Un point de vue réflexif plutôt qu’une position de surplomb
L’ouvrage qu’ont dirigé Gilles Campagnolo et Jean-Sébastien Gharbi ira sans conteste enrichir les rayons des librairies et des bibliothèques de philosophie, souvent pauvres en philosophie économique. L’économie étant sur toutes les lèvres et sous la plume de nombreux philosophes, on pourrait néanmoins s’étonner de ce constat. Pourtant, comme le rappelle l’introduction rédigée par les co-auteurs de l’ouvrage, parler de l’économie, faire de la philosophie de l’économie, ce n’est pas nécessairement participer au développement d’une philosophie dite économique, comme c’est leur intention. Le discours philosophique a en effet tendance à se poser en recul de la science économique, la traitant comme un objet soumis au regard critique d’un sujet, empruntant très certainement par là le chemin ouvert par Marx depuis la Critique de l’économie politique. Si cette démarche est nécessaire et salutaire, elle ne saurait cependant se passer ni nous dispenser d’un travail « conceptuel » sur la pratique même de l’économie (p. 6), qu’un parti pris réflexif ne réduirait pas à une démarche seulement méthodologique. Il s’agit, en substance, du projet des directeurs de cet ouvrage, et l’ensemble des articles qu’ils ont réuni est à la hauteur de cette ambition.
Un vaste état des lieux
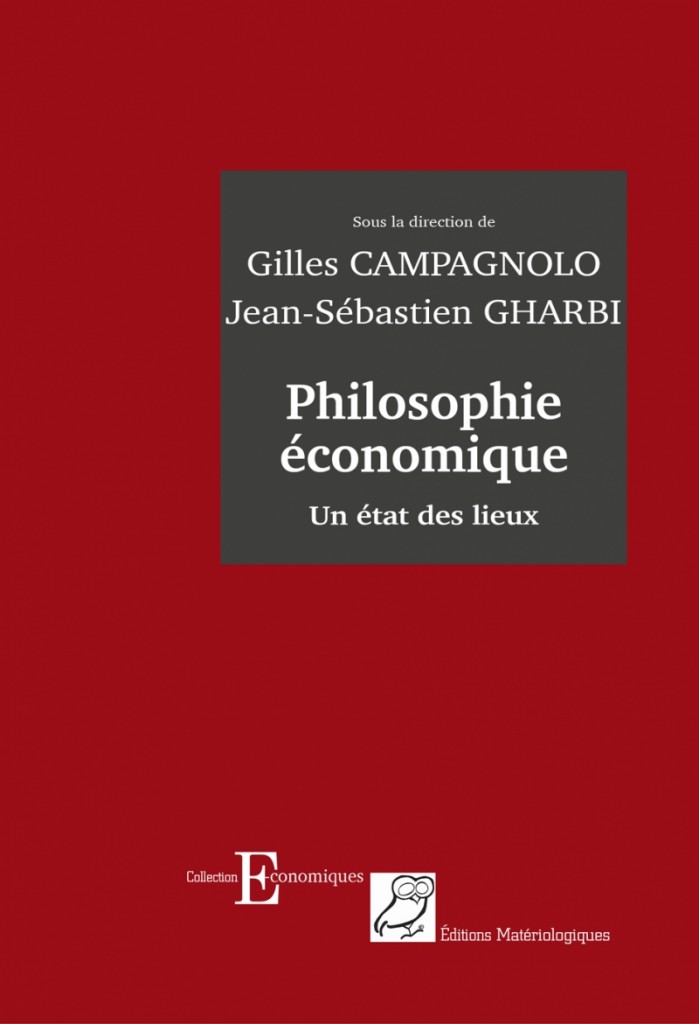 L’ouvrage est, comme annoncé, un « état des lieux » et en possède les qualités comme les limites, car il n’y a pas lieu ici de parler de défauts à proprement parler. Ainsi, le lecteur qui prendra ce fait en considération ne sera pas étonné de constater que les contributions n’ont souvent pas pour vocation de proposer des idées nouvelles, à quelques exceptions près, mais se répartissent plutôt en deux catégories principales : d’une part, les articles prenant la forme d’excellents chapitres d’encyclopédie et s’efforçant de constituer un panorama exhaustif d’une grande question de la philosophie économique, avec quantités de références ; d’autre part, des articles servant d’ouverture ou d’introduction à des recherches plus approfondies, souvent de l’auteur de l’article lui-même. L’aspect monolithique de l’ouvrage (648 pages) ne saurait donc tromper le lecteur, tant il renvoie à un vaste ensemble de réflexions plurielles.
L’ouvrage est, comme annoncé, un « état des lieux » et en possède les qualités comme les limites, car il n’y a pas lieu ici de parler de défauts à proprement parler. Ainsi, le lecteur qui prendra ce fait en considération ne sera pas étonné de constater que les contributions n’ont souvent pas pour vocation de proposer des idées nouvelles, à quelques exceptions près, mais se répartissent plutôt en deux catégories principales : d’une part, les articles prenant la forme d’excellents chapitres d’encyclopédie et s’efforçant de constituer un panorama exhaustif d’une grande question de la philosophie économique, avec quantités de références ; d’autre part, des articles servant d’ouverture ou d’introduction à des recherches plus approfondies, souvent de l’auteur de l’article lui-même. L’aspect monolithique de l’ouvrage (648 pages) ne saurait donc tromper le lecteur, tant il renvoie à un vaste ensemble de réflexions plurielles.
Afin de structurer ce grand nombre de contributions, occupant chacune l’un des quinze chapitres, le livre est découpé en trois parties. L’ouvrage se trouve alors pris dans les contraintes que subissent la plupart des collectifs : la pluralité enrichissante des points de vue n’est pas canalisée par une articulation des contributions les unes aux autres en fonction de thématiques définies. Néanmoins, un lecteur averti ne manquera pas de constater que les articles se répondent, à des degrés divers cependant selon les parties. Les thématiques évoquées résonneront alors toutes à l’oreille des philosophes, puisque de grands domaines de la philosophie y sont représentés : philosophie morale, politique, juridique, théorie de l’action, épistémologie etc., et que l’histoire de la philosophie n’est pas du tout négligée, ce qui est peut-être une prouesse lorsque les recherches évoquées sont si actuelles. Notre présentation entend ici souligner les fils conducteurs de l’ouvrage, sans toujours en respecter l’ordre.
La première partie s’intitule « Philosophie morale et politique, et économie politique », et se trouve être celle dont la cohérence est la plus évidente, en ce que les différents articles développent tous des réflexions sur la théorie de la justice et proposent différents développements autour des questions soulevées par l’égalitarisme libéral. L’article de Catherine Audard (chap. 1, « Une critique de la conception utilitariste de la personne et de l’agent économique) permet de mieux situer la pensée de Rawls à la fois dans la continuité et dans la rupture avec l’utilitarisme classique. On y trouve, selon Catherine Audard, une volonté de prendre en compte la personne comme fin en soi, alors que l’utilitarisme classique est accusé de la considérer uniquement comme moyen. Elle explique avec une grande clarté comment Rawls développe une pensée non-kantienne des droits de la personne, en lien avec une critique à la fois sociale et libérale de l’État providence, où la justice n’est plus seulement pensée comme une redistribution ex post mais comme un travail sur les conditions de possibilité d’une égalité ex ante. Cette réflexion amène à introduire ce que Rawls appelle une « démocratie de propriétaires », thème récurrent de cette partie de l’ouvrage. L’article de Jean Magnan de Bornier (chap. 4, « Philosophie économique de la propriété) permet justement de situer cette réflexion à la suite d’une longue tradition remontant à Saint Thomas d’Aquin et Locke. S’y trouve retracée l’histoire philosophique d’une institution, la propriété, qui, et on le comprend d’autant plus clairement à la lecture de l’article, ne concentre pas par hasard l’attention des économistes et des philosophes, la question de l’appropriation étant étroitement liée à celle de la justice redistributive. On regrettera d’ailleurs peut-être au passage le fait que cette focalisation, dépendante du paradigme proposé par Rawls, ne permette pas de considérer d’autres perspectives que celle la propriété individuelle pour réaliser la justice.
Or, faire de la justice sociale et du bien-être commun une exigence, tout en posant comme principes l’égalité la moins formelle possible et le respect des personnes en tant fin en soi, c’est précisément l’équation formulée par l’égalitarisme libéral de Rawls, qui ne manque pas de poser d’immenses problèmes philosophiques. L’exigeant article d’Antoinette Baujard (chap. 2, « L’économie du bien-être est morte. Vive l’économie du bien-être ! »), à travers l’histoire des tribulations ce que l’on appelle l’économie du bien-être, ou welfare economics, aborde une question fondamentale posée par l’utilitarisme de Bentham : les comparaisons interpersonnelles des préférences individuelles sont-elles possibles ? La réponse à cette question est cruciale si l’on souhaite promouvoir des politiques ayant pour horizon un « mieux-être » commun, tout en respectant comme la liberté de chaque personne et sans imposer une conception unique du bien. L’article propose alors un long panorama exhaustif, conjuguant la précision, la technicité et l’exhaustivité, et qui pourrait faire office de cours auto-suffisant sur cette question. Ces problèmes trouvent leur prolongement dans l’article de Claude Gamel (chap. 3, « Économie de l’égalitarisme libéral. Réflexion pour mieux concilier libéralismes politique et économique ») qui propose une réflexion sur le potentiel opératoire de la théorie politique au niveau économique. On y retrouve la figure cardinale de Rawls, défendue systématiquement contre les différentes objections faites contre la prétendue abstraction de son libéralisme politique, considéré comme incompatible avec le libéralisme économique. L’article prend le parti de puiser dans des réflexions économiques contemporaines pour démontrer la faisabilité économique du programme politique rawlsien. Enfin, l’article de Danielle Zwarthoed (chap. 5, « La justice intergénérationnelle ») prolonge ces questions essentielles à un niveau supérieur, celui de la justice « intergénérationnelle ». Se demander quel type de solidarité peut exister d’une génération envers les générations qui suivront pose à nouveau frais toutes les questions classiques posées par l’utilitarisme et le libéralisme, notamment celui de la liberté individuelle, ou encore celui des préférences individuelles, que l’idée d’une personne potentielle rend d’autant plus complexe. Plus largement, c’est l’ensemble des catégories de la philosophie morale qui se trouvent réinterrogées.modèle
La deuxième partie de l’ouvrage, « Épistémologie et méthodologie économique », soulève des enjeux importants, mais présente une cohérence apparente moindre, et les articles des deuxièmes et troisièmes parties (« Philosophie de l’action et théorie de la décision ») se répondent davantage les uns aux autres qu’ils ne se répondent à l’intérieur même de leurs parties. La raison en est simple, et les directeurs du collectif le soulignent à juste titre : caractériser l’épistémologie de l’économie, c’est aussi s’interroger sur l’ontologie qui la sous-tend, ontologie qui se trouve être aussi « morale que sociale » (p. 45).CA
Deux articles, ceux des chapitre 8 et 10, nous semblent interroger directement le statut de l’économie comme science. Déterminer le statut de l’économie dans la hiérarchie des pratiques et des sciences implique, comme tente de le faire Bernard Walliser (chap. 8, « Méthode scientifique et modes de raisonnement »), de caractériser correctement les « modèles usuels de raisonnement » (p. 298) propres à l’économie. Il entend ainsi montrer comment, loin de se limiter à un ou plusieurs ou plusieurs types de raisonnement (induction contre déduction par exemple), la science économique recourt à l’ensemble des méthodes propres aux sciences naturelles et sociales. Néanmoins, il reste difficile de savoir si cette tentative a une vocation descriptive ou bien normative. En effet, il paraîtrait difficile d’affirmer que les économistes ont une vision aussi claire de leurs méthodes que celle que présente l’article. Denis Phan et Franck Varenne (chap. 10, « Modèles et simulations à base d’agents dans les sciences économiques et sociale ») adoptent une perspective plus resserrée et donc de fait moins normative. Prenant acte de l’émergence dans les sciences sociales de l’utilisation de « simulations informatiques à base d’agents », et des problèmes méthodologiques qu’elles peuvent soulever notamment dans contextes d’interdisciplinarité, ils revisitent avec précision et finesse la vieille dichotomie entre théorie et expérience, en tentant de décrire la place occupée entre ces deux extrêmes par les modèles et les simulations. Le concept clef qui leur permet de rejeter le réalisme naïf comme le formalisme extrême est celui de « hiérarchie dénotationnelle » : c’est en effet selon eux dans les différents degrés de dénotation des symboles présents au sein des modèles et des simulations que l’on peut distingue des niveaux d’abstraction conceptuelle et, à l’inverse, d’empiricité. À ces deux contributions qui tendent à mettre entre parenthèse le contexte social de la production scientifique, Christian Walter (chap. 15, « Philosophie de la finance : l’exemple de l’efficacité informationnelle d’un marché ») apporte un contrepoint important. Il se propose de répondre, à travers l’évolution du concept « d’efficacité informationnelle » d’un marché, à une question qui est peut-être plus saillante aujourd’hui pour l’économie que pour d’autres disciplines : en quoi une science humaine et/ou sociale modifie l’objet qu’elle se propose d’étudier ? Il y répond positivement, mettant en lumière la façon dont l’idée d’un marché « efficace » a pu devenir une forme d’énoncé performatif, structurant la réalité dont il entendait seulement rendre compte.
D’autres articles nous semblent placer le curseur du questionnement au niveau de la place de l’individu économie, et posent systématiquement la question de l’articulation entre le niveau individuel et le niveau social. L’article de Ricardo Crespo (chap. 6, « L’ontologie de l’économie selon Aristote et la théorie économique actuelle ») réussit en quelque sorte une performance difficile, faisant le lien entre une analyse fine la caractérisation de « l’économie » par Aristote, qui affirme son statut de « réalité de type social » (p. 275), et la recherche en économie des institutions. C’est la notion d’habitude qui est clef pour comprendre le fonctionnement des institutions selon une perspective économique, habitudes individuelles et institutions supra-individuelles se nourrissant mutuellement pour assurer un fonctionnement à la fois efficace et juste du marché. Tout ceci suppose d’accepter avant tout l’idée d’une subordination de l’économie à la politique, et de la « chrématistique » à l’économie, que cette dernière soit, selon ses différents sens chez Aristote, gestion des biens, action, capacité, habitude ou encore science, comme l’analyse avec soin Ricardo Crespo. Cet article doit être mis en regard avec celui de Cyril Hédoin (chap. 13, « Théorie des jeux et analyse économique des institutions »), tant les deux articles semblent complémentaires, le premier utilisant la notion aristotélicienne d’habitude pour penser les institutions sans les détacher du niveau individuel, pendant que le second rend compte de la façon dont la théorie des jeux, proposant une ontologie essentiellement individualiste, cherche cependant à rendre compte de l’émergence d’institutions supra-individuelles, et cela sans céder à l’individualisme méthodologique le plus radical. Cyril Hédoin conjugue en effet une présentation générale réussie des enjeux de l’économie des institutions et un développement de ses propres questionnements vis-à-vis de questions fondamentales pour les sciences humaines et sociales dans leur ensemble, comme la relation entre les faits et les théories, la validité de l’individualisme méthodologique, ou encore l’utilisation des modèles évolutionnistes. Sa lecture requiert des connaissances minimales en théorie des jeux pour une compréhension complète, mais reste accessible pour toute personne intéressée par la philosophie politique, juridique et sociale, qui trouvera rafraichissant de se familiariser avec ce domaine. Selon nous, la lecture d’articles comme de Cyril Hédoin souligne toutefois indirectement les limites d’une démarche qui voudrait donner un caractère aussi central à un concept comme celui d’habitude car, s’il nous semble faire le lien (et c’est un pas essentiel) entre l’individu et l’institution sans les opposer, il ressemble parfois à une « boite noire » qui ne permettrait pas de comprendre les mécanismes sous-jacents à l’émergence et au fonctionnement des institutions.
Un serpent de mer ressurgit alors derrière ces interrogations sur l’articulation entre niveau institutionnel et individuel : celui de l’homo economicus et de sa rationalité. La forme de rationalité individuelle qui prime en économie conditionne en effet les réflexions détaillées précédemment, puisque c’est par exemple la méthode évolutionniste captée par la théorie des jeux qui permet d’expliquer l’émergence institutions. De telles circulations de concepts ne sont par ailleurs pas sans poser de questions. Quoi qu’il en soit, tous ceux qui sont intéressés par des réflexions plus en phase avec l’économie contemporaine que les simples critiques de l’homo economicus pourront profiter de l’article de Pierre Livet (chap. 7, « L’ontologie de l’économie »), qui propose de concevoir l’individualisme économique comme un individualisme méthodologique, plutôt qu’ontologique. Cela permet à Pierre Livet de couper court à toute discussion sur le « substrat » qui constituerait la rationalité de l’homo economicus, pour développer plutôt l’idée d’une ontologie relationnelle, où le substrat serait paradoxalement la relation entre des entités plutôt que les entités elles-mêmes. La relation interne entre les préférences, supposée cohérente, primerait au niveau individuel, tandis que le second élément ontologique se trouverait au niveau des relations entre les agents économiques, davantage contextuelles. On ne saurait mieux exprimer que Pierre Livet lui-même la conclusion qui s’impose : « il existe une tension entre deux ontologies de ces théories économiques : celle qui voit dans l’ordre des préférences le propre d’un individu – au sens d’une relation constitutive de son individualité – et dans le marché le système des relations entre individus qui résultent de leurs préférences, et celle qui voit dans les structures qui agrègent ces ordres de préférences individuelles une relation constitutive du collectif (p. 290-291) ». Une telle tension semble être à l’origine des contradictions presque insolubles qu’a pu tenter de résoudre l’économie au cours de son histoire, comme Antoinette Baujard le présente aussi au chapitre 2. La question de la cohérence des préférences individuelles, redoublant de difficulté face aux impératifs du groupe social, apparaît donc comme l’un des thèmes dominants implicitement ce collectif.
Maurice Lagueux (chap. 12, « Agents économiques et rationalité ») reformule ces interrogations d’un point de vue peut-être davantage méthodologique, et propose un compte-rendu court et efficace des réflexions possibles sur la place de la rationalité dans la science économique. Considérer l’homo economicus comme un substrat psychologique n’est, selon lui, une erreur que ne font que les non-économistes. Pour ces derniers, il s’agirait bien plutôt d’un « mode d’explication », d’un « concept épistémologique » (p. 489), qui n’aurait pas d’exigence plus élevée que celle d’un postulat de « rationalité minimale ». Ce postulat, loin de faire de l’agent économique une « machine à optimiser » (p. 491) ayant systématiquement en vue la maximisation de l’efficacité par des calculs optimaux, établit plutôt une présomption de rationalité, aux limites claires. L’économie évolutionniste serait par exemple compatible avec cette présomption de rationalité, en ce qu’elle explique comment des individus pourraient, rationnellement, en venir à choisir collectivement des stratégies pourtant sous-optimales individuellement, cette piste étant pleinement développée par Cyril Hédoin au chapitre 13. L’auteur laisse cependant partiellement ouverte la question des préférences non-cohérentes et de l’influence de l’apprentissage sur l’évolution des préférences individuelles. Mikaël Cozic nous semble proposer dans un très long chapitre (chap. 11, « Le rôle de la psychologie dans la théorie néoclassique du consommateur ») une troisième voie entre la psychologisation à outrance de l’agent économique d’une part, et un behaviorisme poussé à l’extrême qui se contenterait d’une démarche strictement descriptive. S’il est nécessaire selon lui de supposer l’existence de mécanismes psychologiques pour conserver le potentiel explicatif de la science économique, il n’est cependant pas recommandable d’approfondir ce cadre jusqu’à l’élaboration d’une théorie psychologique à part entière. Ces différentes contributions mettent ainsi en valeur une forme de prudence méthodologique, où les postulats ontologiques sont ajustés aux prétentions explicatives spécifiques de l’économie, avec un minimalisme ironiquement très économique.
Le problème des préférences individuelles ressort encore une fois de l’analyse que fait Yves Meinard (chap. 9, « La biodiversité comme thème de la philosophie économique ») de la place du concept de biodiversité dans la philosophie économique. Ce concept, qui désigne des propriétés ou des conjonctions de de propriétés différentes selon son contexte d’utilisation (p. 327), et qui n’est pas une entité fixe observable, semble occuper une fonction davantage herméneutique au sein des discours produits par les sciences écologiques (p. 328-330). Mais il est surtout possible, et c’est l’originalité de cette analyse, de considérer la question de la biodiversité comme un problème de philosophie économique, celui des préférences. La nécessité de prendre des décisions publiques concernant la préservation (ou non) de la biodiversité d’un espace imposerait, si l’on voulait prendre en compte les préférences individuelles, de considérer comme pertinentes à la fois les préférences révélées des individus, et leurs « préférences abstraites », provenant d’expériences de pensée contrefactuelles. Cette approche ne peut que résonner avec celle d’Emmanuel Picavet (chap. 14, « Les normes et la philosophie économique) : si la science économique a, comme tout autre science, ses normes épistémiques, et si les normes juridiques l’intéressent au plus haut point en tant qu’elle s’inscrit dans un cadre politique et social, il est cependant nécessaire pour Emmanuel Picavet de dégager le rôle spécifique que les normes jouent en économie. C’est leur fonction de structuration des comportements des agents économiques qui doit alors attirer notre attention selon lui. Comprendre la possibilité de la coopération à partir des choix individuels impose en effet de prendre en compte les normes sous-jacentes à toute action. Loin de réduire cela à l’évaluation normative des actions, davantage propre à la morale et au droit, Emmanuel Picavet nous invite plutôt à regarder au cœur de l’action elle-même en contexte pratique, afin de remarquer comment les normes occupent et structurent l’horizon de nos comportements, depuis nos attentes en contexte d’échange à la façon dont nos intérêts façonnent notre vision du monde.
Une lecture exigeante
Une fois l’ouvrage terminé, il nous apparaît assez évident qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage grand public au sens le plus ouvert du terme, sans que cela pose d’ailleurs problème. Deux publics principaux nous semblent visés : les philosophes d’une part y trouveront leur compte si tant est qu’ils sont intéressés par la philosophie politique et sociale, et les économistes pourront justement adopter le point de vue réflexif sur leur pratique que les directeurs du collectif appellent de leurs vœux en introduction.
Néanmoins, les philosophes apprécieront l’ouvrage à condition qu’ils aient une connaissance minimale de la tradition qui précède les réflexions développées dans les chapitres, ou bien pourvu qu’ils soient prêts à parfaire leur culture sur le sujet au fil de leur lecture. À cet égard, certains articles, mais ils sont rares, seront ardus à la lecture pour des non-initiés. Les économistes pourraient manquer, en cas d’absence de culture de la discipline philosophique et de ses modes de raisonnement, de certaines clefs de lecture, ce qui leur ferait manquer la portée réelle des recherches exposées. Aussi, même si nous ne saurions nous prononcer à leur place, ils pourraient regretter que les perspectives pour leur discipline qui pourraient ressortir de ces réflexions restent principalement implicites. Ce sentiment confirme cependant que l’ouvrage n’est pas seulement l’« état des lieux » réussi d’un vaste champ de recherche, mais fait signe vers les chantiers qui restent à entreprendre.