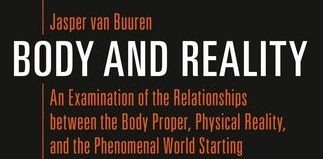Recension — La silhouette de l’humain
Recension du livre de Daniel Andler, La silhouette de l’humain (Paris, Gallimard, 2016, 576 p., 29€)
par Pierre Fasula, chercheur associé au Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La silhouette de l’humain a pour ambition de faire le bilan et de dresser les perspectives du naturalisme aujourd’hui. La manière ressemble assez à celle adoptée dans les deux volumes (collectifs) intitulés Philosophie des sciences[1], où Daniel Andler avait développé notamment les entrées « Processus cognitifs »[2] et « L’ordre humain »[3]. Il serait intéressant de comparer ces ouvrages dans le détail pour mettre en évidence ce qui a changé en une quinzaine d’années, d’un bilan à l’autre. Cependant, dans cette recension nous nous contenterons de présenter le dernier en date.
Une caractéristique de La silhouette de l’humain est une certaine généralité, qui doit être appréciée avant tout de manière positive. Le but est en effet d’embrasser la question du naturalisme sous tous ses aspects, d’où par exemple ces pages assez générales du premier chapitre, intitulées « Raisons et passions », dans lesquelles l’auteur s’interroge sur la légitimité de tel ou tel type d’attaque contre le naturalisme, ou encore ces pages du dernier chapitre sur « notre savoir », dans lesquelles il s’interroge sur son incomplétude, et le lien entre cette incomplétude et l’exigence de naturalisation. Si cette généralité a ses raisons, cela tient à ce que Daniel Andler voit dans le naturalisme autre chose qu’un système philosophique ou scientifique, plutôt une attitude (voire un esprit, une vision) qui se traduit dans un certain nombre de programmes concrets :
La proposition que je vais développer à présent se ramène à ceci : le naturalisme peut consister à s’engager à prendre en considération les programmes de recherche visant à réaliser localement, en quelque sorte sur le terrain, la vision naturaliste. (p. 94)
La question pour le philosophe est alors plus large que celle de la vérité ou de la fausseté d’un système ou d’un certain nombre de thèses, puisqu’il s’agit pour lui :
[…] certes [d’] accompagner, encourager, aider les programmes naturalistes en cours, mais non sans en avoir examiné les présupposés, pris en considération tous les faits pertinents, quelles qu’en soient l’origine et la nature, sans se laisser lier les mains par quelque règle du jeu, théorique ou pragmatique, que ce soit, et sans se laisser impressionner par les arguments d’autorité brandis par les gardiens de la science. (p. 103)
En elle-même une telle affirmation peut sembler générale cette fois au sens négatif du terme, mais en réalité elle doit être évaluée en regard avec sa mise en œuvre dans la présentation de ces programmes, leur description et leur examen critique aux chapitres 2 à 4.
Revenons un instant sur le plan du livre : il est organisé en cinq grands chapitres. Le chapitre un à la fois dépeint le naturalisme d’un point de vue philosophique et le défend sous la forme de cette attitude dont on vient de parler. Les chapitres deux, trois et quatre, sont consacrés à trois domaines scientifiques à la fois distincts et connectés, respectivement : les sciences cognitives, les neurosciences et les approches évolutionnaires. Enfin, le chapitre cinq décrit une catégorie de phénomènes qui pour l’instant échappe aux méthodes du naturalisme (l’intelligence de l’agent), et, pour terminer, revient sur ce qui est présenté comme la meilleure attitude : l’adoption d’un naturalisme critique. Dans les lignes qui suivent, nous ne décrirons pas dans le détail chacune des parties centrales, mais recenserons seulement les points essentiels abordés, tant ils sont nombreux.
Le deuxième chapitre est consacré à la question : « Les sciences cognitives sont-elles en passe de “naturaliser” l’esprit et plus largement la sphère humaine ? » (p. 106–107) Dans un premier temps, Daniel Andler rassemble les éléments (historiques) de ce qu’il appelle la théorie classique en sciences cognitives : cybernétique, ou théorie unifiée des machines complexes et de l’esprit à partir du concept d’information ; fonctionnalisme, ou théorie distinguant les processus mentaux de leur réalisation physique ; hypothèse évolutionnaire, « selon laquelle rien de ce qui est cognitif ne fait sens si ce n’est à la lumière de la théorie de l’évolution » (p. 125). Mais le cœur du chapitre réside dans la contestation de cette version classique au nom de la modularité : l’esprit ne serait pas « un unique programme nourri d’une colossale banque de données » (p. 132), mais constitué au moins en partie de « modules », c’est-à-dire de systèmes autonomes spécialisés dans telle ou telle tâche (la perception par exemple). La présentation est plutôt classique et l’intérêt réside dans la connexion avec le concept d’innéité, et sa discussion, puisque la modularité suppose que « certains modules […] sont présents dès l’origine du développement de tout être humain » (p. 141).
Quel est le résultat de cette description détaillée des sciences cognitives ? Concernant la théorie même, cela ressemble à de l’agnosticisme : « Mais devant quinze ou vingt “philosophies” de la cognition qui s’entrecroisent et s’opposent d’une multitude de façons, il serait présomptueux de prétendre avoir des arguments décisifs pour en préférer une ; ce n’est pas ce dont je me sens capable quant à moi » (p. 170–171). Concernant les résultats empiriques, nous devrions au contraire nous réjouir : une bonne partie des phénomènes mentaux seraient en train d’être rapatriés dans la sphère naturelle.
Le troisième chapitre est consacré aux neurosciences, souvent présentées trop pauvrement selon Daniel Andler, par exemple de la manière suivante : « l’organe de la pensée est le cerveau, les neurosciences cognitives sont la branche de la biologie, science de la nature aux méthodes éprouvées, qui étudie le cerveau, et qui désormais peut observer directement le décours des fonctions supérieurs » (p. 185). La critique de cette présentation prend la forme d’une critique plus précise du localisationisme, c’est-à-dire de l’idée d’une correspondance terme à terme entre ces deux systèmes modulaires que sont le cerveau et l’esprit. De ce point de vue, l’auteur s’engage sans doute davantage que dans les autres chapitres (« le PCM [programme correspondantiste maximal] ne me semble pas défendable », p. 198). De la même manière, le traitement de la neuro-imagerie témoigne d’un engagement plus fort, notamment dans la description de résultats qui n’ont justement pas été obtenus par ce moyen, dans le domaine de la vision (ex. 1), de la compréhension d’autrui (ex. 2), de la mémoire (ex. 3). En résulte un chapitre davantage convaincant dans ce qu’il donne à voir des neurosciences, à la fois du côté des théories et des résultats.
Enfin, le quatrième chapitre est consacré aux approches évolutionnaires de l’homme et de la société, l’enjeu principal étant de « savoir si la rencontre de la théorie de l’évolution et des sciences cognitives modifie en profondeur la perspective pour les sciences de l’homme » (p. 247). Ce chapitre prend la forme tout d’abord d’une présentation critique du « programme de Santa Barbara ». Ses leaders « concevaient chaque capacité spécialisée dans la résolution d’un problème comme un algorithme indépendant […] algorithmes [qui] sont dits darwiniens pour la raison qu’ils résultent de la sélection naturelle : ils sont adaptatifs et inscrits dans le patrimoine génétique » (p. 257). Tout le reste de la section consiste alors dans une longue énumération des critiques adressées à ce programme, dont le résultat est pourtant une défense de la perspective évolutionnaire :
L’évolutionnisme minimal peut être pris comme un filtre, qui nous permet de saisir des configurations, des patterns, dans l’immensité des phénomènes cognitifs, que nous n’avions pas repérés jusqu’ici. Une manière de justifier la PE [perspective évolutionnaire] est de la considérer comme une heuristique. (p. 283)
La défense est très générale et en même temps fondée sur la description de trois exemples qui lui donnent une certaine consistance.
Sur l’autre versant de ce chapitre, Daniel Andler s’attaque à la « socialité profonde » de l’homme : le but est de considérer l’évolution culturelle comme un phénomène naturel, en soulignant le rôle du cerveau social et d’un processus de coévolution gène-culture. L’idée est que « ce à quoi notre “cerveau social” est adapté, c’est une société constituée d’organismes équipés précisément de ce cerveau social » (p. 302) et que « certaines pratiques (d’élevage, par exemple) et certaines modifications génétiques (par exemple celle qui conditionne la persistance de la lactase) se sont mutuellement amplifiées au sein de certaines populations » (p. 314).
Que retenir de ces parties centrales, si ce n’est avant tout qu’elles réussissent une description à la fois historique, philosophique et détaillée de chacun des champs de recherche ? On soulignera notamment la volonté de rentrer dans le détail des débats et controverses, concernant par exemple la modularité de l’esprit (chap. 2), les mises en causes de la conception traditionnelle du cerveau (chap. 3) ou encore les critiques adressées à la psychologie évolutionnaire (chap. 4). L’auteur ne se contente pas en effet d’une description des idées acceptées, qui font consensus, mais cherche et réussit à rendre la vie contemporaine de ces théories, qui inclut leurs mises en cause.
En même temps, il nous a semblé à la lecture que le propos en restait justement au niveau des théories, alors qu’était annoncée une description des programmes de recherche, ce qui implique de faire le bilan de leur productivité réelle et d’entrer dans le détail de leurs acquis empiriques. On aurait aimé que le livre réponde plus ouvertement à la question : que sait-on, grâce aux sciences cognitives, aux neurosciences et aux approches évolutionnaires, que l’on ne savait pas auparavant et qui est corroboré par telle ou telle étude ? Certes on trouve dans cet ouvrage des exemples concrets, notamment si l’on lit les nombreuses notes qui forment un arrière-plan extrêmement riche. Par ailleurs, assumer ce genre de bilan empirique transformerait le projet en celui d’une encyclopédie qu’il faudrait alors actualiser régulièrement, sur le modèle de l’encyclopédie de Neurath – mais pourquoi pas ?
Terminons en soulignant combien on apprend à la lecture de ce livre et combien on peut apprécier la position prise par l’auteur, tantôt dans la défense d’une juste « place pour le naturalisme dans le monde d’aujourd’hui » (pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage), tantôt dans l’examen critique de ce naturalisme. Sur ce dernier point, en témoigne le dernier chapitre du livre qui accorde de longs développements à ce qui résiste à la naturalisation : l’intelligence de l’agent et la normativité du comportement. Un naturalisme critique est celui qui accepte ce genre de difficultés, alors « qu’un certain radicalisme constitue une véritable trahison du naturalisme » (p. 401).
[1] D. Andler, A. Fagot-Largeault et B. Saint-Sernin, Philosophie des sciences I et II, Paris, Gallimard, 2002.
[2] Id., vol. I, p. 226–408.
[3] Id., vol. II, p. 673–824.