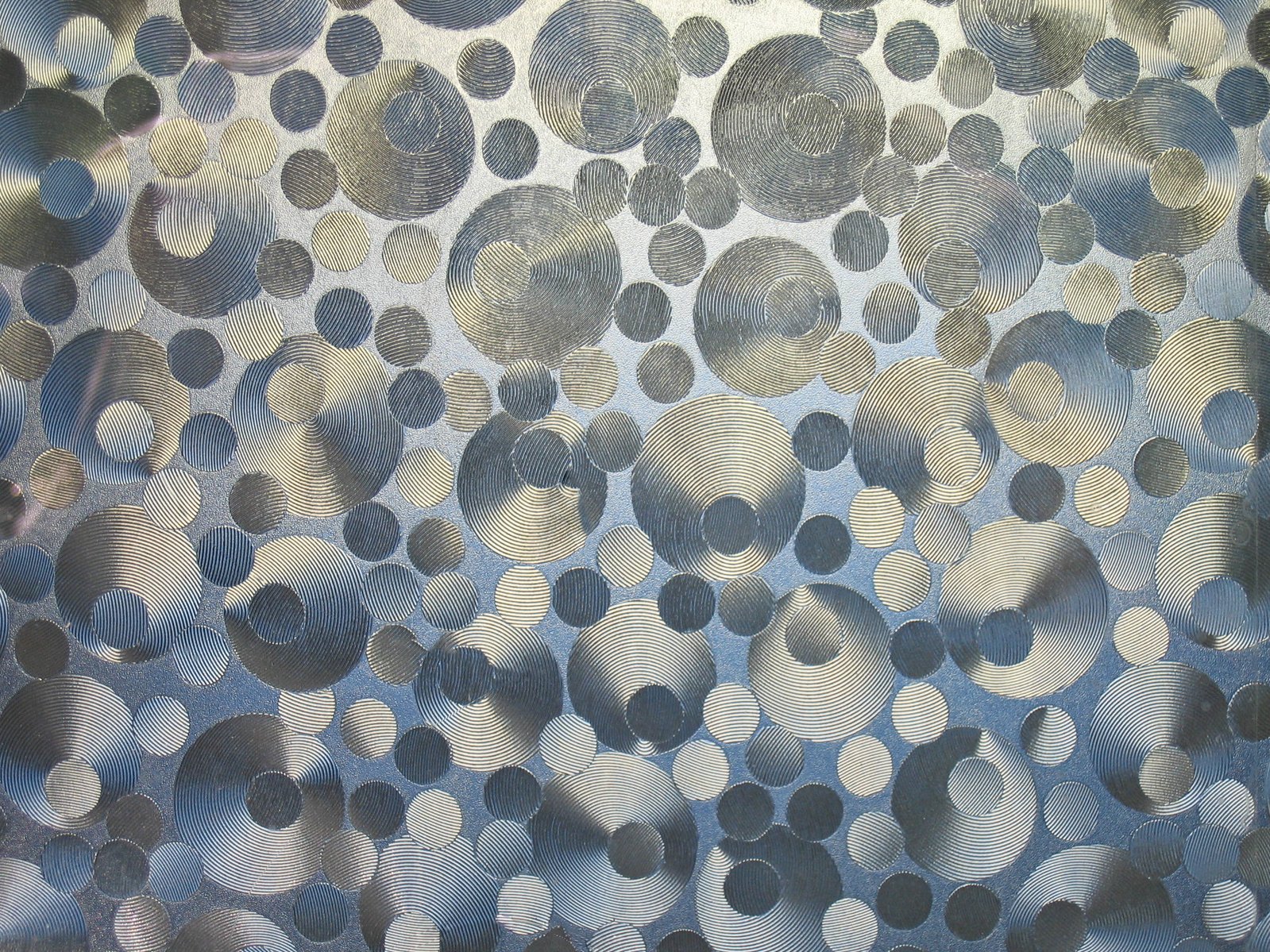La perte de contrôle dans l’addiction
Perte de contrôle, usage contrôlé et retour à une consommation contrôlée : une perspective croisée entre sociologie et philosophie.
Line Pedersen, docteure en sociologie, Université de Fribourg
Mélanie Trouessin, doctorante en philosophie, ENS de Lyon
Introduction.
Dépendance, perte de liberté de s’abstenir de consommer (Fouquet), perte de contrôle, esclavage… autant d’expressions utilisés pour désigner ce qui apparaît comme l’élément central des conduites addictives à savoir le fait d’avoir le sentiment de ne plus consommer une substance ou effectuer un comportement de manière volontaire mais d’y être « forcé ». Il existe ainsi une nébuleuse de termes et d’expressions qui font référence à ce qui est au coeur de l’addiction à savoir les sentiment d’aliénation et de contrainte que ressentent les individus vis-à-vis de leur consommation ou de leur comportement addictif : l’addiction est donc un phénomène fondamentalement conflictuel et ambivalent puisqu’elle s’instaure lorsque l’on ne parvient plus à arrêter une conduite alors que l’on voudrait le faire, ce qui lui procure un aspect fondamentalement pathologique.
Pourtant ces termes ne sont pas identiques et n’impliquent pas forcément la même chose. Par exemple, quelle liberté est-elle perdue lorsqu’il y a dépendance ? Et cette dernière est-elle vraiment la même chose que l’addiction ? Il s’agit donc d’abord de chercher à préciser un peu plus étroitement ce qu’il faut entendre par « perte de contrôle » dans l’addiction avant d’en faire l’élément fondamental des conduites addictives. En outre, ce statut crucial accordé à la perte de contrôle dans l’addiction est-il si légitime que cela ? Deux points semblent relativiser cette idée. D’une part, il s’agit de remarquer la relative absence des références à la perte de contrôle dans les discours sociologiques qui mettent le plus souvent l’accent sur la capacité des consommateurs à « s’auto-contrôler » (Castel et Coppel, 1991) ou sur les régulations sociétales et hétéronomes. En effet « l’addiction » est le plus souvent envisagé comme un processus, c’est-à-dire inscrite dans une trajectoire biographique où le rapport de l’usager aux drogues (au sens large) peut prendre plusieurs formes et où l’on peut identifier plusieurs étapes dans le parcours de consommateurs, étapes non nécessairement chronologiques ni obligatoirement franchies. En ce sens-là, l’usage peut être considéré comme contrôlé par les sociologues, mais, aussi, le retour à une consommation contrôlée est une modalité comme une autre au même titre que la dépendance, l’abstinence, le traitement de substitution etc. D’autre part, que penser de la mise en évidence du fait que, pour de nombreuses personnes ayant souffert d’addiction, il est possible de revenir à un état normal de consommation voire à un état abstinent, parfois sans aucune aide extérieure ? Le problème qui se pose est alors le suivant : si l’on définit l’addiction de manière pathologique en raison du symptôme de perte de contrôle, alors comment la possibilité d’un retour à une consommation contrôlée peut-elle ne pas nier ce caractère pathologique de l’addiction, voire sa réalité même ?
Le terme de perte de contrôle tel qu’il est actuellement utilisé pour caractériser le coeur de l’addiction est-il adéquat et conciliable avec une approche sociologique qui parle d’usage contrôlé ainsi qu’avec la valorisation, face à l’abstinence, de nouveaux buts proposés de traitement comme celui de consommation contrôlée ?
1. La place primordiale du concept de perte de contrôle dans les discours médicaux et philosophiques sur l’addiction.
Bien que les addictions soient souvent rattachées à l’idée d’un temps conséquent consacré à un comportement ou à la quantité importante d’un produit consommé, ce qui apparaît comme fondamental consiste surtout dans la perte de contrôle vis-à-vis de ce temps et de cette quantité. La cinquième et dernière version du DSM compte par exemple parmi les critères de l’addiction (ou des « troubles liés à une substance ») ceux de quantité et de durée plus importantes que prévu. Ajoutés à des critères comme celui de la conscience des conséquences néfastes et de la volonté d’arrêter ou de réduire sa consommation, on comprend aisément que l’idée de perte de contrôle ait été avancée pour tenter de cerner ce qui caractérise en tant que telle une conduite addictive. La seconde partie de la célèbre définition des addictions donnée par Aviel Goodman en 1990 met bien l’accent sur ce point :
« [L’addiction est] un processus par lequel un comportement, qui peut fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est utilisé sous un mode caractérisé par 1) l’échec répété dans le contrôle de ce comportement (impuissance) et 2) la persistance de ce comportement en dépit de conséquences négatives significatives (défaut de gestion) ».
L’addiction ne commence donc pas lorsque l’on a un usage d’une substance ou d’un comportement, même si celui-ci est excessif voire nocif, mais bien à partir du moment où l’individu souhaiterait arrêter sa conduite mais ne le peut pas, parce qu’il a perdu le contrôle sur sa conduite. Autrement dit, il y a addiction à partir du moment où quelque chose d’involontaire se met en place dans la conduite de l’individu, c’est-à-dire à partir du moment où une sorte de contrainte pèse sur sa conduite.
Mais de quelle nature doit être cette contrainte pour qu’un acte puisse vraiment être considéré comme involontaire ? Comment comprendre, dans le cas de l’addiction, l’idée de contrainte, à partir du moment où aucune personne ni force extérieure ne m’oblige à consommer une substance ou à effectuer un comportement alors que je ne le veux pas ? Si pour certains, cette idée de contrainte relève au mieux d’une illusion, au pire d’une preuve de mauvaise foi de la part des personnes addictes, la recherche scientifique a cependant progressivement mis au jour des éléments construisant ce concept de « contrainte » qui serait crucial dans l’addiction et correspondrait en quelque sorte à ce sentiment de perte de contrôle que disent ressentir les personnes addictes.
Après avoir examiné comment cette perte de contrôle a pu être comprise comme une manifestation de faiblesse de la volonté dans le champ de la philosophie, dans un contexte de valorisation de la maîtrise de soi, nous montrerons comment l’idée de perte de contrôle s’est peu à peu médicalisée. Elle a ensuite pris une connotation physiologique, avec l’idée de neuroadaptation et que le cerveau « réclamerait » d’une certaine manière la drogue. L’émergence des addictions comportementales est venue bouleverser la compréhension de cette contrainte, qui est devenue plutôt psychique et interne, ce qui a pu suscité une nouvelle vague de scepticisme envers l’idée que l’addiction existerait ou bien serait une maladie (Davies, 1997 ; Fitzpatrick, 2003).
L’expérience conflictuelle où l’on fait quelque chose que l’on sent en même temps ne pas vouloir faire, ou au contraire, où l’on ne fait pas quelque chose que l’on voudrait faire, est conceptualisée en philosophie sous le terme de « faiblesse de la volonté ». Cela signifie, selon le sens standard que l’on agit intentionnellement, en toute connaissance de cause – et non par ignorance – contre notre meilleur jugement sur ce qu’il convient de faire. Ce n’est pas seulement que nous reconnaissons qu’il s’agit là de la meilleure chose à faire – ne pas manger une deuxième part de gâteau au chocolat – mais que nous préférons satisfaire notre désir – manger cette part – sans dilemme intérieur et regret à venir, mais c’est que nous voulons profondément faire ce qui est le mieux pour nous et que, pourtant, nous n’y arrivons pas et faisons l’inverse. « Le meilleur parti, je le vois et je l’approuve mais je choisis le pire » selon les mots de Médée dans les Métamorphoses d’Ovide. Longtemps appréhendé comme un paradoxe parce qu’il paraît absurde de ne pas agir suivant notre bien à partir du moment où nous le connaissons, selon le précepte intellectualiste platonicien, le phénomène de la faiblesse de la volonté a connu de nombreuses tentatives de résolutions avec l’avènement des théories de l’action contemporaines, notamment à partir de Davidson (1970). En ce qui concerne notre sujet, ce phénomène a surtout été et est souvent encore un modèle fort pour appréhender les conduites addictives en ce qu’il permet de saisir cette dimension conflictuelle si importante dans l’addiction. Le philosophe Jon Elster, qui fait de la toxicomanie et des comportements excessifs comme le jeu pathologique des cas de faiblesse de la volonté, propose de résoudre le paradoxe grâce à une explication en termes de renversement des préférences : ce n’est pas que les individus agissent, au moment même où ils agissent, contre ce qu’ils veulent vraiment, contre ce qu’ils préfèrent, mais c’est qu’ils changent d’avis parfois quelques millisecondes avant le déclenchement de l’action. Ce renversement des préférences peut être dû, pour Elster, soit au phénomène d’escompte hyperbolique du futur soit au fait que des biens éloignés dans le temps pèsent moins que des biens proches dans le temps (Elster, 2007) soit à des déclencheurs ou stimuli perceptuels et cognitifs, soit à des motivations viscérales comme des désirs et des appétits. Plus généralement, dans la version standard de la faiblesse de la volonté, celle-ci est donc considérée comme étant trop faible pour suivre la raison parce qu’elle est assaillie par des désirs. Mais ce qui est fondamental est que cette faiblesse est imputée à l’individu qui aurait pu, en principe, résister à ses désirs, qui aurait dû s’habituer à ne pas y céder et donc à rester maître de lui-même et à suivre sa raison. Lorsque l’addiction est conçue comme une forme de faiblesse de la volonté, il y a certes peut-être un sentiment de perte de contrôle face à ses désirs addictifs, mais l’individu est tenu pour responsable d’avoir initié ou du moins de ne pas avoir renoncé à la satisfaction de plus en plus exigeante à ses désirs.
A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, on voit apparaître l’idée que cette perte de contrôle sur son comportement pourrait ne pas être la faute de l’individu : c’est l’idée qu’il existe des « buveurs involontaires », selon l’expression de Benjamin Rush, à qui l’on attribue généralement la naissance du concept de maladie addictive (Valleur, 2009). Notons cependant que subsiste chez Rush une concomitance certaine avec le champ moral. En effet, lorsqu’il dresse la liste des effets produits par les ligueurs spiritueuses et parle des effets « chroniques », il mentionne dans un même mouvement les « maladies » et les « vices » du corps et de l’esprit. De même, il écrit à la fois que l’usage immodéré de spiritueux est l’effet d’une « habitude d’intempérance » mais que, comme pour les autres maladies, cet « usage immodéré » possède des prédispositions comme le fait d’être atteint de certaines maladies desquelles on cherche à se soulager par l’usage de spiritueux ou d’être écrasé « par le poids de dettes, de déceptions dans leurs entreprises et de culpabilité » et de chercher à « noyer (leur) chagrin dans des boissons fortes ». Rush semble donc encore hésiter à considérer l’usage immodéré d’alcool comme un manque de maîtrise (intempérance) qui serait cause de maladies ultérieures ou comme le moyen de soulager une certaine souffrance, dans la veine de ce qu’on appellera l’automédication, qui fait de l’addiction une pathologie au moins secondaire. Toujours est-il qu’il est un des premiers à lier le phénomène addictif à l’idée de maladie et avec l’idée qu’il y a dedans quelque chose d’involontaire. Même si celle-ci n’est pas encore très nette chez Rush, il doit y avoir une frontière entre les conduites d’intoxication effectivement pathologiques et les autres, que Rush met en exergue en montrant que c’est justement la capacité de volonté, qui a été utilisée au départ par le buveur pour rechercher de l’alcool qui va disparaître, être « paralysée », suite à l’habituation progressive aux effets de l’alcool.
Cependant, si la perte de contrôle et l’aspect involontaire de la conduite addictive sont pressentis, ils ne sont pas scientifiquement prouvés, à tel point que le symptôme de perte de contrôle sera souvent critiqué par les auteurs sceptiques sur le sujet à l’instar de Davies qui, dans Le mythe de l’addiction, écrit que ce type de définition repose entièrement sur les récits des personnes addictes, qui cherchent par-là à se dédouaner de la responsabilité de leur comportement.
Le progrès des sciences du cerveau, à partir du milieu du XXème siècle, va considérablement changer la donne au sens où l’on va identifier la source de ce sentiment de perte de contrôle : c’est ce que l’on va appeler la compulsion. Il ne s’agit pas d’un terme neuf, puisqu’il est déjà utilisé notamment dans le champ de la psychanalyse, mais le terme va être investi des découvertes neurobiologiques pour prouver qu’il y a une perte réelle de contrôle du comportement dans l’addiction. Cependant, il faut être attentif à l’évolution de ce concept même depuis une soixantaine d’année, principalement au déplacement qu’il opère de la dépendance physiologique à la dépendance psychique. En effet, les premières explications neuroscientifiques de la compulsion définissaient celle-ci comme le résultat d’une neuro-adaptation suite à l’usage répété de substances toxiques : un nouvel équilibre se formant dans le cerveau, celui-ci était conçu comme ne pouvant plus « fonctionner » sans la substance auparavant ingérée et comme ayant même besoin de plus en plus de substance (tolérance). La compulsion était alors comprise par rapport à la volonté d’éviter de souffrir des symptômes de manque. Jellinek est un des premiers à entériner cette idée en faisant du manque la source du craving (le sentiment de besoin impérieux de la substance) et du craving l’explication du phénomène de rechute (The disease concept of Alcoholism, 1960). D’autres explications neuroscientifiques sont avancées dans la même optique : c’est la dépendance physiologique qui constituerait le coeur intrinsèque de l’addiction et pourrait rendre compte du sentiment de dépossession et de perte de contrôle de ses actes des individus.
Cette perspective est cependant fortement ébranlée lorsque l’on prend conscience que certaines conduites possèdent des similarités très fortes avec les addictions à ceci près qu’elles ne se caractérisent pas par l’ingestion d’une substance psychoactive. La prise en compte à l’intérieur du champ des addictions de ces « toxicomanies sans drogue (Fenichel, 1953) ou addictions comportementales semble donc rendre impossible une définition des addictions à partir du seul critère de dépendance physique. La recherche neuroscientifique va alors s’orienter vers les mécanismes de prise de décision et d’exécution des actions, entre autres, et mettre en évidence que ce qui est crucial dans les addictions, c’est l’aspect psychique de la dépendance, défini comme le besoin irrésistible et impérieux de reproduire un comportement c’est-à-dire de ne pas pouvoir différer l’effectuation de la conduite addictive. L’addiction est désormais principalement comprise comme une conduite compulsive c’est-à-dire par des désirs si puissants qu’ils orienteraient la prise de substance ou le comportement de manière nécessaire, à force d’envahir les capacités de l’individu à faire des choix rationnels, à planifier des actions en vue de récompense future etc. C’est l’idée développée à partir des années 1990 de l’addiction comme « maladie cérébrale chronique » (Leshner, 1997), qui donne à la notion de perte de contrôle un sens radical parce que celle-ci apparaît comme totale et incurable étant donné les lésions irrémédiables causées au cerveau (Ces points commencent cependant à être remis en cause en raison des résultats récents liés à la plasticité cérébrale et aux techniques de stimulation cérébrale et de neuromédiation cognitive).
En définitive, la recherche neuroscientifique a progressivement entériné une caractérisation de l’addiction centrée autour de la perte de contrôle de ses actes en donnant un sens nouveau aux désirs qui assaillent la volonté des personnes addictes, puisque ces désirs seraient désormais irrésistibles et pathologiques : l’individu ne peut pas ne pas les satisfaire et ne peut donc être tenu pour responsable de sa conduite addictive ; il est un patient, un « malade » qui doit être pris en charge et ne peut sortir de l’addiction – si tant est qu’une « sortie définitive » (Castel, 1992) soit possible – sans une aide extérieure.
2. Son absence dans les discours sociologiques : l’addict comme usager et la neutralité axiologique de la sociologie.
Or, dans le domaine de la prise en charge des addictions, un autre paradigme pour penser les addictions, ou plutôt pour penser les individus « addicts », apparaît dans les années 1990 en France avec les traitements de substitution : la réduction des risques. Elle œuvre pour une politique sanitaire des usages de drogues et prône une approche pragmatique de la prise en charge. Les défenseurs de la réduction des risques soutiennent que l’usager de drogue est un citoyen responsable et non pas un-e malade, capable de prendre en main sa santé et de décider des soins qui lui conviennent. Employer le terme d’usage des drogues plutôt que celui de toxicomanie relève d’une perspective de la consommation des substances psychoactives comme étant une pratique sociale normale (mais en utilisant le triptyque « usage, abus, dépendance », pour expliquer les cas « pathologiques »). C’est une conception que l’on peut retrouver dans la plupart des approches sociologiques et notre hypothèse ici est que la politique de la réduction des risques, au cœur de la prise en charge des addictions, n’est pas insensible aux théories sociologiques et notamment à l’idée de considérer le « toxicomane » comme un sujet social[1], mais aussi à l’idée que la société et ses valeurs d’individualisme et de performance peuvent être la cause de la « dérive » de certains individus dans une expérience totale[2] de la toxicomanie (un toxicomane « au bout de sa trajectoire » (Castel, 1998), qui serait complètement désocialisé). C’est qui est commun entre les deux sphères, celui de la politique de la réduction des risques et celui de la sociologie qui s’intéresse à la place des psychotropes dans les trajectoires et dans la société, c’est de sortir du « traitement moral » des consommateurs des produits psychotropes. En sociologie le champ d’étude des addictions n’existe pas en tant que tel, même si la question de la consommation des psychotropes est bien évidemment traité sous différents angles. Les travaux sociologiques permettent de comprendre en quoi et dans quelles mesures les drogues (au sens large) sont des construits sociaux et normatifs qui participent à régler les conduites humaines en société. Ainsi, la recherche en sciences sociales a largement contribué à pointer le rôle de la culture dans la compréhension des mécanismes d’apprentissage, de continuation, d’autorégulation et d’arrêt des usages dans des contextes et univers sociaux variés (Bergeron, 2010). Les chercheurs travaillant sur la question de l’usage des produits psychoactifs et autres comportements de “recherche de plaisir” sont le plus souvent confrontés à un moment donné à la question de la frontière entre usage contrôlé et dépendance. Pourtant la théorisation cette distinction est bien souvent absente (Weinberg, 2013).
En effet depuis les travaux de Robert Castel (1998) sur les sorties de la toxicomanie, la définition sociologique de ce qui est plus couramment nommée, aujourd’hui, addiction ou « dépendance » (mais aussi parfois toxicomanie), ne semble pas avoir été questionnée. Ces travaux ont le grand mérite d’avoir démontré qu’être toxicomane n’est pas une fatalité en ce sens que la plupart s’en sortent. Robert Castel, pour étudier les sorties, a limité son objet d’étude en nommant la population étudiée les « toxicomanes avérés ». Pour étudier les sorties de la toxicomanie de ces « toxicomanes avérés », Castel a choisi d’étudier la « frange, et cette frange seulement, des consommateurs de drogues ayant eu une consommation intensive qui a profondément perturbé leur existence sociale et personnelle pendant plusieurs années, et qui depuis au moins deux ans ont réorganisé autrement leur mode de vie » (Castel, 1998 : 30). L’addiction serait un désajustement entre la ligne biographique dominante (Ogien et Mignon, 1994), ici la consommation des drogues, et d’autres lignes biographiques (professionnelles, familiales, affectives, etc.).
D’autres études sur les consommateurs des produits, plus anciennes, nous viennent de la sociologie américaine et plus particulièrement du courant interactionniste. Le plus connu est certainement celui de Howard Becker sur les fumeurs de marijuana (1985), qui met en évidence que devenir fumeur est d’abord une carrière faite d’étapes (que l’on peut passer ou non), c’est-à-dire les suites d’événements et des situations qui font qu’une personne devient fumeur de marijuana et où les interactions avec des fumeurs plus expérimentés jouent un rôle primordial. Becker ne s’intéresse pas à la définition de la « toxicomanie avérée », ou, plus précisément, il élabore une théorie de la désignation (aussi nommée « théorie de l’étiquetage ») selon laquelle l’acte déviant dépend de la manière dont autrui réagit : s’il n’y a personne pour « pointer du doigt », il n’y a pas de déviance. La toxicomanie n’existerait ainsi pas sans que l’étiquette de déviant soit collée par des acteurs voulant faire valoir une certaine norme, ceux et celles qu’il nomme les « entrepreneurs de morale ».
Dans les deux approches citées, la notion de contrôle, et de perte de celui-ci, n’intervient pas. Comme il a déjà été remarqué par certains auteurs (Jauffret-Roustide, 2009 ; Weinberg 2013 ; Pharo, 2016) on se situera ici plutôt du côté d’une conception des acteurs rationnels capables de faire un choix en évaluant à chaque « étape » s’il a envie de consommer ou non, ce qui implique aussi qu’un consommateur qui s’aperçoit qu’il peut perdre le contrôle peut revenir à une étape antérieure, ou arrêter et recommencer plus tard. Cette dichotomie est un peu caricaturale en ce sens que ni Castel, ni Becker rendent compte de cette perspective de manière explicite et absolue et que dans les deux cas il y a d’autres éléments à prendre en considération : chez Castel on peut soulever l’idée que les gens sont/peuvent devenir dépendants, mais en précisant qu’il existe des « marges de jeu » dans presque toutes les situations où le « toxicomane » peut mobiliser ses « ressources sociales ». Pour Becker la dernière phase de la carrière de la déviance est l’intégration dans un groupe de fumeurs « émancipé » au niveau de la perception morale de la consommation qui facilite la continuation des pratiques déviantes, confère une légitimité et justification à celles-ci et donne au fumeur un sentiment d’appartenance. Les stratégies d’adaptation et d’action des individus ne sont donc pas entièrement rationnelles, mais médiatisées par une grille d’interprétation (Weinberg, 2013).
C’est en effet le terme de « usages/usagers de drogues » qui semble être aujourd’hui le plus souvent préféré par les sociologues à la place de celui de toxicomanie utilisé autrefois. Alors que le terme « usage » paraît neutre, car il se réfère à une pratique et sous-entend que l’on peut décrire et analyser celles-ci sans faire intervenir un jugement moral, parler des « drogues » suppose déjà une définition préalable : cette appellation ne relève-t-elle pas d’une distinction entre les usages « licites » et les usages « illicites » des substances dont le monopole de leur fabrication et de leur distribution reste un enjeu économique majeur ? François-Xavier Dudouet (2003) qui a étudié le processus d’interdiction des drogues, postule que les « drogues » n’existent pas juridiquement. Dans ce langage on parle de stupéfiants ou de substances psychotropes, dénominations qui découlent des conventions internationales[3]. Selon ce chercheur, ce ne sont justement pas les « drogues » qui sont interdites, mais ce sont certains usages qui sont illicites, comme il y a des usages licites des produits généralement considérés « illicites ». Il n’y a donc pas de définition juridique des « drogues », ni de définition médicale à cause de la variété de substances et de symptômes (ce que le nouveau champ de l’addictologie au sein de la discipline médicale corrobore). La distinction entre usages licites et illicites relève d’un arbitraire, qui a une histoire et une logique propres, lié à la monopolisation des médecins et des pharmaciens sur la production et la distribution des « drogues ». Les drogues ne sont donc pas interdites, mais leurs usages sont contrôlés comme l’indique Dudouet (2003). Le but des politiques des drogues n’a donc jamais été d’éradiquer la toxicomanie, les usages illicites sont simplement la conséquence de la régulation des usages licites.
Dans une perspective sociologique, « la » drogue se définit dès lors par ses usages, et peut ainsi être considérée comme un fait social normal au sens durkheimien du terme, c’est-à-dire un ensemble de représentations qui sont des marqueurs sociaux servant à définir des normes. Dès lors, il faudrait se poser la question du statut moral des drogues en déconstruisant la notion même de « drogues » : comment se construisent les « seuils » d’une consommation normale et d’une consommation abusive ? La notion de « perte de contrôle » n’intervient ainsi pas dans la plupart des théories sociologiques de la dépendance, car le consommateur est considéré comme un sujet qui a certes un mode de vie « déviant », mais qui n’en est pas moins inséré dans des relations sociales, professionnelles, familiales. Cela ne veut pas dire que le terme « contrôle » n’apparaît pas. En effet le « triptyque » élaboré par Castel et Coppel est souvent mobilisé pour comprendre comment les usagers des drogues régulent leurs consommations ou comment celles-ci sont régulées socialement : la justice et la médecine sont en concurrence-collaboration pour l’hétéro-contrôle de la toxicomanie, c’est-à-dire quand l’auto-contrôle et les contrôles sociétaux ne suffisent plus pour gérer la consommation (Castel et Coppel, 1991). L’hétéro-contrôle apparaît à partir du moment où l’usage des drogues devient un problème social, donc menaçant les valeurs collectives (Ehrenberg, 1995) et que la société ne peut plus se contenter de mobiliser des régulations traditionnelles pour encadrer la consommation des produits.
Il apparaît donc évident que les sociologues ne cherchent pas à déterminer si, et comment, les usagers perdraient le contrôle de leurs consommations (même s’ils s’efforcent de décrire et comprendre les parcours avec les drogues jusqu’à la dépendance), mais à comprendre les mécanismes sociaux du processus de l’addition, le sens que les usagers y accordent et interroger les catégories qui semblent « aller de soi » (addiction, dépendance, contrôle, etc.).
Au-delà de l’évidence de ce qui constitue l’objet de la sociologie et son regard sur les drogues, nous pouvons aussi supposer que la neutralité axiologique des sociologues peut expliquer pourquoi la question de la perte de contrôle n’est pas traitée en tant que telle : pour éviter de constituer un « hétéro-contrôle » qui déterminerait précisément le moment où un individu dépasserait la frontière de la consommation contrôlée. La tâche noble dans l’héritage sociologique, notamment bourdieusien, est bien de rendre le pouvoir aux dominés en dévoilant les mécanismes de domination méconnus, ce que l’on fait entre autre en démontrant la construction sociale de la frontière entre normal et pathologique. Cela implique de rendre compte, et de prendre en compte, le sens que les usagers prêtent à leurs pratiques et de les considérer capables de réflexivité et de posture critique à la fois envers leur propre « monde » et envers la « société ». Alors que le retour à une consommation contrôlée est une modalité comme une autre à la fois pour les sociologues et pour les intervenants dans la réduction des risques, il existe aussi des « regroupements d’usagers » qui se rassemblent justement parce qu’ils veulent en sortir complètement de l’addiction. Il s’agit des groupes d’entraide (principalement Vie Libre, Narcotiques Anonymes et Alcooliques Anonymes) dans lesquelles la solution prônée est celle de l’abstinence « totale et définitive », une idée sur laquelle nous reviendrons dans la partie suivante.
Comment alors rendre compte de la tension entre consommation contrôlée et dépendance quand des associations des personnes anciennement consommateurs devenues « malades » revendiquent, contrairement à l’association ASUD par exemple, que revenir à une consommation contrôlée est absolument impossible pour quelqu’un qui a été « pris » ? et comment alors intégrer le fait que certains membres de ces associations racontent qu’ils ont repris une consommation contrôlée, mais le gardent secret face au groupe ? C’est ce problème conceptuel et idéologique que nous traiterons dans la troisième et dernière partie.
3. Le redoublement de la tension : le phénomène du retour à une consommation contrôlée, un problème conceptuel et idéologique.
La reconnaissance du phénomène de retour à une consommation contrôlé nous semble pouvoir s’expliquer par deux éléments : l’observation d’un maturing out[4] de l’addiction et la réalisation de l’échec de l’abstinence comme seul but de traitement. D’une part, il semblerait qu’un changement radical de contexte permette de sortir de l’addiction sans suivre de traitement : le cas des vétérans de la guerre du Viet-Nam a ainsi mis en évidence le fait que, la consommation d’héroïne étant principalement due au contexte extrême de la guerre, le retour à la vie normale a suffi pour 95 % des anciens soldats à arrêter leur addiction (Schuster, 1971 ; Robins, 1975, 1993). De nombreux cliniciens, tel Marc Valleur, insistent sur le fait que le changement de contexte ne doit pas nécessairement être aussi dramatique : le passage d’une période de chômage à de nouvelles opportunités professionnelles, ou la perspective d’un changement familial (un mariage, l’arrivée d’un enfant) constituent également des moteurs puissants du maturing out. L’accent est mis sur les ressources propres de l’individu et sur le fait qu’il ne cesse pas forcément toute consommation, mais qu’il cesse de perdre le contrôle sur celle-ci. D’autre part, l’abstinence comme but de traitement des addictions est depuis les années 1990 reconnue comme un but de traitement souvent irréaliste, qui comporte le risque de décourager les patients à la moindre rechute, qui doit plutôt être envisagée comme faisant partie du cycle de la sortie. Cette critique du « dogme de l’abstinence » est corollaire de l’émergence du paradigme de Réduction des Risques, au sein duquel le rétablissement est compris comme un processus d’accompagnement des soignants vis-à-vis des personnes addictes, où ce sont elles qui déterminent l’objectif du traitement, en tout cas dans l’idéal. Ainsi le registre de soin est-il un « hybride » entre plusieurs champs idéologiques et interventionnels ; les pratiques professionnelles sont plurielles et doivent répondre parfois à des injonctions paradoxales. S’est ainsi imposée l’idée que la diminution de la consommation dans le but de revenir à un usage moins néfaste et que l’on peut contrôler pouvait constituer un objectif de traitement des addictions.
Avant d’être un phénomène dont il faut tenter de rendre compte à l’intérieur d’un discours au sujet de l’addiction, l’idée de retour à une consommation contrôlée pose un problème d’ordre conceptuel à propos de la définition de la nature de l’addiction. En effet, nous avons montré en quoi le concept de « perte de contrôle » était essentiel dans les définitions successives de l’addiction et en quels sens il avait été compris, avec à chaque fois la même idée, selon laquelle l’individu est appréhendé comme « malade » parce ce qu’il n’a plus la possibilité de ne pas agir dans le sens de la satisfaction de l’addiction. Comment l’addiction pourrait-elle encore être conçue comme une pathologie si, finalement, une reprise de contrôle sur son comportement est possible ? Si le retour à une consommation contrôlée est possible si certains addicts parviennent à s’arrêter à un moment donné et sans intervention extérieure, alors ne laisse-t-on pas le champ libre à l’idée que c’est « parce qu’ils le décident » et donc que l’addiction ne serait en fin de compte qu’une mauvaise habitude dont on pourrait, avec un peu de volonté, se débarrasser ? Pour Benn Piers (2007), cet argument n’est cependant valable que contre l’idée de l’addiction comme pathologie incurable : de même que l’on peut guérir de certaines maladies, la reprise de contrôle sur notre comportement marquerait la guérison ou le rétablissement de la maladie addictive. L’addiction pourrait bien être une maladie sans être une maladie incurable, ce qui rend possible, au moins conceptuellement, l’idée d’un retour à une consommation dont on ne perd plus le contrôle. C’est donc avec l’idée d’addiction comme pathologie incurable que le phénomène de retour à une consommation contrôlée est incompatible. Mais est-il vraiment possible de comprendre l’addiction comme une pathologie incurable ? N’y a-t-il pas derrière cette idée – comme derrière celle de l’impossibilité d’une consommation contrôlée – une revendication d’ordre idéologique, face au risque de relativiser le caractère pathologique de l’addiction, à partir du moment où celui-ci n’est pas radical et définitif ?
Or, le caractère définitif de la « maladie » de l’addiction est revendiqué par les groupes d’entraide les plus répandus en France dans le domaine des addictions (les groupes Anonymes et Vie Libre). La particularité de ces groupes est de prôner l’abstinence totale et définitive. En effet, les les membres ne s’y trouvent pas rassemblés par des propriétés sociales, professionnelles ou politiques, mais par une perception partagée des conséquences indésirables de la situation problématique avec le produit. Parmi ces conséquences indésirables, plusieurs sont récurrentes (ne plus pouvoir se passer du produit, perdre son travail, perdre ses amis, ruptures familiales, problèmes financiers, retrait du permis, etc.). Dans nos travaux (Pedersen, 2015) nous avons démontré que les groupes d’entraide organisent leur trouble sous la catégorie de maladie. La caractéristique principale retenue pour cette définition est le fait de ne pas pouvoir s’arrêter une fois qu’on a commencé : « Si vous êtes comme nous, vous savez bien qu’une fois c’est trop et mille fois jamais suffisant » (texte « comment ça marche » des Narcotiques Anonymes). L’abstinence à vie prend ainsi la forme de la seule véritable réponse au trouble et son efficacité permet de valider la définition du « trouble » comme maladie incurable et irréversible. Les groupes d’entraide tirent donc leur force et leur relative popularité (ils existent depuis fort longtemps et n’ont jamais changé leur « formule ») de ce remède, car la rechute est là pour valider à la fois la définition de maladie (on retombe dans le même fonctionnement si l’on recommence à consommer) et le remède (ne jamais recommencer). La difficile autonomisation d’un modèle de soin organisé par les pouvoirs publics, capable de proposer des solutions efficaces à tous les « addicts », explique en partie le relatif succès continu des associations d’entraide dans ce domaine depuis les années 1930. Les réunions hebdomadaires dont elles se font les promoteurs, sont l’objet non seulement d’un partage d’expériences par les récits des histoires de vie, mais participent en même temps à la constitution d’une mémoire collective de leurs parcours avec les produits qui les ont fait « chuter » jusqu’à « toucher le fond ». La référence à des principes de justification autour des « cas » et des « exemples » fait que les addicts en viennent à se reconnaître malades en se reflétant dans le miroir de l’altérité (Strauss, 1992).
Néanmoins, dans les groupes d’entraide, il y a aussi des membres qui consomment certains produits de temps en temps, mais à l’abri du regard du groupe. Ces personnes adhèrent à l’idée d’abstinence totale et définitive prônée dans ces groupes et au cadre qui leur est « imposé » par la régularité des réunions qui représentent des « piqûres de rappel » : « Ça permet de me recentrer un petit peu sur moi-même ». Pourtant, certains mettent en cause le principe du « tout abstinent », en ce sens que le fait de consommer certains produits qui peuvent être considérés comme psycho-actifs (café, cigarettes, traitements médicamenteux) ne doit pas forcément être interprété comme un excès ou une « intempérance ». Il y a une critique du fait de faire « passer le groupe avant les individualités », qui laisse la possibilité d’une conception plus individualisée de l’addiction dont le libertarianisme représente une forme extrême (chacun fait ce qu’il veut librement, même s’il veut s’autodétruire). Ces « addicts » consomment ainsi souvent seuls, ou en tout cas loin du regard des groupes d’entraide, ce qui leur laissent des marges d’autonomie et la liberté de consommer de temps en temps, mais permet aussi de « résister » aux mondes des produits (Fernandez, 2010). On pourrait interpréter cette critique comme une forme de résistance aux imputations morales de l’abstinence ou de l’arrêt des consommations à tout prix, même si cette résistance ne va pas jusqu’à clamer une éventuelle consommation contrôlée dans le cadre des réunions hebdomadaires. Ainsi le caractère incurable de l’addiction a acquis le statut de dogme que l’on ne peut pas remettre en cause si l’on ne veut pas courir le risque de remettre en question le statut pathologique de l’addiction et de retourner à une visée morale et stigmatisante. C’est en ce sens que Sylvie Fainzang rend compte de certains cas où la parole, au centre des groupes d’entraide, peut paradoxalement être prohibée par les personnes elles-mêmes, afin de ne pas remettre en cause la totalité du système. C’est ainsi le cas d’Etienne, qui s’est remis à boire un peu régulièrement mais « tout en vivant normalement » et qui n’en parle jamais pendant les séances :
« La parole interdite est en relation avec l’énoncé d’une pratique également condamné, en l’occurrence avec la consommation modérée d’alcool sans rechute (…). Tout se passe comme s’ils étaient soucieux de ne pas mettre en question un principe fondamental de la lutte anti-alcoolique menée par les associations d’anciens buveurs, alors même que le groupe ne se prive pas d’un libre-parler lorsqu’il s’agit d’une véritable rechute. Or ici, point de rechute. Cet ancien alcoolique fournit à ce titre un contre-exemple au modèle abstinent que diffuse Vie libre. Le cas d’Etienne est subversif puisqu’il infirme le postulat sur lequel se fonde l’action militante du mouvement. La gêne que l’on a à admettre qu’il continue de boire est à la mesure de la volonté de faire vivre l’équation : une seule goutte = rechute. Si le cas d’Etienne est tu, c’est qu’il met en cause cette équation et que la croyance dans sa validité totale (et pour tous) est nécessaire à la guérison de la plupart (…). Le cas de ce buveur est trop limite pour que l’on puisse librement en faire état, sans risquer de faire vaciller les bases de la volonté d’abstinence de nombreux alcooliques sevrés. Au contraire de la rechute, qui, elle ne remet pas en cause la doctrine mais la confirme plutôt, la consommation modérée d’alcool met en péril la théorie de la maladie et de la guérison développée par le mouvement »[5].
On voit ici que la revendication du caractère incurable de l’addiction est prioritaire sur la parole libre, pourtant principe de ce type de groupes d’entraide. La peur de faire effondrer le système entier de cette conception de l’addiction en remettant en cause un de ses présupposés est à l’origine d’une parole moins libre, ce qui constitue le premier effet néfaste de la revendication radicale de l’abstinence.
Entre les consommations ponctuelles, justifiées par une morale épicurienne, et la « recherche d’authenticité » il y a donc un tiraillement entre un choix esthétique de « jouir de la vie » et un choix éthique de se « choisir soi-même ». Si l’abstinence totale et définitive reste mot d’ordre dans ces associations, on peut supposer que c’est non seulement lié à l’enjeu de pérennisation de ces groupes comme alternative à la prise en charge médicale, donc d’ordre plutôt idéologique, mais aussi liée à l’enjeu de pérennisation du « soi » considéré plus « authentique » sans les produit. En effet, le « sens » que l’on décide de donner à sa vie peut être celui d’aider les autres malades à faire le même chemin que soi-même. Une fois basculée dans l’abstinence heureuse, la personne peut s’engager dans une carrière d’entraidant militant, où l’on participe à la « mise à nu » des autres malades. La rupture est donc ici catalyseur d’un « sens » presque inévitable de la suite de la trajectoire de certains entraidants qui consiste à donner de soi dans une démarche militante, trajectoire qui n’est pas forcément suivie par tous les malades abstinents. Autrement dit, l’acceptation d’une possible consommation contrôlée risquerait de briser la cohérence narrative à la fois de l’individu et du groupe.
Le possible retour à une consommation contrôlée semble ainsi constituer un problème à la fois conceptuel et idéologique. Conceptuel parce que la perte de contrôle constitue le cœur de la définition de l’addiction et que, même si on admet l’idée que le contrôle peut être « regagné » par les sujets, on accepte l’idée que le retour à une consommation contrôlée ne serait qu’une question de volonté individuelle. Idéologique parce qu’envisager un retour à une consommation « normale » ou contrôlée ébranlerait la définition de l’addiction élaborée par les groupes d’entraide notamment. Celle-ci est fondée sur leurs expériences de vie et les mises en récit de celles-ci, et c’est donc la légitimité de leur existence mais aussi de leur « expertise » qui est mise en cause, alors que c’est dans cette « expertise » que les membres s’investissent pour, aussi, donner un sens à leur nouvelle vie sans produits psychoactifs. Le phénomène d’un retour à une consommation contrôlée peut donc être observé empiriquement, mais il faut s’efforcer d’en déterminer les modalités conceptuelles et idéologiques pour en faire un objet d’étude scientifique.
Conclusion
En définitive, nous avons abordé ici certains aspects problématiques de ce qui transparaît comme la composante essentielle dans les définitions de l’addiction, à savoir la perte de contrôle. Alors qu’elle renvoyait à l’origine à une absence de maîtrise de soi sur ses désirs, dont l’individu était tenu pour responsable, la notion de perte de contrôle en est progressivement venue à désigner que l’individu ne pouvait faire autrement que d’agir dans le sens de la satisfaction de ses désirs. Ainsi, pour une grande majorité de personnes, la perte de contrôle dans l’addiction a pu dès lors être considérée comme un synonyme de compulsion, c’est-à-dire comme signifiant une perte de liberté totale de ses actes.
Cet article a vu le jour grâce à un premier point d’étonnement, pendant une discussion à un colloque sur l’automédication en mai 2016 entre deux chercheuses travaillant sur l’addiction, une dans le champ de la sociologie et une dans le champ de la philosophie : pourquoi, alors que la notion de perte de contrôle est au coeur des discours moraux et médicaux qu’analyse la philosophie, celle-ci n’apparaît pratiquement jamais dans les discours sociologiques ? Nous avons tenté ici d’apporter des éléments de réponse à cette question, notamment : la neutralité axiologique et l’idée que l’addict est en réalité compris comme un agent, un usager voire un consommateur, qui peut contrôler théoriquement sa consommation à chaque « étape », ce qui implique aussi de considérer que l’addiction est une expérience qui s’inscrit dans une temporalité longue. Ce « mouvement dynamique » semble ainsi plus être au coeur de l’enquête du sociologue que du philosophe. Il s’agit donc de se demander si le-la sociologue et le-la philosophe parlent de la même chose lorsqu’ils parlent de l’addiction : en effet, tandis que le sociologue semble plus s’intéresser au processus et aux conditions sociales de possibilité qui peuvent mener à l’addiction, le philosophe, qui s’intéresse à déterminer la nature des choses, tente surtout de délimiter le plus précisément possible ce que l’on doit entendre par addiction, afin de pouvoir dire ce qui est addiction, et ce qui ne l’est pas, et prévenir contre tout usage abusif du terme (dont la double conséquence serait une pathologisation à l’extrême ou un rejet de l’addiction hors du champ pathologique). Ainsi, pour le-la philosophe, l’addiction ne désigne au sens propre que l’aboutissement du processus, à savoir le moment précisément où l’individu a passé par les différentes étapes d’un usage (occasionnel, régulier voire nocif) – ces étapes-mêmes qui sont au coeur de l’étude de la/du sociologue. En d’autres termes, le-la sociologue cherche à savoir comment se construisent les catégories mais aussi à interroger les catégories qui vont de soi, tandis que le-la philosophe veut savoir si ces catégories existent ou non et quelle en sont les définitions.
Dans cette perspective, un phénomène comme celui du retour à une consommation contrôlée n’est pas de nature à vraiment étonner le sociologue qui voit l’addict comme un usager qui peut passer d’une étape à une autre sur le chemin de l’addiction, mais aussi faire en quelque sorte le chemin inverse (Becker, 1994). Seulement, transposé au niveau conceptuel de celui qui place au coeur de l’addiction une perte de contrôle totale, un tel phénomène a de quoi remettre en cause nos idées à propos du statut pathologique de l’addiction. Tandis que le phénomène de l’usage contrôlé d’une substance (ou le comportement contrôlé, quand il s’agit d’une addiction sans substance) peut être intégré à l’idée que l’addiction au sens pathologique (avec au coeur la perte de contrôle) serait finalement le terme d’un processus constitué de différents types d’usages, le phénomène de retour à une consommation contrôlé semble plus difficile à intégrer à l’idée d’une addiction pathologique, d’autant plus qu’un enjeu idéologique redouble le problème conceptuel. En effet, si l’on peut résoudre le problème conceptuel par l’idée que le retour à une consommation contrôlée met surtout en cause l’aspect incurable de l’addiction comme maladie, l’enjeu idéologique résiste et ce, à cause semble-t-il d’un climat de stigmatisation toujours très présent face aux personnes souffrant d’addiction. C’est bien par rapport à ce risque de stigmatisation que l’idée que l’on peut se rétablir de l’addiction – donc reprendre le contrôle sur sa consommation – est dangereuse : parce qu’elle fait avant tout signe vers l’idée qu’il est possible de se rétablir, qu’il incombe aux addicts de se rétablir et que, le cas échéant, c’est leur faute s’ils n’y parviennent pas. Face à ces idées, le dogme de l’addiction comme maladie incurable et l’idée de perte de contrôle incompressible semblent jouer un rôle de garde fou face au retour possible d’une stigmatisation face à l’addiction, d’autant plus que le stigmate négatif de l’addiction peut pour certaines personnes s’engageant dans une trajectoire militante d’entraidante être renversé en stigmate positif : ces « héros ordinaires » qui se « prennent en main » face aux produits diaboliques pour devenir « responsables de leur devenir ». Le paradoxe que nous avons fait émerger à partir d’un point d’étonnement serait donc principalement normatif, et non conceptuel.
Bibliographie :
Becker, H. S. (1985). Outsiders: études de sociologie de la déviance. Paris: Métailié.
Benn, Piers (2007). “Disease, Addiction and the Freedom to Resist.” Philosophical Papers 36, no. 3: 465–81.
Bergeron, H. (2010). Drogues illicites et toxicomanies. In D. Fassin & B. Hauray, Santé publique: l’état des savoirs (p. 173‑184). Paris: La Découverte.
Castel, R. (1998). Les sorties de la toxicomanie. Fribourg: Ed. universitaires.
Castel, R., & Coppel, A. (1991). Les contrôles de la toxicomanie. In A. Ehrenberg, Individus sous influence: drogues, alcools, médicaments psychotropes. Paris: Éd. Esprit : diff. Éd. du Seuil.
Dudouet, F.-X. (2003). De la régulation à la répression des drogues. Une politique publique internationale. Les cahiers de la sécurité intérieure, (52), 89‑112.
Davies, J. (1997). Myth of Addiction. Second Edition. 2 ed. Amsterdam: Routledge.
Ehrenberg, A. (1995). L’individu incertain. Paris: Calmann-Lévy.
Elster, J. (2007). Agir contre soi: la faiblesse de volonté. Paris: Odile Jacob.
Fainzang, S. (1998). Ethnologie des anciens alcooliques : La liberté ou la mort. 2e éd. Paris: Presses Universitaires de France.
Fernandez, F. (2010). Emprises: drogues, errance, prison. Bruxelles: Larcier.
Fitzpatrick, M. (2003). “Addiction Myths.” The Lancet 362, no. 9381: 412.
Fortané, N. (2010). La carrière des « addictions ». Genèses, n° 78(1), 5‑24.
Fortané, N. (2014). La carrière politique de la dopamine. Revue française de science politique, 64(1), 5-28.
Goodman, A. (1990). “Addiction: Definition and Implications.” British Journal of Addiction 85: 1403–8.
Jauffret-Roustide, M. (2009). Un regard sociologique sur les drogues : décrire la complexité des usages et rendre compte des contextes sociaux, La revue lacanienne 3/2009 (n° 5) , p. 109-118
URL : www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2009-3-page-109.htm.
Leshner, A. (1997). “Addiction Is a Brain Disease, and It Matters.” Science (New York, N.Y.) 278, no. 5335: 45–47.
Pedersen, L. (2015). Expertises et addictions. Trajectoires de déprise à l’épreuve des groupes d’entraide et des centres de soin en addictologie (CSAPA) (Thèse de doctorat inédite). Université de Franche-Comté.
Pharo, P. (2016). https://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/entretien-p-pharo-addiction-et-societe/
Ogien A. & Mignon P. (1994). La demande sociale de drogues. Paris : La documentation française.
Strauss, A. L. (1992). Miroirs et masques: une introduction à l’interactionnisme. Paris: Métailié.
Valleur, M. (2009). “La nature des addictions.” Psychotropes Vol. 15, no. 2 : 21–44.
Weinberg, D. (2013). Post-humanism, Addiction and the Loss of Self-Control: Reflections on the Missing Core in Addiction Science. International Journal of Drug Policy. 24(3): 173-181.
[1] Il est inséré dans des relations sociales, les drogues font partie d’un mode de vie et le consommateur participe à un monde, celui des « drogues », qui est certes particulier, mais qui a aussi ses codes, valeurs et normes.
[2] En analogie avec l’institution totale de Goffman (1968), c’est-à-dire un « mode de vie exclusivement organisé autour d’une seule finalité » (Castel, 1998 : 25).
[3] Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention sur les substances psychotropes de 1971, toutes les deux convoquées par l’ONU. Elles comportent 183 pays signataires.
[4] Nous gardons ici le terme anglais, aucune traduction française ne faisant actuellement consensus. Parmi celles-ci, on trouve les notions de « vieillissement naturel », de « rétablissement naturel » ou de rémission spontanée.
[5] Fainzang, Sylvie. Ethnologie des anciens alcooliques : La liberté ou la mort. 2e éd. Paris: Presses Universitaires de France, 1998.