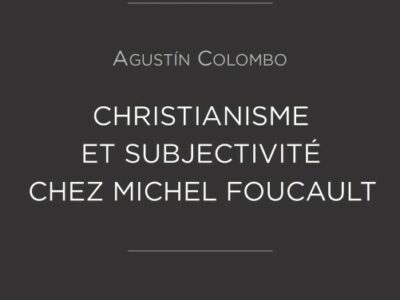Recension — Justice
Recension de l’ouvrage de Michael J. Sandel, Justice, (Traduction française de P. Savidan, Paris, Albin Michel, 2016), par Benoît Basse – professeur de philosophie en lycée à Paris. Il est l’auteur d’une thèse de doctorat intitulée « La question philosophique de la peine de mort » (Université de Paris–X-Nanterre).
Nul doute que la récente traduction française du livre de Michael J. Sandel, intitulée tout simplement Justice, participe d’un phénomène mondial sans précédent. Par son ampleur médiatique tout d’abord. On a peine à croire en effet qu’un cours de philosophie politique, professé à Harvard par un des plus éminents universitaires américains contemporains, ait pu faire l’objet de six millions de « vues » sur Internet, tandis que l’ouvrage émanant de ce cours s’est déjà vendu à plus de trois millions d’exemplaires. Patrick Savidan nous livre une traduction claire et irréprochable, même si nous ne pouvons que recommander, à titre de complément, de visualiser ce cours disponible en ligne[1], afin de prendre toute la mesure du talent pédagogique de Sandel, de sa simplicité, de son humour, et du caractère très interactif de ses leçons.
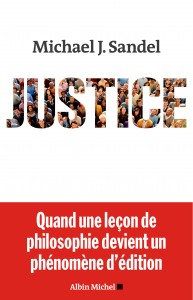 Certes, un tel succès paraîtra d’emblée suspect à tous ceux qui, sans toujours le dire, estiment qu’un ouvrage véritablement profond se doit de rester confidentiel. Tel n’est pas le point de vue de Sandel qui semble au contraire avoir adopté le mot d’ordre de Diderot : « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire[2] ! » En l’occurrence, s’agissant de la philosophie morale et politique, cela signifie donner au plus grand nombre un certain nombre de références et d’outils intellectuels permettant de se poser les bonnes questions et de construire, en chaque circonstance, des réponses argumentées à la question « Que faut-il faire ? ».
Certes, un tel succès paraîtra d’emblée suspect à tous ceux qui, sans toujours le dire, estiment qu’un ouvrage véritablement profond se doit de rester confidentiel. Tel n’est pas le point de vue de Sandel qui semble au contraire avoir adopté le mot d’ordre de Diderot : « Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire[2] ! » En l’occurrence, s’agissant de la philosophie morale et politique, cela signifie donner au plus grand nombre un certain nombre de références et d’outils intellectuels permettant de se poser les bonnes questions et de construire, en chaque circonstance, des réponses argumentées à la question « Que faut-il faire ? ».
Mais bien plus qu’un simple cours, cet ouvrage nous semble destiné in fine à conduire insensiblement le lecteur vers l’une des principales options philosophiques de Sandel, à savoir l’impossibilité selon lui de traiter des questions de justice indépendamment de celles portant sur la vie bonne, contrairement à ce qu’affirmait John Rawls[3]. Régler les questions portant sur ce qui est juste, tout en mettant entre parenthèses les diverses conceptions du bien, telle était en effet la signification de la thèse rawlsienne de la priorité du juste sur le bien. Acceptant le fait du pluralisme comme une donnée indépassable des sociétés démocratiques contemporaines, Rawls estimait indispensable que les citoyens s’accordent sur des principes de justice sans pour autant se fonder sur leur conception particulière du bien, sous peine de manquer de respect aux personnes et à leur liberté de déterminer pour elles-mêmes ce qu’est une vie bonne. Or Sandel, on le sait, juge vaine cette exigence rawlsienne. C’est pourquoi, renouant avec une tradition plus aristotélicienne que kantienne, il s’efforce à nouveau ici de montrer que l’on ne saurait répondre à la question de la juste distribution de X sans se demander au préalable quelle est la fin (le telos) de X. En d’autres termes, « la manière juste de répartir l’accès à un bien pourrait être relative à la nature de ce bien, à sa finalité[4]. »
L’enjeu est donc bien la viabilité du projet libéral lui-même et son présupposé selon lequel la loi se doit de rester parfaitement neutre vis-à-vis des diverses conceptions du bien auxquelles adhèrent les individus d’une société pluraliste. Est-ce seulement possible ? Sandel reprend à son compte un problème que d’aucuns pouvaient croire définitivement tranché : « Une société juste a-t-elle pour tâche de promouvoir la vertu des citoyens ? Ou bien la loi qu’elle se donne se doit-elle de rester neutre et ne pas trancher entre les conceptions concurrentes de la vertu, de sorte que les citoyens puissent, pour eux-mêmes, choisir librement la façon de vivre qui leur semble la meilleure[5] ? » Reste à savoir si l’on peut, comme le pense Sandel, défendre la première option sans remettre gravement en cause l’exigence de liberté individuelle constitutive des sociétés démocratiques.
Une conception vivante de la philosophie et de l’enseignement
Rappelons que cet ouvrage est issu d’un cours professé à Harvard, dont l’objectif était de familiariser les étudiants avec un certain nombre d’auteurs de la philosophie morale et politique, parmi lesquels Aristote, Kant, Bentham, Stuart Mill et Rawls. Une grande partie de l’ouvrage consiste donc à présenter, sans technicité inutile, l’essentiel de la pensée de ces philosophes. À cet égard, Sandel nous livre une des meilleures introductions aux grands courants qui structurent ce domaine : l’utilitarisme, l’éthique déontologique kantienne, le libertarisme de Nozick et la théorie de la justice comme équité de Rawls se voient en effet expliqués avec un talent pédagogique indéniable. Il est vrai que ces diverses présentations pourront sembler relativement sommaires à des lecteurs plus avertis. Pourtant, reconnaissons que ce cours est extrêmement stimulant, notamment en raison du recours à plusieurs dizaines d’exemples tirés de la vie quotidienne et d’expériences de pensée. Car telle semble bien être une des ambitions majeures de Sandel : montrer que la philosophie donne aux citoyens les moyens de penser des situations réelles et de se poser les bonnes questions relatives à la justice. Ce faisant, il s’agit bien pour lui de contribuer à la formation intellectuelle d’authentiques citoyens, suffisamment instruits pour débattre et se prononcer en connaissance de cause sur des questions impliquant des choix collectifs.
Une des raisons du succès de Sandel réside selon nous dans son effort pour mettre en lumière les implications pratiques des différentes théories de la justice. Loin de s’en tenir au niveau d’abstraction généralement requis dans les universités françaises, le philosophe américain n’hésite pas à mettre à l’épreuve chaque théorie à l’aune de ses conséquences sur des sujets actuels controversés tels que le suicide assisté, le service militaire, le mariage pour les personnes de même sexe, la vente d’organes ou encore la gestation pour autrui. Ainsi, l’éthique appliquée tient-elle lieu en grande partie de « test » pour les théories normatives : sommes-nous prêts à assumer toutes leurs conséquences ? Comme souvent chez les penseurs anglo-saxons, il ne s’agit pas tant d’entretenir un quelconque culte de l’histoire de la philosophie pour elle-même, que de puiser en elle des ressources afin de penser les problèmes contemporains.
Par ailleurs, la probité du Professeur Sandel réside encore dans sa volonté de restituer les pensées qu’il aborde en commençant toujours par les présenter sous leur meilleur jour, sans parti pris. La persistance d’un courant de pensée est le signe qu’il répond au moins partiellement à une exigence partagée, ce qui nous oblige à le considérer avec respect et à reconnaître ses points forts, quand bien même nous serions amenés ultérieurement à lui préférer une autre approche. Dans la conclusion de son cours oral, Sandel prenait d’ailleurs soin de préciser devant ses étudiants qu’il n’existe pas selon lui, en philosophie morale, d’arguments absolument probants (« knocked-down arguments ») ayant valeur de démonstrations, mais de simples « considérations » auxquelles nous accordons plus ou moins de poids.
Utilitarisme versus éthique déontologique
L’ouvrage repose d’abord sur la division courante entre utilitarisme et éthique déontologique. En bon professeur, Sandel expose les caractéristiques propres à chacune de ces éthiques, puis prend en compte les objections qui leur sont classiquement adressées. Sans surprise, l’utilitarisme se voit soumis à deux critiques principales. Premièrement, dans quelle mesure est-il compatible avec la reconnaissance de droits individuels fondamentaux ? En effet, la maximisation du bonheur du plus grand nombre n’autorise-t-elle pas de sacrifier les intérêts des minorités ? Deuxièmement, l’utilitarisme n’a-t-il pas le tort d’introduire une valeur étalon commune (« l’utilité ») à tous les types de biens, en dépit de leur profonde hétérogénéité ? On pourrait avoir le sentiment, à première vue, que Sandel ne prend pas suffisamment le temps d’évoquer les réponses qui, depuis Bentham, ont été proposées par d’autres utilitaristes à ces objections. Mais à cet égard, les pages qu’il consacre à John Stuart Mill sont tout à fait passionnantes. Sandel montre de façon convaincante qu’en s’efforçant de contrer ces critiques adressées à Bentham et à son père James Mill, John Stuart Mill fut finalement amené à soutenir des thèses qui, en dernier ressort, ne se fondent pas sur le seul principe d’utilité, contrairement à ce que ce dernier avait pu soutenir[6]. Ce n’est d’ailleurs pas le moindre intérêt de ces pages que de nous restituer les divers aspects de la pensée de Stuart Mill que l’on réduit trop souvent, en France notamment, à la seule défense du « principe de non-nuisance », voire à une « éthique minimale »[7]. Sandel estime à juste titre qu’en mobilisant des notions telles que la « vie digne » et le « sens de la dignité », ainsi qu’en distinguant des plaisirs supérieurs et inférieurs, Mill a certes voulu prémunir l’utilitarisme contre ses critiques, mais il n’y est parvenu « qu’en invoquant un idéal moral de dignité et de personnalité humaines qui ne dépend pas lui-même de l’utilité[8]. » Si bien qu’il est permis de se demander, à partir des remarques de Sandel, si Stuart Mill ne serait pas plus proche, sur certains points, de Kant que de Bentham.
S’agissant des pages consacrées à la morale déontologique, le lecteur trouvera d’abord un exposé scolaire mais irréprochable des thèses de Kant sur le principe suprême de la moralité, la liberté comme autonomie, ou encore la célèbre distinction entre le prix (des choses) et la dignité (des personnes). Sans doute le lecteur averti trouvera-t-il davantage d’intérêt dans la manière pour le moins originale dont Sandel propose de défendre la position controversée de Kant en matière de mensonge. Son interprétation mérite véritablement d’être prise en compte, car elle permet de congédier les poncifs sur le « rigorisme », voire la « cruauté » de la morale kantienne, et de montrer que celle-ci se révèle bien plus capable qu’on ne le pense d’ordinaire de s’adapter aux circonstances particulières de l’action. Sandel nous demande à cette occasion s’il est moralement pertinent d’opérer une distinction entre un mensonge (a lie) d’une part et une « affirmation trompeuse » (a misleading statement) d’autre part. Pensons à ce cas célèbre imaginé par Kant : que faire face à un homme qui me demande si je cache la personne qu’il désire assassiner ? Plutôt que de lui mentir directement, je peux lui indiquer que j’ai aperçu cet homme il y a deux heures au marché du village. Cette seconde affirmation est objectivement vraie, même si je compte sur le fait qu’elle trompe l’assaillant (peut-être se détournera-t-il de ma maison et se rendra-t-il au marché). Or, du point de vue d’une morale de l’intention comme celle de Kant, le pur mensonge (« Il n’est pas chez moi ») et l’affirmation trompeuse (« Je l’ai vu au marché il y a deux heures ») ne reviennent pas tout à fait au même. Certes, dans les deux cas, l’intention est bien de tromper. Cependant, il est possible de soutenir, estime Sandel, qu’ « une esquive savamment conçue rend hommage au devoir de véridicité d’une manière qui est tout à fait étrangère au mensonge direct[9]. » Car une forme de respect pour la loi morale se trouve ainsi préservée. Qui plus est, comme le rapporte Sandel, il semblerait que Kant ait lui-même eu recours à cette distinction morale lors d’un épisode de sa vie que nous nous abstiendrons de dévoiler ici[10].
La question des inégalités socio-économiques
S’agissant du débat sur la justice sociale (comment répartir les ressources ?), force est de reconnaître la grande probité intellectuelle de Sandel. Bien qu’il doive sa renommée dans le milieu académique à sa critique de John Rawls[11], Sandel ne manque pas de présenter les thèses de son collègue avec clarté et rigueur, ainsi que les possibles réponses de Rawls aux objections qui lui furent adressées. Du reste, la critique adressée à son collègue de Harvard n’avait pas tant porté sur les deux célèbres principes de la Théorie de la justice que sur la conception que Rawls se faisait du sujet ou du « moi ». Il n’est donc pas difficile de pressentir sa plus grande proximité à l’égard de Rawls que de Nozick s’agissant de la question de savoir si un État juste doit assumer une politique de justice sociale (redistributive). Sandel rappelle d’ailleurs que Rawls a en réalité fourni non pas une seule, mais bien deux justifications de son fameux principe de différence, selon lequel les inégalités de revenus et d’opportunités ne sont acceptables qu’à condition de bénéficier d’une manière ou d’une autre aux moins bien lotis de la société. La première justification consiste, on le sait, à prétendre que ce second principe serait lui aussi choisi par des individus dans la position originelle, c’est-à-dire placés derrière un voile d’ignorance les empêchant de savoir à l’avance quelle sera leur position – plus ou moins avantageuse – dans la société, et quels seront leurs atouts, s’ils en ont, notamment en termes de talents naturels et de capital culturel, économique ou relationnel. Mais Sandel insiste à juste titre sur une seconde justification, sans doute moins connue, proposée par Rawls dans la section 17 de son ouvrage. Celle-ci consiste à poser d’emblée qu’une juste distribution ne devrait pas être fondée sur des facteurs purement arbitraires d’un point de vue moral. En d’autres termes, une juste distribution ne doit pas se contenter de refléter des différences individuelles qui ne sont dues qu’à la chance et au hasard de la naissance.
C’est pourquoi, il faut y insister, non seulement ce critère disqualifie d’emblée un régime de type aristocratique, mais également le libertarisme de Milton Friedman ou Robert Nozick, ainsi que la méritocratie elle-même. Il est en effet insuffisant, aux yeux de Rawls, de compenser les inégalités socio-économiques affectant les individus. Car quand bien même l’origine sociale ne déterminerait plus les perspectives de chacun, la distribution des aptitudes naturelles n’en demeurerait pas moins arbitraire. D’où l’idée, clairement assumée par Rawls, qu’une théorie de la justice ne doit aucunement se donner pour objectif de récompenser le mérite ou les efforts produits par chacun. Ce serait en effet oublier que la capacité d’un individu à mettre en œuvre tel ou tel talent est elle-même largement déterminée par des facteurs arbitraires que l’on ne saurait mettre à son crédit. Pourtant, on le sait, la méritocratie continue d’avoir les faveurs d’un large public, en raison de l’illusion tenace selon laquelle il nous serait possible d’évaluer objectivement le mérite des uns et des autres. Mais Sandel nous rappelle à juste titre que la théorie de la justice de Rawls avait précisément proposé d’écarter un tel critère[12]. Il s’agit en revanche de faire en sorte que cette répartition naturelle des talents – en elle-même ni juste ni injuste – puisse être utile à tous et en priorité aux plus mal lotis.
Quant aux lecteurs de Rawls qui se demandent à bon droit si le principe de différence rawlsien n’autorise pas malgré tout des inégalités de richesses abyssales, on ne peut que recommander à leur attention un autre argument en faveur d’une limitation de ces inégalités, sans doute plus décisif aux yeux de Sandel : au-delà d’un certain niveau de richesse, les plus aisés n’éprouvent plus nécessairement le besoin de financer des institutions publiques destinées au plus grand nombre. De sorte que de trop fortes inégalités tendent à éroder le sens civique des plus riches et à effacer tout sentiment de solidarité à l’égard de leurs concitoyens. C’est donc l’idée même d’une communauté d’intérêts qui se trouve alors en péril.
Peut-on raisonner sur le juste indépendamment du bien ?
Mais venons-en à présent à la thèse principale de Sandel, suggérée à plusieurs reprises au cours du livre, avant d’être argumentée pour elle-même dans les deux derniers chapitres : l’impossibilité de trancher les questions de justice sans engager une réflexion sur le bien. On se souvient que le libéralisme politique entendait rester à distance des controverses morales et religieuses sur le bien et la vertu, estimant qu’il existait dans les sociétés démocratiques un pluralisme que l’État se devait tout simplement de respecter en s’imposant une attitude de neutralité vis-à-vis des diverses conceptions de la vie bonne auxquelles les citoyens sont libres d’adhérer. Mais cette neutralité est-elle tenable ? Sandel mobilise ici trois débats illustrant cette impossibilité : l’avortement, l’utilisation des cellules souches et le droit au mariage pour les personnes de même sexe. S’agissant de l’avortement, on voit mal en effet comment un État pourrait rester absolument neutre. Car de deux choses l’une : ou bien cet acte est interdit par la loi car il constitue à proprement parler un meurtre (comme le pensent ceux qui considèrent le fœtus comme une personne à part entière), ou bien il est toléré et légalisé, ce qui à l’évidence revient à prendre parti sur le plan moral et à juger que l’avortement n’est pas assimilable à un meurtre. En effet, comment ne pas voir que la légalisation d’une action, que nous le voulions ou non, comporte implicitement un jugement moral au moins de type négatif ? Ainsi, du point de vue de Sandel, dès lors que le législateur autorise une action, c’est qu’il ne l’estime pas radicalement contraire au bien et à la vertu, et non pas parce qu’il resterait indifférent à son statut moral. Légaliser l’avortement revient de fait à considérer que le fœtus n’est pas encore à proprement parler une personne jouissant du droit à la vie. Et il serait vain d’exiger d’une personne qui, pour des raisons religieuses par exemple, soutiendrait le contraire, qu’elle parvienne à raisonner sur le juste en mettant entre parenthèses sa propre conception du bien.
De même à propos du droit au mariage pour les personnes de même sexe, est-il inévitable, explique Sandel, de se poser la question de la finalité du mariage et d’y apporter une réponse. Il est là aussi illusoire d’espérer trancher ce débat contemporain sans prendre parti sur la valeur propre à cette institution. S’inscrivant dans une perspective aristotélicienne, Sandel insiste sur la nécessité de déterminer le telos des choses afin de savoir comment les distribuer de façon juste. Tant que l’on répond, par exemple, que le mariage a pour finalité la procréation, il est évident qu’il ne peut pas unir deux personnes de sexe identique. L’originalité de Sandel sur ce sujet comme sur bien d’autres réside dans sa volonté de s’opposer au conservatisme moral non pas en invoquant l’autonomie et la liberté de choix des individus (comme le font les libéraux), mais en continuant d’occuper le terrain de la finalité et de la vie bonne. Autrement dit, demandons-nous pourquoi le mariage continue d’être valorisé :
« Le débat concernant le mariage gay ne pose pas le problème de la liberté de choix mais celui de savoir si des unions entre partenaires de même sexe sont dignes d’être honorées et reconnues par la communauté – si elles accomplissent les fins de l’institution sociale du mariage. Dans les termes d’Aristote, l’enjeu est la juste répartition des charges et des honneurs. C’est une question de reconnaissance sociale[13]… »
De fait, on voit mal comment un catholique fervent, faisant sienne la position officielle de l’Église, ne ressentirait pas la loi autorisant le mariage homosexuel comme une négation de sa conception de la vie bonne. Car une telle légalisation revient en vérité à faire un pas hors du cercle de la neutralité libérale et à proposer une redéfinition jugée plus adéquate des finalités du mariage. On dira par exemple, en suivant le juge américain Marshall, que « le mariage civil est à la fois un engagement profondément personnel à l’endroit d’un autre être humain et une célébration hautement publique des idéaux de mutualité, de compagnonnage, d’intimité, de fidélité et de famille[14]. » Sur la base d’une telle redéfinition, mentionnant simplement un « engagement » à l’égard d’un « autre être humain », rien ne nous autorise alors à refuser aux couples homosexuels le droit au mariage. C’est pourquoi il paraît fort difficile de ne pas suivre Sandel sur ce point : sur toute une série de débats engageant les convictions morales les plus profondes des individus, il est illusoire de croire que l’État puisse rester absolument neutre.
Cependant, remarquons bien que cette manière de justifier un droit (comme celui de se marier) ne repose plus ici sur l’exigence libérale de respecter les individus et leur autonomie, mais bien plutôt sur la reconnaissance d’une valeur intrinsèque à telle ou telle pratique. En d’autres termes, c’est d’abord parce que l’on serait parvenu à montrer que le mariage est un acte intrinsèquement bon et vertueux – en tant qu’il favorise un engagement mutuel – qu’il faudrait en dériver un droit au mariage. Mais c’est précisément à ce stade que l’argumentation téléologique de Sandel pourra heurter ceux d’entre nous qui estiment que cette perspective nous fait accomplir un pas de trop hors du libéralisme politique. Car dans ce cas précis, le fait de reconnaître une valeur intrinsèque au mariage (y compris pour les couples homosexuels) ne revient-il pas à dévaloriser le mode de vie célibataire ? Bien plus, si le mariage est bon par nature, n’avons-nous pas alors l’obligation morale de nous marier ? Or, le célibat ne permet-il jamais d’avoir une vie bonne ? L’État ne devrait-il pas tout simplement s’abstenir de porter un tel jugement de valeur et reconnaître à chacun le droit de valoriser ou non la vie maritale ? Le moins que l’on puisse dire est qu’il est problématique de justifier un droit par la valeur soi-disant intrinsèque d’une pratique et de sa finalité.
Quoi qu’il en soit, si ce constat est juste, reste alors à savoir quelle est pour Sandel la façon la plus légitime de trancher ces questions ayant trait à la vie bonne. L’auteur saisit alors l’occasion de prendre ses distances vis-à-vis de ceux que l’on a pris l’habitude d’appeler les « communautariens ». Car une fois reconnue l’impossibilité de raisonner sur le juste indépendamment du bien, il existe non pas une mais deux façons de lier le premier au second. Certains, comme Alasdair MacIntyre ou Michael Walzer, sont tentés de définir le bien par un ensemble de convictions partagées, inscrites dans une culture et une tradition données. Mais cette approche ne semble pas satisfaire Sandel, qui lui reproche son relativisme. Du reste, sans doute vaudrait-il mieux éviter de le ranger parmi les philosophes politiques communautariens si cela implique une dépendance radicale des valeurs à l’égard des habitudes d’une communauté particulière. Sandel ne cesse au contraire d’en appeler au débat civique et semble faire confiance à la discussion publique pour rapprocher les points de vue : « plutôt que d’ignorer les convictions morales et religieuses que nos concitoyens font pénétrer au cœur de la vie publique, nous devrions nous en préoccuper plus directement – parfois en les mettant en cause et en les contestant, d’autres fois en les écoutant et en apprenant d’elles[15]. » Cependant, il est difficile de se départir du sentiment que Sandel surestime les vertus de la discussion publique en matière morale et religieuse. Que faire, en effet, dans tous les cas où le débat ne sert qu’à mettre en évidence les profonds désaccords pouvant subsister au sujet de la vie bonne ? Sandel estime pour sa part qu’il « ne faut pas exclure que le fait de mieux connaître une doctrine morale ou religieuse puisse nous conduire à l’apprécier moins[16]. » Le philosophe semble ainsi attribuer à la critique et à la discussion publique le pouvoir, à terme, de marginaliser les positions les moins raisonnables et de neutraliser par conséquent leur influence sur les lois. Mais cet espoir est-il bien fondé ? Quelle garantie avons-nous à cet égard ? Telle est la difficulté pour qui entend prendre acte du caractère indissociable du juste et du bien. Comment gérer les inévitables désaccords dès lors que, tournant le dos à la neutralité libérale, nous ferions entrer dans la discussion publique les différentes conceptions de la vie bonne ?
Concluons que cet ouvrage du Professeur Sandel constitue d’abord une excellente introduction à la philosophie morale et politique, en raison de ses qualités pédagogiques indéniables, se traduisant notamment par le recours constant à des exemples extrêmement stimulants. Par ailleurs, comme nous l’avons vu, certaines thèses personnelles du philosophe s’y trouvent mentionnées, mais sans jamais atteindre un niveau d’argumentation comparable à celui qui fut déployé dans son ouvrage majeur Le libéralisme et les limites de la justice, ou même dans sa dernière publication intitulée Ce que l’argent ne saurait acheter[17]. Cependant, il serait injuste d’y voir un défaut puisque l’auteur, fidèle à son souhait de voir la philosophie enrichir le débat public, a manifestement voulu mettre à la portée du plus grand nombre quelques-unes des grandes conceptions de la justice.
[1] Le cours de Michael Sandel, intitulé « Justice. What’s the right thing to do ? » comporte 12 épisodes et est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=kBdfcR-8hEY.
[2] Denis Diderot, De l’interprétation de la nature [1753], § XL, Paris, éd. Garnier, 1990, p. 216.
[3] John Rawls, Libéralisme politique [1993], trad. fr. Catherine Audard, Paris, PUF, 1995.
[4] Michael Sandel, Justice, trad. fr. Patrick Savidan, Paris, Albin Michel, 2016, p. 267.
[5] Ibid., p. 18.
[6] John Stuart Mill écrit en effet : « Je considère l’utilité comme le critère absolu dans toutes les questions éthiques » (De la liberté, chap. 1, trad. Laurence Lenglet, Paris, Gallimard, « folio essais », p. 76).
[7] Pour une critique des lectures réductrices de John Stuart Mill, voir Nathalie Maillard, Faut-il être minimaliste en éthique ? Le libéralisme, la morale et le rapport à soi, Genève, Labor et Fides, 2015, p. 46-60.
[8] Michael Sandel, Justice, op. cit., p. 85-86.
[9] Ibid., p. 202.
[10] Ibid., p. 198-199.
[11] Michael Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice [1982], trad. fr. Jean-Fabien Spitz, Paris, Seuil, 1999.
[12] Rawls écrit de façon on ne peut plus explicite : « L’idée de récompenser le mérite n’est pas réalisable. » (Théorie de la justice, § 48, trad. fr. Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987, p. 350).
[13] Michael Sandel, Justice, op. cit., p. 379.
[14] Cité par Michael Sandel, in justice, op. cit., p. 380.
[15] Ibid., p. 399.
[16] Ibid.
[17] Michael Sandel, Ce que l’argent ne saurait acheter, trad. fr. Christian Cler, Paris, Seuil, 2014.