Paganisme et anthropologie à propos de l’hypothèse de R. Girard
Dan Arbib, École Normale Supérieure, « Mathesis », La République des savoirs, USR 3608.
Il[1] y a quelque péril à examiner l’œuvre de R. Girard d’un point de vue autre que le sien : l’œuvre fonctionne bien, très bien ; trop bien ? Peut-être, mais par quel mystérieux paradoxe reprocherait-on à une théorie d’être trop efficace ? Pourtant, l’anthropologie girardienne gagnerait à être analysée du point de vue du judaïsme, même si l’entreprise paraît d’avance périlleuse – et pour deux raisons : (a) La première raison est disciplinaire : on ne voit pas qu’une anthropologie puisse être examinée du point de vue d’une religion ou qu’une religion puisse se prononcer sur le contenu d’une théorie scientifique (et la théorie girardienne se veut scientifique, au moins autant que la psychanalyse). Une théorie anthropologique décrit des faits et des processus humains (l’hominisation chez Girard), une religion prescrit un certain rapport au divin. Entre la description et la prescription, nulle passerelle n’autorise les va-et-vient d’une démarche mixte. (b) La deuxième raison tient au bougé d’un deux pôles. Si l’on veut jeter un regard sur la théorie girardienne à partir d’un autre point qu’elle-même, ce point lui-même doit demeurer fixe et garantir une relative immobilité de la lunette. Or il n’en est rien : le judaïsme n’a aucune fixité propre, puisque au corpus de l’Ancien Testament (Torah écrite), il faut ajouter le Talmud (Torah orale) et le très grand nombre de commentaires sur le Talmud ou la Bible, qui n’ont cessé de se collecter et même de s’inventer depuis le début de l’ère chrétienne. Un tel foisonnement empêche toute position confiante en un judaïsme, fixé par des Conciles ou des décisions dogmatiques centralisées. De là à éclater le concept de judaïsme pour n’admettre que des juifs aux thèses, aux existences et aux positions religieuses forcément diverses, il y a un pas qu’on doit se garder de franchir sous peine de voir le juif lui-même disparaître, pulvérisé par la violente lumière du nominalisme. Mais ce rappel doit néanmoins appeler à la prudence, et nous assigner à l’inconfort d’une position qui refuse à la fois toute fixité monolithique au judaïsme et tout relativisme idiosyncrasique du juif. Notre site est quelque part entre la dureté rocailleuse de l’essentialisme et l’effritement sablonneux du relativisme. La théorie de R. Girard n’est pas ici face à une autre théorie ou à un corpus dogmatique, mais face à une pluralité dont l’unité demeure précaire, même si toujours intuitivement sentie et vécue.
Ces deux difficultés levées, ou plutôt seulement soulevées, on admettra la possibilité d’examiner le corpus girardien à la lumière du judaïsme, pour deux raisons aussi fortes. (a) La première, que Girard manipule des thèses, des concepts et des textes issus du patrimoine juif : la Bible, le sacrifice, etc. Il est difficile qu’une telle mobilisation de motifs juifs se soustraie à la mise en question de sa pertinence. (b) Il y a plus fondamental : Girard a assumé de plus en plus nettement la dimension chrétienne de son propre travail. Or, s’il n’est pas évident de comparer une anthropologie à une religion, encore faut-il que l’anthropologie elle-même s’épargne une auto-interprétation de nature religieuse ; et c’est là que le bât blesse : l’auto-interprétation de la théorie girardienne par elle-même tend à la poser en pensée chrétienne. Ce tournant chrétien n’est ni surérogatoire ni facultatif : s’il veut donner à voir le phénomène victimaire, R. Girard ne peut parler que depuis le christianisme. C’est une anthropologie chrétienne, non point d’abord en ce qu’elle validerait les déterminations chrétiennes de l’homme, mais parce qu’elle s’inscrit dans le mouvement de la révélation chrétienne – et plutôt encore : parce que la Révélation est le site d’où elle parle, le seul qui la rende possible : et on ne choisit pas ce site, puisque la Révélation ayant eu lieu, on ne plus faire comme si elle n’avait pas eu lieu, comme si l’on était encore dupe du bouc émissaire. L’anthropologie girardienne est donc chrétienne en son fond, de par la condition qui la rend possible – la révélation chrétienne. De cette auto-interprétation doivent s’ensuivre deux corollaires : soit que la scientificité de l’hypothèse garantisse et rejaillisse sur le christianisme lui-même, au point d’ériger le christianisme en théorie scientifique ; soit que le christianisme présupposé par l’hypothèse n’en fragilise la scientificité au point de satisfaire irrémédiablement au concept d’idéologie. Dans le premier cas, la religion se renforce de la théorie, dans le second la théorie se soumet à la religion. Cette alternative elle-même présuppose encore que la pensée dite chrétienne de R. Girard soit de facto et de jure parfaitement chrétienne et ne suscite pas chez les chrétiens eux-mêmes maintes réserves de nature à en hypothéquer la valeur théologique ; car alors, la théorie girardienne, en sacrifiant la scientificité à une auto-interprétation religieuse finalement invalidée par ceux-là mêmes qui devraient la garantir, aurait perdu et l’une et l’autre. Ce faisant, parce qu’elle présuppose le christianisme, la pensée girardienne ne peut pas ne pas entrer en dialogue direct avec le judaïsme.
Un examen de la théorie girardienne depuis les textes juifs s’impose donc : d’une part, parce qu’elle mobilise une certaine conceptualité héritée du judaïsme, d’autre part parce qu’en se donnant comme chrétienne elle ne peut laisser indifférent le judaïsme. Si Girard ne peut parler qu’à partir du christianisme, reste à savoir ce que vaut son anthropologie aux yeux de qui ne veut pas occuper cette place et qui ne veut pas se mettre à l’École du Christ. Nous nous proposerons trois questions, sur lesquelles nous nous attarderons inégalement, trois questions reprenant chacune une thèse de R. Girard : (a) Le désir mimétique est-il le fond de l’humanité ? (b) Le sacrifice doit-il s’interpréter en terme de bouc émissaire par lequel du sacré et du religieux se trouvent produits ? (c) Le christianisme a-t-il révélé le bouc émissaire comme bouc émissaire, au point d’aboutir à une apocalypse qui doit s’entendre à la fois comme révélation et comme extrême violence, et la première parce que la seconde ? Ces trois questions présentent la difficulté de leur enchâssement : car si l’anthropologie fondamentale (le désir mimétique) sous-tendu par le travail de Girard est contestable, alors le mécanisme du bouc émissaire appelé par la crise mimétique s’évaporera. Notre thèse sera la suivante, que nous énonçons de la manière la plus brutale possible : l’anthropologie girardienne est, du point de vue du judaïsme, une anthropologie païenne.
Le désir mimétique
D’emblée pourtant, à la première thèse – le désir mimétique comme fond de l’être de l’homme –, une gêne survient, car la thèse paraît aussi empiriquement valide que bibliquement discrète. Empiriquement valide, et Girard n’est pas le seul à la voir et à la faire voir – Aristote l’avait élucidée avant lui comme propre à l’homme (Poétique IV[2]), saint Augustin naturellement l’avait vérifiée chez les enfants (Confessiones I, 7), et Spinoza l’avait géométriquement déduite sous le concept d’affectuum imitatio (Ethica III, 27) : un philosophe grec, chez qui Girard cherche son concept de mimésis ; un père de l’Église, qui trouve dans les yeux des enfants l’expression d’un désir féroce et amer ; un juif renégat, pour qui l’imitation des affects procède des logiques propres aux conatus dont sont tissés les êtres. Un grec, un chrétien, un juif : trois attestations d’une thèse qui paraît dès lors bien peu contestable. Reste que la tradition biblique et talmudique lui fait relativement peu de place. On objectera l’interdit d’éprouver de l’envie (« Tu ne convoiteras pas… », Ex 20, 17 et Deut 5, 21) dernier des Dix Commandements ; et il est vrai, de ce point de vue, que certains commentateurs juifs interprètent la jalousie comme infraction génératrice des autres : le jaloux ment pour obtenir contre le médiateur l’objet, ce qui revient à un vol, puis à un meurtre, etc., jusqu’à ce Dieu lui-même soit déclaré inexistant. Mais il nous semble que, si cette tradition existe, elle est secondaire.
Plus que l’envie, quelle est la détermination ontologique fondamentale de l’homme selon le judaïsme[3] ? La parole ; l’homme est un être parlant, et c’est la parole qui l’unit à Dieu, c’est par elle qu’il est à l’image de Dieu[4]. Soit trois cas exemplaires : – (a) D’abord, le péché originel, jamais nommé ainsi dans la tradition juive[5]. Certes, il peut s’interpréter suivant le désir mimétique, mais le point est ailleurs : le serpent parle, Eve lui répond mais ne parle pas à Adam. Entre l’homme et la femme, nul verbe, nul discours, ne vient contrebalancer celui du serpent ; quant à Eve, elle rapporte au serpent la parole de Dieu en la déformant (Gen 3, 3). En définitive il n’en résultera qu’une parole d’accusation de la femme par l’homme (3, 12) et de condamnation des trois par Dieu (3, 14 sqq.). L’enjeu est bien là : ce qui reste d’une parole divine, ce qui (ne) se transmet (pas) de la femme à l’homme, de la femme à serpent, etc. – (b) La rivalité fratricide entre Caïn et Abel, si centrale pour l’interprétation girardienne, illustre la même impasse du discours. Soit le verset : « Caïn dit à Abel, son frère. Et c’est quand ils sont au champ, Caïn se lève contre Abel, son frère, et le tue. »[6] Il n’a pas échappé aux rabbins qu’il manque ici un complément d’objet au verbe dire, comme si la parole s’étouffait dans la gorge de Caïn. La parole impossible engendre le meurtre du frère. –(c) Enfin, la tour de Babel explicite on ne peut plus clairement ce point : « il n’y avait qu’une seule langue sur la terre et les mots étaient uniques ». L’hébreu donne ahadim, mot qui peut se lire ahoudim, c’est-à-dire littéralement « fermés », « clos », « forclos ». À Babel, l’humanité était grosse d’un verbe qui ne parvient pas à s’installer durablement dans le monde. Ainsi, depuis la dernière parole créatrice, le Verbe a déserté le monde et ni le premier couple (Adam et Eve), ni la première fratrie (Caïn et Abel), ni la première société (Babel) ne parviennent à en restaurer le règne. Qui y parvient ? Non pas le premier couple humain (Adam et Eve) mais, vingt générations plus tard, le couple formé par Sarah et Abraham. Devant le risque de jalousie du roi d’Égypte, Abraham dit à sa femme : « je le savais, oui, tu es une femme belle à voir » (Gen 12, 11) ; et parce que Sarah est belle, elle risque de se faire séquestrer, et Abraham, s’il est reconnu comme son mari, d’être tué ; il lui faudra donc mentir en disant qu’Abraham est son frère. Mais qu’est-ce à dire, sinon que la première parole de l’homme à la femme : « tu es belle » a sauvé le couple du désir mimétique du roi d’Égypte ? Pour le judaïsme, le fait est là : la première parole restaure la parole divine et sauve l’humanité de la brutalité du désir mimétique. L’anthropologie est une anthropologie de la parole, de la bonne parole ou de la mauvaise, de celle qui imite Dieu ou de celle qui la singe, de la parole du prophète ou de celle du faux prophète. L’histoire même de Joseph, si clairement interprétable en termes de rivalité et de crise mimétique (les éléments ne manquent pas), se laisse reconduire à la bonne ou à la mauvaise parole rapportée par Joseph à ses frères.
Cette première analyse n’est pas accessoire ; elle ne consiste pas à substituer au désir mimétique une autre détermination de niveau comparable. De fait, la Parole ici reconnue comme déterminante est une détermination de l’Absolu, que la théorie de R. Girard ne peut prendre en compte ; s’il est aberrant d’interdire par principe toute interprétation des textes bibliques en termes de désir mimétique, ce désir doit être ordonné à l’Absolu, c’est-à-dire compris à partir d’une détermination supérieure : la Parole. Comment l’homme se situe-t-il face à la Parole ? Telle est la question fondamentale, et c’est elle qui décide du désir mimétique. Le regard de R. Girard ne se porte pas assez haut ; il en reste au premier ordre de choses ; mais aussi haut que le troisième, seule une religion, nous le concédons, peut prétendre y monter.
Le sacrifice
Soit à présent la seconde thèse girardienne : la crise mimétique aboutit au sacrifice, sans lequel la société ne saurait réguler sa propre violence. Évidemment, ce point est extrêmement discutable d’un point de vue juif, pour des raisons qui ont été de nombreuses fois discutées. (a) D’abord, il n’y a pas d’unité du concept de sacrifice dans le Lévitique : le Lévitique décrit un si grand nombre de type d’offrandes, dans des cas si dissemblables et selon des rituels de mise à mort si divers, qu’on doit hésiter avant de parler du sacrifice dans le judaïsme. (b) Il y aurait même une raison plus profonde, peu invoquée, mais sans doute décisive : les sacrifices ne peuvent avoir lieu que dans le Temple de Jérusalem, lequel a été par deux fois détruit, la dernière fois en 70 par Titus. Or un judaïsme sans sacrifice est-il envisageable ? Oui, autant qu’un judaïsme sans Temple. Mais derechef, un judaïsme sans temple est-il une aberration historique ou théologique ? Certainement non. C’est un judaïsme diasporique. On pourrait, on doit sans doute, soutenir que non seulement un judaïsme diasporique n’est pas un contresens, mais que c’est même l’un des visages du judaïsme. Non seulement Moïse n’entre pas à Canaan, mais ce n’est pas la même génération qui sort d’Égypte et qui entre en Canaan ; les Hébreux doivent errer quarante ans, certes parce qu’ils ont commencé par renier la terre, mais aussi et d’abord, fondamentalement, parce que le peuple de la Loi ne peut être le peuple de la Terre. Sachons entendre la leçon des faits : que les hommes qui entrent en Canaan ne sont pas ceux qui ont reçu les dix commandements ! Que le peuple qui a entendu la parole de Dieu ne puisse entrer en Canaan, que Moise lui-même n’y entre pas, voilà qui invite à ne point trop essentialiser le rapport du peuple à sa terre, et partant à son Temple et à ses sacrifices. Un judaïsme diasporique sans terre, sans sacrifice ni Temple est parfaitement possible, et même, pour ainsi dire, théologiquement nécessaire, puisque la Bible même décrit le peuple hébreu comme consubstantiellement diasporique : « peuple dispersé et séparé parmi les peuples » (Esther 3, 8)[7]. L’arrachement à la terre, à toute terre, définit le juif comme celui qui traverse – le ‘ivri, l’hébreu.
Ainsi il faudrait soutenir que le sacrifice n’a qu’une fonction extrêmement accessoire dans le rite juif. Nul plus que Maïmonide ne l’a souligné. Quelle fonction attribue-t-il au sacrifice ? Au strict point de vue théologique, il va de soi que le vrai Dieu ne saurait accepter ni requérir le moindre sacrifice. Comment comprendre alors ce qui est à la fois prescrit par l’Écriture, mais qui choque la raison en contredisant l’idée juste du vrai Dieu ? Tel est le type de questions exemplaires de la démarche de Maïmonide dans le Guide des Égarés, s’il est vrai que la situation d’égarement consiste moins en un défaut de repères (l’athée ou l’agnostique) qu’en un excès de repères (l’homme de foi et de rationalité, à la fois croyant et philosophe). Une réponse à cette aporie est proposée par Maïmonide, qui nous intéressera ici particulièrement (Guide des Egarés, III 32 et 46). Selon lui, l’essence du sacrifice est sans nul doute tout à fait païenne ; mais alors, pourquoi donc Moïse en prescrit-il ? C’est que le peuple hébreu, à peine sorti de la païenne Égypte, avait un besoin psychologique du sacrifice, encore tout pétri qu’il était de croyances magiques et superstitieuses ; et alors il revient à la Bible soit de commander les sacrifices précisément proscrits par les idolâtres en guise d’épreuve (III 46), soit de céder à la pulsion sacrificielle héritée des Égyptiens pour la tourner vers le vrai Dieu : « la sagesse de Dieu (…) ne jugea pas convenable de nous ordonner le rejet de toutes ces espèces de culte, leur abandon et leur suppression ; car cela aurait paru alors inadmissible à la nature humaine, qui affectionne toujours ce qui lui est habituel » (Guide, III, 32, p. 522). Cette réponse est d’une audace et d’une portée inouïe : elle relègue le sacrifice à la partie païenne de nous-même[8], et introduit une anthropologie différenciée : il y aurait une anthropologie païenne – décrivant l’homme païen – et une anthropologie juive. Quand le juif sacrifie, c’est le païen en lui qui sacrifie, et c’est pour répondre à ce besoin (en l’encadrant) que Dieu a prescrit le sacrifice. Un commentaire rabbinique important rapporte (Rachi, ad loc.), au sujet de la ligature d’Isaac, que Dieu n’avait jamais demandé à Abraham de sacrifier son enfant, mais seulement de « le monter en montée » (Gen 22, 2), c’est-à-dire de l’élever ; et c’est Abraham, encore résiduellement païen, qui a interprété pareil ordre comme commandement du sacrifice ; si bien qu’au moment où l’ange interrompt son geste, Abraham, selon ce même commentaire, demande à Dieu la permission d’au moins faire couler quelques gouttes de sang de son fils – ce que Dieu refuse. Bref, dans le sacrifice, il en irait d’un paganisme fondamental, peut-être toujours résiduel, mais contre lequel le Juif doit s’élever pour accéder à sa véritable nature.
Reste un point. S’il est vrai qu’un judaïsme diasporique est possible, s’il est vrai que l’anthropologie juive pourrait fondamentalement être non sacrificielle, alors le sacrifice ne débouche sur aucun sacré et la paix se gagne d’une manière autre que par le sacrifice – autant dire qu’un autre rapport à Dieu est requis, inévitablement. Quel est ce rapport ? Nous en proposerions deux : la prière et la loi. (a) Il est assez clair que la prière ne s’est pas seulement substituée aux sacrifices, comme un expédient ou un ersatz propre au juif diasporique ; au contraire, elle a toujours vécu sa vie propre parallèlement aux rites sacrificiels du temple. Hanna prie pour avoir un enfant (I Sam 1, 11 sqq.) tout comme Isaac s’était tourné vers Dieu en présence de sa femme (Gen 25, 21). Mais pourquoi aller chercher si loin ? Les prophètes, et Abraham le premier, ne cessent d’entretenir avec Dieu un double rapport – rapport de discussion ou de négociation (Abraham, au sujet de Sodome et Gomorrhe) et rapport de prière (Moïse). La prière n’est pas seulement un acte de langage à même l’immanence du créé, elle jette un pont vers la transcendance, ou plutôt elle emprunte le pont que la transcendance a, elle-même et d’elle-même, jeté vers l’immanence confuse de l’humanité. (b) La loi ne contrevient pas à cette logique supérieure de la parole : car la loi est parole de Dieu, que répète, que change et que renouvelle la parole humaine. À travers la Loi, se signale l’importance de l’étude par laquelle la répétition introduit de la différence (michna) ; à travers la loi aussi, le Verbe se fait chair, pour reprendre les termes chrétiens, car la loi demande à être incarnée, à prendre corps. Mais attention : le Verbe n’est pas Dieu, il est de Dieu[9], et est remis à l’humanité qui l’héberge en son discours et l’incarne en son corps. De plus et surtout, rien ne peut plus ni mieux que la Loi s’ériger contre la violence humaine. La loi n’est pas seulement une manière de tempérer la violence, elle fait d’emblée barrage au sacrifice. Une loi juive disqualifie un verdict qui aurait été prononcé à l’unanimité des juges. Pourquoi ? R. Girard nous en donne la raison : car l’unanimité transformerait la justice en lynchage sacrificiel. D’où il faut conclure qu’il n’y a pas du sacrifice au droit une continuité apaisante, mais à proprement parler solution de continuité, une rupture vers un autre ordre[10]. Parce qu’il est un juridisme, le judaïsme ne fait aucune place au sacrifice.
Ainsi, parce qu’ils font échec à la loi du sol et à tout territorialisme, la prière et le droit prennent en charge une parole divine qui, pour n’être déposée ou fixée nulle part, interdit tout unanimisme de clan. La parole biblique fait échec au droit du sol (qui est toujours le droit du sang), et le nomadisme est la situation exacte où la parole fait figure de moteur anthropologique alternatif au rite sacrificiel. Il faut conclure que c’est la prière et l’étude de la Loi qui lient l’homme au divin, c’est-à-dire au saint, au séparé ; le divin n’est pas le sacré, mysterium tremendum, mais celui qui parle, à qui on parle, dont on parle. La rivalité mimétique est subsumée par la parole – prière et Loi.
La passion comme révélation du sacrifice
Ainsi, la parole semble en tous points se substituer à la rivalité mimétique. La crise mimétique provient d’un défaut de parole ou d’une parole inassurée, mal fondée en Dieu ; quant au sacrifice, il ne se justifie que pour autant qu’il consiste à céder à la part païenne de nous-mêmes. Vient à présent l’examen de la question de la Passion. Question difficile, mais qui le serait bien davantage si des chrétiens eux-mêmes (entre autres H. U. Von Balthasar, J.-R. Armogathe ou P. Valadier) n’avaient questionné l’interprétation girardienne de la Passion du Christ. Point n’est besoin ici de rappeler l’évolution de R. Girard sur l’interprétation non sacrificielle puis sacrificielle de la Passion du Christ[11], car le cœur de l’affaire est ailleurs : si l’on admet que la Passion du Christ consiste à révéler l’innocence de la victime sacrificielle et dessille les yeux des lyncheurs au point de rendre à l’avenir le processus du bouc émissaire définitivement impossible (puisque nous ne pouvons plus méconnaître l’innocence de la victime), bref si la Passion est fondamentalement apocalyptique par la violence qu’elle fait voir et la violence qu’elle déchaîne, alors la fonction de la Passion est d’abord et avant tout phénoménologique.
Certes, mais alors une question : un tel dévoilement phénoménologique de l’essence du bouc émissaire ne suppose-t-il pas, d’abord, une répétition du processus lui-même ? Mieux, ou plus précisément : pour révéler l’essence du processus, la Passion du Christ ne doit-elle pas répéter le sacrifice en sa détermination païenne, plutôt que juive ? En ce sens, certes le christianisme prolonge l’apaisement non sacrificiel inauguré par le judaïsme, mais il ne peut le faire qu’en répétant pour ce faire le mécanisme païen lui-même. La divinisation de la victime et la victimisation du divin, sont un fait à la fois païen et chrétien, mais assurément pas juif. D’un point de vue juif, une telle analyse de la Passion (sur laquelle encore une fois un juif n’a pas à se prononcer) ne consiste-t-elle pas à rapprocher davantage le christianisme du paganisme que du judaïsme ? Certes, la Passion met un terme à la ritualité sacrificielle, mais seulement sous la condition d’une dernière fois la répéter ; pour faire voir la machinerie de la mise en scène, il faut rejouer la pièce. Aux chrétiens d’en juger, suivant leur cœur, leur foi et surtout leurs dogmes. Mais d’un point de vue juif, l’analyse de R. Girard conduit à la constitution d’un complexe pagano-chrétien, d’où le moment juif de la révélation aura forcément tendance à s’exclure. Car le judaïsme conteste l’analyse du bouc émissaire en termes girardiens de sacrifice : « Le « bouc émissaire » étant destiné à l’expiation totale des grands péchés (…) on ne devait point l’égorger, ni le brûler, ni l’offrir en sacrifice ; mais on devait l’éloigner autant que possible » (Maïmonide, Guide, III 46, p. 587-588) ; on le voit, en aucun cas le bouc émissaire ne provoque un quelconque lynchage sacrificiel : « Il est indubitable pour tout le monde que les péchés ne sont point des corps qui puissent se transporter du dos d’un individu sur celui d’un autre. Mais tous ses actes ne sont que des symboles destinés à faire impressions sur l’âme, afin que cette impression mène à la pénitence ; on veut dire : nous sommes débarrassés du fardeau de toutes nos actions précédentes, que nous avons jetées derrière nous et lancées à grande distance » (Guide, III 46, p. 588). À aucun moment le bouc n’est sacrifié, mais surtout à aucun moment il n’est coupable, présumé coupable ou cru coupable, fût-ce pour dévoiler la fonction d’une pareille culpabilité : il est symboliquement chassé, comme on peut vouloir renvoyer son passé loin de soin. Ainsi, à supposer que l’essence du sacrifice soit celle que Girard lui assigne, il ne reviendrait surtout pas au bouc émissaire de la donner à voir, puisqu’il n’y a pas sacrifice. Qu’en revanche la Passion exhibe le mécanisme du bouc émissaire en levant la méconnaissance, voilà qui suppose une continuité du dispositif païen au dispositif chrétien, continuité passant outre la béance gigantesque que constitue sur ce point le judaïsme.
Pareil complexe pagano-chrétien pourrait naturellement choquer les chrétiens, et il n’est pas impossible qu’une partie des réserves chrétiennes à la pensée de R. Girard provienne de là ; du reste, Rosenzweig et Levinas, et même J.-L. Marion récemment, n’ont-ils pas distingué le « christianisme des juifs et [le] christianisme des païens », reconnaissant par là, explicitement, qu’il y a bien un christianisme des païens ? Mais la question (qui vaut d’être retournée en tous sens) ne pourrait alors s’adresser qu’aux chrétiens : faut-il admettre cette fonction phénoménologique de la Passion au prix de la constitution d’un pareil complexe pagano-chrétien ? Le chrétien est sommé de choisir entre un christianisme de païen et un christianisme de juifs : à l’évidence, Girard a choisi la première voie.
Arrivé ici, le Juif ne peut que se taire, lui qui a toujours récusé le sacrifice, sacrifice d’autrui autant que sacrifice de soi. Il lui apparaît seulement que l’anthropologie girardienne s’oppose au judaïsme autant qu’à un certain christianisme. En fait, elle formalise les données fondamentales de la condition païenne : le juif ne pourra s’y reconnaître, sauf à n’y voir que sa plus mauvaise part, celle par laquelle il n’est pas juif ; il pourra même craindre de se retrouver devant un complexe pagano-chrétien avec lequel il ne se sentira rien en commun, pas davantage du reste que d’autres chrétiens. De fait, l’anthropologie girardienne est d’abord une anthropologie caïnienne : inutile d’y lire une invitation à faire admettre par les Juifs la part païenne du judaïsme[12] ! Tout le judaïsme n’est-il pas au contraire une puissante protestation contre le geste de Caïn, à laquelle elle oppose la participation au Verbe de Dieu ? – Mais alors qu’est-ce à dire sinon que, si aucun juif ne saurait être païen, en retour nombre de chrétiens pourraient être chrétiens par la via judaica ? Récuser l’anthropologie girardienne, c’est sans doute lui refuser le dernier mot sur le peuple de Dieu[13], mais peut-être aussi sur les chrétiens eux-mêmes – du moins ceux qui préféreront le « christianisme des juifs » au « christianisme des païens »[14].
[1] Cet article reprend l’essentiel d’une communication prononcée au colloque sur « René Girard et la théologie. A propos de J. Alison, Le péché originel à la lumière de la Résurrection, tr. fr., Paris, éd. du Cerf, 2009 », à l’invitation de B. Chantre. Nous remercions J. Alison, B. Chantre et J. Duchesne de leurs réactions.
[2] C’est d’ailleurs à Poétique IV, que Girard emprunte l’exergue du premier livre des Choses cachées depuis la fondation du monde, Paris, Grasset, 1978, Livre de Poche, p. 9.
[3] Les développements qui suivent reprennent A. Neher, L’exil de la parole, Paris, Seuil, 1970.
[4] Sur ce point, cf. notre article : « Les trois guises de l’image de Dieu : l’interpelé, le prophète, l’orant », Essaim, 2016, 37.
[5] Cela pour une raison évidente : le péché ne prend sens que dans une perspective sotériologique et donc, d’abord, dans son lien à la Résurrection.
[6] Nous citons la Bible d’après la traduction d’A. Chouraqui (Paris, DDB, 1987) non sans la modifier parfois, notamment dans le cas des noms de Dieu et des personnages, afin suivre l’usage français.
[7] Quoique le propos soit du ministre Amman, il ne fait guère de doute qu’il puisse trouver un appui rabbinique.
[8] L’analyse de J. Alison est donc ici hautement contestable : « D’où l’ambiguïté des actes sacrificiels dans les Écritures juives : ils sont à la fois présenté (sic) comme vitaux et décriés par les Prophètes, qui proclament avec insistance que ce n’est pas le sacrifice, mais la relationnalité (sic) humaine pacifique qui est agréable à Dieu » (p. 213).
[9] Réponse à J.-L. Marion, qui nous a souvent fait observer que la loi juive revient finalement à « l’Incarnation » : or dans le judaïsme, la Torah n’est pas Dieu – ce qui revient, en site chrétien, à énoncer que le Verbe n’est pas Dieu.
[10] Cf. J. Alison, op. cit., p. 167, en dépit de l’interprétation paulinienne restituée, p. 185.
[11] Cf. par exemple le glissement depuis Des choses cachées, op.cit., p. 306 à Quand ces choses commenceront, Paris, Arléa, 1994, p. 169. Cette évolution serait à interroger comme telle.
[12] En réponse à une suggestion orale de J. Alison, selon qui nous refoulons le christianisme interprété par Girard du côté du paganisme parce que, par principe, nous excluons du judaïsme toute dynamique sacrificielle, et donc païenne ; au contraire, il conviendrait, selon lui, que le judaïsme accepte sa part de paganisme. C’est à saint Paul qu’il revient d’avoir fait du christianisme un « judaïsme pour hommes à problèmes païens » (E. Levinas, Carnets de Captivité, in Œuvres 1, Paris/Caen, Grasset/Imec, 2009, p. 148) ; le judaïsme demeure une gigantesque protestation contre le paganisme, un soulèvement sans compromis.
[13] Cette thèse s’appuie sur (ou reformule) le principe talmudique suivant lequel le peuple d’Israël n’est pas soumis à la fatalité astrale : « Ein mazal léisrael » (Talmud de Babylone, Nédarim, 32 a ; Chabat, 156a) ; sed contra, J. Alison, p. 112, 117, 119. Cf. aussi p. 219 : « Il est facile de voir la relation entre Jésus et Israël comme porteuse d’une forme de critique prophétique. […] A la racine d’Israël, comme de toutes les sociétés, il y a le meurtre fondateur, ce que Jésus révèle en se laissant devenir victime – et ainsi la critique d’Israël est-elle complète. » Nous récusons de toutes nos forces le comme de toutes les sociétés. Cf. encore, dans un autre contexte, p. 305 : « La relecture juive montre déjà une tendance à raconter l’histoire du point de vue de la victime » : l’exemple de Noé sauvé du Déluge invoqué par J. Alison est peu probant, car Noé n’est précisément pas la victime.
[14] E. Levinas, Carnets de captivité, op. cit., p. 134.










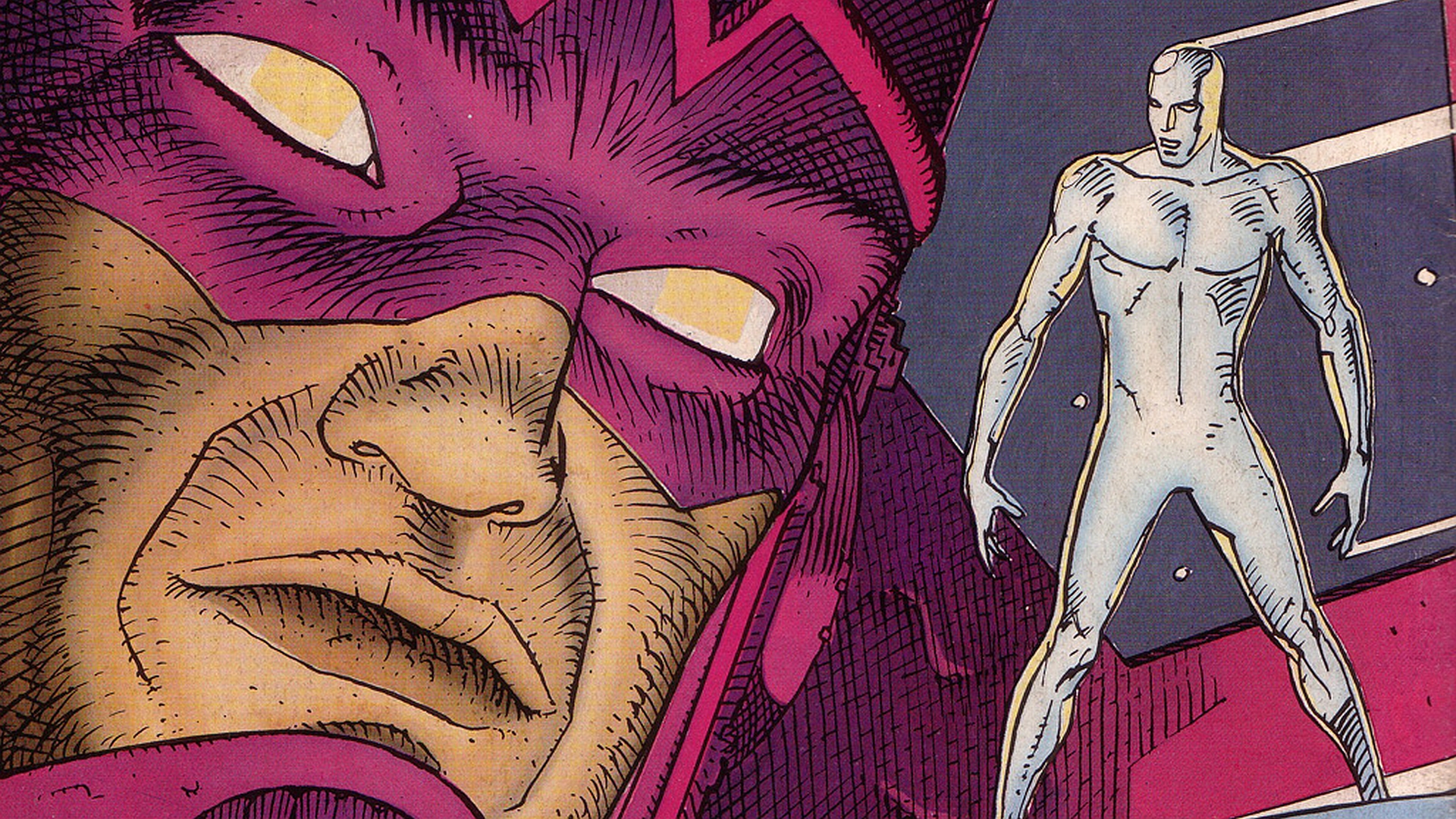



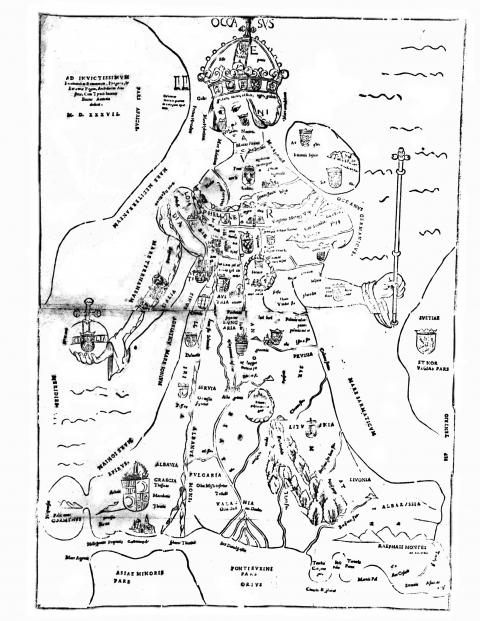

Votre texte est extrêmement intéressant, surtout cette idée de la Parole comme fondement (je n’avais pas remarqué qu’Eve ne s’adressait pas à Adam !).
Malgré tout, la théorie de René Girard (ou l’idée, si l’on préfère) a le mérite de nous encourager à devenir pacifistes, à renoncer à la montée eschatologique de la violence, à ré-inventer l’innocence, à pardonner, à nous méfier du mimétisme, et à moins « rendre » que « servir » la justice. Elle est le constat d’une inversion extrêmement pertinente du point de vue anthropologique : dans le christianisme, ce ne sont plus les hommes qui sacrifient pour leur Dieu mais Dieu qui se sacrifie pour les hommes. Il faut que cette oeuvre soit lue et commentée. Et votre commentaire, finalement, en est la preuve, puisqu’il lui ajoute de la valeur en la contestant. Pour reprendre les termes girardiens, vous n’avez pas « achevé » mais « poursuivi » Girard. Merci.