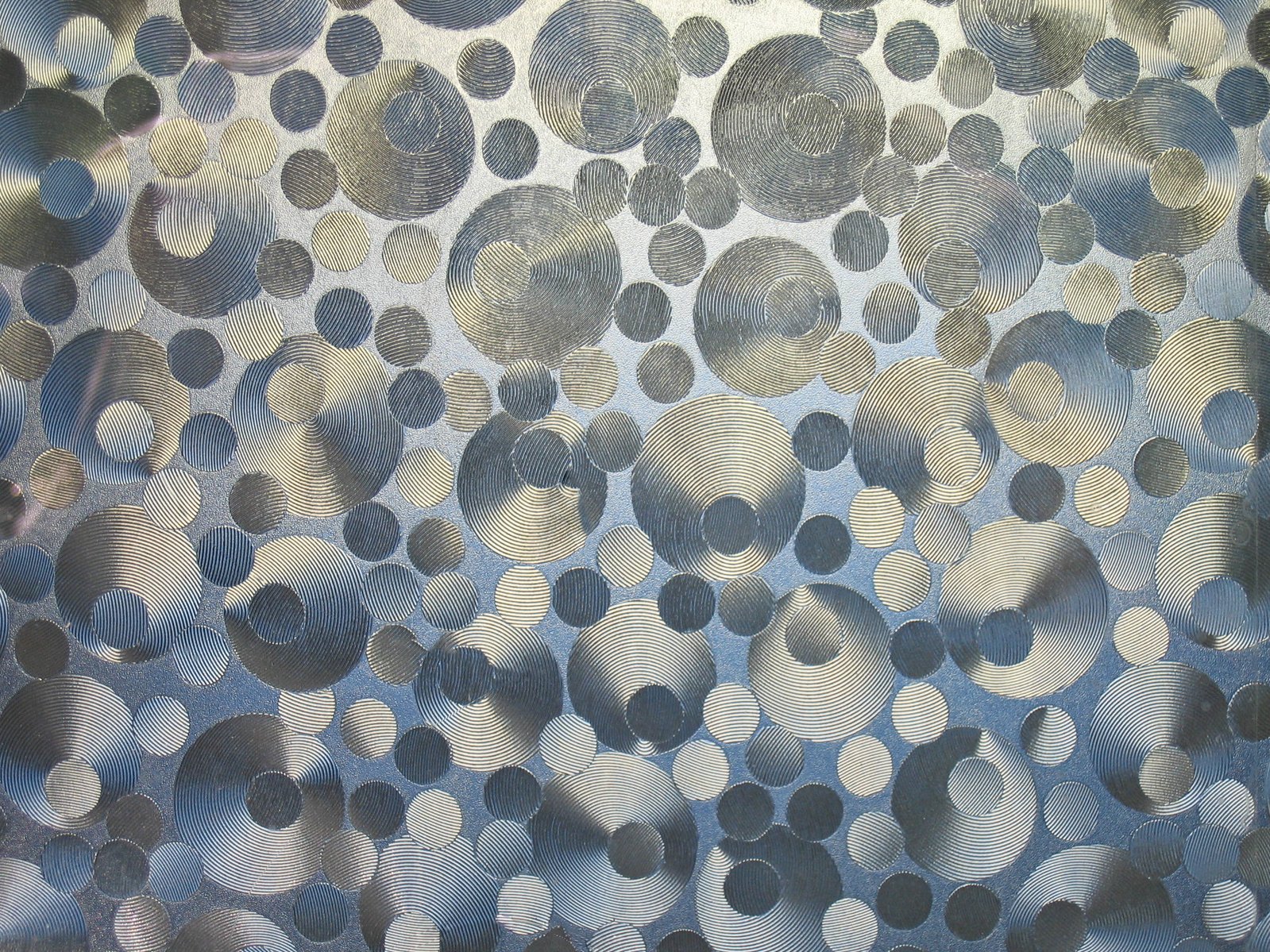Addiction et société : entretien avec Patrick Pharo
Patrick Pharo – CNRS / CERSES
Mélanie Trouessin – ENS de Lyon
Mélanie TROUESSIN : Patrick Pharo, avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous parler de votre parcours intellectuel ? Comment en êtes vous arrivé à travailler sur la question des addictions ?
Patrick PHARO : J’ai eu une formation en philosophie auprès notamment de René Schérer pour la phénoménologie et de Vladimir Jankélévitch pour la philosophie morale. J’ai ensuite fait une thèse de sociologie de la connaissance avec Pierre Ansart sur « Le gauchisme de mai 68 », puis des enquêtes ethno-sociologiques assez classiques sur « les savoirs ouvriers » et « paysans ». Au CNRS, j’ai travaillé en sociologie de l’éthique auprès de François Isambert et j’en ai profité pour combler mes lacunes en philosophie morale et politique. L’essentiel de mon travail a alors porté sur des questions de sémantique de l’action : justice, respect, plaisir ou souffrance – avec des approches empiriques sur des sujets très divers : civilité, civisme, mendicité, torture, expertise, débat public… C’est en fait l’ancrage de mon travail dans la tradition wébérienne qui m’a conduit à m’intéresser à la philosophie analytique et en particulier à la théorie frégéenne du sens, puis aux sciences cognitives sous différentes formes (y compris pendant un moment l’intelligence artificielle !). Il m’a semblé finalement que certains débats théoriques (je pense notamment au modularisme de J. Fodor) aboutissaient à des impasses et que la meilleure façon de rendre les sciences cognitives opérationnelles pour les sciences sociales était de tirer parti de quelques résultats mieux circonscrits pour faire avancer des questions très sensibles, mais totalement irrésolues. Les neurosciences de l’addiction, dont j’ai découvert l’apport il y a une vingtaine d’années, me semblaient être un de ces passages privilégiés, d’autant qu’elles permettaient de renouveler complètement l’étude d’un objet central pour la sociologie mais encore très peu exploré : celui des sentiments humains.
Dans vos travaux, par exemple dans Philosophie pratique de la drogue, vous critiquez à la fois les conceptions de l’addiction comme déficience de la volonté et perte de l’autonomie et celles de l’approche par choix rationnel au sens de Becker ; quel lien faites-vous alors entre le concept de volonté et celui d’addiction ? Plus globalement, comment situez-vous votre propre conception de l’addiction (s’il est possible d’avoir une conception unique) ?
– L’addiction est une énigme pour les théories de l’action rationnelle puisqu’il semble avéré qu’un sujet peut faire b, qu’il juge pourtant moins bon que a, par exemple prendre de l’héroïne alors qu’il juge qu’il ne faut pas en prendre ou, de façon moins dramatique, manger toute la tablette de chocolat alors qu’il s’est juré de n’en prendre qu’une seule barre. Face à cette difficulté, il existe deux stratégies possibles, celle des rationalistes stricts qui vont chercher à réduire l’antinomie par différentes manœuvres : par exemple les considérations temporelles (le sujet change d’avis à l’instant de l’acte), ou l’analyse de l’escompte du futur (appréciation différente suivant la rigueur et le retard des effets indésirables). D’autres auteurs admettent qu’il y a dans l’action humaine quelque chose de « sourd », comme dit D. Davidson. C’est sur cette « surdité » de l’action que les neurosciences ont jeté un éclairage tout à fait nouveau en obligeant à reconsidérer les schémas de l’action rationnelle. En montrant comment les drogues agissent sur, et dérèglent des dispositifs neurologiques préexistants : circuit dopaminergique de la récompense, récepteurs endogènes de neuropeptides…, elles permettent de mieux comprendre les fluctuations des régimes de l’action « volontaire » – laquelle n’est du reste que le nom donné à une action intentionnelle, par opposition à un mouvement directement causé par une force physique.
Lorsque je me suis mis à travailler sur ce sujet, j’ai constaté que la plupart des travaux philosophiques soulignaient l’imperfection des « volitions » associées à la consommation de drogue, en termes d’akrasia (faire b quand on juge que a est meilleur) ou d’incapacité du sujet à porter un métajugement sur ses désirs. L’enquête empirique m’a au contraire convaincu que les usages de drogue se font originellement sur le mode de ce qu’Aristote appelait l’akolasia, c’est-à-dire l’auto-indulgence lorsqu’on juge meilleur ce que tout le monde, y compris soi-même en d’autres circonstances, jugerait moins bon. On y va de bon cœur, souvent d’ailleurs sous l’effet de mimétismes de groupe et des premières ivresses associées à l’alcool et à la fête. Les conflits de volonté, et en particulier les mécanismes de l’akrasia, ne font leur apparition que lorsqu’on échoue à mettre en œuvre un programme personnel de régulation ou d’abstinence. On risque à ce moment-là d’entrer dans un cycle de consommation aussi malheureuse qu’elle pouvait être heureuse dans ses débuts.
Il faut d’ailleurs souligner que la consommation de drogues, même très dangereuses, n’implique pas forcément une addiction. Les phénomènes de craving, de tolérance élevée, d’usage compulsif, de sevrage en cas d’abstinence, d’envahissement des préoccupations quotidiennes…, qui sont caractéristiques de l’addiction, n’apparaissent pas immédiatement, y compris lorsqu’il s’agit de substances très addictives, comme par exemple les opiacés qu’on espère (au début) pouvoir consommer de façon purement épisodique. On doit aussi distinguer l’addiction proprement dite de la dépendance au sens plus large d’un désir de retour régulier aux consommations et pratiques que l’on aime, qu’il s’agisse d’alcool et autres psychotropes, de sexe, de jeux, d’activités fortement motivantes comme le travail ou les sports… Au contraire de ce genre de dépendances consenties, souvent indispensables à un heureux équilibre de vie, l’addiction est clairement une pathologie du consentement, comme le savent parfaitement les individus qui ont eu à la subir au travers par exemple de l’alcool, de l’héroïne ou du crack.
Vous liez, dans plusieurs de vos travaux, l’addiction avec les thèmes du plaisir et de la jouissance d’un côté, et de la quête de bien-être et du bonheur de l’autre ; pourriez-vous nous expliquer ce lien ? La référence au bonheur vous permet-elle d’inclure les addictions à but plutôt sédatif (soulager la souffrance) ?
– La raison la plus immédiate pour laquelle on prend des drogues est qu’elles apportent du plaisir, au sens positif d’une jouissance ou d’une excitation ou au sens négatif (et épicurien) d’une cessation de souffrance. Ce point a longtemps été minoré par les autorités sanitaires pour ne pas céder au sentiment de puissance que les usagers peuvent avoir sur ce terrain-là. Mais il ressort très clairement des travaux existants, à commencer par le magnifique Phantastica de Louis Lewin. Au cours de mes enquêtes, j’ai été frappé par une expression qui revenait souvent : « se faire une fête », pour qualifier le moment où on décide de consommer. L’alcool, le tabac, la marijuana et d’autres drogues comme la cocaïne ou le MDMA sont clairement associés à des situations de fête, c’est-à-dire une forme de bonheur extrême qui s’empare des sujets, surtout d’ailleurs lorsqu’ils sont ensemble. L’héroïne aussi, avec ses effets flashants et sédatifs de toutes les angoisses, est souvent décrite comme la drogue du bonheur. Il en va de même du LSD et autres hallucinogènes qui furent au centre du programme de vie extatique de la contre-culture américaine des années 60. Il existe néanmoins toutes sortes de chemins différents qui favorisent la consommation de psychotropes, y compris lorsqu’on cherche simplement à se libérer de l’ennui, de l’angoisse, de la déprime, de la peur, de la routine de la vie ordinaire ou de certaines autorités répressives…
On sait aujourd’hui que les effets euphorisants, sédatifs ou stimulants des drogues jouent sur des dispositifs neurologiques, en particulier les circuits de la récompense situés dans la partie frontale du cerveau, que les humains partagent avec d’autres animaux, et qui sont associés à toutes les activités fortement motivantes : drogues, mais aussi et surtout attachement, sexualité, jeux ou aventures. Dans mon dernier livre sur La dépendance amoureuse (PUF, 2015), j’ai exploré et rendu compte d’une série de travaux en neurosciences et en psychologie évolutionniste qui s’interrogent sur l’origine de ces dispositifs neurologiques du plaisir et de la récompense. L’hypothèse dominante est que ce n’est pas la consommation de drogues qui aurait favorisé leur apparition, mais plutôt les liens sexuels et l’attachement parental, dont on sait désormais par des études d’imagerie cérébrale qu’ils agissent sur les mêmes circuits neuronaux de la récompense. Considérant que les liens sexuels et l’attachement parental ont certainement beaucoup plus de valeur adaptative que les effets euphorisants, sédatifs ou stimulants des drogues, les chercheurs concluent que celles-ci piratent (c’est le terme utilisé dans plusieurs articles) des dispositifs neurologiques façonnés par l’évolution naturelle à des fins beaucoup plus indispensables. Autrement dit, si les humains sont devenus les êtres de plaisir qu’ils sont, ils ne le doivent pas aux drogues, mais aux liens amoureux et parentaux !
Une de vos idées que je trouve particulièrement éclairante est celle de la « logique d’exception » des addicts, selon laquelle ils éprouveraient un sentiment d’invulnérabilité et de toute puissance au départ, qui rendrait le passage à la dépendance encore plus insidieux. Pourriez-vous revenir sur cette idée ? Peut-on en faire un élément explicatif intrinsèque de l’addiction, qui résulterait alors d’une sorte d’échec de stratégie de contrôle ?
– Oui sans aucun doute sur l’addiction comme échec du contrôle : c’est là le point développé dans Philosophie pratique de la drogue (Cerf, 2011), que je me suis du reste contenté de transcrire à partir de ce que m’ont dit mes interlocuteurs. On peut néanmoins préciser que la plupart des gens que j’ai vus étaient en traitement et en situation de lutte contre leur addiction, laquelle signait l’échec du contrôle. Mais je ne dis pas que le contrôle serait toujours en échec. C’est même exactement le contraire que je pense, du moins tant qu’il s’agit de drogues « contrôlables » comme le sexe, l’amour, le vin, le travail, le jeu, le tabac, la marijuana, les benzodiazépines, les antidépresseurs… Certaines drogues, à mon avis, ne sont pas vraiment contrôlables. C’est le cas de l’héroïne, et, dans une moindre mesure, de la cocaïne qui va vous habiter en profondeur et vous désarticuler mentalement si vous en prenez sur la durée – à condition qu’elle ne vous ait pas déjà occasionné une crise cardiaque. Je suis pour la légalisation de toutes les drogues, mais en tenant compte de ce que je viens de dire. Pour la cocaïne et autres stimulants très insidieux, il vaudrait mieux se contenter de les réintroduire à très petite dose dans des préparations licites, comme cela existait autrefois avec le vin Mariani, et comme cela existe encore avec les opiacés dans la codéine.
Quant au sentiment d’invulnérabilité dont vous parlez, je crois qu’il est associé à cette origine évolutionnaire de l’ « organe » neurologique du plaisir et de la motivation qui associe la survie génétique ou individuelle à une prise de risques mortels. L’attraction sexuelle et le lien parental sont deux façons différentes de surmonter le risque d’annihilation : par la transmission des gamètes, comme c’était le cas des oiseaux observés par Darwin qui défiaient les prédateurs et la mort en arborant des couleurs très vives pour séduire les femelles, ou par l’abandon sans réserve à la sollicitude d’un parent ou d’un alloparent auquel le petit peut toutefois avoir le malheur de ne pas plaire. Il n’est pas paradoxal de se croire invulnérable lorsqu’on court un risque mortel si l’on suppose que la confiance en soi améliore les chances de surmonter le péril, et que l’audace des aventuriers ancestraux, pour périlleuse qu’elle ait pu être, a eu peut-être un avantage adaptatif.
Vous accordez beaucoup de place à la fois à l’entrée et à la sortie de l’addiction ; que pensez-vous des phénomènes de « carrière » ou « trajectoire » et de « rétablissement naturel », souvent utilisés par des auteurs sceptiques pour arguer du caractère volontaire de l’addiction ? Est-ce que ce sont des arguments convaincants contre les conceptions de l’addiction comme maladie ?
– Les rétablissements spontanés ont fait l’objet de beaucoup d’études aux Etats-Unis, à la suite de l’exemple spectaculaire et avéré des soldats américains qui rentraient du Viêt-Nam avec une addiction à l’héroïne et dont la très grande majorité s’était, un an plus tard, libéré de leur dépendance. De nombreux spécialistes français pensent d’autre part que les usages immodérés que l’on observe chez de très jeunes gens ne donnent pas forcément lieu sur le long terme à des addictions. Dans la très grande majorité des cas, là aussi, on se calme, sur le modèle de ces étudiants américains qui, selon le plus amusant des romans de Tom Wolfe (Moi, Charlotte Simmons), donneraient libre cours à toutes leurs pulsions de sexe et de drogue pendant leurs années d’étude, pour rentrer tranquillement dans le rang une fois leurs études terminées. Dans les récits que j’ai moi-même recueillis, l’addiction n’est pas un phénomène immédiat, mais elle a plutôt tendance à s’installer sur le long terme après plusieurs années de multi-consommations et d’habituation progressive. La notion de carrière est donc très importante, puisque la dépendance est en fait un habitus, qu’on peut comparer à celui d’un footballeur ou d’un mathématicien dont la tournure d’esprit, ou le « pli » des systèmes neuronaux, dépend étroitement des longues années passées à se concentrer sur un certain objet. Il s’agit là d’habitus d’existence (et non pas d’habitus sociaux hérités comme chez Bourdieu) que n’importe qui acquiert au cours de sa trajectoire individuelle, de sorte qu’au bout d’un certain temps, à un certain âge, une certaine routine de l’esprit et du corps a fini par s’installer. C’est l’existence subjective et morale des humains, au demeurant de plus en longue, qui est faite comme ça. Les questions d’âge de la vie et de durée des expériences sont consubstantielles aux questions de dépendance. Un bon exemple est celui des histoires d’amour qui n’ont pas la même signification suivant l’âge de la vie et la durée de la relation.
Quant à votre question sur les entrées et les sorties, je dois dire que j’ai commencé mes recherches avec le préjugé ordinaire qui veut que les drogues soient une sorte de calamité dont il est souhaitable à un certain moment de sortir. Après mes lectures et mes enquêtes sur le sujet, je n’ai plus vu les choses de la même manière. Je pense maintenant qu’on n’est jamais complètement « rétabli » d’une histoire de drogue, comme on ne l’est d’ailleurs pas d’une histoire d’amour, sauf peut-être lorsque l’histoire intervient de façon éphémère au tout début de l’existence du jeune adulte. Les histoires qui durent laissent des traces profondes dans le psychisme, c’est-à-dire dans le cerveau. C’est vraiment, encore une fois, en termes d’habitus d’existence sur le long terme qu’il faut penser les choses. Les participants aux Alcooliques ou aux Narcotiques anonymes ont coutume de dire qu’ils sont « alcooliques » ou qu’ils sont « addicts », même lorsqu’ils ne consomment plus depuis vingt ans, dans le souci de tenir compte de cette partie d’eux-mêmes qu’ils ont peut-être réorientée sur d’autres objets mais qui n’a jamais disparu. On sait aussi, par des enquêtes comme celle qu’avait dirigées autrefois R. Castel, que certains héroïnomanes qui ont survécu à leur addiction connaissent un phénomène d’épuisement du désir qui peut les conduire à cesser leur consommation. Mais l’état dans lequel ils sont à ce moment-là dépend de la nature et de la durée de ces consommations, de leur âge et de leur état physique, sans même parler des individualités génétiques qui sont plus ou moins favorables aux rémissions. Il faut aussi tenir compte des traitements de substitution qui ont profondément modifié le devenir des usagers d’héroïne.
Je comprends par ailleurs que la thèse de la « maladie du cerveau » popularisée par le NIDA américain (National Institut on Drug Abuse) fasse l’objet de la plus grande suspicion, compte tenu de son caractère idéologique, dans un contexte sanitaire qui entend soigner n’importe quelle maladie avec les molécules que les laboratoires mettent sur le marché, à l’exclusion des psychothérapies. D’autre part, il existe dans les sciences sociales en France une très grande antipathie vis-à-vis de toute « réduction » organique des phénomènes psychiques et sociaux, liée à un rejet très justifié des dérives réactionnaires du biologisme en sciences sociales. Mon propre pari est qu’on peut accepter les données de la science en matière de neurophysiologie ou d’évolution naturelle sans céder le moins du monde au réductionnisme et sans être réactionnaire. Quoiqu’il en soit, un des meilleurs remèdes contre le doute sur le caractère réellement pathologique de l’addiction est d’avoir été le proche, l’ami ou l’amant d’un alcoolique ou d’un héroïnomane.
Vous voulez rendre accessible une « vision de l’intérieur » de l’addiction, ce que vous appelez le « le versant phénoménologique » de la recherche ; comment articulez-vous, concrètement cet aspect-là avec un apport plus théorique sur les addictions et avec l’apport des neurosciences et des sciences cognitives notamment ?
– Sans vouloir engager ici des discussions philosophiques compliquées, on peut dire que les gens parlent de ce qu’ils sont, de ce qu’ils vivent. Ils sont et ils vivent leur corps et leur cerveau. On trouvait déjà des descriptions cliniques de l’ivresse et de la dépendance dans les textes les plus anciens. Or, ces descriptions n’ont jamais été contredites par les neurosciences, bien au contraire. Il est possible qu’il y ait ici une sorte de cercle primaire qui nous incite à chercher dans les sciences du corps et du cerveau un prolongement, une documentation supplémentaire pour l’expérience clinique ou phénoménologique – prise ici au sens de l’intériorité subjective – que nous avons des êtres et de nous-mêmes. La phénoménologie que je préfère n’oppose pas les sciences de la nature aux sciences de l’esprit mais fait des premières un moyen de documentation et d’extension des secondes.
Vous expliquez, dans l’introduction de votre ouvrage Philosophie pratique de la drogue, que votre point de vue est celui de la « sociologie morale » ; c’est un point de vue que vous introduisez comme une alternative à celui de la sociologie cognitive. Qu’est-ce que cela signifie ? Quel est le lien avec la « philosophie pratique » ?
– La philosophie pratique, c’est tout simplement, je crois, la morale au sens le plus lâche du terme, telle qu’on peut la pratiquer dans la vie de tous les jours lorsqu’il faut gérer au coup par coup les questions de bien, de mal et de liberté pour soi-même et pour les autres. Et la sociologie morale, telle que je la comprends, est tout simplement l’étude empirique de cette philosophie pratique, au travers d’entretiens ou d’œuvres littéraires et cinématographiques, qui permettent parfois de tirer des enseignements philosophiques plus généraux.
Ceci étant, je n’oppose pas la sociologie morale à la sociologie cognitive. Quand j’écrivais mes rapports annuels pour le CNRS, je présentais même mon travail comme une sociologie cognitive et morale. Mais de fait, vous avez raison, mon travail relève davantage d’une sociologie morale et subjective (au sens de l’étude des sentiments) que d’une sociologie cognitive. La raison de cette tendance relève peut-être de l’histoire personnelle de ma recherche. Quand je me suis intéressé aux sciences cognitives proprement dites, c’était au travers de ce qu’on appelait alors l’intelligence artificielle « classique » qui se fondait sur une approche purement logique. Or, comme vous le savez, cette approche a été ruinée par l’arrivée du modularisme et l’idée de réseaux neuronaux fonctionnant en parallèle. Cette approche de la cognition a substitué au contrôle logique immédiatement accessible par le chercheur, des mécanismes purement arithmétiques ou statistiques liés au renforcement ou à l’affaiblissement de liens neuronaux massivement distribués. De ce point de vue, il n’y a peut-être pas de cognition proprement dite dans le fonctionnement du cerveau, mais seulement des mécanismes neurochimiques que les êtres de langage que nous sommes aussi sont capables d’exprimer sous forme de relations logiques. La neurochimie du cerveau me semble en revanche plus directement informative sur la sémantique des sentiments (qui ne sont pas réputés « rationnels ») que sur celle des raisonnements logiques. J’aimerais dire, pour résumer ce qui précède, que le cerveau, en tant que tel, sent davantage qu’il raisonne, le raisonnement lui-même étant l’affaire du langage et de ses garanties logiques et sociales (et non pas neurochimiques).
C’est pour les mêmes raisons que j’accepte beaucoup plus facilement l’idée de dispositifs neuronaux dédiés au plaisir et à la souffrance que l’idée d’une « neuro-éthique » au sens d’un équipement neurologique inné permettant de reconnaitre le bien et le mal pris au sens moral. L’éthique relève en effet de considérations philosophiques ouvertes à la discussion que le cerveau n’est pas en mesure de « supporter » en tant que telles. Ce que je veux dire, c’est que le cerveau n’est pas capable de reconnaître l’éthique, de même, si je peux me permettre une comparaison, qu’un équipement informatique peut vous annoncer : « cette vidéo n’est pas supportée ». Il reconnaît en revanche le plaisir et la souffrance et, peut-être, une forme axiologique très élémentaire qui serait la beauté des choses et des situations de la vie. C’est une des raisons pour lesquelles je serais enclin à considérer certains travaux en neurosciences comme une sorte de confirmation scientifique des suggestions des philosophes britanniques du 17ème et du 18ème siècle comme Shaftesbury et surtout Francis Hutcheson, qui considérait le « sens interne » de ce qui est beau ou bon comme un sixième sens de plein droit. Sauf que, selon moi, la portée axiologique de ce sens interne est minimale : ce n’est pas un sens du beau ou du bien au sens philosophique le plus fort, mais en un sens existentiel plus faible de ce qui nous apporte du plaisir, de la motivation ou des illuminations. C’est précisément ce qu’on pourrait appeler « le sens de la belle vie ». J’ai développé ce point dans un livre à paraître à la rentrée chez Vrin dans la collection d’éthique de Sandra Laugier, et dont le titre provisoire est : La belle vie dorée sur tranches.
Vous avez une formation en anthropologie ; quel est selon vous l’apport majeur d’une discipline comme l’anthropologie dans le champ des addictions ? Par ailleurs, dans votre article « Addictions et éthique de la belle vie », vous dites que « l’anthropologie comparée montre qu’on ne rencontre pas dans les sociétés pré-capitalistes de phénomène d’addiction de masse, comme c’est le cas dans les sociétés contemporaines » ; quels sont selon vous les éléments explicatifs majeurs de l’explosion du phénomène addictif dans nos sociétés modernes ?
– Je lis les textes et les études des anthropologues, mais je ne suis pas moi-même anthropologue. Ce que je dis sur l’absence de phénomène d’addiction de masse est une donnée de seconde main qui me permet d’introduire des considérations plus actuelles sur l’extension et l’ouverture au vingtième siècle de tous les marchés locaux et nationaux, dans un contexte général de recherche de profit qui incite à promouvoir et à consommer tous les plaisirs susceptibles d’entretenir ces marchés. La consommation massive de drogues n’étant selon moi qu’un effet de bord du développement des sociétés libérales, la farouche répression publique de certaines d’entre elles n’en est que plus paradoxale. Un contre-feu possible serait de favoriser non pas le retour à un usage sacralisé des drogues, mais à un usage plus émancipateur, comme c’était peut-être le cas dans les années 60 lorsque certaines drogues étaient associées à un projet de régénérescence culturelle et politique. Les drogues ne sont plus aujourd’hui qu’une des consommations individuelles courantes des sociétés capitalistes, alors qu’elles ont été dans le passé et pourraient être encore une voie d’auto-émancipation ou d’émancipation politique – sachant néanmoins que certaines drogues et certains usages sont en réalité parfaitement incompatibles avec tout projet émancipateur.
A la fin de l’article « Bien-être et dépendances », vous abordez la question de la dépénalisation des drogues. Vous critiquez notamment l’approche prohibitionniste, en ce qu’elle s’attaque uniquement aux substances illicites et laisse de côté des substances licites comme l’alcool ou la cigarette. Adhérez-vous ainsi à l’approche plus récente de « réduction des risques » ? Quelle pourrait être selon vous une politique publique plus efficace en matière d’addictions ?
– J’adhère sans réserve à l’approche de réduction des risques et des dommages, dont les effets en termes de santé publique et de réconfort des personnes concernées sont clairement attestés. Je souhaiterais qu’un processus du même type (conférence de consensus) permette un jour de mettre en place une légalisation raisonnée des substances psychoactives. Sachant néanmoins qu’aucun produit psychoactif n’est anodin et que la mise sur le marché des produits illicites suppose des réglementations adaptées à chacun d’entre eux. Le cas le plus simple est sans doute celui du cannabis sur lequel on dispose de nombreux modèles pratiques (en Espagne ou aux Pays-Bas par exemple). Il existe aussi, paradoxalement, des modèles pratiques sur la distribution d’héroïne, non pas à tout le monde, mais aux personnes qui en sont devenues dépendantes. La présence à faible dose d’opiacés dans des préparations aisément disponibles est aussi un modèle sur lequel on pourrait réfléchir. On pourrait par exemple envisager une sorte de « marché des drogues légères » qu’on pourrait se procurer librement, et un marché sur prescription de produits plus lourds réservés à des personnes souffrant déjà d’une addiction – sur le modèle actuel des salles de consommation à moindre risque. Il semble en effet préférable, en première intention, de distribuer de façon licite des produits peu dosés, que laisser les consommateurs se procurer au marché noir des produits beaucoup plus purs et infiniment plus dangereux – je pense ici à l’exemple de la méthamphétamine que les autorités sanitaires américaines ont progressivement exclue de toutes les préparations licites et qui s’est finalement retrouvée à l’état pur sur le marché parallèle, occasionnant alors des ravages chez les usagers. Une autre idée intéressante serait de rapprocher les réglementations à établir sur les produits actuellement illicites de celles qui existent sur les produits actuellement licites (tabac, alcool, médicaments psychotropes…), en rendant les premiers plus faciles d’accès et les seconds au contraire moins faciles d’accès.
Enfin, pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos travaux actuels et vos futurs projets ? Certains de vos derniers travaux portent, par exemple, sur le rôle de l’éthique dans la société, par rapport aux normes et aux rôles sociaux ; allez-vous délaisser pour un temps le champ de l’addiction ?
– Le texte auquel vous faites allusion était en fait une commande de colloque par rapport à des travaux plus anciens sur l’éthique et les normes (voir en particulier Morale et sociologie, folio Gallimard, 2004). Mon orientation actuelle serait plutôt d’essayer de penser l’ensemble de la vie sociale des démocraties libérales sur le mode d’un processus addictif collectif, dont toutes les fins convergent sur les satisfactions liées aux différents objets sur lesquels on se fixe, sous l’effet de la profusion des offres et des incitations publicitaires et marchandes. Le fait d’avoir travaillé pendant quinze ans sur des questions de dépendance et d’addiction m’oblige alors « logiquement », si l’on peut dire, à envisager aussi le contrepoint naturel de la dépendance et de la domination addictive, qui est tout simplement l’émancipation individuelle et politique, si on pense que la société comme un tout maîtrise de moins en moins les processus d’intenses consommations qu’elle a hautement favorisés : technologies, ressources naturelles, argent, positions, divertissements, drogues, sexualités et plaisirs…
Ma ligne de recherche actuelle est d’essayer de repenser la liberté positive, non pas en termes d’auto-accomplissement, mais plutôt en termes d’émancipation politique et d’auto-émancipation. Je pense qu’il y a aujourd’hui plus à apprendre dans le domaine de la liberté positive que dans celui de la liberté négative (sous ses formes de non-interférence ou de non-domination) – quoique celle-ci ait toujours besoin d’être défendue mordicus. D’un point de vue politique, la liberté positive au sens d’auto-accomplissement peut être antinomique de la liberté négative. Mais ce n’est pas le cas de la liberté positive au sens d’auto-émancipation qui exclut, par définition, tout contrôle moral extérieur, sinon intérieur.
Permettez-moi pour finir de vous remercier très vivement pour les questions que vous avez bien voulu me poser.