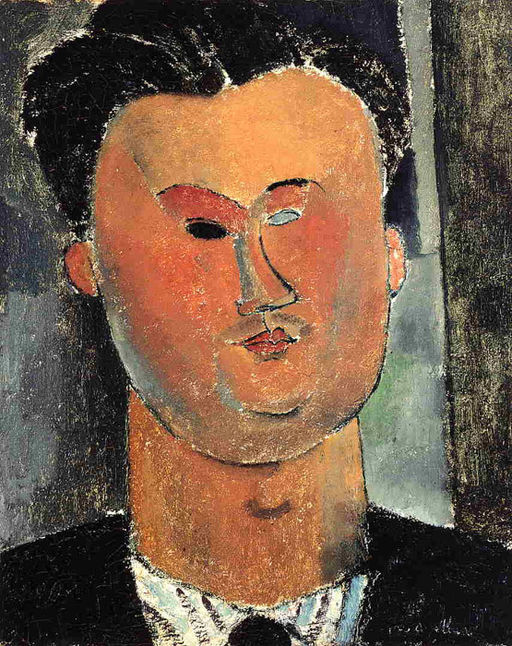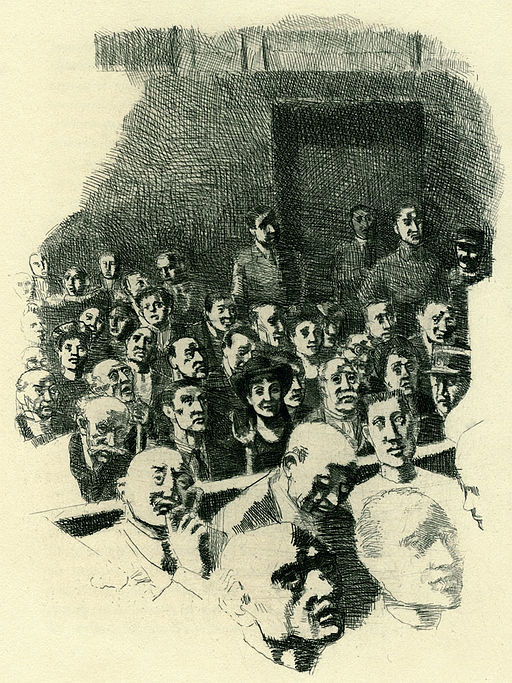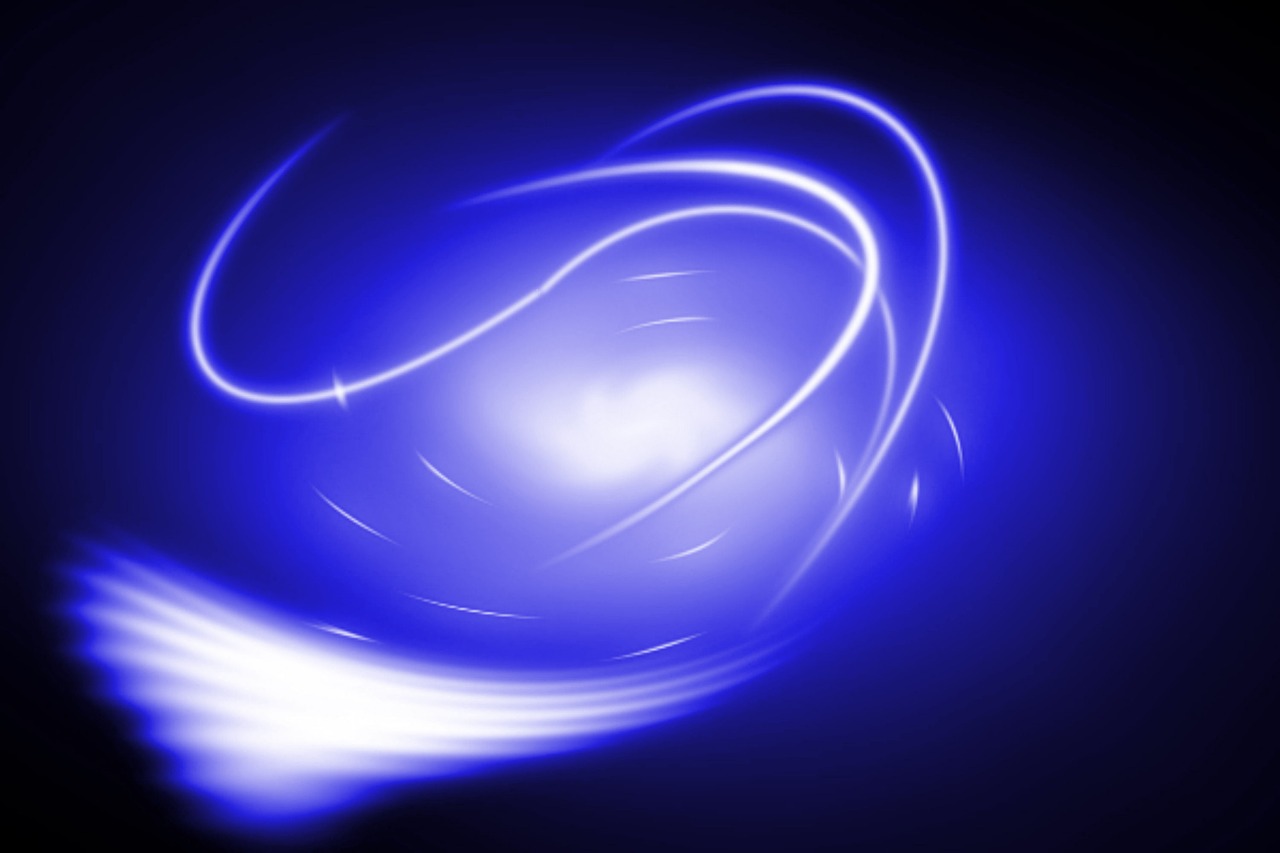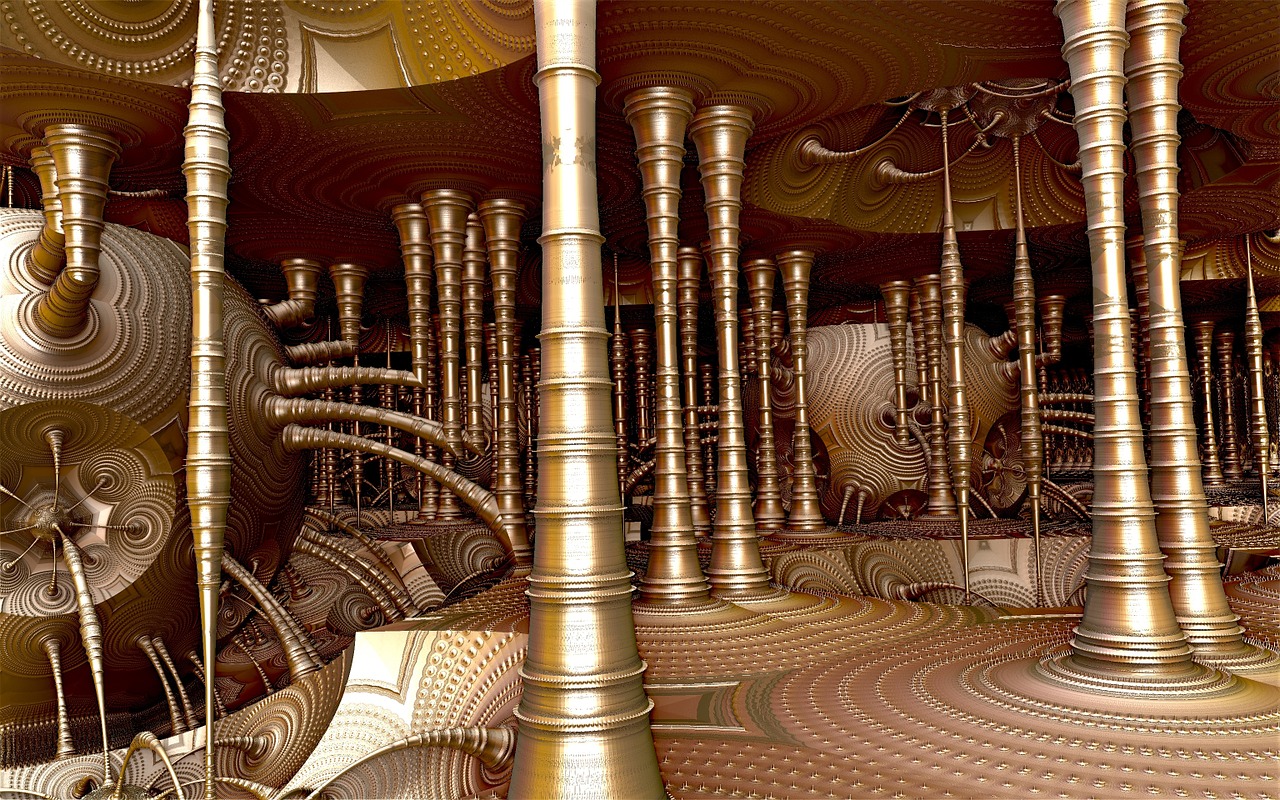Le café ou le néant
Enquête sur l’absurde dans le café romanesque français des années 1930-1950
David Bélanger, doctorant en études littéraires à l’Université du Québec Montréal
Thomas Carrier-Lafleur, chercheur postdoctoral au département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques de l’Université de Montréal
Résumé : À travers la thématique de la représentation littéraire du concept philosophique de l’absurde, ou, pour le dire autrement, le thème de la minceur de l’existence, le présent article souhaite faire la lumière sur un sujet majeur du roman moderne de la première moitié du vingtième siècle : celui des cafés. Comme nous l’apprend Roquentin dans La Nausée ou Sartre dans L’Être et le néant, le café est un lieu où l’existence se remarque, se pèse et s’étudie. C’est ainsi que nous nous intéresserons à l’opposition entre le café, lieu en apparence fixe et routinier, et la rue, pleine d’agitation et de renversements. C’est grâce à ce jeu entre le repos et la vitesse propre à la dialectique du café et de la rue que le roman est en mesure de réfléchir l’existence moderne et, par conséquent, la sienne. Cette enquête sera menée à travers la lecture de deux romans qui ont été choisis pour leur complémentarité temporelle et thématique : d’une part, Le Chiendent (1933) de Raymond Queneau et, d’autre part, Les Gommes (1953) d’Alain Robbe-Grillet.
Abstract: Through the theme of the literary representation of the philosophical concept that is “l’absurde”, or, to put it another way, the theme of the thinness of existence, this article aims to shed a light on a major motif of the modern novel from the first half of the twentieth century: the cafe. We learn with Roquentin in La Nausée or with Sartre in L’Être et le néant that the cafe is a place where the existence is noticed, weighed and studied. We will focus on the opposition between the cafe as a fixed and humdrum location, and the street, full of turmoil and overturns. It is through this play between rest and speed, specific to the dialectic of the cafe and the street, that the novel is able to reflect the modern way of existence and, therefore, his own. This article will travel through two novels that have been chosen for their temporal and thematic complementarity: on one hand, Raymond Queneau’s Le Chiendent (1933), and on the other hand, Alain Robbe-Grillet’s Les Gommes (1953).
La grande fatigue de l’existence n’est peut-être en somme que cet énorme mal qu’on se donne pour demeurer vingt ans, quarante ans, davantage, raisonnable, pour ne pas être simplement, profondément soi-même, c’est-à-dire immonde, atroce, absurde.
— Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit
Il y va de la grande allégorie sartrienne, elle a été trop souvent disséquée pour s’y attarder encore, sinon peut-être pour en rappeler l’essentiel : « il faut observer que, dans la perception, il y a toujours constitution d’une forme sur un fond[1]. » C’est dans L’être et le néant que Jean-Paul Sartre énonce cette maxime qui justifie cette description d’une scène du quotidien, dont le décor est celui, désormais célèbre, d’un café :
Il est certain que le café, par soi-même, avec ses consommateurs, ses tables, ses banquettes, ses glaces, sa lumière, son atmosphère enfumée, et les bruits de voix, de soucoupes heurtées, de pas qui le remplissent, est un plein d’être. Et toutes les intuitions de détail que je puis avoir sont remplies par ces odeurs, ces sons, ces couleurs, tous phénomènes qui ont un être transphénoménal. Pareillement la présence actuelle de Pierre en un lieu que je ne connais pas est aussi plénitude d’être. […] Lorsque j’entre dans ce café, pour y chercher Pierre, il se fait une organisation synthétique de tous les objets du café en fond sur quoi Pierre est donné comme devant paraître. Et cette organisation du café en fond est une première néantisation[2].
Et Sartre ajoutera : « Ainsi cette néantisation première de toutes les formes, qui paraissent et s’engloutissent dans la totale équivalence d’un fond, est la condition nécessaire pour l’apparition de la forme principale, qui est ici la personne de Pierre[3]. » L’exemple plus que le principe importe dans cette assertion : le café sert à Sartre à exprimer l’interaction, c’est le lieu où rabattre le singulier sur le général, et, inversement, le décor sur son sujet. Le café, plus encore, paraît si chargé, pour le philosophe, qu’il est aussi permis d’entendre quelque métatexte dans cette scène du café, où Sartre philosophe ferait résonner le Sartre romancier de La nausée, paru presque dix ans plus tôt. Antoine Roquentin est alors en errance dans une petite ville, il va de café en café et cherche moins à justifier sa vie qu’à se convaincre de son existence : « Pour personne, Antoine Roquentin n’existe. Ça m’amuse. Et qu’est-ce que c’est que ça, Antoine Roquentin ? C’est de l’abstrait[4]. » Cette quête radicale d’existence s’ancre dans le climat apaisant des cafés, qui s’opposent dialectiquement aux routes méandreuses où le narrateur se perd : « Je suis au café Mably, je mange un sandwich, tout est à peu près normal. D’ailleurs, dans les cafés, tout est toujours normal[5]. » Individus existants ou personnages romanesques, tous, dans les cafés, trouvent un rôle qui leur sied. Ils s’inscrivent, pour reprendre les termes du Sartre philosophe, dans un fond sensé : « ils prennent un café et jouent au poker d’as : ils font un peu de bruit, un bruit inconsistant qui ne me gêne pas. Eux aussi, pour exister, il faut qu’ils se mettent à plusieurs[6]. » Mais cela ne sait produire un plein d’existence, au terme de la quête de Roquentin ; les cafés servent de contexte où le sens se crée et se perd, établi dans l’ordre social puis aussitôt − comme Sartre philosophe l’énonçait − néantisé : « Elle n’existe pas. […] À travers des épaisseurs et des épaisseurs d’existence, elle se dévoile, mince et ferme, et quand on veut la saisir, on ne rencontre que des existants, on bute sur des existants dépourvus de sens[7]. » Voilà comment le café sert, chez Sartre, à faire ressortir la constitution du sens et de l’être : comme fond du commun, le café désigne l’individu dans son être, mais le lieu même doit s’effacer pour laisser la place à l’individu particulier, comme l’individu est appelé à s’effacer dans le lieu commun.
Le présent article ne retiendra de cette dialectique que l’intuition première : le café est un lieu significatif, en littérature − notamment entre 1930 et 1950, de la fin des années folles à l’âge d’or de l’existentialisme −, pour exprimer l’absurdité de l’existence. Métatexte porteur d’une série de situations réflexives sur la place de l’être et de la pensée, le café est également un métalieu, embrayeur de situations romanesques typées, reprises par de nombreux auteurs de l’époque, dont plusieurs écrivaient leurs œuvres à même les cafés. Nous suivons cette intuition en nous fondant sur deux principes. Le premier, méthodologique, soutient la proposition de Pierre Macherey au centre d’À quoi pense la littérature ? :
La philosophie littéraire, dans la mesure où elle est inséparable des formes de l’écriture qui la produisent effectivement, est une pensée sans concepts, dont la communication ne passe pas par la construction de systèmes spéculatifs assimilant la recherche de la vérité à une démarche démonstrative. Les textes littéraires sont le siège d’une pensée qui s’énonce sans se donner les marques de sa légitimité, parce qu’elle ramène son exposition à sa propre mise en scène[8].
La littérature comme « refoulé de la philosophie » s’étudie, dans un horizon philosophique, en s’appuyant moins sur des concepts que sur des mises en scène. Son organisation au sein d’espaces diégétiques et de tensions narratives est effectivement réfractaire, par principe, aux concepts. Le café paraît alors, à la fois comme scène et comme lieu commun − frappé d’interdiscours, de déjà-dit et d’intertextes −, des plus porteurs pour l’analyse de l’absurdité existentielle ; informé par la démarche sartrienne, porté par ses propres représentations historiques − le café des Dada, le café des hommes de lettres des Lumières, dont on ne pourrait retenir, pour représentation, que Le Neveu de Rameau − il porte sa propre histoire, il est topos. Ainsi le café est-il à la fois espace textuel et espace discursif. Le second principe qui nous fait enfourcher cette intuition est à trouver, forcément, dans les textes représentatifs où ces cafés semblent chargés des mêmes tensions : traversés d’existants partiels, dont les rôles sont prédéfinis, formatés. Lieu qui s’oppose aux errances individuelles, également, qui s’offre en termes « d’ancrage », mais un ancrage qui ne sait donner de sens. On en retrouve des exemples chez Aragon, Sartre, Miller, Bataille, Céline, Queneau, Robbe-Grillet…
Pour les besoins du présent article, nous porterons notre attention sur les œuvres des deux derniers auteurs : Le Chiendent[9] et Les Gommes[10]. Notre démarche paraîtra peut-être peu orthodoxe ; elle consistera à traverser le corpus de façon descriptive, ce qui offre l’avantage de focaliser le regard sur la mécanique et le déroulement du récit, en s’attachant à expliciter les représentations du café pour, au terme de rapides analyses, présenter quelques premières conclusions, prolégomènes à une recherche plus large. Ces conclusions partielles, mais, souhaitons-le, éclairées, s’accorderont évidemment avec notre hypothèse de départ, à savoir que le café agit, au sein des fictions, comme pauses − telles que les entendait Genette dans son Discours du récit[11] −, au caractère métadiscursif explicite, mais aussi bien en tant qu’espace discursif saturé, comme, pour le dire simplement, des lieux communs. Ils sont en cela opposés aux quêtes existentielles des individus-personnages. C’est évidemment l’absurdité de cette existence que mesurent alors les cafés. De là, il sera permis de penser le café dans son incidence discursive, à savoir, comme relayeur de topoï, d’évidences, comme chasseur d’incertitudes. La première hypothèse, en ce sens, se repliera sur la seconde pour montrer comment l’action d’un roman peut produire du discours. Cette éversion pourrait, en soi, constituer l’objet de cet article ; on en tirera les conséquences en conclusion.
Le café : un allié
La dialectique est simplement exprimée : la ville des Gommes est traversée de routes labyrinthiques où Wallas se perd sans cesse − perdant son identité à certains détours, quand l’ivrogne le confondra avec l’assassin rencontré la veille ou quand la remplaçante aux postes le confondra avec son client, lui aussi croisé la veille −, et le café, au contraire, est connu d’avance, convenu même, chaque élément, chaque personnage se trouve là où il doit. Au café, impossible de se perdre. La narration explicite à divers moments cette opposition :
[Wallas] s’étonne de se trouver tellement à son aise dans ce bistro malpropre ; est-ce seulement parce qu’il y fait chaud ? Après l’air vif de la rue, un bien-être légèrement engourdi pénètre son corps. Il se sent plein de bienveillance pour ce clochard ivre, et pour le patron lui-même qui pourtant n’encourage guère la sympathie. (LG : 118)
Les gens sont communs dans ce café, et parfois, comme le fait la vieille dame qui vient appeler pour annoncer la blessure, prétendument mortelle, de son maître, on y joue une comédie : « elle paraissait pourtant vouloir atteindre, au-delà [du patron], un auditoire plus vaste, comme une foule sur une place publique » (LG : 27). Le lieu est ainsi organisé, et l’existence, certes typée, trouve là un certain fond. Wallas y revient, dans cette salle « chaude et accueillante », « comme vers un refuge » (LG : 230). Lorsqu’il n’y est pas, il ne fait que s’égarer dans les rues de la ville, menant son enquête comme on se perd dans un labyrinthe :
Est-ce une disposition particulière des rues de cette cité qui l’oblige à demander sans cesse son chemin, pour, à chaque réponse, se voir conduit à de nouveaux détours ? Une fois déjà il a erré au milieu de ces bifurcations imprévues et de ces impasses, où l’on se perdait encore plus sûrement quand, par hasard, on réussissait à marcher tout droit[12]. (LG : 136)
Les chemins sont changeants et inattendus, presque sans balises. Avec un boulevard nommément circulaire (il s’agit précisément du « boulevard Circulaire »), il est peu étonnant que le personnage tourne en rond et progresse par spirales ; de même, la rue où est sis le Café des alliés se nomme la rue de l’Arpenteur, intertexte des plus explicites au personnage de Kafka, personnage lui aussi invité à l’errance, toujours repoussé du Château, qui est à la fois partout et nulle part. D’ailleurs, le manoir de la victime, sur le meurtre de laquelle enquête Wallas, se trouve également dans la rue de l’Arpenteur. Quête illusoire, arpentage impossible, le territoire échappe à l’enquêteur, mieux vaut l’espace clos, allié, du café, où chaque identité est vérifiée ; n’est-ce pas le premier souci du patron, déclarer Wallas au commissaire ? « Il s’appelle Wallas, dit-il, Double vé, a, deux èl, a èss. Wallas. Du moins c’est ce qu’il prétend. » (LG : 124. Sic).
Un autre lieu significatif est franchi et refranchi par Wallas dans son errance dans la ville : le pont. Plus encore, le pont-bascule, qui coupe la route pour laisser les embarcations filer sur le canal. L’assassiné, dans Les Gommes, assassiné qui ne l’est pas − qui prétend la mort pour que l’on ne tente pas de l’assassiner de nouveau − se nomme bien Dupont. C’est ce pont qui bascule sans cesse dans le roman : victime d’un meurtre qui n’a pas eu lieu, il devient l’agresseur un court instant, lequel suffit à ce que Wallas le tue, se rendant coupable du crime qu’il tâchait de résoudre. À force de traverser le pont, tout bascule pourrait-on dire. Les rôles échappent à l’ordre strict. Ainsi se perd-on dans la ville.
Or, c’est le café qui ouvre le récit et qui le ferme, non sans donner l’illusion de la levée d’un brouillard. Mais ce brouillard se lève sur une scène réglée d’avance, comme mythique : « De très anciennes lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions humaines ; chaque seconde marque un pur mouvement […]. Chaque seconde à sa place exacte. Bientôt malheureusement le temps ne sera plus le maître. » (LG : 11) Qui donc commandera, dès lors ? Les événements, poursuit la narration :
Les événements de cette journée, si minimes qu’ils puissent être, vont dans quelques instants commencer leur besogne, entamer progressivement l’ordonnance idéale, introduire çà et là, sournoisement, une inversion, un décalage, une confusion, une courbure, pour accomplir peu à peu leur œuvre : un jour, au début de l’hiver, sans plan, sans direction, incompréhensible et monstrueux. (LG : 11)
Ainsi, l’incipit ploie-t-il sous le poids de l’extérieur, quelque chose aura lieu – forcément −, qui n’a rien à voir avec l’ordre strict et immémorial de ce café, ni avec les mouvements répétitifs du patron ni avec les scènes répétitives de la salle commune. Quelque chose en sortira, sans plan, sans direction, à l’instar de Wallas qui se perd dans la ville. D’ailleurs, s’étonnera aussitôt le Patron, Wallas est déjà sorti de sa chambre louée la veille, et le patron « n’aime pas les gens qui se lèvent avant l’heure[13]. » (LG : 14) Parce que dans le café, répétons-le, tout est réglé d’avance.
Retenons pour le moment la force de l’opposition : la routine, le déjà-là, l’habitude qui donne au café sa chaleur, qui en fait un véritable fond, sans étrangeté, sans mise à distance[14]. Devant : les rues inattendues, déréglées, traversées dans la distance, l’étrangeté, la surprise, dans lesquelles se tisse l’absurdité d’une énigme dont le personnage, doutant de plus en plus de lui-même, n’aura jamais la vision globale. La dialectique est simple, et néanmoins révélatrice. Entre la quête, qui se vit dans le mouvement et donc dans la rue, et l’apathie oisive qui trouve son socle dans les cafés − « Et vous avez traîné dans tous les cafés, sans doute aussi, avant de venir ? » (LG : 88) tempête Mme Smite, gouvernante du faux mort à l’adresse de Wallas −, nous avons droit à une construction des plus claires. La quête de Wallas le tire hors de l’espace mythique du café, là où les identités et les actions sont triées ; il se fond, est menacé de se dissoudre, dans la rue, où rien n’est déterminé, où seuls le mouvement et ses changements ont valeur de loi[15]. Finalement, dès le commencement, dans le brouillard de l’incipit, « derrière la vitre, le patron encore qui se dissout lentement dans le petit jour de la rue » (LG : 12) annonce ce jeu de contraste. Retenons ceci car ces effets se multiplient dans Le Chiendent.
Le café : un point de vue
Reprenons l’argument mis en avant jusque-là : « La silhouette d’un homme se profila ; simultanément, des milliers. […] Il venait d’ouvrir les yeux et les rues accablées s’agitaient, s’agitaient les hommes qui tout le jour travaillèrent. » (LC : 9) L’indétermination joue ici du contraste entre le perçu et le percevant, l’actif et le passif. La silhouette, sujet de la première phrase, naît aussitôt énoncée ; à la seconde, elle est née sous le regard d’un « il », elle n’est sujet que si elle est perçue. Le centre de cette perception est double : un personnage, Pierre Legrand, homme oisif qui ne travaille pas − contraste que l’on remarque à la fin de la citation −, et un point de vue, le café, d’où il regarde la rue dans son mélange d’étrangeté et de familiarité. Du café également, parce que c’est un véritable leitmotiv, la veuve Cloche traque les drames qui se passent dans les rues de Paris : « Par une série de hasards soigneusement préparés, elle se trouva assise, vers la même heure, en face du même endroit, à la terrasse d’un café qu’une bienheureuse coïncidence avait justement placé là[16]. » (LC : 41) Les deux grandes actions qui traversent le roman, soit la « naissance » au monde d’Étienne Marcel, le perçu de l’incipit, et la filature de la femme de ce dernier par Narcense, musicien désargenté qui tentera plus tard d’assassiner le fils Marcel ; ces deux naissances se font sous l’œil du badaud de café. Les fils du hasard se nouent donc dans la rue mais se perçoivent grâce aux cafés « qu’une bienheureuse coïncidence » place face à l’action.
Comme chez Robbe-Grillet, le café ouvre et ferme le récit dans Le Chiendent. Lieu de perception et lieu de discours, il sert alors à organiser le commentaire sur les actions, comme une scène où se jouerait un constant métatexte. Là le sens s’organise encore une fois contre le diffus de la rue, son absurdité principielle. Trois exemples, trois cafés, serviront à exprimer cet état et nous amèneront à quelques premières conclusions.
Le café de Blagny est le premier désir d’Étienne Marcel une fois sa naissance à l’existence constatée. En effet, perçu, Étienne naît, il se met à regarder le monde hors de sa routine, de ses itinéraires tracés d’avance, sa vie rencontre le contingent et l’étonnant ; de silhouette dans la foule il commence à prendre de l’épaisseur[17], il deviendra un « être de réalité minime » avant d’acquérir une pleine substance. Touchant aussi bien aux personnages qu’au récit qui leur sert de socle, cette recherche de l’épaisseur existentielle par la mise en scène spatiale d’une pensée qui se cherche à coup de jeux d’esprits et de boutades est sans contredit le motif central de ce premier roman de Queneau. Du train le menant à sa « maison en construction » (LC : 46), Étienne aperçoit l’enseigne, FRITES, du café de Blagny. Il ne comprend pas ce qui l’y attire, mais il s’y rend. « L’endroit n’a rien d’effarant. Des tables et des bancs. » (LC : 48) On le juge aussitôt entré. Petit employé de bureau, assurément peu fortuné − sa maison en construction, faute de fonds pour l’achever, l’atteste − Étienne est mal perçu : « Ce bourgeois, qui ça peut être ? » (LC : 48) Il est vrai que le café est habitué aux catégories du commun, ainsi pensera Étienne à l’arrivée d’un nouveau client : « Tiens, un autre client. C’est un ouvrier. » (LC : 48) Mais en ce lieu où son identité se formate aux catégories préétablies, « l’être de réalité minime ne sait que penser de lui. » (LC : 48) : « Il regarde dans le fond l’autre femme et l’homme. Les frites se mettent à rissoler. Tout cela lui paraît prodigieusement absurde. » (LC : 48) Qui est-il, après tout, dès lors qu’il rejoint ce fond où il prend substance ? Il se présentera aux propriétaires et les « taverniers », devant son nom, ajouteront au burlesque : « Mais alors, dit Meussieu Belhôtel, vous avez déjà votre rue à Paris. » (LC : 51) En effet, Étienne Marcel, marchand parisien du Moyen Âge, est un personnage historique dont une rue porte le nom. Le passage marque bien le sursaut d’être du personnage à la « réalité minime » : attiré vers l’endroit par une force singulière qui l’individualise − il s’agit de sa conquête de l’existence −, il est, aussitôt là-bas, fondu dans le décor, puis rabattu sur ce qu’il n’est pas, un bourgeois, un nom de rue. Plus que jamais, une nouvelle fois, le café et la rue s’opposent dans leur lutte pour définir les identités.
Le café d’Obonne, non loin de la maison en construction d’Étienne Marcel, se fait le siège de nombre de discussions confusément métaphysiques entre les personnages. C’est également là, au début du récit, que Narcense, au terme de sa filature de la femme d’Étienne Marcel, trouve refuge. De même, Pierre Legrand, au terme de sa filature d’Étienne, va s’y rendre. Le café y semble traversé de gestes inconscients. Narcense y « command[e] distraitement un mandarin-curaçao » (LC : 27), un « individu très indéterminé » (LC : 27) y prend la parole, « Narcense égaré laisse de la monnaie sur la table et sort » (LC : 28). Aussi, la « table de marbre [est] veinée de crasse » (LC : 31), on « avait posé négligemment une cuiller, une fourchette, un verre » (LC : 31) sur une table, « le client regardait distraitement une photo de transat » (LC : 31 ; nous soulignons). Le décor est alors celui des discussions sans fondement, pur entrechoquement d’anecdotes qu’énumère le marin jusqu’à ce que le patron « juge bon de faire marcher le phono mécanique. » (LC : 28) On n’y fait rien, dans ce café, on y est à peine quelqu’un. Voilà un lieu tellement typé qu’il est à la limite du non-lieu. Narcense, pourtant, à l’instar de Wallas dans Les Gommes, est jaugé par le patron : « J’ai comme une idée qu’il n’aime pas qu’on lui demande ce qu’il fait. […] Allez, à l’occasion, je saurais donner son signalement à la police. » (LC : 33) C’est donc devant cette scène que Pierre rencontre Narcense. Le premier tient ce langage au second :
Je […] ne connais pas de spectacle plus lamentable que celui des bateaux ivres, qui se dessoûlent dans une gargote de lotissement ; je n’en connais pas de plus ignoble que celui de gargotier qui n’a d’autre but dans la vie que d’espionner, d’espionner sans cesse, jusqu’à ce qu’enfin il se trouve qu’un quelconque criminel passe à sa portée et qu’il puisse enfin servir la société en le dénonçant à la police. Ils sont là tous deux : l’abruti par les latitudes et le mouchard ; leur rencontre donne la sensation d’une éponge d’encre qu’on vous enfoncerait dans le gosier. (LC : 33-34)
L’ivrogne et le patron sont véritablement les archétypes que décrit Pierre ; ceux que l’on rencontre aussi bien chez Sartre que chez Robbe-Grillet. Ils constituent le décor de café, son véritable fond − le café de Blagny a lui aussi son ivrogne et son tavernier −, et ils participent, semble-t-il, de l’ordre du monde, celui-là même que le roman est en train de remettre en question. La généralité avec laquelle s’exprime Pierre − « je ne connais pas de spectacle », sous-tendant que celui-ci s’inscrit dans un temps gnomique, assurément itératif − institue même cet ordre. La longue réplique de Narcense tend vers une autre direction :
Je ne vois pas ça comme vous. Pas du tout. Ce marin est très amusant, bien que ses histoires soient un peu vieillottes. Il se répète ; mais ne vous répétez-vous pas ? Qui ne se répète pas ? […] Moi je trouve ce bistrot splendide et tragique. La lune à moitié dans la vitre. Le patron qui fait semblant de roupiller derrière son zinc, et tend l’oreille. […] Je m’escuse, mais je suis dénué de scepticisme. De plus, je ne suis pas philosophe. Non, vraiment pas. Mais comme ça, de temps en temps, une chose vulgaire me paraît belle et je voudrais qu’elle fût éternelle. Je voudrais que ce bistrot et cette lampe mazda poussiéreuse et ce chien qui rêve sur le marbre et cette nuit même − fussent éternels. Et leur qualité essentielle, c’est précisément de ne pas l’être. (LC : 34-35)
Le vulgaire et le répétitif, l’archétype et le convenu sont alors au centre des gloses de ces personnages ; rejetés de la rue vers cette gargote, au terme de filatures aussi peu justifiées que la venue de l’arpenteur au château − ou que l’enquête de Wallas, dans Les Gommes − les personnages sont alors confrontés au quelconque, routinier, du café. Lorsque Pierre avouera être à Obonne pour observer quelqu’un, Narcense s’exclamera : « Tiens. Romancier ? » Ce à quoi Pierre rétorquera : « Non. Personnage. » (LC : 36) La fiction du moment aussitôt dénudée nous pousse, de notre côté, vers de premiers constats.
Chez Robbe-Grillet comme chez Queneau, on observe les traits du café, toujours les mêmes : ils sont marqués par la stabilité, par la répétition du même. Les gestes du café sont anciens et sous le signe de l’identique, alors que les personnages qui le traversent paraissent versés vers le geste singulier, qu’ils s’expliquent eux-mêmes difficilement. Wallas dans la ville, Étienne Marcel à Blagny ; le tragique destin de Potice semble en faire foi. Cet ami de Narcense, filant avec lui l’épouse d’Étienne, semble frappé par un coup du sort, passant devant un café − coup qui ne peut se lier qu’à l’apprentissage de la rue, jamais à la routine du café : « Absurdement cette ligne idéale de trottoir à trottoir que Potice n’avait pu parcourir jusqu’à son extrémité, absurdement cette ligne lui paraissait devoir attirer maintenant le sort, ou le destin, ou la fatalité. » (LC : 41) Le café est un lieu de perception où la narration peut trouver l’ancrage nécessaire − le fond, encore une fois − pour percevoir la forme du singulier. Le répétitif fait saillir l’exceptionnel. L’individu n’apparaît en tant qu’individu que dans ce lieu de collectivité : Wallas, Étienne, Narcense sont jugés par les patrons car le café est conforme. Voilà une première conclusion : l’expérience du café n’a pas à être authentique, elle peut se contenter de l’abstraction, celle même que constatait Roquentin dans La Nausée. Elle s’en contente, car elle est une expérience non singulière, toujours vécue sur fond de coutume et pétrie d’itérations. Le café devient mise en scène du commun en regard duquel se pensent la rue et ses errances. Pour reprendre la pensée de Macherey, le concept philosophique alors à l’œuvre se trouve en creux : dans le café, il n’y a que la néantisation du sujet, néantisation en un lieu plein où il se fond. Ce néant plein échappe au fardeau d’une vie justifiée et profonde, elle est prise en charge par un décor, des us, et surtout sans doute, un discours. Le néant plein du café annihile l’absurde, tout en le remettant involontaire en avant-plan. Il est une étape à la fois marginale et centrale dans la quête existentielle du roman.
Nous en arrivons ainsi au troisième café dont nous voulons traiter dans Le Chiendent. Ce café n’en est pas un, il est l’idée même du café, qui traverse tout le livre. Narcense disait : « [J]e ne suis pas philosophe. Non, vraiment pas. » Celui qui est philosophe, c’est Descartes et son Discours de la méthode dont Le Chiendent serait une écriture romanesque. Le concierge de l’établissement où loge Narcense, Saturnin, aime à jouer le métaphysicien. Dans un cahier, il trace un projet d’écriture : « En épigraphe, mettre ça : Descartes ; on se demande pourquoi, dans les cafés, les joueurs appellent si souvent le garçon par ce nom. » (LC : 96) Et il précisera aussitôt : « On se demande pourquoi, dans les cafés, les joueurs appellent si souvent le garçon Descartes. » (LC : 96) La philosophie du garçon de café est annoncée, sceptiquement, par Saturnin. Cette dernière idée nous amènera à notre conclusion.
Le café : un discours
« Pas chaud ce matin » (LG : 53), lance Wallas au remorqueur en traversant le pont-bascule. Et le repassant, c’est un cycliste qui l’interpelle : « Pas chaud ce matin » (LG : 57). « Pas chaud ce matin ! » répétera plus tard Wallas en entrant au café « pour dire quelque chose » (LG : 116). Le lieu commun est ici répété, marquant cette sorte de poétique du quotidien. De même, chez Queneau, la météo devient le phénomène du quotidien, appelant ses formes préétablies :
Description d’un orage à Paris. En été. Les craintifs se mettent à galoper ; d’autres relèvent le col de leur veston […]. Ça commence à sentir la boue. Beaucoup cherchent un abri, sagement ; et lorsque la pluie bat son plein, on ne voit plus que des groupes noirâtres accrochés aux portes cochères […]. Les cafés font recette. (LC : 21)
Plus tard, Narcense rôde près de chez les Marcel, « ne sait que faire. Bien heureusement, un événement extérieur précis le détermine. Il se met à pleuvoir avec violence. Et le voilà qui galope vers le plus prochain abri. Un bistrot. » (LC : 27) Dans ces romans, un discours de la banalité − la météo, en l’occurrence, mais d’autres aussi − installe le stéréotype, l’évidence, au centre de la fiction. Comme le café est le topos par excellence, lieu commun au sens littéral, le discours − philosophique, intertextuel, quotidien − s’y trouve en parfaite homologie, s’opposant, comme le café, aux quêtes fragmentaires d’un romanesque qui se cherche lui-même. « L’observateur laisse parvenir jusqu’à lui ces paroles [de météo] vaines qui ne disent rien d’autre que la vérité ; il constate avec amertume que ces banalités correspondent parfaitement à la réalité. » (LC : 22), souligne la narration après qu’une rumeur se soit élevée dans le café quant à la rage météorologique. Et d’ajouter, non sans qu’on y lise quelque discours sur le romanesque lui-même : « La réalité présente n’en demanderait-elle pas plus ? » (LC : 22)
À « l’époque de la reproduction mécanisée » comme le souligne le titre du célèbre essai de Walter Benjamin, d’ailleurs contemporain de nos romans, le déjà-dit, le déjà-là, devient le socle des discours. Ruth Amossy et Anne Herschberg-Pierrot rappellent à cet égard que le stéréotype est avant tout un terme d’imprimerie, et que celui-ci est constitutif du sujet − pas seulement écrit. « Tout locuteur est toujours traversé par le discours de l’Autre, la rumeur publique qui sous-tend ses énoncés[18]. » Loin de stigmatiser cet état de fait, Amossy et Herschberg-Pierrot conçoivent dans le cliché une conscience du vivre ensemble, une sorte de nécessité productive. Au contraire, hanté par l’esprit romantique, Benjamin voyait dans cette reproductibilité − il ne parlait que peu de l’écrit, mais les effets sont les mêmes − la perte de l’aura :
Qu’est-ce qu’en somme que l’aura ? Une singulière trame de temps et d’espace : apparition unique d’un lointain, si proche, soit-il. […] Cette déchéance [de l’aura] est due à deux circonstances, en rapport toutes deux avec la prise de conscience accentuée des masses et l’intensité croissantes de leurs mouvements. Car : la masse revendique que le monde lui soit rendu plus « accessible » avec autant de passion qu’elle prétend déprécier l’unicité de tout phénomène en accueillant sa reproduction multiple[19].
Entre le café du commun et les quêtes singulières, la même tension s’observe. Tout fonctionne comme si l’aura du romanesque – ce lointain qui appelle les personnages-enquêteurs – tâchait de survivre dans un monde aux signifiés marqués d’avance : la quête de Wallas ne sera jamais que la répétition structurale de l’aventure d’Œdipe, comme le souligne l’ivrogne du Café des alliés à plusieurs reprises, comme la quête d’Étienne Marcel, qu’une sorte de parodie de la recherche de vérité cartésienne, dans une ère où le « je », l’« être » et le « penser » sont teintés de soupçon. Indirectement, par le biais d’une mécanique romanesque, qui, elle, est originale, Les Gommes et Le Chiendent ne cessent de marteler que plus rien n’est authentique. C’est ainsi que l’on doit entendre la réplique de la narration : « La réalité présente n’en demanderait-elle pas plus ? » Pour répondre à cette faille absurde de la réalité, qui est d’abord et avant tout celle des mots et des choses, le roman proposera une mécanique formelle réflexive qui permet à la fois de brouiller et d’épaissir l’existence. Sur ce point, l’Oulipo et le Nouveau Roman iront d’ailleurs plus loin que l’existentialisme. La plus grande absurdité est maintenant celle d’un roman qui ne réfléchit pas ses propres conditions d’existence. Voilà peut-être la seule manière de conserver un peu d’aura – la plus grande valeur d’existence qui soit – dans un monde où tout se mécanise, même l’écriture, même la métaphysique, même les moulins à café.
Lors de la dernière scène du roman, dans un café – où sinon ? –, la veuve Cloche rencontre, après des années de guerre, son frère Saturnin et Étienne Marcel. Elle s’informe : « À quoi vous passez vot’ temps ? » Et Étienne de répondre : « Autrefois, on faisait de la métaphysique […] On en fait encore de temps en temps […] mais ça devient de plus en plus rare » « Pourquoi ça ? » s’étonne la veuve. « À cause de la pluie », laisse tomber Saturnin, innocemment. La veuve exultera et assurera, doctement, avec l’accent d’un Louis XIV, « eh bien, la pluie, c’est moi… » (LC : 427). La pluie sera alors décrite dans sa construction et sa destruction des empires, dans sa toute-puissance face au monde, son affreuse banalité balayant les sujets humains dans leur quête − assurément illusoire − de métaphysique. Roquentin le disait déjà en 1936, Étienne Marcel et Saturnin en convenaient en 1933, Wallas fut quelque peu forcé de l’avouer en 1953 : l’être, cette forme qui prend de l’épaisseur dans le roman, n’est qu’une abstraction qu’avale le fond du commun. Tout se passe comme si la grande quête existentielle du roman des années 1930-1950 avait consisté à dire, aplanissant les personnages et sérialisant les lieux, que penser ne suffit pas à être. On ne s’étonnera pas alors du fait que Descartes n’occupe plus que la place du garçon de café.
[1] Jean-Paul Sartre, L’Être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1986 (1943), p. 44.
[2] Ibid., p. 43-44.
[3] Ibid., p. 44.
[4] Jean-Paul Sartre, La Nausée, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972 [1938], p. 239.
[5] Ibid., p. 20.
[6] Ibid., p. 21.
[7] Ibid., p. 245.
[8] Pierre Macherey, À quoi pense la littérature ?, Paris, Puf, coll. « Pratiques théoriques », 1990, p. 198.
[9] Raymond Queneau, Le Chiendent, Paris, Gallimard, 1974 [1933]. Désormais, les références à cette édition seront marquées par (LC : suivi du numéro de page).
[10] Alain Robbe-Grillet, Les Gommes, Paris, Minuit, 1953. Désormais, les références à cette édition seront marquées par (LG : suivi du numéro de page).
[11] Voir Gérard Genette, « Discours du récit », dans Figures III, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 133-138. Il s’agit des « pauses descriptives » « où un segment quelconque du discours narratif correspond à une durée diégétique nulle » (128). Mais ces « pauses » remarque-t-il en s’appuyant sur l’exemple proustien, ne sont que rarement de véritables pauses des actions : elles changent de régime temporel sans néanmoins arrêter l’enchaînement actionnel propre au récit. On change simplement de registre de récit, et les actions s’y déroulent à côté de l’action principale. »
[12] Sentiment d’autant plus prégnant que, lors d’une discussion dans le Café des alliés, deux personnages se disputent sur « la signification du mot oblique » (LG : 231). L’un prend l’exemple de la ville du roman pour illustrer son point : « Tu ne comprends pas : je dis que je peux aller droit, tout en suivant une direction qui est oblique − oblique par rapport au canal. » (LG : 232) Et il s’étonnera auprès de Wallas du scepticisme de son interlocuteur, marquant à la fois sa propre bêtise et, par sorte de métonymie, celle qui semble organiser les rues de la ville : « Vous avez entendu, Monsieur ? Voilà un type censément instruit qui n’admet pas qu’une ligne puisse être à la fois oblique et droite. » (LG : 232)
[13] Référence symptomatique : aux premiers moments du roman, la montre d’Albert Dupont a cessé de fonctionner. Ayant survécu à une tentative de meurtre, voilà le moindre de ses soucis. Or, lorsque Wallas le tuera bel et bien, le confondant avec l’assassin qu’il traquait, cette même montre se remettra à fonctionner. Alors que l’on avait annoncé la mort d’un Dupont la veille, on rappellera, deux jours plus tard, la mort répétée du Dupont, faisant s’exclamer un badaud du café : « Tu ne vas pas nous faire croire […] qu’on tue tous les soirs un type qui s’appelle Dupont. » (LG : 262) Le temps déréglé est ici le grand orfèvre du drame en marche.
[14] Ainsi pourrait-on se risquer à avancer que le café est une sorte de campagne en pleine ville, un microcosme non romanesque qui vient mettre un frein à l’agitation urbaine, mais qui dans le même mouvement la relance. Cette idée est fédératrice pour notre corpus romanesque. On en trouve plusieurs manifestations, par exemple, dans Le Paysan de Paris, dont ici, alors que le narrateur se lance dans une longue description du café Le Petit Grillon : « Les clients de ce café, ce sont des habitués que j’ai vus depuis des années revenir aux mêmes places, et que rien ne distingue des autres hommes. Qu’est-ce qui les attire ici ? Une espèce d’esprit de province peut-être. Ce sont pour moi des fantômes si naturels que je n’y prête guère d’attention. » (Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972 [1926], p. 34). Cette présence fantomatique des êtres et de leur mode d’apparition, également propre à l’ambiance du café, est aussi très présente dans Les Gommes et Le Chiendent.
[15] La loi est, à cet égard, un litige dans Les Gommes. Outre le fait qu’il s’agisse d’un roman policier, on assiste également aux affrontements entre divers services de police, faisant s’exclamer le commissaire : « J’avais tort, sans doute, de me croire responsable de la sécurité publique dans cette ville. » (LG : 67)
[16] D’ailleurs Radu I. Petrescu utilise cette phrase pour appuyer l’hypothèse de lecture suivante : « On pourrait considérer l’histoire racontée dans Le Chiendent comme un engin (narratif) qui fonctionne à base de hasards décidés par l’instance auctorielle. Cette contradiction entre les termes peut faire sourire, mais n’en est pourtant pas moins valable : les personnages doivent subir les décisions que leur auteur, du haut de sa “transcendance”, prend à leur égard. » Cela dit, la démonstration s’avère décevante : appuyant tout son argument sur la pratique d’écriture de Queneau, l’argument semble inapte à rendre compte du texte à l’étude. Dans « “Une série de hasards soigneusement préparés.” Notes sur Le Chiendent de Raymond Queneau », Agathos, vol. i, no i, p. 94. Pour un article sur Le Chiendent qui rencontre davantage notre propre lecture du roman, voir Philippe Sabot, « Trois figures littéraires du philosophe », Europe, no 849-850, p. 227-248.
[17] Alain Robbe-Grillet fait d’ailleurs de cette scène un moment des plus importants de la littérature moderne, qu’il rapproche du Château de Kafka : c’est la naissance du personnage, être typé du roman bourgeois, qui serait, pour Robbe-Grillet, désigné par cette scène. Dans Préface à une vie d’écrivain, Paris, Seuil/France Inter, 2005 − enregistrement audio.
[18]Ruth Amossy et Anne Herschberg-Pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Nathan, coll. « 128 », 1997, p. 99.
[19] Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproduction mécanisée », Zeitschrift für Sozialforschung, no 5 (1936), p. 43-44.