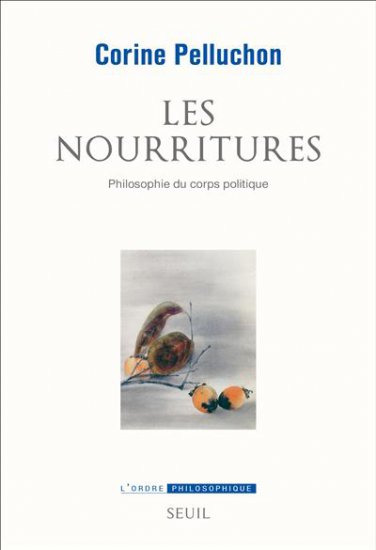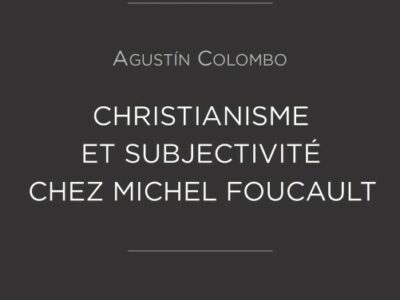Recension – Les nourritures
Recension par Nicolas Delon de l’ouvrage de Corine Pelluchon, Les nourritures – Philosophie du corps politique, Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 2015
Nous sommes ce que nous mangeons, dit-on. Généralement, nous mangeons ce que nous ne sommes pas. C’est, pour nous animaux, ce que signifie être hétérotrophes : nous incorporons une matière organique étrangère pour croître. Parce que manger nous définit par le style de vie que nous adoptons, les choix de consommation que nous faisons et ceux que nous incluons ou non dans le périmètre de ce qui ne se mange pas, ce que nous mangeons nous caractérise aussi sous l’aspect éthique – par l’implication de ceux que nous mangeons et de ceux qui cultivent et produisent nos nourritures. Le nouveau livre de Corine Pelluchon est un livre ambitieux et imposant à bien des égards, au carrefour du champ peu étudié de la philosophie de la nourriture[1] – sous ses aspects éthiques, esthétiques (de la cuisine comme art aux plaisirs de la bouche), économiques et écologiques – et de la philosophie politique. Son sous-titre, Philosophie du corps politique, est volontairement ambigu. L’ouvrage propose en effet une philosophie politique adossée à une ontologie du corps vivant, en même temps qu’une réflexion à part entière sur le corps politique.
Les nourritures s’inscrit dans le prolongement des travaux précédents de l’auteur, notamment L’autonomie brisée (Paris, PUF, 2009) ou Éléments pour une éthique de la vulnérabilité. (Paris, Le Cerf, 2011). Philosophie du sujet incarné, vulnérable, dépendant, l’articulation entre philosophie politique et ontologie de Corine Pelluchon a ouvert dans le paysage bioéthique français des horizons inédits, rapprochant par exemple l’éthique du care et la pensée de Heidegger ou Levinas. Participant du développement, en France, des recherches en sciences humaines et sociales, et des discussions publiques, sur le thème de la vulnérabilité et de la dépendance, à côté des éthiques dites du care ou de la philosophie du soin, l’éthique de la vulnérabilité de Corine Pelluchon offre une voie supplémentaire adossée à la tradition phénoménologique[2]. Les nourritures poursuit cet effort en proposant cette fois-ci rien moins qu’une fondation du contrat social sur l’ontologie (du sujet incarné). Alors que l’éthique de la vulnérabilité était centrée sur « le souci de ne pas imposer aux autres hommes et aux autres vivants une vie diminuée », la phénoménologie des nourritures est centrée sur la joie (p. 251). Pour ainsi dire, à la responsabilité négative de la première succède la responsabilité positive (faire et laisser jouir) de la seconde. Procédant par la méthode husserlienne de la réduction phénoménologique, et puisant notamment dans l’œuvre de Levinas et du phénoménologue japonais Watsuji Tetsurō, l’auteur centre son projet sur l’hypothèse fondamentale selon laquelle « vivre, c’est vivre de », dont l’un des corollaires est que « dès que je mange, je suis dans l’éthique » (p. 179).
« [N]otre ambition, dans ce livre, est d’élaborer une philosophie de l’existence qui prolonge l’effort de Levinas, lequel a pensé le “vivre de” mais n’a pas tiré les conséquences politiques de sa réflexion sur ce qu’il appelle l’“élémental” et le monde comme nourritures. » (p. 29)
Le corps du sujet politique (non-humains inclus) est au fondement du contrat social, qui doit viser son épanouissement dans la mesure même où le sujet est incarné. Or le corps du sujet est situé et dépendant d’un milieu, lui-même décliné à plusieurs niveaux : l’environnement, le paysage, la communauté locale et globale, la nature, la biosphère, ainsi que les générations passées, actuelles et futures. Chaque sujet, si l’on peut dire, vit avec et pour tous ces autres êtres au sens où sa propre existence est de part en part relationnelle selon ces dimensions — ou structurée par ces « existentiaux ». Mais chaque sujet, pour les mêmes raisons, vit de ces êtres : dépendant et jouissant en même temps des plaisirs, joies, délices et moments partagés que lui offre — sinon de fait, en droit — la vie. La phénoménologie du « vivre de » situe ainsi au carrefour des multiples aspects de l’espace et du temps le sujet du contrat social.
Seulement, dans la mesure où l’ontologie évoquée dégage des « biens premiers », non seulement d’une vie digne d’être vécue, mais d’une vie de jouissance et de convivialité, il ne s’agit plus du sujet désincarné — indépendant et théoriquement égal — de la tradition contractualiste, de Hobbes et Locke à Rawls. Aux ressources sont substituées des nourritures ; aux droits naturels inhérents de l’individu des droits relationnels construits. Cette phénoménologie est en outre à la fois universaliste et existentielle. Les existentiaux dégagés ne constituent pas une essence immuable mais les structures même de l’existence en contexte. Pour autant, ces structures sont universelles et l’on peut en déduire des principes qui le sont aussi. L’auteur mène une discussion serrée des principaux auteurs de la tradition contractualiste, puisant chez chacun les éléments qu’elle juge essentiels au contrat social tout en rejetant les présupposés responsables de l’incapacité du contractualisme de rendre compte de façon satisfaisante de nos obligations envers les générations futures, l’environnement, les animaux et les plus pauvres et vulnérables de la planète.
« Le problème politique auquel le contrat social doit pouvoir apporter une solution est le suivant : imaginer une forme d’association qui protège la personne, les biens et l’intimité de chaque associé et encourage la convivialité et la justice conçue comme partage des nourritures. » (p. 254)
Contre les « philosophies de la liberté », l’auteur soutient que la jouissance de chacun n’est possible qu’à condition de reconnaître le lien entre habitation et cohabitation (donc relations à l’environnement et aux autres habitants de cet environnement). Il en découle, selon elle, que « certains biens premiers donnent lieu à des droits qui doivent orienter les politiques publiques et les échanges nationaux et internationaux » (p. 248), notamment un droit à l’alimentation :
« Tout être a droit aux aliments assurant sa vie, y compris les animaux qui se nourrissent en chassant leurs proies. Laisser des vivants sans nourriture est un crime qu’aucune circonstance n’atténue. » (ibid.)
* * *
L’ouvrage est divisé en deux grandes parties, chacune composée de trois chapitres. La construction est simple et élégante et fait volontairement écho à la méthode contractualiste. Alors que dans les théories classiques de la justice – chez Locke, Hobbes, Rousseau, Kant ou Rawls – on part d’une certaine anthropologie, souvent idéale, pour en dégager les fondements d’une société juste, Corine Pelluchon fonde l’institution d’un nouveau monde commun sur sa phénoménologie des nourritures. L’ontologie joue peu ou prou le rôle de l’état de nature dans la tradition contractualiste. En disparaissent le constat de la compétition et de l’intérêt propre et les réquisits d’indépendance et la rationalité. Il n’en reste pas moins que, pour autant que nous devons vivre ensemble, nous le devons selon des principes de justice directement déduits, non plus tant d’une anthropologie philosophique que d’une ontologie du sujet incarné, et que la forme de validation de ces principes est elle-même entendue comme un contrat social : « les principes de la justice comme partage des nourritures […] sont déduits des existentiaux décrits dans la première partie de ce livre » (p. 260).
Le sujet politique est décrit comme un « cogito gourmand », et le droit de se nourrir, suffisamment et bien, est le premier des droits. Quoiqu’ils ne soient pas eux-mêmes des « cogito », et ne puissent « énoncer les principes de la justice et en déduire des lois » (p. 259), les animaux[3] sont eux aussi les destinataires directs de la justice. Non seulement parce que nous dépendons d’eux mais parce qu’ils ont chacun leur subjectivité propre, ce sont des sujets d’expériences qui vivent eux aussi du monde que nous façonnons. Quant aux plantes et aux ensembles naturels, quoiqu’ils ne soient pas doués de subjectivité, ils ont néanmoins une valeur intrinsèque irréductible à leur utilité pour nous. Nous vivons d’eux précisément dans la mesure où ils ne nous sont pas seulement utiles mais aussi parce que nous leur attribuons une valeur pour eux-mêmes.
Manger, c’est être dans l’éthique, pour l’auteur, parce que nous affectons par nos choix et nos comportements alimentaires ceux dont nous dépendons et qui dépendent de nous, humains et non-humains, travailleurs, producteurs, habitants des pays pauvres, animaux d’élevage, écosystèmes, paysages, climat et générations futures. La phénoménologie des nourritures n’est donc pas une simple philosophie du mangeur jouisseur, d’un cogito égoïste, mais, parce qu’elle est immédiatement éthique, celle du mangeur juste — pouvoir et savoir manger sont au cœur de la justice. Manger avec justesse, c’est ainsi participer à la justice et recevoir en même temps que donner son dû. On comprend ainsi mieux comment cette philosophie s’articule au contrat social. Quoiqu’elle fasse l’économie d’une condition de réciprocité entre les sujets de la justice (pour des raisons évidentes étant donnée la nécessité d’inclure la nature, les animaux, les générations futures et des personnes dans des situations d’inégalité de pouvoir et de richesse), la théorie relationnelle de la justice de Corine Pelluchon déduit ses principes de l’interdépendance des sujets.
L’auteur prend soin de préciser que l’individu n’est pas, en tant que tel, le principe premier ni la fin ultime du contrat, comme il peut l’être dans ce qu’elle appelle les « philosophies de la liberté, pour lesquelles le problème majeur est de garantir la sécurité et la satisfaction individuelle » (p. 248) :
« l’individu n’est ni le point de départ ni le point d’arrivée de l’éthique et de la justice comme partage des nourritures. Tout ne commence et ne finit pas avec l’égo, parce que le cogito est un cogito gourmand et engendré » (p. 259)
La nouvelle démocratie défendue par l’auteur n’est donc pas celle d’une collection abstraite d’individus mais celle d’individus vivant d’un monde commun, intégrant au cœur de ses préoccupations la condition animale et l’écologie, représentée d’ailleurs par une Troisième Chambre (idée que l’auteur reprend à Dominique Bourg). C’est que, ensemble, nous habitons le monde et que nous ne pouvons donc dissocier les conditions matérielles, affectives et sociales de notre épanouissement de celles de la nature et de ceux qui en font partie, nous y compris : « La responsabilité […] signifie que le rapport aux autres constitue l’identité personnelle » (p. 248).
Je suis (responsable de) ce que je mange. On mesure ici l’écart par rapport au contrat social puisque la responsabilité précède les obligations produites par le contrat. Le cogito, gourmand, engendré et concerné, « dès qu’il mange, par le sort qu’il impose aux autres hommes habitant loin de chez lui, aux générations présentes et futures et aux autres animaux. » (p. 255) Mais on peut alors se demander ce que le contrat est encore censé expliquer si, de cette responsabilité originaire, nous pouvons déduire nos obligations par la prise en compte de la situation d’autrui. Si la notion de contrat social a une fonction plus évidente au niveau des structures de base d’une société juste, n’est-elle pas superflue si l’ontologie intègre déjà une éthique ? Il semble que les principes de la justice[4] ne découlent pas tant d’un éventuel contrat que de l’ontologie du sujet, et que la théorie de la justice puisse alors faire l’économie du contractualisme.
Le lecteur intéressé à l’éthique animale trouvera, comme l’auteur de ces lignes, rassurant de voir les animaux occuper une place centrale dans l’élaboration des principes de justice, à travers notamment des emprunts à l’approche par les capabilités de Martha Nussbaum (Frontiers of Justice, Harvard, 2006) et à la théorie des droits politiques de Sue Donaldson et Will Kymlicka (Zoopolis, Oxford, 2011) – droits négatifs et positifs et dépendants du contexte. Plus d’une fois Corine Pelluchon caractérise d’ailleurs sa philosophie politique comme une zoopolitique et une cosmopolitique. L’originalité, selon nous, réside dans le pari d’une conciliation entre phénoménologie et philosophie analytique. Il est difficile d’évaluer la réussite d’un tel pari tant sont rares ceux qui sont familiers des deux traditions et importants les présupposés de chacune au moins du point de vue de l’autre.
La remise en cause de nos modes de consommation et de notre modèle de développement actuels n’est pas triviale. Toutefois, on ne manquera pas de souligner un relatif conservatisme dans la recherche du compromis : les droits de base inviolables et directs des animaux ne s’étendent pas à leur droit à ne pas être mangé (malgré la recommandation d’une réduction drastique de notre consommation de viande, la condamnation des pratiques cruelles, un appel à l’amélioration de la condition animale, à l’élevage extensif et un éloge sincère du végétarisme), ni d’ailleurs, pour le moment, à ne pas subir d’expérimentations. L’idéal végane n’est pas adapté à une théorie de la justice libérale et pluraliste. Les droits des animaux exigent que leurs besoins éthologiques soient satisfaits, qu’ils ne subissent pas douleur, souffrance, ennui, dépression, angoisse, qu’ils ne soient pas tués trop jeunes (p. 264-266). On peut également se demander pourquoi, si chaque animal a le droit à une nourriture suffisante, il n’a pas également le droit de ne pas être mangé par les autres animaux, en particulier si notre responsabilité s’étend à tout vivant. Comment garantir le droit des proies à la jouissance si celui des prédateurs a pour condition de ne pas protéger le premier ? On ne peut reprocher à l’auteur de ne pas résoudre ces problèmes difficiles autrement que par la solution proposée par les auteurs de Zoopolis (i.e., par l’appel à l’idée de souveraineté des populations d’animaux sauvages[5]), mais on ne peut s’empêcher de se demander si les implications d’une phénoménologie des nourritures faisant du cogito gourmand « le gardien de la création » (p. 267) ne sont pas en réalité plus radicales que l’auteur ne semble l’envisager.
Une courte recension ne peut rendre justice à un ouvrage aussi ambitieux. Et peut-être est-ce là son péché : d’avoir voulu trop embrasser. Telles ses propositions sur l’éducation, de nombreux éléments relèvent de tel ou tel « sujet qui mériterait à lui seul de faire l’objet d’un livre » (p. 305). L’ouvrage est riche, mais au risque parfois d’être indigeste. Il n’a pas la frugalité sensuelle louée dans ses propres pages. C’est que Corine Pelluchon ne veut pas simplement fonder le contrat social. Les terrains qu’elle entend réformer vont de la compréhension de notre alimentation à nos obligations envers les plus pauvres en passant par nos relations au monde agricole et aux autres animaux, de la réforme des institutions politiques nationales au cosmopolitisme en passant par la démocratie délibérative, l’Ecole, la formation des experts et le rôle de l’utopie. L’auteur annonce d’ailleurs un projet complémentaire – celui, en partie inspiré de l’idée de religion civile dans Du Contrat Social de Rousseau – d’une éthique de la vertu à l’appui pour le citoyen de cette démocratie reconstruite. Le lecteur trouvera bien des nourritures dans ce livre : rituel du thé et gastronomie, paysage et habitat, agricultures alternatives, « désordres alimentaires » (faim, malnutrition, anorexie, boulimie, obésité), effets pervers du système financier sur les petits agriculteurs et les pays pauvres, ou encore réforme des institutions de la Ve République et rapports entre sciences, culture et démocratie. Mais ce sont autant de sujets qu’il faudrait ruminer patiemment.
[1] On peut mentionner bien sûr l’hédonisme de Michel Onfray ou encore David Kaplan (dir.), The Philosophy of Food, Berkeley-Los Angeles, The University of California Press, 2012. Le classique gastronomique de Jean Anthelme Brillat-Savarin, Physiologie du goût, ou Méditations de gastronomie transcendante (A. Sautelet, 1826) est cité maintes fois par Corine Pelluchon. On se reportera aussi avec profit à la bibliographie du Philosophy of Food Project dirigé par David Kaplan (http://www.food.unt.edu/ , consulté le 22 juin 2015).
[2] Ce courant, divers, est particulièrement bien développé dans la philosophie animale française, et au-delà, notamment grâce aux travaux pionniers de Florence Burgat puisant dans une riche tradition éthologique et phénoménologique, de Uexküll et Buitendijk à Merleau-Ponty. Mentionnons aussi, entre autres, les travaux d’Elisabeth de Fontenay, Hicham-Stéphane Afeissa et Etienne Bimbenet.
[3] Du moins les animaux doués de sensibilité et de subjectivité – de ce qu’on appellerait en philosophie de l’esprit, à point nommé, la capacité d’expérience phénoménologique.
[4] Ces principes sont nombreux et leur déduction n’est pas suffisamment explicite pour qu’il apparaisse clairement qu’ils sont tous nécessaires et indépendants, ni comment ils sont hiérarchisés (cf. pp. 260-266) : 1) Ne pas nuire à autrui ; 2) Recherche d’un consensus dans le cadre d’un désaccord raisonnable ; 3) Ne pas causer des dommages irréversibles à la planète et aux écosystèmes ; 4) Eviter d’imposer aux générations futures une vie diminuée ; 5) Droit de chaque être humain et chaque animal à avoir de quoi manger et boire en quantité et en qualité suffisantes ; 6) Droit de chacun à un chez-soi (intimité, mode de vie, lieu d’existence) ; 7) Respect des autres cultures ; 8) Organisation de la production et du travail en fonction de l’entité exploitée et du bien à produire ou du service à rendre ; 9) Devoirs particuliers envers les animaux domestiques qui dépendent de nous.
[5] Le sixième principe (note ci-dessus) pourrait ainsi bloquer l’application du cinquième principe dans un sens interventionniste.