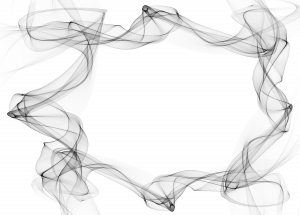Sur quelques acceptions de la mise en ordre de soi-même
Jonathan LOULI Etudiant en Master 2 de socio-anthropologie, Université de Lille 1
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Texte mis à jour le 19 juillet 2014 (Coquilles, ajout d’une référence pour la note 21. )
La prévention spécialisée se veut une démarche éducative alternative et marginale, en direction d’adolescents et jeunes adultes, dans une perspective d’insertion sociale et professionnelle. L’originalité revendiquée de la profession s’observe notamment dans ses principes d’action très précis[1] : libre-adhésion des jeunes accompagnés quant aux activités et accompagnements proposés (les jeunes sont conçus comme libres d’accepter ou de refuser ce qui est proposé par les éducateurs, de rompre la relation quand ils souhaitent, sauf rares cas de placement judiciaire), anonymat des jeunes accompagnés (les éducateurs sont conçus comme refusant de réaliser des fiches nominatives ou dossiers, comme ayant très peu d’écrits sur les jeunes, et ne transmettant à l’extérieur de leur structure aucune information permettant d’identifier les jeunes accompagnés), absence de mandat nominatif pour les intervenants (les éducateurs sont conçus comme n’étant pas mandatés pour intervenir auprès de certains jeunes ou familles en particulier, mais simplement sur un territoire urbain), non-institutionnalisation des pratiques (les pratiques sont conçues comme devant être souples et adaptables aux réalités du terrain, aux demandes du public).
Ces principes, à commencer par celui de « libre-adhésion » du public, induisent une pratique qu’on peut dire « symbolique »[2], car consistant, pour une large partie, en un travail sur les signifiants sociaux, à travers le plan verbal ou « oral »[3], les gestes, les attitudes des éducateurs. Ce travail peut également être dit symbolique car il vise une production de sens par les éducateurs en direction du public et veut se situer en dehors de toute forme de contrainte pratique (physique, administrative…) ; en somme le travail des éducateurs vise à une « prise de conscience » (selon l’expression du chef de service) par les personnes accompagnées de leurs problèmes, et, surtout, des moyens subjectifs ou objectifs de les résoudre, ce qu’on peut appeler une mise en ordre de soi-même.
Ce travail symbolique vise donc une « restructuration du Moi »[4], une réorganisation de la façon dont le public appréhende son environnement. Pour atteindre cette « efficacité symbolique »[5], les professionnels évoquent souvent l’importance de la « relation de confiance » entre eux et les personnes accompagnées. Parallèlement, ils rendent intelligible leur pratique professionnelle en mobilisant certaines acceptions de la « confiance » constituées comme des fins en soi : confiance de la personne en elle-même, confiance en l’adulte, confiance en l’employeur… La « confiance » dans la pensée des éducateurs paraît donc être un « mot problématique »[6] que nous allons étudier.
L’objet de cet article est donc de réfléchir à la dimension symbolique revendiquée dans la façon dont les éducateurs en prévention pensent leur travail, en prenant comme fil conducteur la catégorie de « confiance ». Ce que nous aborderons après avoir brièvement situé la profession et les professionnels auprès desquels ont été recueillies les données empiriques[7].
1. Situation de la profession
Cette partie visera à esquisser une présentation de la prévention spécialisée en France dans une perspective socio-historique, pour mesurer, d’une part, l’emprise de la puissance publique sur les registres de lisibilité et de légitimité de la forme générale de cette profession ; et, d’autre part, l’importance d’une confrontation de ces données générales avec une forme empiriquement incarnée.
1.1. Mise en perspective socio-historique
Dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale, des « clubs d’enfants » ou « clubs loisirs », animés notamment par des bénévoles et des militants, constituent « la première génération d’expériences reconnues comme fondatrices du milieu »[8]. Au fondement de la prévention spécialisée se trouve une série de thèses établissant une prise de position éducative alternative à partir de laquelle les acteurs rendaient intelligible leur engagement. Ces thèses se rapportaient, principalement, à l’« exploration d’une autre voie pédagogique, en rupture avec l’idée d’enfermement des jeunes délinquants ou inadaptés »[9], et se traduisaient dans des pratiques concrètes qui ont fait la particularité de ce secteur, et la font encore largement à l’heure actuelle[10], notamment à travers le « travail de rue », qui consiste pour les éducateurs à visiter régulièrement le quartier d’intervention pour se laisser interpeller par les habitants.
A partir des années 1950, la croissance du secteur amène les acteurs à exprimer une relative dépendance à l’égard des politiques publiques, notamment en matière de soutien financier. Cette demande de régulation publique rencontre alors les dynamiques d’extension de l’action étatique, dans le cadre du développement de la politique sociale d’après-guerre[11] : « la tension entre institutionnalisation et rupture constituera dès lors une caractéristique majeure de la prévention spécialisée »[12].
L’emprise de la puissance publique s’étend notamment à travers la mise en place du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé en 1967, les diverses réglementations qui donnent corps à la politique sociale et à l’action sociale étatique[13], parmi lesquelles les actions ministérielles balisant les champs de l’enfance et jeunesse en danger[14] ainsi que les arrêtés et circulaires à propos de la prévention spécialisée promulgués au début des années 1970. Ces textes consacrent officiellement et reconnaissent la spécificité des méthodes, des finalités et des principes de la prévention spécialisée, mais ce, paradoxalement, tout en générant une certaine planification ou rationalisation de la pratique : « sitôt pris en compte par les pouvoirs publics, les Clubs et Équipes de Prévention connaissent une situation de torsion entre d’un côté l’autonomie et l’originalité fondées sur leur histoire, et d’autre part la reconnaissance, principalement financière, dont ils ont besoin »[15]. Cette situation de torsion de la profession, entre la commande publique et l’engagement personnel des éducateurs, s’accentue avec la fin des Trente Glorieuses et l’enclenchement de la décentralisation de l’action sociale[16].
Les deux vagues successives de décentralisation (années 1980, années 2000), ont mis les clubs et équipes de prévention spécialisée sous la tutelle directe et quasi-exclusive des Conseils Généraux, eux-mêmes étroitement contrôlés par l’État central[17]. A travers cette reconfiguration des politiques publiques, le registre réglementaire de lisibilité et de légitimité de la prévention spécialisée est considérablement étendu par le biais des dispositifs de contrôle de la dépense publique et de réglementation de la pratique : progressivement ce registre réglementaire se désencastre et s’autonomise, atténuant les références aux positions éducatives et militantes des acteurs ; phénomène qui constitue une « rationalisation gestionnaire »[18] des modes d’intelligibilité et de lisibilité de la profession.
Les dynamiques de la territorialisation et de la gestionnarisation de l’action sociale ne vont donc pas sans un certain nombre de « difficultés relationnelles des acteurs du social avec nombre d’élus »[19], notamment dans l’attribution d’objectifs contractualisés et de modes d’évaluation du travail, jugés inadéquats et normatifs[20]. Le désencastrement du registre réglementaire et l’emprise de la puissance publique sont des indicateurs de la fonctionnalisation tendancielle de la profession : la gestionnarisation porte des modes d’agir et des modes de dire le travail (« référentiels qualité », recommandations de bonnes pratiques, items administratifs et « intranet » relatifs à la communication interne, rapports d’activité quantitativistes, comptes-rendus formatés, fonctionnement par « projets », etc.) qui deviennent la seule langue partagée par les travailleurs de terrain et les instances étatiques de tutelle, entre lesquels sont tiraillés les cadres et employeurs associatifs. Ces modes gestionnaires de lisibilité de la pratique indiquent une forme particulière d’objectivation du travail, autoritaire, quantophrénique et réifiante, qui peut amener les instances commanditaires ou les travailleurs à diverses formes d’aliénation, ou pertes du rapport au réel[21].
Après avoir suggéré ces données contextuelles générales, nous avons à envisager comment elles permettent de saisir la « singularité »[22] de la forme incarnée de prévention spécialisée qui a été l’objet de ma recherche, et comment celle-ci amène, à son tour, de nouvelles questions.
1.2. A propos de la forme étudiée
Les clubs de prévention sont des petites structures associatives dont les « ressources humaines » et les financements sont gérés par des établissements gestionnaires, la plupart du temps eux-mêmes associatifs. Le club dans lequel j’ai enquêté a été fondé dans les années 1970, puis, après avoir été rattaché dans les années 1980 à une importante association gestionnaire, il a pu développer ses territoires d’intervention au sein d’une moyenne agglomération, ses projets, son équipe (une dizaine d’éducateurs), et sa reconnaissance partenariale, jusqu’à devenir un important club d’un des départements les plus pauvres de France.
Cette position de force relative du club a les inconvénients de l’institutionnalisation et de la gestionnarisation, notamment dans les rapports aux partenaires ou à l’établissement gestionnaire, parfois très procéduraux ou contraignants ; mais cela a également les avantages d’une certaine stabilité dans le statut professionnel, et d’un poids dans l’énonciation et la revendication de principes professionnels pouvant résister aux injonctions et assignations (réglementaires, financières, sécuritaires…) des instances de tutelle.
Ainsi, lorsque je les ai interrogés sur leurs activités et objectifs, les éducateurs ont assez peu évoqué l’emprise de la puissance publique, sauf pour la déplorer, et, en diverses occasions, les interlocuteurs développent même une certaine critique des instances de tutelle ou de certains acteurs qui composent leur environnement institutionnel. Indice que ces professionnels se pensent moins en termes d’assignations (ce qu’on leur dit de faire) qu’en termes de revendications quant au sens qu’ils souhaitent conférer à leur pratique.
Les registres critiques, observables surtout lors des réunions professionnelles, concernent avant tout ce qui est perçu comme étant des incohérences des politiques locales (surveillance et fichage des familles, montée des politiques de répression des déviances, querelles politiciennes qui nuisent au fonctionnement des dispositifs…), des pratiques douteuses de partenaires (médisances à propos d’usagers, entorses au secret professionnel, manque de lien avec les usagers, conversions aux registres sécuritaires, rigidités des fonctionnements institutionnels…), ou des aberrations dont certaines instances de plus large envergure sont productrices (injonctions à transmettre des fiches nominatives sur les personnes accompagnées, gestion irrationnelle de budgets, instrumentalisations de la prévention spécialisée et du travail social, rationalisation économiciste du secteur professionnel, gestionnarisation de certains dispositifs…)
Les ressources dont disposent les salariés pour résister à ces assignations ou contradictions à leurs revendications sont activées de différentes façons et à différents moments selon la façon dont ils sont inquiétés (ressources réglementaires, pratiques, éthiques, intellectuelles…) Parmi ces ressources, un certain nombre de catégories de pensée du métier alimentent une conception « symbolique »[23], revendiquée, du travail. Cette conception symbolique se repère d’abord à la finalité revendiquée du travail : l’« autonomie » des personnes accompagnées, la « prise de conscience ». La conception symbolique se repère également dans les modes de pensée de certaines pratiques :
On a le souci du détail, c’est à dire que, nous, les gros objectifs, les gros axes, les bazars, les trucs, c’est bien pour cadrer, mais nous ce qui nous intéresse c’est ce qu’on voit, ce qu’on observe, les détails, quoi, c’est à dire qu’il y a des choses qui se passent, qu’on pourra jamais évaluer, mais qui pourtant sont valorisantes (ES3)
Tu ne peux pas écrire une conversation, voilà, il y a toute cette part d’informel, il y a tellement de choses qui se jouent dans ces moments-là, quand tu vas ramener un jeune chez lui le soir après une activité, ou quand tu vas… c’est des petits moments comme ça où même toi t’as pas prévu que ça soit aussi riche, aussi… T’écris pas tout ce que tu vis […] Bref, tout ça pour dire que des fois c’est très riche et t’as pas le temps de digérer tout ça, et tu vas pas écrire tout ce qui s’est dit, tout ce qui s’est joué à ce moment-là, il fallait y être, et c’est tout (ES7)
Le « souci du détail », la revendication de « l’informel » sont des catégories de pensée qui tendent à indiquer qu’aux yeux des professionnels, une part considérable de l’intelligibilité de leur activité passe par des phénomènes a priori inobjectivables, car signifiants uniquement dans une situation intersubjective particulière, « au cas par cas » comme disent les éducateurs. D’autres dispositions intellectuelles alimentent la conception symbolique du travail : mécanismes de l’empathie, exigences de réflexivité collective, « relativité politique »[24] dans la relation au public, revendications d’« indétermination »[25] de la pratique (« Ce qui est bien c’est de cheminer avec les gens, ne pas avoir d’objectif précis », ES8 ; « un accompagnement n’est jamais le même d’un jeune à un autre, d’une famille à une autre », ES1). Le travail symbolique se repère surtout dans la revendication du travail éducatif comme étant une production de sens :
C’est… donner ou redonner des repères… par rapport à la… norme de la société. Mais… c’est pas dans l’idée de marteler, c’est travailler avec les jeunes leur identité, c’est pas rentrer dans un moule pour rentrer dans un moule, c’est comment fonctionne la société, le rythme de la société, et c’est comment… on arrive à leur faire comprendre comment elle fonctionne et comment eux ils peuvent être acteurs par rapport à ce fonctionnement de la société. (chef de service)
1.3 Conclusion
Cette partie avait vocation à brosser le champ complexe d’entendement de la prévention spécialisée. Si plusieurs registres s’opposent (gestionnaire-associatif, financeur, politique, professionnels de terrain…), l’ethnographie que j’ai menée donnait davantage à entendre les revendications des éducateurs eux-mêmes, parmi lesquelles ce que j’ai appelé une dimension symbolique du travail.
Au-delà du magma de modes de pensée du travail symbolique, on peut tenter de mieux comprendre cette revendication des interlocuteurs en prenant comme fil conducteur leurs problématisations de la catégorie de « confiance ». On verra que celle-ci indique une répartition du travail symbolique entre deux pôles typiques : la conception instrumentale du travail symbolique et la conception finale.
2. Sur quelques acceptions instrumentales du travail symbolique en prévention spécialisée
En quoi peut consister un travail symbolique ? Avant d’étudier en quoi la catégorie de « confiance » peut nous aider à répondre à cette question, on peut mobiliser quelques catégories de pensée proches, qui tendront à indiquer que, dans la situation empirique qui a été la mienne, un travail symbolique doit être entendu comme un travail réalisé dans le champ de circulation des signifiants sociaux, c’est-à-dire les signifiants verbaux et non-verbaux que, d’après les éducateurs, les personnes accompagnées ont à partager avec autrui, en vue d’accéder à une « autonomie », une « émancipation », une « place sociale » convenable. Les types de pratiques qui composent le travail symbolique sont en tension entre deux pôles, dont un premier est l’objet de cette partie : le pôle instrumental.
2.1 Le travail symbolique comme instrument
A la base de l’ensemble des pratiques qui mettent les éducateurs en relation avec le public, ou pratiques symboliques, se trouve l’activité communicationnelle, et, plus spécifiquement, la « parole », pour reprendre un mot de mes interlocuteurs :
On s’appuie sur un réseau de partenaires très varié, très riche, et ça il faut se le créer aussi, ce réseau, pour pouvoir orienter les personnes. Donc on n’est pas forcément bien outillé parce qu’on a quoi ? On a notre parole. (ES1)
Il y a un gros gros travail de passage de relai, et c’est pour ça que pour moi il est important d’avoir un maximum de partenaires, pour pouvoir répondre au mieux à ces problématiques […] Parce que [bref soupir] Finalement seul on n’est pas… on n’est pas grand chose, on va rentrer en contact avec les jeunes, on va créer un lien de confiance, mais après voilà, on est vite démuni sans partenaires, on n’a rien, mis à part la parole, on n’a rien pour répondre aux jeunes. (ES5)
Que signifie que d’après les éducateurs, si le « passage de relai » aux partenaires n’est pas possible, la « parole » devient l’unique moyen dont ils disposent pour travailler ? On peut faire l’hypothèse que dans ce cas précis les interlocuteurs songent à une opérationnalisation de la relation au public, dans la mesure où, dans ces extraits, ce qui fait qu’une relation a bien fonctionné, c’est le fait d’avoir pu « répondre » aux problématiques des jeunes, notamment par l’orientation partenariale. La relation est objectivée à travers la « problématique » posée par un jeune, à laquelle l’éducateur doit répondre en opérant une mise en relation avec un partenaire compétent.
Ainsi, très prosaïquement, même avec pour finalité « l’autonomie », « l’émancipation », « l’indépendance » des personnes accompagnées, tout comme « le voyage de mille lieues commence par un pas »[26], des éducateurs peuvent concevoir le « parcours » du jeune comme une succession de résolutions de problématiques ; processus de durée indéterminée dans lequel le plan symbolique – à commencer par « la parole » – est le principal moyen, ou instrument, des éducateurs.
2.2 La relation de confiance
La première acception de la « confiance » repérée dans les entretiens est, avant tout, aux yeux des éducateurs, un moyen pour travailler, pour stabiliser une relation, comme l’exprime l’interlocutrice suivante en parlant d’une concertation partenariale au cours de laquelle des organismes réclamaient au club de prévention de transmettre les noms de certains jeunes accompagnés et suspectés de dégradations dans l’espace urbain :
On se refuse, malgré toutes les pressions, malgré tous les questionnements, on se refuse à donner les noms des jeunes. Il est hors de question en tout cas en ce qui nous concerne, qu’il y ait un nom de jeune qui sorte de là […] ça c’est vraiment… la garantie de la confiance que les jeunes portent en nous, parce que moi systématiquement quand il y a des réunions où on parle d’eux, les jeunes sont avertis […] et je pense que c’est grâce à cette confiance-là qu’on peut continuer à travailler avec eux, parce que quand je leur ai dit qu’on allait avoir une réunion et que le lendemain il y a eu cinq interpellations, si les jeunes savaient pas qu’ils pouvaient nous faire confiance à ce niveau-là, on aurait très bien pu se faire griller complètement, et ne plus pouvoir intervenir avec eux (ES4)
On voit ici que la « confiance » du jeune en l’éducateur est conçue sur un registre instrumental, comme un moyen pour le professionnel de travailler convenablement et d’approfondir la relation avec le public. Dans ce cas le registre instrumental d’entendement du travail symbolique prend une tonalité assez différente qu’avec la catégorie de « parole » : avec cette dernière, le travail de l’éducateur était assez neutre et visait à aider le jeune à appréhender l’environnement institutionnel ; en revanche, avec l’acception instrumentale de la confiance, c’est, inversement, l’environnement institutionnel qui, indirectement, doit s’adapter au fonctionnement du club de prévention et aux modes d’existence juvéniles. Dans ce cas, la relation éducative et intersubjective passe avant la relation partenariale et institutionnelle.
C’est également à travers ce registre instrumental du travail symbolique que l’on peut, selon moi, interpréter l’irritation qu’éprouvent les professionnels lorsque les jeunes les questionnent sur leur salaire :
On doit être toujours dans la justification, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps on doit justifier ce qu’on fait, auprès des jeunes. Pourquoi on est là, pourquoi on est payé pour faire ça, combien on est payé […] Mais ça ça arrive souvent, qu’on doive justifier ça, comme la dernière fois ils demandent « 1300, 1400, c’est ça, à peu près ? » Donc on laisse un peu de vague, mais ils sont pas très loin, putain, ils ont bien réfléchi, je pense, ils ont dû aller sur internet. (ES3)
Si l’éducateur est pensé avant tout comme un salarié, cela peut laisser penser aux jeunes qu’il occupe une fonction, qu’il répond à une assignation qui provient d’ailleurs ; les éducateurs pensent que si les jeunes les conçoivent comme des salariés et leur demandent constamment ce qu’ils viennent faire, c’est une expression de méfiance qui leur complique la tâche en laissant entendre que, d’une certaine façon, les éducateurs ne travaillent pas avant tout pour le public.
Dans ces discours, les jeunes ont donc le choix de faire confiance ou pas à l’éducateur, il y a une prise de risque à se confier aux professionnels : les jeunes sont donc appelés à développer ce qu’on pourrait nommer une « confiance décidée »[27], en ce qu’ils pourraient la regretter. Cette capacité à prendre la décision d’accorder ou pas sa confiance dépend de l’expérience intersubjective, concrète, que les éducateurs parviennent, ou pas, à conforter :
La confiance décidée est une attitude qui permet de prendre des décisions comportant un élément de risque. Le développement de ce type de confiance (et de méfiance) dépend du milieu local et de l’expérience personnelle […] Il faut un contexte relativement concret pour pouvoir tester et contrôler la confiance décidée et percevoir les évènements symboliques susceptibles de la détruire[28].
2.3 Conclusion
L’acception instrumentale du travail symbolique, ou travail avec et sur les signifiants sociaux, revient à penser le symbolique comme l’instrument d’une opération, ou le vecteur d’une objectivation possible de la relation entre le professionnel et le public (amorcer un accompagnement éducatif, réaliser des orientations partenariales, lutter contre le « décrochage scolaire », le chômage des jeunes, les troubles de santé physique ou psychique, les problèmes de logement, etc.) Cette opérationnalisation et objectivation de la relation éducative entre en résonnance avec certains pans du registre gestionnaire de lisibilité de la prévention spécialisée, caractérisés par l’assignations d’objectifs à atteindre : ces conceptions instrumentales et fonctionnelles du travail se retrouvent notamment à l’œuvre dans les « référentiels qualité », les questionnaires de satisfaction à destination des usagers, les comptes-rendus administratifs, et, notamment, les rapports d’activité largement quantitatifs et formatés exigés par les instances de tutelle.
Cependant, comme je l’ai suggéré plus haut, de nombreuses catégories de pensée des interlocuteurs doivent nous amener à compléter cette première conception restrictive du travail symbolique : au-delà de cette acception où le symbolique est l’instrument d’une opération, il faut donc étudier en quoi consiste, plus précisément, cette opération, et comment d’autres problématisations du concept de « confiance » peuvent nous renseigner à ce sujet.
3. Sur quelques acceptions finales du travail symbolique en prévention spécialisée
Pour les éducateurs, le travail symbolique n’est pas seulement l’instrument d’une opération générale et objectivable, il peut également être conçu par les interlocuteurs comme une fin en soi : c’est le registre que j’appellerai final d’entendement du travail symbolique. Dans la conception instrumentale du travail symbolique, les éducateurs mobilisent les signifiants comme simples moyens des procédures qui peuvent survenir dans le cadre d’un accompagnement, dont la logique surdétermine le travail symbolique ; inversement, dans la conception finale les signifiants ont leur fin et leur effet en eux-mêmes, et ne sont pas surdéterminés : dans ce cas les éducateurs cherchent ce qu’on peut appeler une « efficacité symbolique »[29]. Cette seconde conception du travail symbolique, qui entre en tension avec la conception instrumentale et participe à polariser les façons de penser des éducateurs, est l’objet de la présente partie.
3.1 Les efficacités symboliques en prévention spécialisée
Les relations entretenues par les éducateurs avec le public n’ont pas toujours vocation à être opérationnalisées dans une logique de parcours d’insertion : les « temps partagés », comme disent les éducateurs, les activités collectives, les échanges verbaux, peuvent, de différentes façons, être leur propre fin et receler, en eux-mêmes, une « efficacité symbolique » :
Pour l’instant le sens… tu le trouves dans des petites choses. Simplement quand un jeune vient en rendez-vous ou… traverse le trottoir pour venir te dire bonjour, tu te dis que quelque part il a trouvé quelque chose dans la relation sinon… C’est ça que tu ne peux pas calculer finalement […] Je me dis que parfois les jeunes ce qu’ils viennent chercher c’est juste… un échange… ils verbalisent, et des fois ils s’entendent dire des choses, ils doivent se surprendre. Des fois tu parles et tu dis « merde, c’est moi qui aie dis ça ? » et tu comprends un peu mieux le sens de ta pensée, ou tu comprends mieux ce dont tu as envie… Je pense que des fois la relation elle est là, et ça tu le calcules pas. Il y a beaucoup de choses qui passent… par la parole. Et ça tu le calcules pas (ES7)
Cet interlocuteur, comme ceux qui considèrent que les enjeux de la pratique communicationnelle ne sont pas toujours objectivables, car contingents par rapport à une situation intersubjective, développe ce qu’on pourrait appeler une conception « clinique »[30], en ceci que la parole est, pour lui, génératrice « d’effets de vérité »[31], de « prise de conscience », signifiante dans le cadre de ce qui est subjectivement éprouvé.
En effet, il a pu être suggéré que l’« autonomie » passe notamment par la production d’un « discours » subjectif, d’un discours qui pense et affirme le sujet, en distinguant ce qui, en lui, tient du « non-sujet », de l’« hétéronomie »[32]. Dans cette perspective, le symbolique intervient donc bien dans la « formation du sujet »[33] : on imagine alors qu’en fonction du sens conféré au travail symbolique, en fonction des signifiants sociaux mobilisés et des imaginaires normatifs auxquels ils renvoient, le travail éducatif peut effectivement mener à une « émancipation » des personnes accompagnées, comme l’énoncent certains interlocuteurs rencontrés, mais il peut également se transformer en une « entreprise de redressement tyrannique »[34], notamment lorsque l’éducateur fait prévaloir l’imaginaire social, extérieur, sur l’imaginaire subjectif, personnel, du jeune accompagné.
Cette seconde polarisation, qui s’ajoute à la tension entre instrumental et final, devient patente lors des activités collectives qui sont mises en place par les éducateurs avec des jeunes, et notamment les « chantiers » au cours desquels des groupes de jeunes effectuent des travaux manuels peu complexes entre contrepartie d’une sortie de loisir. Ces temps collectifs visent à amener les jeunes à se confronter à certaines normes, notamment la « valeur travail » comme disent les éducateurs : la signification de ces activités collectives est alors variable d’un jeune à l’autre, et peut devenir un « dispositif d’encadrement et de contrôle »[35] tout aussi bien qu’une source d’épanouissement et de maturation[36] : en somme le travail symbolique dans ces séquences éducatives partiellement ritualisées[37] peut s’entendre comme une progressive « prohibition de l’enfance »[38], qui peut donc être plus ou moins péniblement vécue par les jeunes.
Ainsi, à l’intérieur même du second pôle d’entendement du travail symbolique, qui consiste à considérer ce dernier comme une fin en soi, comme doté d’une « efficacité symbolique » propre, une nouvelle polarisation se déploie et recoupe l’opposition repérée de longue date entre l’« émancipation » et la « normalisation » potentiellement réalisées par le travail social[39]. Le retour à une analyse de la catégorie de « confiance » mobilisée par les éducateurs pourra nous aider à démêler quelque peu cette complexité.
3.2 Les objets de la confiance
La catégorie de « confiance » peut désigner, pour les éducateurs, une fin en soi, à condition qu’elle soit appliquée à certains objets particuliers. Comme beaucoup de travailleurs sociaux, les éducateurs revendiquent la nécessité de travailler sur la « confiance en soi » ou l’« estime de soi » que développent les jeunes :
Il y a cette confiance aussi à redonner dans les institutions, et ça je veux dire… passer ou repasser la porte d’une institution c’est déjà compliqué, c’est aussi l’image que le jeune a de lui, c’est aussi tous les échecs qu’il a déjà rencontrés dans sa vie, que ce soit au niveau scolaire, au niveau formation, même pour entrer dans une formation quelque fois il y a des tests, et ces tests quelque fois ils peuvent pas les passer parce qu’ils ont un niveau scolaire extrêmement bas, parce qu’on leur a toujours dit qu’ils étaient nuls, c’est aussi l’image qu’ils ont d’eux-mêmes qui est aussi à renforcer, à revaloriser, plutôt. (ES4)
On constate avec ce type de raisonnement que les problèmes sociaux sont davantage envisagés à travers leurs conséquences psychiques et individuelles[40], et l’idée selon laquelle les personnes accompagnées ont quasi-pathologiquement « perdu confiance », comme disent les éducateurs, relève d’une psychologisation ou d’une « sanitarisation du social »[41]. Même si la « confiance en soi » peut certes être considérée comme un des trois étages indispensables à la reconnaissance sociale[42], il peut être problématique de faire prévaloir l’imaginaire subjectif, personnel, du jeune accompagné, sur l’imaginaire social, extérieur, et sur le fonctionnement effectif de l’environnement institutionnel.
Certains éducateurs peuvent déplacer légèrement le curseur de la « confiance » pour que son objet soit situé au-delà de la situation subjective ou intersubjective, jusqu’à croiser le monde institutionnel et social dans lequel les jeunes doivent s’« insérer ». Ils souhaitent alors que le « jeune parle de plus tard, de façon pas noire mais un peu plus rose […] Un jeune qui n’est plus révolté, qui a enfin confiance, en lui, en son employeur, en son responsable de formation… » (ES5). En cherchant à ce que les jeunes « aient un lien de confiance avec les institutions » (ES4, ES5), les éducateurs aimeraient, d’une certaine façon, orienter la « confiance décidée » que les jeunes leur accordent vers d’autres objets sociaux : « employeur », « responsable de formation », « institutions »… Cela est à nouveau problématique : la confiance en l’environnement institutionnel est-elle une condition à la réussite sociale ? Ne peut-on être un « révolté » et gagner une « autonomie » satisfaisante ? Inversement, avoir une « confiance » sans ombre en l’environnement institutionnel signifie-t-il être « autonome », avoir réussi ? Comment avoir « confiance » en une entité aussi désubjectivée qu’un réseau institutionnel ?
Les éducateurs eux-mêmes perçoivent la contradiction : ils sont assignés à un travail partenarial, à « orienter les jeunes vers l’existant », selon la formule consacrée :
L’existant c’est toutes ces personnes, ces dispositifs, la Mission locale, le collège par exemple, en qui les jeunes n’ont pas forcément… Ou généralement ne connaissent pas, il y a une méconnaissance, ou alors ils n’ont pas confiance, ou alors leurs frères ont eu des expériences désastreuses avec eux, mais tout ce travail là, l’existant, c’est ces gens en qui on essaie de redonner confiance, par le biais de notre réseau, de notre partenariat. (ES3)
Au cours d’une réunion interne, le même éducateur confessera à ses collègues, durant une discussion sur le partenariat : « c’est dur de donner envie à un jeune d’aller vers une structure où on sait que ça ne marchera pas ». D’où la question posée par certains interlocuteurs durant la même réunion :
Est-ce que notre rôle des fois c’est pas de dire aux jeunes « tu as raison c’est pas normal ce qu’il se passe » ? Les orienter vers les institutions qui sont compétentes mais les accompagner autrement quand ce n’est pas le cas… Mettre les institutions face à leur réalité, car elles ne fonctionneront pas sans les jeunes. (ES7)
La « confiance en l’existant », celle des jeunes comme celle des éducateurs, on le voit, est très problématique, par l’intrication des registres depuis lesquels elle est pensée, et peut laisser les professionnels dans une certaine incertitude, notamment lorsque les insuffisances de celui-ci deviennent patentes :
Il y a des réunions qui se font comme ça, entre les élus et les jeunes, par rapport à l’emploi, l’employabilité des jeunes, le problème c’est que derrière concrètement ça suit pas et que les jeunes ils s’essoufflent. Ils y croient à chaque fois, nous on les mobilise, et puis derrière ça suit pas. Donc qu’on on arrête aussi de leur faire croire n’importe quoi et qu’ils soient à chaque fois de nouveau déçus […] (ES4)
Là à nouveau, contrairement à l’idée que les éducateurs doivent redonner « confiance » en l’environnement institutionnel, c’est, à l’inverse, la perception des tares de celui-ci qui prévaut : plusieurs éducateurs repéraient que le milieu de l’insertion et les champs de décisions politico-économiques locaux étaient en partie inefficaces dans la lutte contre le chômage des jeunes défavorisés, voire pervers dans le sens où ils répétaient les promesses intenables qui, à la longue, rongent la « confiance » que les éducateurs essaient de développer. Les éducateurs, pédagogues et praticiens travaillant avec des jeunes savent bien que « le plus grand mal que tu puisses leur faire, c’est de promettre et de ne pas tenir. D’ailleurs tu le paieras cher et ce sera justice »[43].
Conclusion générale
On a vu que dans les efforts pour donner du sens à leur travail, les éducateurs revendiquaient une dimension symbolique à leur activité, une production de sens à destination des personnes accompagnées, en vue de participer à la mise en ordre d’elles-mêmes par elles-mêmes. L’activité communicationnelle verbale et non-verbale, interindividuelle ou collective, permet de cerner cette dimension symbolique ; l’objet ici était de prendre, plus spécifiquement, comme fil conducteur, la catégorie de « confiance » mobilisée par les éducateurs, pour éclairer la dimension symbolique et mieux comprendre leur travail.
On a vu que cette catégorie était problématisée de diverses façons selon, notamment, l’objet vers lequel elle était adressée : dans le processus éducatif, le professionnel doit établir avec le jeune une relation de confiance, qui n’est que le moyen ou la condition pour le bon déroulement de l’accompagnement, c’est la conception instrumentale du symbolique. Mais les éducateurs énoncent parfois que leur activité vise à redonner confiance au jeune, et développent donc une conception finale du symbolique : ils disent alors vouloir travailler la « confiance en soi », la « confiance en les institutions », la « confiance en l’existant »…
Plusieurs subdivisions sont possibles à l’intérieur de cette polarisation du symbolique, notamment en fonction des directions vers lesquelles sont dirigées la confiance (soi-même ou autrui), mais il semble que la double polarisation se fasse, de façon profondément intriquée, dialectique et mouvante d’un individu à l’autre, entre le pôle de l’émancipation et celui de la normalisation ; entre la « subjectivation » et l’« asservissement »[44] dans la formation du sujet ; entre l’allégeance fataliste des professionnels à l’inéluctable ordre social, et l’idéalisme maïeutique et « d’autogestion »[45]. La mise en ordre de soi-même peut se faire selon les schèmes réorganisés et réappropriés du Moi, ou ceux de l’ordre social, l’un faisant écho à l’autre.
Cette importance du travail symbolique pour les professionnels, ainsi que la complexité qui l’entoure, posent la question de savoir quel mode de lisibilité adopter des pratiques professionnelles ? Comment déterminer la valeur, la légitimité d’une activité, et sur quels critères en fonder la critique ?
D’une part, on peut s’interroger sur les risques de perte du réel que courent les acteurs partageant un mode de lisibilité aveugle à la revendication d’une dimension symbolique du travail, et sur la tendance au « solipsisme collectif »[46] développée par les instances de tutelle à travers leurs instruments d’appréhension cognitivement minimaliste de la réalité[47].
D’autre part, il me semble que des modes d’évaluation et de lisibilité de la pratique qui donneraient la parole, dans une perspective compréhensive, à la diversité des parties prenantes (hiérarchie, professionnels de terrain, usagers…) permettraient d’approfondir la compréhension du travail socio-éducatif[48], d’un point de vue normatif (les acteurs professionnels pourraient prendre du recul sur ce que font vraiment les uns et les autres), et d’un point de vue scientifique (cela permettrait de démêler des conditions ou des variables compréhensives de production de tel ou tel type de sujet, d’autonomie, de rapport à l’ordre social…) La prévention spécialisée, le travail social, auraient en effet, semble-t-il, vocation à servir l’intérêt général… à moins que leur fonctionnalisation autoritaire et leur mise au pas soient effectivement en marche ?
[1] Andrieu, P., Groupe de travail interinstitutionnel sur la prévention spécialisée, 2004, La prévention spécialisée : enjeux actuels et stratégies d’action. Rapport du groupe de travail interinstitutionnel, Paris, Délégation interministérielle à la famille, en ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000187/index.shtml (consultée le 13 janvier 2014) ; Becquemin, M., 2007, « Pour une critique de la prévention. À travers le prisme des réformes » in Informations Sociales, n° 140, p. 74 – 87 ; Berlioz, G., 2002, La prévention dans tous ses états. Histoire critique des éducateurs de rue, Paris, L’Harmattan ; Le Rest, P., 2007, « Prévention spécialisée et évaluation », in Bouquet, B., Jaeger, M., Sainsaulieu, I. (dir.), Les défis de l’évaluation en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, p. 197 – 217 ; Arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention, publié au Journal Officiel du 13 juillet 1972, p. 7398 – 7399.
[2] Autès, M., 1999, Les paradoxes du travail social, Paris, Dunod, p. 242 – 246.
[3] Ion, J., Ravon, B., 2005 [1984], Les travailleurs sociaux, Paris, La Découverte, p. 76.
[4] Verdès-Leroux, J., 1978, Le travail social, Paris, Éditions de Minuit, p. 164 – 165.
[5] Thouvenot, C., 1996, « L’éducateur et son efficacité », in Agora Débats Jeunesses, n°4, p. 33 – 42.
[6] Lazarus, S., 2001, « Anthropologie ouvrière et enquêtes d’usine : état des lieux et problématique », in Ethnologie française, Vol. XXXI (3), p. 389 – 400.
[7] La présente réflexion s’appuie sur des résultats d’une recherche ethnographique qui s’est déroulée entre décembre 2011 et l’été 2013, au sein d’un club de prévention spécialisée. Cette immersion, réalisée dans le cadre d’un mémoire de recherche de Master 2 de Socio-anthropologie à l’Université Lille 1, m’a permis d’observer diverses séquences de travail (réunions, temps informels, activités collectives avec des jeunes) et de réaliser une quinzaine d’entretiens semi-directifs avec les éducateurs, le chef de service, la secrétaire-comptable du club, le fondateur du club, désormais retraité, le directeur général adjoint de l’établissement gestionnaire, et un jeune accompagné par des éducateurs.
[8] Peyre, V., Tétard, F., 1985, « Les enjeux de la prévention spécialisée : 1956 – 1963 » in Bailleau, F., Lefaucheur, N., Peyre, V. (dir.), Lectures sociologiques du travail social, Paris, Les Éditions Ouvrières / Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, p. 116 – 132.
[9] Peyre, Tétard, « Les enjeux de la prévention spécialisée », Op. cit. p. 119.
[10] Peyre, V., Tétard, F., 2006, Des éducateurs dans la rue. Histoire de la prévention spécialisée, Paris, La Découverte, p. 49.
[11] Castel, R., 2005, « Devenir de l’État providence et travail social » in Ion, J. (dir.), Le travail social en débat[s], Paris, La Découverte, p. 27 – 49.
[12] Peyre, Tétard, « Les enjeux de la prévention spécialisée », Op. cit. p. 126.
[13] Autès, Les paradoxes du travail social, Op. cit. p. 7 – 77.
[14] Berlioz, La prévention dans tous ses états, Op. cit. p. 39 – 42.
[15] Berlioz, La prévention dans tous ses états, Op. cit. p. 64.
[16] Et, dans une certaine mesure, avec le déclin du militantisme traditionnel et la professionnalisation croissante du « travail social » : Chauvière, M., 2009, « Peut-on parler d’une culture professionnelle des éducateurs ? » in Sociétés et jeunesses en difficulté, n°7, en ligne : http://sejed.revues.org/6067 (consultée le 27 février 2014), p. 6 ; Géraud, D., 2007, L’imaginaire des travailleurs sociaux, Paris, Téraèdre, pp. 65 – 66, 76 – 77.
[17] Andrieu, La prévention spécialisée : enjeux actuels et stratégies d’action, Op. cit. p. 19 ; Chauvière, M., 2010, « Quel est le « social » de la décentralisation ? » in Informations Sociales, n°162, p. 22 – 31 ; Lafore, R., 2005, « Le financement des politiques sociales locales » in Annuaire des collectivités locales, Tome 25, p. 15 – 29.
[18] Bureau, M.-.C, Sainsaulieu, I. (dir.), Reconfigurations de l’État social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 20 – 22.
[19] Chauvière, « Quel est le « social » de la décentralisation ? », Op. cit. p. 23.
[20] Bouquet, B., 2009, « Du sens de l’évaluation dans le travail social », in Informations sociales, n° 152, p. 32 – 39 ; Chauvière, M., 2006, « Les référentiels, vague, vogue et galères », in Vie sociale, n°2, p. 21 – 32 ; Eme, B., 2008, « Misères et grandeurs de l’évaluation de l’économie sociale et solidaire : pour un paradigme de l’évaluation communicationnelle » in Economie et Solidarités, Vol. 39 (1), p. 35 – 52 ; Rivet, G., 2011, « Le consultant face aux évolutions des politiques sociales : conditions d’une posture alternative » in Journal des anthropologues, « Postures assignées, postures revendiquées », Hors-Série, p. 89 – 114.
[21] Dejours, C., 2006, « Aliénation et clinique du travail » in Actuel Marx, n°39, p. 123 – 144. Louli, J., 2014, « Critique des bâillonnements », in Les Cahiers de la PRAF, n°3, Communication et travail social, en ligne : http://www.praf-alsace.org/images/cpn3.pdf (consultée le 2 juillet 2014).
[22] Lourau, R., 1970, L’analyse institutionnelle, Paris, Éditions de Minuit, p. 10.
[23] Autès, Les paradoxes du travail, Op. cit. p. 242 – 246.
[24] Alinsky, S., 1976, Manuel de l’animateur social, Paris, Éditions du Seuil, p. 138.
[25] Castoriadis, 1999 [1975], L’institution imaginaire de la société, Paris, Éditions du Seuil, Coll. Points Essais.
[26] Lao-Tseu, cité par Godelier, M., 1978, « La Part idéelle du réel. Essai sur l’idéologique », in L’Homme, Vol. 18 (3 – 4), p. 155 – 188.
[27] Luhmann, N., 2001, « Confiance et familiarité. Problèmes et alternatives » in Réseaux, Vol. 108 (4) : 15 – 35.
[28] Luhmann, « Confiance et familiarité… », Op. cit., p. 29.
[29] Thouvenot, « L’éducateur et son efficacité », Op. cit.
[30] Chauvière, « Peut-on parler d’une culture professionnelle des éducateurs ? », Op. cit., p. 6 – 7.
[31] Barus-Michel, J., 2006, « Clinique et sens », in Barus-Michel, J., Enriquez, E., Lévy, A. (dir.), Vocabulaire de psychosociologie. Positions et références, Éditions Érès, Ramonville Saint-Agne, p. 313 – 323.
[32] Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Op. cit. p. 150 – 158.
[33] Autès, Les paradoxes du travail social, Op. cit. p. 245.
[34] Rouzel, J., 2000, « Éducateur : un métier impossible » in Le Sociographe, n°1, p. 107 – 112.
[35] Mauger, G., 2001, « Les politiques d’insertion », in Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 136 – 137, p. 5 – 14.
[36] Meirieu, P., 1997, « Praxis pédagogique et pensée de la pédagogie » in Revue française de pédagogie, n°120, p. 25 – 37 ; Rouzel, « Educateur : un métier impossible », Op. cit.
[37] Thouvenot, « L’éducateur et son efficacité », Op. cit.
[38] Lapassade, G., 1963, L’entrée dans la vie. Essai sur l’inachèvement de l’homme, Paris, Editions de Minuit, p. 82.
[39] Esprit (revue), 1972, « Pourquoi le travail social ? », n°413, avril-mai ; Autès, Les paradoxes du travail social, Op. cit. ; Bouquet, B., 2011, « Regards sur le contrôle social. Une approche socio-historique », in Bureau, M.-.C, Sainsaulieu, I. (dir.), 2011, Reconfigurations de l’État social en pratique, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, p. 42.
[40] Soulet, M.-H., 2005, « Une solidarité de responsabilisation ? » in Ion, J. (dir.), Le travail social en débat[s], Paris, La Découverte, p. 86 – 103.
[41] Fassin, D., 2008, Faire de la santé publique, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Santé Publique.
[42] Honneth, A., 2000, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Éditions du Cerf.
[43] Deligny, F., 2004 [1945], Graine de crapule, Paris, Éditions du Scarabée, p. 27.
[44] Eme, B., 2011, « Postures assignées, usages revendiqués de la talvera », in Journal des anthropologues, « Postures assignées, postures revendiquées », Hors-Série, p. 21 – 49.
[45] Ion, Ravon, Les travailleurs sociaux, Op. cit., p. 96.
[46] Orwell, G., 2009 [1949], 1984, Paris, Gallimard, Coll. Folio, p. 352.
[47] Louli, J., 2013, « Une science des intuitions » in Le Sociographe, n°42, juin, p. 33 – 40.
[48] Eme, « Misères et grandeurs de l’évaluation de l’économie sociale et solidaire : pour un paradigme de l’évaluation communicationnelle », Op. cit.