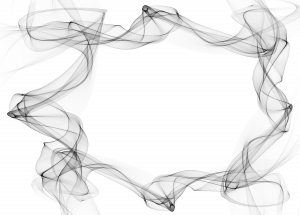Le sentiment de confiance au sein de l’armée : tensions entre hiérarchie et égalité
Olivia Leboyer
Docteur en science politique, IEP de Paris Chercheur associé au PACTE
Introduction
Si la confiance est souvent présentée comme un ressort pour l’action, elle demeure essentiellement une énigme.
Dans La Fabrique de la défiance[1], Yann Algan, Pierre Cahuc et André Zylberberg émettent une hypothèse : il y aurait corrélation entre une société fondée sur la hiérarchie et le statut et un taux de défiance élevé. Cette hypothèse s’applique-t-elle également à une micro-société comme l’armée ? N’a-t-on pas affaire là, à l’inverse, à un cas particulier ? Dans ce cas, comment comprendre cette exception ? Il semble en effet que l’armée exige de ses hommes une confiance spontanée, préalable à l’expérience de terrain, fondée sur le respect de l’ordre et de la hiérarchie. Institution fermée, l’armée constitue un microcosme qui, bien souvent, demeure mal connu pour l’observateur extérieur. L’armée obéit en effet à des codes particuliers.
Spontanément, l’armée évoque les idées d’espace clos, d’esprit de corps, d’attachement à certaines valeurs. De même, le terme de confiance suggère, à première vue, les idées d’espace protégé, de sécurité, de partage. Nous chercherons à comprendre comment l’institution militaire s’attache à produire et à préserver un sentiment de confiance en son sein. Nous nous efforcerons également de dégager les points de rupture et autres lignes de faille qui ont pu fragiliser cette confiance dans l’armée. Notre méthode se situe au croisement de la philosophie politique et de la socio-histoire.
Sur le phénomène de la confiance, les travaux de Niklas Luhmann ont compté. En distinguant la « confiance décidée » (trust) de la « confiance assurée » (confidence), Niklas Luhmann[2]met l’accent sur l’ambivalence de la confiance, qui peut naître d’une décision réfléchie ou bien d’un mouvement spontané, intuitif. Pour Luhmann, l’instauration de la confiance agit comme un mécanisme de réduction de la complexité sociale, où la confiance permettrait de fluidifier les relations et échanges sociaux. Indéniablement intéressante, cette analyse souligne, selon nous, la dimension positive de la confiance, en évitant cependant de s’interroger sur les zones d’ombre du phénomène. De fait, nous pensons que la confiance spontanée, immédiate et sereine, n’exclut pas nécessairement la prise de conscience de risques, sans que ces derniers soient forcément envisagés de manière exhaustive. Phénomène complexe, la confiance peut également s’accompagner de peurs, d’incertitudes et de doutes, dont on ne sait pas à l’avance s’ils l’affaibliront ou s’ils la renforceront.
Dans les études sur la confiance, une distinction est souvent établie entre la confiance, ou la défiance, à l’égard des institutions politiques et la confiance, ou la défiance, à l’égard des hommes politiques. Pour de nombreux auteurs[3], la confiance dirigée vers les institutions est de nature plus complexe, car elle concerne des entités plus abstraites, voire désincarnées. Or, il n’est pas évident que la confiance ressentie pour un homme politique puisse être comprise de la même manière qu’une confiance qui lierait un homme à un voisin ou à un collègue : on sait que la représentation politique a quelque chose d’ambivalent et de mystérieux, où se mêlent une simple part de la délégation et une part, plus trouble, d’incarnation.
Dans l’ouvrage collectif Democracy and Trust, dirigé par Mark Warren, la question de la confiance dans la démocratie est traitée en profondeur. Mark Warren souligne bien les tensions entre la confiance et la démocratie, deux notions dont il rappelle qu’elles ne vont pas de soi. De même que la confiance possède plusieurs dimensions, il existe différents sens et différentes théories de la démocratie. Dans le chapitre « How can we trust our fellow citizens ? », Claus Offe[4] s’interroge sur la crise de la démocratie, qu’il analyse comme une crise de perte de la confiance. Précisément, Claus Offe pense qu’il peut se développer dans les structures institutionnelles un ethos de confiance, un esprit particulier, qui leur imprime un sens véritablement démocratique. Des concitoyens anonymes deviennent alors des compatriotes à part entière.
Des recherches récentes s’efforcent de dresser une véritable archéologie du concept de confiance. Il y a dans la confiance quelque chose d’assez paradoxal : on peut bien décider d’accorder sa confiance à quelqu’un, mais la confiance s’éprouve dans les actes et, donc, dans le temps. Dans son ouvrage consacré à la notion de confiance, Die Praxis des Vertrauens[5] Martin Hartmann définit la confiance comme une véritable praxis, qui existe et se développe dans l’acte de confiance en tant que tel, conçu comme une épreuve. Où la confiance n’a pas une valeur en tant que telle, mais bien dans la praxis selon laquelle la relation de confiance se développe. Hartmann ne se représente pas la confiance comme une simple émotion. La confiance est, selon lui, une disposition relationnelle, évaluative, dont le contenu se comprend dans le cadre d’une praxis sociale. La confiance n’a de sens que dans la perspective de telle relation particulière. On ne peut pas dire de la confiance qu’elle possède une valeur intrinsèque, que l’on mesurerait par avance. Ainsi, la confiance entre des amis n’est pas identique à la confiance qui s’instaure entre des inconnus, ni à la confiance politique ou à celle du monde des affaires, non plus qu’à la confiance que l’on place en Dieu. C’est de la praxis, telle qu’elle se développe, que naissent alors certaines normes et valeurs, comme par exemple la liberté, l’égalité ou la dignité humaine. Mais Hartmann insiste sur le fait que la confiance ne doit jamais apparaître comme une obligation morale, comme une vertu absolue : la confiance reste, dans quasiment tous les cas, une option parmi d’autres options possibles.
Au sein de l’institution singulière, fermée, qu’est l’armée, comment la confiance peut-elle naître et se développer ?
Nous étudierons, dans une première partie, la confiance fondée sur un ensemble de croyances étroitement codifiées, qui correspondent à tout un imaginaire classique, traditionnel, de la guerre.
Dans un second temps, nous nous interrogerons sur la confiance comme décision, comme déclencheur de l’action : si le climat de confiance est un préalable à l’action des hommes, nous verrons que cette confiance s’appuie, bien souvent, sur les qualités de relationnel et de management que sur des valeurs parfois obsolètes et déconnectées du quotidien. Enfin, dans un troisième moment de notre réflexion, nous tenterons d’établir une typologie des temporalités de la confiance. Le phénomène de la confiance ne peut en effet se comprendre que dans un jeu de temporalités, qui n’a rien de figé. La notion est en elle-même mouvante, sa fragilité ou à l’inverse sa solidité, n’étant jamais parfaitement prévisibles. Que le temps altère, brise ou bien renforce la confiance, il en constitue sans doute la dimension la plus essentielle.
I Confiance et fixation des croyances
Spontanément, la notion de confiance évoque celle d’obéissance. Et dans une armée, faire confiance à son supérieur, cela revient à le croire sur parole, à se fier à son jugement et à exécuter ses ordres sans les discuter. Le supérieur hiérarchique doit savoir comment agir ou, du moins, ce qui revient presque au même, doit charger ses hommes d’exécuter telle action. En ce sens, s’engager dans l’armée représente bien un acte de confiance. Comme si l’on acceptait, par ce geste, d’appartenir à un ensemble plus grand, et auquel sont dus respect et obéissance. Il y a là quelque chose de naturel, un lien logique entre la relation hiérarchique et l’obéissance qui en découle. L’armée possède une structure hiérarchique bien délimitée. L’ordre, la discipline, la hiérarchie doivent, naturellement, inspirer un sentiment de confiance qui engendre à son tour l’action. Les rapports de force sont donnés à voir sur un mode clair et lisible, qui facilite et fluidifie les relations. Tous les gestes d’obéissance quotidiens, comme le passage de revue des troupes, ou le fait d’ôter sa casquette en présence de son supérieur, constituent ainsi autant de symboles, de répétitions d’une forme d’obéissance plus générale. Il s’agit bien de créer un état d’esprit et un véritable esprit de corps.
Être en confiance implique-t-il que l’on se sente en sécurité auprès de quelqu’un, ou bien au sein d’un groupe, d’une institution, au point de laisser la peur de côté ? Il y aurait, dès lors, quelque chose d’assez paradoxal à parler de la confiance au sein d’une armée : c’est précisément là qu’il est demandé aux hommes de mettre en jeu leur vie. Pour les militaires engagés dans l’armée, la peur constitue certainement un sentiment familier. Mais, comme tous les opposés, la peur et la confiance constituent peut-être bien l’endroit et l’envers d’une même médaille et ne vont que rarement l’un sans l’autre.
Dans Mars ou la guerre jugée, en 1921, Alain écrit ainsi :
Il y a un esprit de corps, une imitation des anciens, une crainte de ne pas faire ce qu’il faut, qui sont plus forts que la peur dans les moments critiques.[6]
Dans cette phrase, construite selon un rythme ternaire, Alain souligne à quel point la confiance ne vient pas nier la peur mais, tout au contraire, l’accompagne et la sublime. Dans les modèles anciens, l’esprit de corps, la confiance, forment et soutiennent le courage. La confiance est plus forte qu’une peur néanmoins présente, mais qui n’est pas une peur paralysante.
La confiance que l’on place dans les modèles anciens, dans les guerriers mythiques d’autrefois, représente une véritable éducation. L’imitation des anciens, voilà un thème classique, solide, que l’on retrouve chez nombre de mémorialistes. Chez le Général de Gaulle, dans Le Fil de l’Epée en particulier, la mobilisation des grandes figures, d’Alexandre le Grand à Napoléon, correspond à un topos. Mais, derrière le passage attendu, affleure bien une vérité : ces exemples-là, ces citations de L’Iliade et de L’Odyssée, ont très certainement constitué, pour le jeune enfant qu’était alors le Général de Gaulle, un choc initial, et peut-être le point de départ d’une vocation. Pour un futur militaire, la lecture de récits héroïques peut évidemment se révéler déterminante, la figure du héros apparaissant comme un modèle que l’on s’efforcera d’approcher. Aussi les valeurs antiques de la guerre continuent-elles, bien souvent, d’exercer leur étrange attraction, quand même elles paraîtraient d’un autre temps. D’une génération à l’autre, les légendes, les récits, les valeurs se transmettent, au sein d’un petit cercle. Héritage familial ou enseignement classique, tel que peut le dispenser encore aujourd’hui Saint-Cyr, où les jeunes élèves sont parrainés par un ancien. Soumis à un ensemble de rituels, comme les exercices de gymnastique rythmés par la récitation par cœur de textes classiques, ou des bizutages plutôt rudes, les Saint-Cyriens se sentent bien souvent dépositaires de tout un héritage, de traditions soigneusement préservées. La confiance ainsi créée repose sur un sentiment fort d’appartenance.
Chez le Général de Gaulle, l’attachement à des valeurs classiques, l’appel à la grandeur, au prestige, prennent souvent des accents quelque peu exaltés :
(Les armes) De quelles vertus elles ont enrichi le capital moral des hommes ! Par leur fait, leur courage, leur dévouement, la grandeur d’âme atteignirent des sommets. Noblesse des pauvres, pardon des coupables, elles ont, du plus médiocre, tiré l’abnégation, donné l’honneur au gredin, la dignité à l’esclave. (…) Il n’y eut d’hellénisme, d’ordre romain, de chrétienté, de droits de l’homme, de civilisation moderne que par leur effort sanglant.[7]
Le Général recourt fréquemment au champ sémantique de la grandeur, de l’honneur, des vertus. Autant de valeurs qui forment l’ossature d’une éthique de la guerre, au sens classique de conflit armé, public et juste. Dans son ouvrage Etats de violence, Essai sur la fin de la guerre, le philosophe Frédéric Gros souligne à quel point cette conception classique de la guerre se trouvait soutenue par une tension éthique, où la défense de l’honneur, le courage, le sens du sacrifice tenaient une place incontestée. Pour désigner ces valeurs éthiques primordiales, Frédéric Gros emploie une expression qui revient également très souvent sous la plume du Général de Gaulle : les « forces morales » :
On commencera par un mythe : au moins pour l’Occident, le mythe de la chevalerie, ou celui encore des héros homériques (et pourquoi pas encore les samouraïs en Orient : le bushidô japonais). Toujours on retrouve une imagination de la bonne guerre, celle des origines. Avant ce qu’on connaît, il y aura toujours eu autrefois, dans des temps perdus, la guerre loyale, respectueuse, un authentique affrontement de deux forces.[8]
Ce mythe évoque l’idée d’une confiance spontanée dans les vertus guerrières, dans une éthique valeureuse, nettement codifiée.
Pour de Gaulle, l’esprit militaire vient directement de cette force morale intime qui, venue de l’autorité hiérarchique, se diffuse naturellement et produit l’obéissance :
En vertu de la discipline, une sorte de contrat est passé entre le chef et les subordonnés. Il est entendu que l’obéissance est due par ceux-ci à ceux-là et que chacun s’efforce de réaliser ce qui lui est hiérarchiquement prescrit. (…) Mais il ne suffit pas au chef de lier les exécutants par une obéissance impersonnelle. C’est dans leurs âmes qu’il lui faut imprimer sa marque vivante. Frapper les volontés, s’en saisir, les animer (…) par une suggestion morale qui dépasse le raisonnement, cristalliser autour de soi tout ce qu’il y a dans les âmes de foi, d’espoir, de dévouement latents, telle est cette domination.[9]
Deux sortes de confiance sont évoquées ici : la confiance d’ordre contractuel, fondée sur la discipline, essentielle mais qui ne suffit pas à animer véritablement le corps des troupes ; et la confiance entendue dans un sens moins rationnel, qui naît d’un rayonnement, d’une aura, particuliers. Les termes employés possèdent une grande force de suggestion : « imprimer sa marque vivante », « frapper » « se saisir », « espoir, dévouement latents », « domination ». Dans cette distinction établie entre deux sortes de confiance, on peut voir la préfiguration de la distinction qu’établira, dans les années 1960, Niklas Luhmann entre le trust, ou confiance décidée, et la confidence, ou confiance assurée. En insistant sur l’importance de la confiance plus irrationnelle, née d’une suggestion morale frappante, le Général de Gaulle souligne la part de l’imagination, du rêve, dans la constitution d’une armée animée d’un esprit de corps.
Grandeur, prestige, noblesse, ces mots sonnent aujourd’hui de manière assez désuète. Comme si la force d’évocation qu’ils véhiculent avait perdu de ses couleurs. Déjà en 1932, le Général de Gaulle relevait cette évolution vers une certaine perte des repères, un certaine désaffection vis-à-vis de ces valeurs traditionnelles :
Notre temps est dur pour l’autorité. (…) Par conviction et par calcul, on a longtemps attribué au pouvoir une origine, à l’élite des droits qui justifiaient les hiérarchies. L’édifice de ces conventions s’écroule à force de lézardes. Dans leurs croyances vacillantes, leurs traditions exsangues, leur loyalisme épuisé, les contemporains ne trouvent plus le goût de l’antique déférence, ni le respect des règles d’autrefois.[10]
Tout ce qu’il y avait de solide, de ferme et d’assuré se lézarde, selon de Gaulle, avec l’entrée dans l’ère des sociétés modernes. On retrouve ici une intuition tocquevillienne : les temps modernes risquent d’entraîner une perte de la grandeur et de l’héroïsme, qui seraient des valeurs aristocratiques par excellence.
Aujourd’hui, bien sûr, plus que la littérature, ce sont plutôt le cinéma et, plus encore, la télévision ou même les jeux vidéo, qui véhiculent ces images héroïques et guerrières que l’enfant gardera en mémoire et qui l’influenceront au moment de décider d’un métier. On trouve une réflexion pertinente sur cette influence des médias chez James Der Derian, notamment dans l’ouvrage Virtuous War[11]. Michael Ignatieff, dans Virtual War[12], avait déjà abordé cette thématique troublante de la guerre spectacle. On peut sourire devant les clips réalisés pour les campagnes de recrutement de l’armée. Mais il se peut que le pouvoir suggestif d’une affiche ait pu attirer vers l’armée plus sûrement qu’une longue réflexion. Voir un chasseur alpin, tapi dans la neige, scruter l’horizon avec ses jumelles, cela peut déterminer un jeune homme à signer dans la cavalerie. Parce que la photographie était belle, et qu’il y avait quelque chose dans l’image, une promesse d’aventures. Que l’on s’engage pour imiter Thucydide, Alexandre le Grand ou Rambo, la part d’imagination est toujours présente, essentielle. Le pouvoir d’attraction de l’uniforme, le parfum d’aventures, la perspective de voyages et d’action sont, pour un jeune adulte, de puissants moteurs. Il s’agit bien, en s’engageant, de retrouver une confiance en soi tangible, de correspondre enfin à une certaine image de héros.
Dans Mars ou la guerre jugée, Alain médite contre les pouvoirs et leurs abus potentiels, constamment attentif à cette ligne rouge que l’on franchit parfois sans s’en douter. Ambigu, le court chapitre « Du commandement » est particulièrement éclairant sur le rapport complexe entre application de la discipline et sentiments :
« Trop de paroles. Il s’agit de trouver un responsable et de le punir. » Ainsi parlait un capitaine qui, par sa fonction, gouvernait une petite ville d’aviateurs et d’ouvriers. Il n’était pas aimé et je crois qu’il ne s’en souciait guère.
Cette méthode a de quoi étonner ; car l’amitié, la confiance et l’attention au beau travail peuvent beaucoup sur les hommes. (…) Les utopies que l’on peut concevoir à ce sujet, d’une armée agissant par la fraternité seule et par la compétence reconnue des chefs, viennent de ce que la guerre est toujours oubliée. La guerre dépasse toujours les prévisions et le possible.[13]
Alain remarque que les sentiments n’ont généralement que peu à voir avec l’exercice du commandement. Les hommes de pouvoir ne s’inquiètent d’ailleurs pas d’être aimés, du moment qu’ils sont craints et obéis. On trouve déjà une réflexion similaire chez Machiavel dans ses conseils au Prince.
Pour Alain, seuls les hommes de commandement aiment la guerre et la gloire militaire :
Tel est ce métier terrible, et tellement au-dessous du jugement moral que les plus résolus n’en parlent qu’en badinant. Ce qui détourne de mépriser la gloire militaire, mais peut-être aussi de l’aimer. « Ne parlons pas de cela » dit le héros.[14]
Indispensable, la confiance contient une part d’irrationnel. Décision, trust, à certains égards, elle repose également sur un élan plus mystérieux. Entre le chef et ses subordonnés, il ne s’agit pas, aux yeux du commandant en chef de l’ensemble des armées françaises Henri Bentégeat[15], d’une relation seulement contractuelle. Quelque chose de plus intime se joue :
Nul n’a mieux saisi que Paul Valéry le paradoxe fondamental de l’exercice du commandement : « le chef, c’est celui qui a besoin des autres ».[16]
Si l’on évoque souvent, et avec raison, la solitude du chef, forcé de prendre par lui-même ses décisions et de maintenir avec ses subordonnés une certaine distance, ce n’est que par les autres qu’il jouit de ce pouvoir. Et le besoin des autres évoqué par Paul Valéry n’est pas simple besoin de domination, sur un mode instrumental : paradoxal, ce besoin met également en jeu des sentiments et repose sur une forme de confiance.
Le chef a besoin des autres pour lui obéir et lui rappeler la dignité de sa fonction. Mais il a également besoin d’établir une relation de confiance avec l’espace du politique, extérieur à l’armée mais dont elle dépend néanmoins. Là aussi, c’est d’une relation interpersonnelle, d’homme à homme, qu’il s’agit. Le Général Henri Bentégeat, qui a servi à l’état-major des Présidents Mitterrand et Chirac, rappelle ainsi l’importance de sa relation particulière avec le Chef de l’Etat :
Le chef militaire (…) garde un important espace de liberté dans le dialogue avec le responsable politique, avant et pendant l’action. C’est avant tout, je l’ai vécu personnellement avec le Président Chirac, une question de confiance réciproque.[17]
Pour qu’il y ait relation de confiance, il faut en effet qu’il y ait réciprocité, et donc équilibre et symétrie. Y aurait-il, dès lors, une contradiction avec la stricte hiérarchie établie au sein de l’armée ? Peut-on parler de confiance, au sens plein du terme, entre un officier et un sergent ? La confiance que le sergent place dans l’officier ne s’adresse-t-elle pas, tout autant, à ce qu’il incarne, à un ensemble de valeurs ? En s’engageant, le soldat sans grade particulier place sa confiance dans tout ce que l’armée représente. Ainsi, avoir confiance dans son supérieur hiérarchique relève du réflexe naturel. Le contraire ne serait pas imaginable. Entrer dans l’armée, cela revient à en accepter les codes, les rites et la hiérarchie. Mais, l’officier sur un terrain, en charge de centaines d’hommes sous son commandement, quelle sorte de confiance peut-il placer dans ses hommes ? Il n’est pas question, pour lui, de les considérer comme une masse indifférenciée. Son travail consiste bien, au contraire, à les connaître petit à petit et à les apprécier. Savoir commander implique, non pas de juger, mais de jauger les hommes avec un certain coup d’œil, comme l’écrivait Machiavel. Si un soldat a été distingué, par ses performances dans les exercices comme par son efficacité dans les missions, le supérieur décide généralement de lui confier d’autres missions, qui le distinguent encore davantage aux yeux de ses camarades. L’armée ne fonctionne pas sur le mode égalitariste, où chacun se verrait à son tour confier une mission. Pas de tirage au sort, ni de maximum de missions par personne. Si un soldat se révèle plus doué que les autres pour mener une expédition, son supérieur lui fait confiance pour en entreprendre d’autres, cette confiance devant favoriser l’émulation au sein du groupe.
II La confiance au sein de la relation hiérarchique
Si un climat de confiance est indispensable au bon fonctionnement d’une armée, c’est en effet parce que la confiance favorise l’action. Nous l’avons vu, l’envers de la confiance est la peur, qui peut avoir des effets paralysants. Mais confiance et peur peuvent également coexister, sur un mode paradoxal et dynamique, poussant les hommes à l’action. C’est ce que remarque Alain :
Tel est l’ordre du combat, chacun poussant l’épée aux reins de celui qui le précède, et sentant une autre pointe derrière ; en sorte que nul ne peut savoir si ce n’est pas une grande peur qui va à l’assaut. Contre quoi il n’y a qu’une consolation, qui est d’admirer et d’acclamer les vainqueurs ; mais le visage de la guerre n’en est pas touché comme on pourrait croire. Indéchiffrable. Il craint la pensée. Et ce n’est point fausse modestie, sachez-le bien.[18]
Le courage peut bien être le nom noble pour un mélange obscur de peur et d’audace, de confiance et de mise entre parenthèses de la pensée. Temps suspendu, le temps de l’action est particulièrement difficile à ressaisir après coup. Il n’est pas évident que la seule confiance suffise à soutenir l’action. Tel peut éprouver les plus sincères émotions devant les rites, les symboles, l’Histoire de l’armée, et flancher au moment décisif d’agir. A l’inverse, le courage d’un soldat peut soudain se révéler à la faveur d’une opération, quand même rien n’aurait laissé soupçonner jusque-là ses qualités.
Interviewé au cours d’un entretien non directif, un officier des transports nous confie certaines réflexions critiques. Les jeunes qui viennent de s’engager sont souvent des jeunes qui ont été réfractaires au cadre scolaire. S’ils ont fait le choix de l’armée, c’est souvent pour suppléer à une autorité qu’ils n’ont pas connue. Au sein de l’armée, certains espèrent trouver une famille, des repères, un sens. Pour les jeunes qui attendent trop de l’armée, qu’ils ont rêvée sur un mode fantasmatique, il est souvent difficile d’aimer un métier avant tout répétitif, rudimentaire, fait de petites tâches quotidiennes sans éclat. Précisément, le fait que les nouvelles recrues disposent de six mois avant de signer définitivement leur permet de mesurer la portée de leur engagement. Ceux à qui les conditions de vie, la discipline, l’autorité ne conviennent pas s’en rendent en effet rapidement compte et, déçus, ne confirment pas leur engagement. Entre l’espace de l’imaginaire et la réalité, l’écart peut se révéler important.
L’exercice du pouvoir même n’est pas sans difficulté : entre les enseignements reçus dans les écoles militaires et l’épreuve effective du commandement, les choses ne vont pas forcément de soi. L’officier que nous avons interviewé nous a fait part de son ressenti sur cette question de l’exercice du pouvoir. Selon lui, les qualités de chef ne se révèlent que dans l’action. Certains élèves brillants de Saint-Cyr peuvent se révéler, dans la vie militaire au quotidien, manquer de cet alliage de qualités qui fait un bon chef. Pour exercer son autorité, un chef, par exemple un officier, ne peut pas seulement compter sur ce qu’il a appris, sur ce qu’il a lu. Une part d’instinct est nécessaire, afin de trouver la distance la plus juste avec ses subordonnés. Il faut se représenter le doute qui peut envahir un jeune homme, souvent à peine plus âgé que les hommes dont il a la charge, au moment de leur adresser ses premiers ordres. Certes, l’uniforme et le grade en imposent naturellement. Mais il faut aussi trouver le ton, avoir le regard bien assuré. Comme dans toute rencontre, les premières secondes sont déterminantes. Quand l’officier se livre à l’inspection de la revue, il serait par exemple inimaginable que ses soldats gardent leur casquette, qu’ils jugent souvent peu esthétique. Bien souvent, ils l’ôtent en vitesse dès que le chef paraît.[19] Et cette précipitation montre bien le respect mêlé de crainte que ce dernier inspire. On retrouve là les caractéristiques du chef énumérées, au XVe siècle déjà, par Machiavel : le Prince doit être craint plutôt qu’aimé.
Ce que Machiavel décrit, c’est l’attitude la plus juste que le Prince doit adopter vis-à-vis de ses sujets. Dans le cas d’un officier de notre époque, effectuant sa première prise de contact avec ses subordonnés, les conseils machiavéliens ne s’appliqueraient qu’imparfaitement. Mais l’on retrouve la nécessité d’en imposer par le décorum, par l’image. Il s’agit bien de recréer du mythe, de la fiction, pour permettre à un sentiment réel de respect et de confiance d’advenir. La mise en scène, les codes constituent des éléments essentiels de la relation hiérarchique. Que l’on rompe l’équilibre de la distance juste, et tout peut s’en trouver faussé. Aussi le chef doit-il éviter une trop grande familiarité avec ses hommes. S’il leur semble trop proche, trop amical, la relation de respect risque d’être altérée. Un officier doit ainsi jouer un rôle, incarner une fonction, en adoptant tout un ensemble d’attitudes et de codes.
Paradoxalement, la confiance doit, tout à la fois, préexister à la relation entre le chef et ses subordonnés, et se construire de manière tangible. Comme si le chef devait, en quelque sorte, confirmer un acquis, réinventer un sentiment qui existait déjà mais qui pourrait disparaître si les choses ne se déroulaient ainsi que les traditions le commandent.
Le sentiment de confiance qui doit relier les hommes de troupe entre eux a quelque chose à voir avec l’idée de fraternité. Chez Alain, la méfiance à l’égard des pouvoirs institués porte naturellement vers une solidarité avec les sans grade :
Ce qui est remarquable, c’est qu’avec ma position de favori j’eus toujours la confiance de la plèbe militaire, si naturellement défiante à l’égard des rapporteurs.[20]
Alain insiste sur ce que cette confiance a de remarquable et, pour ainsi dire, de contre nature : alors que la plèbe militaire se méfie naturellement des rapporteurs, elle éprouve néanmoins pour lui une sorte de bienveillance. Comme si quelque chose de commun transparaissait, une forme d’humanité, au-delà des rôles tenus par les uns et les autres.
Dans un autre passage, Alain remarque que ce sentiment fraternel, amical, a quelque chose de gratifiant :
Je secouai le lieutenant en termes vigoureux (…) Mais, dans le petit moment avant les excuses, je délibérai de lui sauter dessus, et cela se vit ; car l’ami C. qui était là comme signaleur, et qui, sur le moment, fit comme les autres et ne marqua rien, m’a dit depuis : « Quand vous avez été sur le point d’empoigner le lieutenant, et cela ne tenait qu’à un fil, j’ai bien regardé, et je me suis dit qu’il n’y aurait pas un seul témoin contre vous. » D’où l’on peut voir que j’étais resté homme de troupe et qu’ils me comptaient comme l’un d’eux.[21]
Dans cette anecdote, le sentiment de solidarité entre les soldats apparaît nettement, bien marqué par l’expression « homme de troupe ». Dans la phrase « D’où l’on peut voir que j’étais resté homme de troupe et qu’ils me comptaient comme l’un d’eux », le dernier syntagme vient redoubler le sens. Alain est heureux de constater « qu’il est resté » homme de troupe, non seulement au fond de lui, mais également aux yeux des autres, qui le reconnaissent comme l’un d’eux. « On peut voir » signifie en effet que tout le monde, sans exception, peut voir qu’il est resté homme de troupe, qu’il n’a pas changé en côtoyant les hommes de pouvoir de plus près. Quelque chose d’incorruptible est donc demeuré, que l’accès à des responsabilités plus élevées n’a pas éteint : le sentiment d’égalité ou, comme le dirait Alexis de Tocqueville, le sentiment du semblable. La confiance protectrice, solide, qui lie les hommes de troupe les empêcherait ainsi de témoigner contre l’un de leurs camarades. On sent qu’Alain a plaisir à relater cet épisode, qui montre que quelque chose de profond peut subsister entre les soldats, quand bien même leur position évoluerait.
Même en position de favori, il « a toujours » la confiance de la plèbe militaire. Et ce sentiment de confiance qu’il a réussi à conserver lui est d’autant plus précieux. Cela signifie qu’un lien existe pour de vrai, que le temps même ne rompt pas. Qu’un homme de troupe reste un homme de troupe, à ses yeux comme à ceux des autres, cela a pour Alain quelque chose de rassurant. Comme si la vie quotidienne au sein de l’armée avait permis de construire des relations authentiques et de retrouver le sentiment d’une appartenance commune. Il ne s’agit pas de simple camaraderie, mais d’un sentiment plus essentiel de fraternité et d’égalité. Où l’on retrouve l’idée, très forte, d’un véritable esprit de corps, qui anime les soldats, non pas individuellement, mais dans leur ensemble.
La confiance s’appuie, bien souvent, davantage sur les qualités de relationnel que sur des valeurs parfois obsolètes et déconnectées du quotidien. Un terme que les généraux, colonels ou autres supérieurs hiérarchiques n’aiment guère employer est celui de management. Rapprocher la fonction du commandement de l’univers de l’entreprise reviendrait à lui retirer de sa noblesse, à la vulgariser. Cela sous-entendrait, en quelque sorte, que les méthodes pour diriger les hommes sont les mêmes partout, où l’armée ne serait plus conçue comme cet univers spécifique, singulier. Or, de plus en plus de voix se font entendre, au sein même des commandements de troupes, pour en appeler à la nécessité d’une bonne gestion, efficace, proche des méthodes de management telles qu’elles se pratiquent dans le monde de l’entreprise. En désacralisant la fonction de commandement, ce vocabulaire nouveau, anglicisé, mettrait l’accent sur le caractère pratique, très concret, du métier.
Entrer dans l’armée, cela revient, d’une certaine manière, à s’en remettre à ce grand corps, à accepter de ne plus se penser sur le seul mode individuel. Précisément, l’institution militaire, très consciente de la relation singulière qui lie les individus au tout, se reconnaît une véritable responsabilité envers eux. Ainsi, dans le cas où un militaire, au bout de plusieurs années de service, souhaiterait démissionner, l’armée se charge de lui retrouver un emploi dans la vie civile. C’est d’ailleurs à l’institution militaire de verser les cotisations du chômage aux militaires en recherche d’emploi dans le civil. Aussi a-t-elle directement intérêt à replacer ses hommes rapidement. Un militaire qui a servi assez longtemps sait qu’il peut compter sur l’institution si jamais son projet de vie le porte ailleurs.
Récemment, le climat de confiance a été mis à mal avec le problème des soldes non payées pour un certain nombre de soldats. De manière apparemment totalement aléatoire, des soldats se sont vus oubliés au moment de la paye mensuelle, et ce plusieurs mois consécutifs. Prise en compte, l’erreur ne peut néanmoins être réparée rapidement. Avec les lenteurs administratives, de nombreux soldats ont donc dû accuser une baisse conséquente de leur compte en banque pendant quelques mois. Tant que la source de ce dysfonctionnement n’a pas été identifiée, le problème n’est pas entièrement réglé. Une inquiétude diffuse plane ainsi sur nombre de soldats, qui ne savent pas s’ils seront payés ou non.
L’hiver dernier le climat était à l’inquiétude, la parution début 2013 du Livre Blanc, rédigé par Jean-Marie Guéhenno, alimentant les angoisses. Les militaires s’attendent naturellement à des réductions de postes, des réductions de salaires et autres mesures restrictives en ces temps de crise. Le Livre Blanc planait, avant les fêtes de fin d’année, comme une épée de Damoclès, accentuant l’inquiétude qui règne actuellement dans l’armée avec le problème des salaires non rétribués. La parution du Livre Blanc était attendue avec circonspection et un certain fond d’inquiétude. On savait plus ou moins qu’il y aurait des réductions de postes, mais le chiffrage n’ayant pas été annoncé à l’avance, l’espoir comme l’anxiété ont pu se développer.
III Les temporalités de la confiance
Le phénomène de la confiance ne peut se comprendre que dans un jeu de temporalités. La notion est en elle-même fluctuante, la fragilité ou à l’inverse la solidité de la confiance n’étant jamais parfaitement acquises. Le temps constitue la dimension essentielle de ce phénomène mobile.
La mémoire, les habitus, jouent un rôle essentiel. Fondée sur la discipline, l’ordre, le respect, l’obéissance, la vie quotidienne des armées tient, toujours, par la force des choses. Si la confiance est à réinventer et à maintenir en permanence, elle s’appuie également sur tout un passé d’habitudes fermement ancrées. Les évolutions récentes, notamment avec l’usage répandu d’internet, modifient les rapports, dans une certaine mesure. Le rapport au temps connaît des modifications conséquentes, que ce soit dans la vie de caserne au quotidien ou dans le déroulement des conflits : à la bataille classique de la guerre juste se substituent des « états de violence » plus troubles, plus difficiles à délimiter dans le temps comme dans l’espace. L’ennemi, avec le terrorisme notamment, n’a plus forcément un visage clairement et immédiatement assignable.
Avec l’apparition de nouvelles formes de guerre, davantage déterritorialisées, moins fixées dans le temps, la confiance est sans doute devenue une valeur plus menacée, plus fragile. à quelles temporalités sa construction obéit-elle à présent ?
On trouve ainsi, chez le Général de Gaulle, ce constat, qui souligne l’affaiblissement des croyances, des attachements indéfectibles :
Notre temps est dur pour l’autorité. (…) Par conviction et par calcul, on a longtemps attribué au pouvoir une origine, à l’élite des droits qui justifiaient les hiérarchies. L’édifice de ces conventions s’écroule à force de lézardes. Dans leurs croyances vacillantes, leurs traditions exsangues, leur loyalisme épuisé, les contemporains ne trouvent plus le goût de l’antique déférence, ni le respect des règles d’autrefois.[22]
« Croyances », « traditions », « loyalisme » sonnent à présent, selon le Général, comme des valeurs désuètes, des mots galvaudés. Le bel édifice de la confiance se serait progressivement fissuré. L’analyse semble amère, presque sans appel. On retrouve un accent de déploration, de regret d’une sorte d’âge d’or. Mais la pente du déclin n’est pas fatale pour de Gaulle, qui, presque aussitôt, modère son propos :
Une pareille crise, pour générale qu’elle paraisse, ne saurait durer qu’un temps. Les hommes ne se passent point, au fond, d’être dirigés, non plus que de manger, boire et dormir. Ces animaux politiques ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordre et de chefs.[23]
Susciter l’inquiétude pour, ensuite, en appeler aux esprits courageux, c’est là un procédé rhétorique classique, à l’efficacité éprouvée. Le Général s’alarme des changements de mentalités pour mieux insister sur la permanence de certains besoins, indéracinables à ses yeux : le désir d’être commandés serait ainsi chevillé au corps des soldats. L’esprit d’obéissance, la confiance dans l’armée, ne peuvent que renaître. De Gaulle imagine alors une véritable régénération. La relation hiérarchique de commandement/obéissance serait, selon lui, quasiment d’ordre naturel. A rebours du credo tocquevillien d’égalisation des conditions en démocratie, le Général de Gaulle souligne, à l’inverse, le substrat élitiste fort qui imprègne les rapports entre les hommes au sein de la société et, plus particulièrement, au sein de cette microsociété singulière qu’est l’armée.
Précisément, le Général s’attache à retracer les étapes de la perte de confiance :
Dans la crise morale qui provoque le désastre d’une armée, on a coutume d’étudier : la perte de la confiance en la victoire ; puis la surprise, résultat d’une brutale manifestation de la volonté ennemie, et entraînant la stupeur et le découragement ; puis la panique, survenant à la suite d’un incident quelconque de la bataille ; enfin la déroute ou la capitulation. Ces phases de l’effondrement moral…[24]
Le découpage en phases montre bien ce que le processus a de logique, si l’on peut dire. Très suggestive, l’expression « crise morale » souligne l’importance du facteur psychologique dans une victoire ou dans une défaite. La perte de confiance entraîne le découragement, le doute, et précipite le « désastre ». Il y a là un enchaînement presque mécanique, la perte de la confiance conduisant naturellement à une déroute impossible à éviter. Dans cette succession de phases, la perte de confiance représente un instant décisif, de rupture.
La confiance apparaît ainsi comme une lutte contre le temps. Il y aurait là comme une manière de conjurer le temps, de construire un espace mental imprenable. A l’inverse, la perte de confiance intervient généralement brutalement, à la manière d’un choc en retour, d’une rupture. Un événement traumatisant, le contact avec les réalités du combat, peuvent provoquer la désillusion. Mais, nous l’avons, vu, la confiance peut également perdre de son pouvoir sous l’effet d’érosion du temps et des attentes déçues.
Revenant sur l’Affaire Dreyfus, le Général de Gaulle rappelle que l’atmosphère délétère qui régnait alors au sein de l’armée, et qui préparait la grande crise de l’Affaire, n’ont pas, dès l’abord, été perçus à leur juste mesure. L’Affaire a surpris, créant un véritable choc, alors que certains signes étaient pourtant là :
Pourtant, il n’y a là, d’abord, qu’un malaise sans profondeur. Tant de griefs de détails ne font pas une grande querelle. Mais l’Affaire Dreyfus survient. Par une sorte de fatalité, au moment même où l’esprit public tend à s’éloigner de l’armée, éclate la crise la plus propre à conjuguer les malveillances. Dans ce lamentable procès, rien ne va manquer de ce qui peut empoisonner les passions.[25]
Précisément, un malaise sans profondeur constitue un terreau d’instabilité, une zone mouvante et sans appuis auxquels se raccrocher. Dans ces sortes de moments de flottement, les crises prennent une ampleur d’autant plus retentissante. L’Affaire cristallise les malveillances, les haines couvées, les passions malsaines et met à mal, pour un temps assez conséquent, la confiance dans l’armée. Significativement, c’est au moment où l’opinion publique est devenue sensiblement indifférente à l’armée que cette dernière revient, brutalement, au cœur de toutes les attentions. L’armée va diviser, passionner, ceux-là mêmes qui, jusqu’alors, n’avaient pas de sentiment particulier sur le sujet. Peut-on mettre en question la parole donnée par un officier de l’armée ? C’est bien la confiance qui est ici directement en cause. Le Général de Gaulle indique que tous les ingrédients sont réunis pour « empoisonner les passions » et troubler une confiance dont on se rend compte qu’elle ne va pas forcément de soi.
Comme l’écrit Alain dans Mars ou la guerre jugée, au chapitre XLIII « L’Affaire Dreyfus » :
Je revenais à l’Affaire Dreyfus et j’en apercevais le vrai sens. Cette révolte fameuse fut moins contre une erreur judiciaire que contre un pouvoir arrogant qui ne voulait point rendre des comptes. Ce fut une guerre d’esclaves. Et je ne m’étonne plus que, dans le monde entier, esclaves et maîtres l’aient suivie avec une attention passionnée. Les uns tenaient pour la liberté et les autres pour le pouvoir absolu ; aussi n’y eut-il point de pardon, d’un côté ni de l’autre ; et les familles furent divisées jusqu’à l’injure. (…) La guerre remit tout en ordre, si je puis dire. « Je n’admets pas que l’on mette en doute la parole d’un officier français » ; ce mot célèbre m’avait paru traduire seulement le paroxysme des passions, et sous une forme ridicule. Mais l’expérience quotidienne, en ces terribles années, me fit voir que c’était bien un axiome de pratique à l’usage des esclaves.[26]
Pour Alain, le vrai sens de l’Affaire tient dans l’opposition entre maîtres et esclaves, entre les tenants d’un pouvoir absolu et les partisans de la liberté. Au cœur de ce tumulte, la phrase solennelle « Je n’admets pas que l’on mette en doute la parole d’un officier français » a pu semblé, tout d’abord, plutôt ridicule à Alain. Mais, à la réflexion, voilà qu’elle résonne comme « un axiome de pratique à l’usage des esclaves ». L’observation de la guerre conduit Alain à affirmer que « le propre du tyran est de croire que l’esclave est heureux d’obéir »[27]. Les ressorts de l’obéissance, donc de la confiance, reposent sur une sorte d’illusion, de malentendu. Aussi, Alain espère que « si ces cinq ans d’esclavage ont bien instruit les esclaves »[28], ceux-ci vont trouver la lucidité et le courage de se révolter contre les pouvoirs absolus, incarnés notamment par cet axiome selon lequel la parole d’un supérieur ne saurait être mise en doute. Contre une confiance aveugle et non réfléchie, Alain espère la réaction des masses, animées par une confiance dans leurs propres forces. Loin de prôner l’anarchie, Alain rêve seulement d’un contrôle, d’une limitation, de pouvoirs dont la toute-puissance ne peut être que nuisible :
Pour moi, jugeant, il me semble, d’après les causes, qui sont toujours petites et d’un moment, je suis au contraire ramené à l’espérance par la vue des maux à leurs racines. (…) Mais une défiance assez éveillée, une action mieux concertée, des jugements d’abord explicites, quelque confiance enfin de chaque homme en sa propre puissance, produiraient une révolution diffuse et continue, sans aucune violence.[29]
Dans cette analyse, le rapport au temps est évoqué de manière assez saisissante. La crise de l’Affaire Dreyfus survient brutalement, sur le fond d’un climat empoisonné, et vient remettre en cause les fondements d’une confiance dans l’armée jusque-là tacitement acceptée et tenue, dans le même temps, pour conventionnelle et naturelle. En envisageant la perte de confiance dans sa soudaineté, le Général de Gaulle comme Alain, mettent ici l’accent sur le facteur de la temporalité. Si la confiance résulte d’une certaine alchimie, elle peut être brisée en un instant. De grandes crises, comme l’Affaire Dreyfus, peuvent donner lieu à une remise en question de ce qui auparavant semblait aller de soi.
Conclusion
Si, comme l’écrit Frédéric Gros dans ses ouvrages Etats de violence, essais sur la fin de la guerre (2005) et Le Principe Sécurité (2012), la guerre a changé de visage, s’inscrivant dans une temporalité plus floue, plus heurtée, on peut penser que le sentiment de confiance des soldats dans l’armée s’en trouve également modifié. Moins stable, moins arrimée à des valeurs traditionnelles, pérennes, la confiance spontanée, immédiate possèderait-elle moins de force qu’avant ?
Il nous semble que la confiance intuitive dans les valeurs et l’imaginaire de l’armée conserve une puissance d’évocation relativement solide. L’histoire, la force des récits, des films de guerre contribuent à alimenter tout un imaginaire, peut-être naïf, mais qui agit comme un véritable principe actif. De fait, c’est à l’action que conduit la confiance, qu’elle soit assurée (confidence) ou décidée (trust), selon la distinction établie par Niklas Luhmann. Au sein de l’armée, les supérieurs hiérarchiques bénéficient à la fois d’une confiance a priori, spontanée, de la part de leurs hommes, et d’une autre sorte de confiance, qu’il leur faut établir et consolider au fil du quotidien. Le premier type de confiance s’adresse à leur persona, à leur fonction. Il s’agit d’une confiance envers l’institution dans son ensemble. Le second type de confiance constitue une relation d’homme à homme, plus incarnée.
Précisément, la confiance s’inscrit dans un jeu de temporalités complexe. Au sein du microcosme qu’est l’armée, la confiance est à la fois un donné et un sentiment qui se construit par l’épreuve du terrain. Le terme d’engagement implique bien une confiance a priori, une confiance dans l’institution. Par la suite, c’est une forme de confiance interpersonnelle qui s’établit, selon les codes de la relation hiérarchique.
La confiance représente un pari. Il s’agit, dans la relation de confiance, de croire dans une forme de fidélité, de respect de la parole donnée. Relation ambivalente, la confiance peut se trouver altérée ou bien brisée net. La peur, l’incertitude, font partie de la confiance, au même titre que l’espoir.
Bibliographie
Ouvrages et articles
Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg, La Fabrique de la défiance… et comment s’en sortir, Albin Michel, 2012.
James Der Derian, Virtuous War : Mapping the Military Industrial Media Entertainment Network, 2001 et 2nde édition 2009.
Frédéric Gros, Etats de violence, Essais sur la fin de la guerre, Gallimard, 2006.
Frédéric Gros, Le Principe Sécurité, Gallimard, 2012.
Russel Hardin, « Do we want trust in government ? » in Democracy and Trust, Mark Warren, Cambridge University Press, 2004.
Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2011.
Michael Ignatieff, Virtual War : Kosovo and Beyond, 2003
Niklas Luhmann, La confiance : un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris, Economica, Etudes sociologiques, 2006.
Claus Offe, « Wie können wir unseren Mitbürgern vertrauen ? », Frankfurt/M. Campus, 2001, in Democracy and Trust, op.cit., 2004.
Les Cahiers du Cevipof, La confiance dans tous ses états, les dimensions politique, économique, institutionnelle, sociétale et individuelle de la confiance, numéro 54, juillet 2011.
IRSEM, étude de Ronald Hatto, Anne Muxel, Odette Tomescu-Hatto, Enquête sur les jeunes et les armées : images, intérêt et attentes, Paris, 2011.
Le Monde Diplomatique, Manière voir, L’armée dans tous ses états, décembre 2012-janvier 2013.
Ouvrages classiques
Alain, Mars ou la guerre jugée (1921), Pléiade.
Alain, Souvenirs de guerre (1931), Pléiade.
Général de Gaulle, La défaite, question morale (1927-1928).
Général de Gaulle, Le Fil de l’Epée (Berger Levrault, 1932).
Machiavel, Le Prince (1513).
Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, 1835 et 1840.
[1] Yann Algan, Pierre Cahuc, André Zylberberg, La Fabrique de la défiance… et comment s’en sortir, Albin Michel, 2012.
[2] Niklas Luhmann, La confiance : un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris, Economica, Etudes sociologiques, 2006.
[3] Notamment, Russel Hardin, « Do we want trust in government ? » in Democracy and Trust, Mark Warren, Cambridge University Press, 2004.
[4] Claus Offe, « Wie können wir unseren Mitbürgern vertrauen ? », Frankfurt/M. Campus, 2001, in Democracy and Trust, op. cit., 2004.
[5] Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2011.
[6] Alain, Mars ou la guerre jugée (1921), Pléiade, p. 460.
[7] Général de Gaulle, ibid., p. 190.
[8] Frédéric Gros, Etats de violence, Essais sur la fin de la guerre, Gallimard, 2006, p. 17.
[9] Général de Gaulle, Le Fil de l’Epée, op.cit., p. 160.
[10] Général de Gaulle, Le Fil de l’Epée, op.cit., « Du Prestige », p. 179.
[11] James Der Derian, Virtuous War : Mapping the Military Industrial Media Entertainment Network, 2001 et 2nde édition en 2009.
[12] Michael Ignatieff, Virtual War : Kosovo and Beyond, 2003.
[13] Alain, Mars ou la guerre jugée, op.cit., « Du commandement », p. 562.
[14] Ibid., p. 563.
[15] Général Henri Bentégeat, Aimer l’armée, une passion à partager, éditions DuMesnil, 2012.
[16] Général Henri Bentégeat, op.cit., « 2. Aimer cette vocation », p. 39.
[17] Général Henri Bentégeat, op.cit., « 12. Aimer la liberté », p. 148.
[18] Alain, Mars ou la guerre jugée, op.cit., chap.. XIII « La tête de Méduse », p. 573.
[19] De récents travaux de sociologie militaire rendent également bien compte de cette socialisation, comme A genou les hommes, débout les officiers : la socialisation des Saint-Cyriens, de Claude Weber (préface de Michel Wieviorka) Presses Universitaires de Rennes, 2012.
[20] Alain, Souvenirs de guerre, op.cit. p. 534.
[21] Ibid. p. 434.
[22] Général de Gaulle, Le fil de l’épée, « Du prestige », op.cit., p. 179.
[23] Ibid.
[24] Général de Gaulle, La défaite, question morale (1927-1928), in études et correspondance, Paris, Plon, 1973.
[25] Général de Gaulle, op.cit. p. 461.
[26] Alain, Mars ou la guerre jugée, op.cit. chapitre XLIII « L’Affaire Dreyfus », p. 622.
[27] Ibid., p. 623.
[28] Ibid.
[29] Alain, ibid., chapitre XLVI « Ne pas désespérer », p. 627.