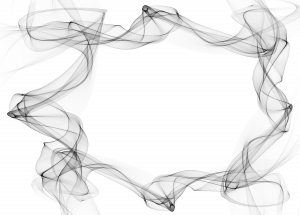Sociologie des conflits environnementaux
Cet article a été publié dans le dossier 2014 – la confiance.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des contributions du dossier
Les relations épistémiques de confiance et d’autorité dans l’action collective et le militantisme. Exemple par la sociologie des conflits environnementaux
Aurélien Allouche, Chercheur associé au LAMES , Aix-Marseille Université,
Introduction
L’action collective attribue une place essentielle à la confiance que les acteurs sont le plus souvent contraints de s’accorder les uns aux autres. La confiance est vue depuis Georg Simmel ([1900] 1987, [1908] 1999) comme une force de synthèse des collectifs tout à fait remarquable qui établit un rapport spécifique entre la connaissance et l’ignorance que l’on entretient envers les propos ou les actes d’une personne. Une trop grande ignorance quant à la fiabilité des propos de cette personne empêche de coordonner une action collective et peut aller jusqu’à rendre impossible la relation sociale. A l’inverse une connaissance parfaitement avisée des propos de cet acteur ou une prévisibilité complète de ses actions vide de son contenu l’acte de lui attribuer notre confiance. La relation sociale s’affaiblit alors fortement en perdant la valeur réciproquement engageante qui provient à la fois du fait d’être dépositaire de la confiance d’un autre et du fait de reconnaître explicitement cet autre comme digne de notre confiance. La confiance supposerait, en ce sens, une dose d’ignorance. Cela se comprend aisément lorsque cette relation si particulière porte sur la conduite qu’un tiers promet de tenir dans un proche avenir. On ne peut pas être proprement assuré de son comportement futur et on accepte cet état d’ignorance partielle en lui attribuant notre confiance. Au reste si nous étions parfaitement en mesure de prévoir ses actions futures, il n’y aurait pas de sens à dire que nous lui faisons confiance et, plus probablement, pourrions-nous uniquement dire que nous faisons confiance à notre interprétation des données et des facteurs qui nous conduisent à prédire avec certitude ses actions.
Si nous acceptons ainsi un certain état d’ignorance en faisant confiance à un tiers, il n’est pas certain que nous acceptions la même dose d’ignorance si nous nous remettons à ce dernier pour accéder à une connaissance scientifique, à une donnée technique ou encore à un jugement expert. La situation particulière où nous devons choisir de faire confiance à un tiers pour réduire notre état général d’ignorance peut être distinguée à partir de la notion de « confiance épistémique », c’est-à-dire la confiance que nous plaçons en une autorité épistémique pour nous communiquer (honnêtement) des contenus véritablement fiables. La nature de la vigilance[1] que les acteurs exerceront dans ce cas pour évaluer si leur confiance pourra être maintenue risque a priori d’être de nature différente que dans le cas où seuls des comportements font l’objet de la relation de confiance. De même, la nature et la quantité de choses que l’on accepte d’ignorer risquent de différer dans le cas où la confiance s’inscrit dans une attitude de prise de connaissance.
Ces considérations appellent le sociologue à porter son attention sur le rôle spécifique que la confiance épistémique joue dans les formes d’action collective lorsque l’accès à des connaissances et des données techniques ou scientifiques constitue un enjeu crucial pour les acteurs.
De ce point de vue, le militantisme environnementaliste fournit un champ de réflexion pertinent en se distinguant par l’importance que les acteurs accordent aux données et aux raisonnements scientifiques et techniques, laissant ainsi supposer que la confiance épistémique constitue une dimension essentielle de ce type de mobilisations collectives.
L’objet de cette contribution sera donc de questionner comment la prise en compte dans l’analyse sociologique des contraintes propres à l’établissement de la confiance épistémique permet d’éclairer certaines dynamiques de l’action collective et spécialement du militantisme pro-environnemental. On peut pour cela appuyer notre réflexion sur différents travaux sociologiques et anthropologiques qui ont montré le gain heuristique pour l’analyse des phénomènes sociaux de résultats et de concepts issus de l’épistémologie sociale[2]. L’autorité épistémique et plus encore la confiance épistémique ont récemment ouvert en sociologie un champ fécond d’interrogations avec des contributions telles que celles de Clément et al. (2004), Ogien et Quéré (2006), Bouvier (2007), Bouvier et Conein (2007), Orrigi et Spranzi(2007), Sperber et al. (2010), Lazega (2011).
Dans cette perspective, nous souhaiterions porter ce questionnement dans le cadre du militantisme pro-environnemental en nous intéressant tout particulièrement aux processus qui peuvent conduire une simple protestation collective de riverains contre un projet d’aménagement (par exemple, la construction d’un aéroport ou d’une autoroute, l’installation d’une centrale nucléaire, etc.) à devenir une action militante pour la protection de l’environnement. Si de nombreux travaux sociologiques ont abordé ces dynamiques d’évolution de l’action collective, le rôle de la confiance épistémique dans ce type de processus a peu fait l’objet d’un questionnement sociologique systématique, même si l’on peut citer des travaux tels que ceux de Louis Quéré (2006) ou d’Alban Bouvier (2007).
Notre questionnement sera donc le suivant : lorsque des individus s’unissent en un collectif pour s’opposer à un projet d’aménagement, dans quelle mesure les contraintes propres à la confiance et à l’autorité épistémiques, ainsi que les logiques par lesquelles ces acteurs établissent celles-ci, peuvent-elles jouer sur l’objet de l’engagement de ce collectif ? La confiance et l’autorité épistémiques peuvent-elles jouer un rôle dans l’évolution d’une simple action de « blocage » d’une infrastructure non désirée vers un engagement collectif pour la défense de solutions pro-environnementales et alternatives à un projet d’aménagement ?
Pour aborder cette problématique d’un point de vue sociologique, on peut procéder en distinguant des moments nécessaires et caractéristiques de l’activité des groupes protestataires, et analyser pour chacun d’eux la place que peuvent y occuper la confiance épistémique et l’autorité épistémique. Les actions menées par des collectifs protestataires sont aussi diverses que complexes, en particulier lorsqu’elles impliquent une logique de mobilisation de ressources (McCarthy et Zald, 1977), ou l’utilisation de répertoires d’actions collectives variés (Tilly, 1978), ou encore lorsque les arguments mobilisés par ces collectifs s’inscrivent dans l’espace-temps de plusieurs controverses publiques (Chateauraynaud, 2007 ; Fourniau, 2007). En dépit de cette diversité, trois moments de l’activité protestataire nous paraissent indéniablement s’imposer à un collectif d’opposition à un projet d’aménagement. En premier lieu, les membres d’un tel collectif doivent définir une ligne commune, valant pour la position du collectif et comportant les principales raisons motivant leur opposition, leurs revendications et les arguments justifiant que ces dernières soient satisfaites. La définition de cette ligne commune s’opère tout au long de l’activité du groupe et pose le contenu a minima sur lequel chaque membre s’engage. Dans la mesure où, lors d’un conflit d’aménagement, le principal mode d’action d’un collectif d’opposition consiste à défendre un argumentaire (Chateauraynaud, 2007 ; Fourniau, 2011), une seconde dimension de l’activité protestataire revient, dans ce cadre, à ajuster l’argumentaire afin de répondre aux réfutations qui apparaissent inévitablement dans l’espace de controverse. Enfin, un troisième passage « obligé » consiste dans la révision des jugements collectifs lorsque des arguments ont été opposés au groupe et que celui-ci n’a pas été en mesure de les réfuter. Cela ne signifie pas nécessairement que le groupe abandonne sa position, mais plutôt qu’il doit procéder à une évaluation répondant au doute naissant de l’incapacité à invalider sur le plan épistémique les contradictions soulevées dans l’espace de la controverse. Les raisonnements tenus par les acteurs risquent alors de se déplacer à un niveau méta-épistémique, c’est-à-dire de quitter le niveau de l’évaluation de proposition à partir de critères partagés pour discuter directement ces critères eux-mêmes.
Quelle que soit la diversité des actions menées dans une protestation, l’engagement sur une ligne commune, l’ajustement de l’argumentaire collectif et la révision du jugement du groupe à un niveau méta-épistémique nous paraissent être des moments récurrents, sinon indépassables, de l’activité des groupes d’opposition à un projet d’aménagement. Nous choisissons donc d’analyser comment la question de la confiance épistémique se pose lors de chacun de ces moments de la protestation et d’interroger la possibilité que les acteurs, du fait de devoir attribuer leur confiance épistémique à un tiers ou de chercher à susciter une telle confiance, en viennent à faire évoluer la nature de leur engagement.
Pour faire reposer l’analyse sur un matériau empirique, nous nous appuierons sur une étude de cas correspondant au suivi, de 2004 à 2007, d’un collectif de dix-huit associations formé en vue de s’opposer à un projet de canal de dérivation de la chaîne hydro-électrique « Durance-Verdon » dans la région de l’étang de Berre (département des Bouches-du-Rhône).
1. La confiance et l’autorité épistémiques dans l’entrée en protestation et leur rôle dans la formation d’une intention partagée
L’étang de Berre est le réceptacle des effluents d’une chaîne hydro-électrique, gérée par EDF, qui dérive l’eau de la Durance, une rivière située en amont de l’étang, et la rejette après turbinage dans le plus grand étang salé d’Europe (155 km2). Cet aménagement, décidé en 1966, a profondément perturbé les écosystèmes de l’étang, lequel reçut, dès les premières années de fonctionnement de la chaine, plus de trois milliards de mètres cubes d’eau douce par an. Cette situation fit naître à la fin des années quatre-vingt un long processus de contestation sociale de l’aménagement hydro-électrique[3] qui déboucha en 2000, après l’application de différents plans d’action, à la mise en place d’un groupement d’intérêt public, le GIPREB, ayant pour mission d’évaluer les différents scénarios techniques de restauration écologique de l’étang compatibles avec le maintien de l’activité de la chaîne hydroélectrique. A cet effet, le GIPREB mit à l’étude en 2003 un scénario de dérivation des eaux turbinées par la centrale au moyen d’un canal rejetant ces effluents dans le Rhône (qui s’écoule à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de l’étang de Berre), en traversant la plaine agricole de la Crau.
Cette proposition souleva la protestation de plusieurs acteurs tout au long du tracé (prospectif) de ce canal et leur indignation de ne pas avoir été concertés dans l’étude de ce scénario. Une mobilisation se fit jour, spécialement portée par des producteurs de foin de Crau, qui voyaient la traversée des plaines par un canal de quelques quarante mètres de large comme une menace pour l’infrastructure hydraulique de leurs productions et l’intégrité des parcelles. D’autres acteurs de territoires limitrophes à l’étang de Berre (Alpilles et Crau) exprimèrent également leur mécontentement en défendant des centres d’intérêt très divers, ainsi d’une association altermondialiste, de plusieurs associations d’initiative locale ayant pour objet l’amélioration de la qualité de vie dans leur commune et d’une association de protection et de patrimonialisation de la nature.
Ces différents acteurs n’avaient alors aucune connaissance particulière du fonctionnement de l’étang de Berre ni de la nature des problèmes écologiques qui motivaient le scénario de dérivation auquel ils étaient confrontés. De même, la restauration des écosystèmes de l’étang n’entrait pas dans leurs motivations à protester contre le projet de canal. Cela changea sous l’impulsion d’une association locale à l’étang de Berre venue à la rencontre des acteurs de la Crau et des Alpilles, au gré de l’intersection de réseaux associatifs, pour les « éclairer » sur les tenants et les aboutissants du scénario de dérivation. Cette association était engagée depuis la fin des années quatre-vingt dans la contestation de l’infrastructure hydro-électrique et proposait des « solutions » techniques pour résoudre le problème écologique de l’étang de Berre. Elle se chargea d’expliquer à ces opposants les données techniques et scientifiques du problème. Elle leur fit également comprendre que la contestation du canal nécessitait de s’appuyer sur la proposition de solutions techniques alternatives puisque, les services de l’Etat considérant comme un enjeu national le maintien du potentiel énergétique de la chaine hydro-électrique, le simple refus local de l’aménagement risquait de devoir s’effacer devant l’évocation de l’intérêt public. Pour ces raisons, les principaux acteurs de la Crau et des Alpilles décidèrent de rejoindre l’association berroise en formant un collectif qui s’opposerait au canal en défendant les solutions techniques de cette dernière.
Une telle situation est relativement récurrente dans les conflits d’aménagement. L’opposition à un projet d’aménagement au nom de ses conséquences sur un espace de vie personnel se confronte le plus souvent aux attentes publiques en matière de participation démocratique à la gestion du bien commun. Aussi, les opposants doivent-ils opérer une montée en généralité dans la définition des raisons qui motivent leur opposition (Lolive, 1997 ; Trom, 1999 ; Fourniau, 2011), cela étant d’autant plus nécessaire que les acteurs de l’espace public s’approprient de façon notable les catégories d’analyse que les sciences politiques emploient pour décrire le « repli » sur la sphère des considérations personnelles, sinon égocentrées, de la participation au bien commun, ainsi du « phénomène » de NIMBY[4] (Ollirault, 1996). Les acteurs protestataires peuvent opérer cette montée en généralité en mobilisant dans leur argumentaire des axiologies permettant de se rattacher à des définitions du bien commun partageables par le plus grand nombre, ainsi que les travaux de Claudette Lafaye et de Laurent Thévenot[5] l’ont montré de longue date dans le cadre des conflits d’aménagement. De façon complémentaire, un groupe d’opposition montrera qu’il dépasse la simple défense de son intérêt propre et immédiat en s’affichant comme soucieux de résoudre le problème qui motive le projet d’aménagement refusé. Son argumentaire se déplacera alors de l’impératif de devoir justifier du caractère acceptable ou tolérable des raisons qui lui font rejeter ce projet à la démonstration que les solutions qu’il propose sont efficaces et préférables à toute autre, et ce, indépendamment des raisons qui ont motivé la réflexion des membres de ce groupe.
Ce déplacement, d’apparence banale, de l’activité protestataire de la légitimation de son refus à la mise à l’épreuve de ses solutions techniques met les acteurs en prise avec des questions de confiance épistémique et d’autorité épistémique. Les problématiques d’autorité épistémique sont les plus immédiatement perceptibles pour l’analyse dans la mesure où les acteurs, en prônant une solution alternative, devront défendre leurs propositions face à des experts et montrer qu’ils ont toute crédibilité à formuler des jugements dont l’examen n’est pas toujours possible dans l’espace-temps de la controverse. Il sera étudié plus loin quelques-unes des ramifications possibles de cette problématique dans l’activité concrète des groupes d’opposition à un projet d’aménagement et les liens qu’elle peut entretenir avec la confiance épistémique. Mais, avant même que de tels groupes ne participent pleinement aux controverses du conflit d’aménagement, la confiance épistémique s’impose comme un facteur conditionnant la nature et la forme de l’engagement des acteurs qui décident d’entrer dans la protestation.
En effet, une relation spécifique entre les acteurs naît de la situation qui veut que les membres de groupes de protestation définissent l’objet de leur revendication à partir de la défense de solutions techniques alternatives, ou a minima, de la défense d’une expertise technique invalidant, sur la base d’un argumentaire collectif, le projet d’aménagement. L’engagement des membres se comprend dans ce cas comme le fait de soutenir ces solutions, voire de participer à leur élaboration ou à leur amélioration. Contrairement à un engagement sur des valeurs ou sur la défense d’un intérêt commun, comme ce peut être le cas de nombreux mouvements sociaux, ce mode d’engagement est le plus souvent inséparable du consentement, plus ou moins tacite, à une division du travail cognitif (Kitcher, 1990) et à un état de dépendance épistémique entre les différents opposants. La situation où tous les membres d’un groupe d’opposition à un projet d’aménagement comprennent et maîtrisent l’intégralité des connaissances nécessaires à l’élaboration de solutions techniques et à l’évaluation des données constitue très certainement un cas particulier. Un cas plus commun correspond sans nul doute à celui où différents membres, en fonction de leur domaine d’expertise, apportent différentes compétences et prennent en charge l’évaluation, l’élaboration et la défense de différentes propositions, reproduisant ainsi à une échelle plus réduite la division du travail cognitif qui prévaut à la controverse du conflit d’aménagement.
Dans le cas du collectif enquêté, l’essentiel des propositions défendues proviennent de deux membres de l’association berroise évoquée précédemment, Benoît et Hyacinthe. Benoît, qui préside le collectif, est professeur retraité de mathématiques et il est diplômé d’une maîtrise en sciences de l’ingénieur. Hyacinthe est professeur en construction dans un lycée professionnel. Ensemble, ils ont élaboré une expertise technique du fonctionnement de la chaine hydroélectrique. Ils ont collecté et synthétisé de nombreux suivis écologiques du milieu, des rapports d’expertise sur les dynamiques écologiques de l’étang et sur l’hydrologie de la Durance. Le crédit accordé à leur parole au sein du groupe est très important, spécialement envers Benoît. Benoît et Hyacinthe ont construit un argumentaire technique pour montrer que la construction d’un canal de dérivation était inutile pour résoudre le problème écologique de l’étang de Berre. Ils ont axé cet argumentaire sur deux « solutions » techniques visant à réduire les volumes rejetés dans l’étang sans mettre en péril le fonctionnement de la chaîne hydroélectrique[6]. Cet argumentaire a été repris, in extenso, pour constituer la ligne défendue par le collectif. Pour autant, la participation des autres membres est nécessaire à la défense de ces propositions techniques.
Chaque membre intervient dans un domaine qui lui est propre, soit pour étayer l’argumentaire de Benoît et de Hyacinthe, soit pour apporter quelque nouvelle proposition, soit encore pour particulariser cet argumentaire à des contextes d’énonciation spécifiques. Plusieurs membres producteurs de foin de Crau ont ainsi apporté des arguments supplémentaires quant à l’intérêt pour leur activité de l’augmentation du débit de la Durance grâce aux solutions défendues par Benoît et Hyacinthe. Un membre provenant d’une association altermondialiste a également fourni différentes données permettant d’inscrire l’opposition à d’EDF dans une contestation plus globale de la privatisation de l’accès à l’eau. Un autre membre ayant longtemps travaillé dans le secteur pétrochimique a également apporté certaines données relatives aux procédés industriels, tout comme un autre membre, longtemps salarié d’un bureau d’étude en ingénierie environnementale, a fait profiter le collectif de sa connaissance en matière d’enquête publique et d’études d’impacts. La situation qui caractérise le groupe est largement celle d’une dépendance épistémique entre ses membres (et dans une certaine mesure entre les membres du groupe et l’extra-groupe), d’une dépendance néanmoins fortement asymétrique, certains membres concentrant l’essentiel des connaissances dont les autres membres dépendent.
L’engagement des membres du collectif correspond à un engagement valant pour consentement à cet état de leurs relations, tout autant qu’à un engagement sur le contenu des propositions elles-mêmes. Tout du moins l’étude de cas menée le laisse-t-elle penser.
L’engagement initial des membres se fonde au moins tout autant sur une confiance épistémique accordée à l’analyse de Benoît et de Hyacinthe, et donc sur le consentement à la situation de dépendance épistémique dans laquelle ils sont envers les jugements de ceux-ci, que sur leur accès cognitif et épistémique au contenu de ces propositions. En effet, en premier lieu, une part importante de l’analyse de Benoît et de Hyacinthe repose sur la proposition selon laquelle si les déversements de la centrale dans l’étang de Berre sont réduits de deux tiers, les écosystèmes marins repeupleront l’étang. Cette proposition, contestée par d’autres acteurs du débat, s’appuie sur l’observation de deux sécheresses successives, en 1989 et en 1990, au cours desquelles les rejets annuels dans l’étang avaient été réduits de deux tiers du fait de la pénurie d’eau. Les riverains de l’étang avaient pu observer alors le repeuplement de l’étang par des espèces marines. Cette donnée est strictement testimoniale et les membres du collectif qui n’ont pas vécu cette situation ne peuvent que s’en remettre à Benoît et Hyacinthe. Opportunément, plus d’un an après la formation du collectif, un nouvel épisode de sécheresse eut lieu et les membres purent à leur tour observer un changement très net de l’étang, ce qu’ils ne pouvaient jusque lors croire que par récits interposés.
Plus encore, lorsque dans différentes occasions, telles que des conférences de presse, des demandes de précision leur étaient adressées, la plupart des membres reconnaissaient s’en remettre à Benoît pour l’aspect technique et renvoyaient à ce dernier les demandes d’éclaircissement. Lorsqu’en petit comité Benoît se livrait à des explications techniques sur les solutions défendues par le collectif, plusieurs membres disaient « décrocher » et certains géraient le malaise qui en résultait en exagérant ostensiblement leur position de « mauvais élèves de la classe ». Pour la plupart des membres, passé un certain point de complexité, la confiance épistémique placée en Benoît et en Hyacinthe se substituait à l’accès cognitif et épistémique au contenu des propositions défendues par le collectif. De ce fait, Benoît ne communiquait pas au reste du groupe certains éléments pourtant indispensables à l’évaluation de ses propositions et qui ne lui étaient le souvent pas demandés (par exemple, le calcul de l’intégrale de la fonction d’écoulement hydraulique au point de restitution du canal usinier à la Durance).
Cette situation, somme toute banale, et dont les raisonnements qui y sont à l’œuvre peuvent aisément être partageables par le plus grand nombre, appelle à interroger la nature des engagements fondés sur des relations de dépendance épistémique avec la confiance pour principal lien entre les membres. On peut concevoir sur cette base qu’à l’extrême limite, un engagement collectif est possible pour lequel aucun membre ne partagerait une compréhension commune avec les autres membres quant à la nature des propositions qu’ils défendent, voire qu’aucun d’entre eux ne serait en état d’évaluer la totalité des propositions. Il suffit pour cela que différentes propositions aient été portées à l’argumentaire collectif par différents membres qui en ont seuls l’autorité, et que les autres membres aient limité l’exercice de leur jugement aux éléments permettant d’attester de cette autorité. Si, de plus, l’engagement des membres est réduit à la dimension strictement pratique consistant à promouvoir l’argumentaire commun, des individus peuvent parfaitement s’engager à soutenir des propositions, et les soutenir effectivement, sans qu’il puisse être dit qu’ils accèdent pleinement à leur contenu cognitif et épistémique.
Cela aboutit à la possibilité qu’un engagement reposant sur le principe participatif de résolution citoyenne des problèmes publics et de prise en charge du bien commun par le plus grand nombre pourrait être moins partagé qu’un engagement reposant sur la simple communauté d’intérêts pour s’opposer à un aménagement sans nécessité d’adopter collectivement des propositions justifiant cette opposition ou étayant une solution alternative. Cette première forme d’engagement suppose que les acteurs s’entendent sur les propositions qu’ils adoptent conjointement et donc ajustent réciproquement leurs cognitions et leurs systèmes de valeurs pour aboutir à une conception que chacun d’eux peut assumer en tant que membre. A l’inverse, une simple coalition d’intérêts suppose uniquement l’accord de chacun à soutenir une action, sans nécessiter que les acteurs explicitent leurs motifs personnels, ni leur compréhension de la situation et encore moins les valeurs et principes qui leur paraissent justifier leur démarche. On pourrait donc s’attendre à ce que des engagements de citoyens à soutenir des solutions alternatives à un aménagement en revendiquant de prendre en charge le bien commun supposent une plus grande intention partagée. Pourtant en fonction des situations de dépendance épistémique, des réactions de type NIMBY peuvent être pourvoyeuses d’une intention partagée plus proprement collective que les mobilisations de personnes se regroupant autour de solutions co-construites.
2. L’autorité épistémique dans la défense d’un argumentaire collectif et dans la constitution d’une ligne commune
Cette situation de dépendance épistémique prolonge ses effets sociologiques jusque dans la définition des contenus que les acteurs s’engagent collectivement à défendre.
Dans la mesure où le principal mode d’action d’un groupe d’opposition relève de la défense d’un argumentaire collectif, celui-ci doit pouvoir être correctement défendu par n’importe quel membre du groupe qui serait amené à s’exprimer en cette qualité, sauf à élire des porte-parole ou à informellement attribuer à certains membres ce rôle. Mais même dans ce dernier cas, un tel groupe gagnera toujours à ce que ses membres soient capables de correctement défendre l’argumentaire collectif du fait que chacun d’eux peut alors jouer le rôle de relai d’opinion dans l’espace public. Une difficulté apparait si l’argumentaire naît d’une division du travail cognitif très segmentée. On peut en effet identifier analytiquement l’existence d’un ensemble de contraintes déductibles des conditions de confiance et d’autorité épistémiques qui tendront à s’imposer à l’activité du groupe ; ce qui permet à l’analyse empirique de s’intéresser à son tour à la façon dont les acteurs gèrent ces contraintes potentielles et avec quelles conséquences sur la forme que prend l’action collective.
Pour cela, on gagnera à analyser le cas-limite où pour chaque prémisse de l’argumentaire collectif l’autorité épistémique qui conduit le groupe à son adoption est détenue par un membre différent. La prémisse a pourra avoir été acceptée par le groupe sous l’influence du membre A dont la compétence dans le domaine relatif à a est reconnue de tous les membres. De même, les membres pourront s’être prononcés favorablement à la prémisse b, parce que B, véritable expert en la matière, a fortement poussé le groupe en cette direction, et ainsi de suite pour d’autres membres et d’autres prémisses. Appelons q la proposition qui se déduit de a et b (etc.) et qui correspond à la ligne adoptée par le groupe. Dans ce cas-limite, chaque membre est en situation de dépendance épistémique par rapport à tous les autres quant à l’examen de la proposition q, puisque celle-ci est épistémiquement dépendante[7] des propositions a, b, etc.
De ce fait, le jugement du groupe ne peut s’identifier à aucun des jugements que chaque membre aurait pu personnellement former à partir de son seul domaine de compétence.
Une fois le jugement collectif établi suivant cette modalité, les relations épistémiques des membres avec le hors-groupe sont également potentiellement marquées par les conditions de formation de ce jugement. En effet, on peut se demander quelle autorité épistémique le groupe parviendra à se faire reconnaître quant à la défense de la proposition q. Quelle confiance épistémique un tiers devrait-il placer dans les propos du membre Z, si celui-ci est amené à défendre q, Z n’étant détenteur d’aucune compétence particulière ? De même, le membre B pourra-t-il faire valoir une autorité épistémique s’il est amené à défendre a et non pas b, ou encore si a est nécessaire à b ? D’un point de vue diachronique, si les membres A et B ont quitté le groupe et que ce dernier a continué à défendre la proposition q, dans un contexte factuel et épistémique changeant au cours du temps (les données évoluant, les interprétations anciennement justes ont pu devenir erronées, et inversement), quelle autorité épistémique le groupe parviendra-t-il à faire valoir quant à la proposition q ?
Ainsi, un ensemble de contraintes peuvent s’imposer aux membres d’un groupe protestataire sitôt que son argumentaire est collectivement défini et que les compétences nécessaires à cela sont inégalement réparties dans le groupe.
Le collectif enquêté a été confronté à des difficultés de cet ordre. Le groupe étant en trop faible effectif pour désigner un nombre suffisant de porte-parole – d’autant plus qu’il souhaitait communiquer sur un vaste territoire correspondant au linéaire du canal combattu – chaque membre était appelé, au gré des situations, à devoir défendre publiquement l’argumentaire du collectif. Lors de plusieurs évènements publics, certains membres du collectif se sentirent mis en défaut car ils ne parvenaient pas toujours à défendre ni à expliquer des propositions qu’ils comprenaient pourtant globalement. D’autres fois, ces membres ne parvenaient pas à retrouver à temps les sources citées ni à justifier la validité d’une donnée technique. De façon informelle et progressive, le groupe répondit à ces situations en intégrant tous ces cas de figure dans l’argumentaire collectif, que ce soit à l’intérieur de tracts, de dossiers d’information, de contributions à des enquêtes publiques, ou dans la prise de parole du président du collectif à laquelle les autres membres faisaient écho lors de leurs « performances » publiques.
Lorsqu’un membre moins « expert » devait prendre la parole sur une scène publique, l’ensemble du collectif, de manière informelle, revenait au cours de ses réunions de travail sur cette prise parole afin que ce membre rende compte de « comment ça s’était passé » ou de « ce qui s’en était dit ». A cette occasion, le président du collectif ou d’autres membres également avisés pouvaient faire remarquer à ce membre ce qu’il aurait dû répondre à telle objection et ce qu’il devra dire une fois prochaine. On peut donner une illustration empirique de cela en rapportant les propos du président du collectif lorsqu’il revint sur la performance publique d’un membre qui n’avait pas su pleinement défendre l’argumentaire du groupe et en avait rendu compte à Benoît :
Benoît : « Arnaud, il était un peu contrit parce […] quand il [a] dit “on peut remettre de l’eau dans la Durance”, y a un élu qui a dit “non, c’est pas possible, le syndicat mixte, il ne veut pas d’eau c’est trop dangereux [en cas de crue]” […]. Mais le rapport SOGREAH dont j’ai rapporté le propos majeur [dit] page 3 du rapport, tout début : “les crues importantes – il s’agit de celles de la Durance après son aménagement – restent proches de leur état naturel. L’absence de crues ordinaires les rend d’autant plus dangereuses”. Voilà. Alors quand tu leur dis ça, [Arnaud] il n’a pas eu le réflexe de le dire, il s’en rappelait plus, tu leur dis le rapport SOGREAH, ils ne peuvent pas récuser SOGREAH.
La communication du groupe tenta de répondre à la nécessité pressante de permettre à chaque membre de défendre l’argumentaire collectif sans que la question de son autorité épistémique puisse s’imposer à son auditoire. Pour cela, les éléments attestant de l’autorité du groupe furent inscrits directement dans le discours, de sorte que quiconque dans le groupe pouvait porter cet argumentaire et ne pas soulever de doute auprès de l’audience quant à son autorité pour le faire. Progressivement, les prises de parole des membres offrirent moins de variabilité. L’argumentaire du collectif, écrit principalement par Benoît et amendé par quelques membres, était quasiment reproduit à l’identique à l’oral, les membres qui se sentaient les moins « compétents » osant difficilement changer cet argumentaire et d’autres membres le reproduisant sous la forme d’une routine dont ils avaient déjà éprouvé l’efficacité.
On aboutit ainsi à la situation relativement paradoxale où des acteurs, dont l’accès cognitif et épistémique aux propositions qu’ils défendent peut être faible pour certains d’entre eux, en viennent à porter un discours fortement explicité, unique et difficilement modifiable, et ce, avec une constance remarquable que l’on prête usuellement à la conviction. A l’hétérogénéité des compréhensions de chaque membre répond l’unicité d’un discours qui s’impose à l’ensemble – la confiance jouant à nouveau pour réduire la quantité d’informations à approfondir[8]. Marquons le contraste avec des mobilisations sociales portant sur la défense de valeurs, où l’objet est, par exemple, l’opposition à un projet de loi : les défenseurs d’une même valeur peuvent porter des discours très divers et ne doivent s’entendre que sur l’impératif déontologique d’agir conformément à cette valeur.
Il convient de noter que cette situation paradoxale dans laquelle sont placés les opposants à un projet d’aménagement ne se réduit pas à une problématique d’autorité institutionnelle, telle que par exemple, le rapport entre les représentants du groupe et la base. Cette situation apparait davantage comme résultant de la rencontre des contraintes d’autorité épistémique et des contraintes de l’espace public, et ce, dans une situation de dépendance épistémique où un argumentaire commun participe à l’agentivité d’un ensemble d’acteurs dont aucun a priori ne peut être tenu (ni n’a besoin) de comprendre chacune des propositions qu’il soutient.
3. Le rôle de la confiance épistémique dans l’affirmation d’un éthos de groupe lors de la révision du jugement collectif
On peut ainsi concevoir que sous certaines contraintes de dépendance épistémique et par le biais de relations de confiance et d’autorité épistémiques, on aboutisse à la situation où des acteurs s’engagent à porter un argumentaire unique qui promeut des propositions qu’à l’extrême limite aucun d’entre eux ne peut dire qu’il est en mesure de toutes les comprendre ni de toutes les évaluer. Cette situation repose sur le fait que la confiance épistémique permet, en quelque sorte, aux membres de déléguer à quelques-uns d’entre eux la charge de la preuve (« burden of proof »), tout en se laissant engager, plus ou moins tacitement, par des propositions qu’ils peuvent se permettre de ne pas approfondir, en raison précisément de cette relation de confiance. Néanmoins, on peut penser que lorsque le groupe voit ses propositions contredites par un tiers sans être en mesure de répondre sur un plan épistémique à ces réfutations, les dynamiques de confiance et d’autorité épistémiques sont enclines à se modifier.
En effet, les membres qui s’en remettent aux plus « experts » d’entre eux risquent de ne plus pouvoir maintenir cette relation de délégation tacite si ces derniers ne parviennent pas à répondre aux contradictions. En particulier, on peut le penser dans le cas où la participation des acteurs dans le groupe se comprend comme la défense de propositions pour lesquelles ils représentent individuellement une autorité épistémique. Si les propositions réfutées sont solidaires dans l’argumentaire du groupe de propositions qui n’ont pas elles-mêmes été contestées, les membres qui ont toute autorité pour celles-ci voient leur participation dans le groupe partiellement compromise par la contestation de propositions qui n’émanent pourtant pas d’eux.
Le groupe peut résoudre cette difficulté de plusieurs façons. Il peut par exemple tenter de réduire la dépendance épistémique des membres afin d’être en mesure de traiter collectivement les contradictions portées par l’extérieur. Il peut aussi refondre son argumentaire en excluant les propositions incriminées. Il est toutefois un autre cas de figure sur lequel nous souhaiterions nous attarder, celui où le groupe répond de façon non épistémique à une contradiction portée sur le plan épistémique. Cette situation nait également de la nécessité de dépasser l’état de dépendance épistémique relatif à la proposition contredite, mais n’implique pas la perte de confiance épistémique que le groupe place dans le jugement des membres dont émane cette proposition. C’est précisément le maintien de cette confiance qui peut conduire le groupe à chercher des justifications non épistémiques pour conserver la proposition contredite.
Un profond doute peut résulter au sein du groupe de la dissonance entre la confiance maintenue au porteur de la proposition contestée, confiance qui empêche de douter du caractère fondé de celle-ci, et le fait que des tiers, supposés de bonne foi et compétents, ne sont pas convaincus par cette proposition. Pour sortir de cet état de doute, le groupe pourra avancer des raisons non épistémiques de nature très prosaïque, prêtant par exemple quelque qualité négative à l’entendement de leur interlocuteur. Mais plus fondamentalement, il est prévisible que la réflexion collective se déplacera vers la recherche de critères méta-épistémiques permettant de lever cet état de doute ou d’incompréhension (et l’inconfort psychologique qu’il représente).
C’est tout du moins ce que l’observation du collectif d’associations enquêté nous conduit à penser. Plusieurs des propositions portées par le président du collectif, dont on a vu l’autorité épistémique qu’il revendiquait et la confiance épistémique que les autres membres plaçaient dans ses jugements, soulevaient le désaccord de différents acteurs du débat. Dans de nombreux cas, le groupe intégrait les contre-argumentations en y répondant sur le plan épistémique, soit directement dans le temps du débat, soit indirectement, une fois le groupe revenu dans son « entre-soi ». Néanmoins, le collectif échouait parfois à traiter ces contradictions par des justifications épistémiques.
Plusieurs cas de figure conduisaient à cela. Dans certains cas, la réfutation de leurs propositions reposait sur un argument d’autorité ou ne comportait que peu de données techniques, de sorte que les membres du collectif, sans être convaincus de l’argument, n’étaient pour autant pas en situation de répondre sur le plan épistémique à l’objection. Ce fut notamment le cas lorsqu’un représentant d’EDF opposait au collectif que plusieurs des aménagements qu’il préconisait n’étaient pas financièrement viables pour l’entreprise. Le collectif n’ayant pas accès aux données comptables ni à la stratégie industrielle de l’entreprise, il lui était difficile de traiter cet argument autrement que comme un argument d’autorité et plus encore de répondre par un argument épistémique. Il pouvait également arriver que les membres du collectif n’accédaient pas au contenu épistémique des réfutations qui leur étaient faites sans pour autant percevoir cet état de fait, interprétant alors ces réfutations comme un désir de désaccord en dépit d’un accord inavoué de leur interlocuteur supposé dire la même chose[9]. Un dernier cas de figure correspondait à la situation où le groupe, bien qu’ayant obtenu l’acquiescement de son interlocuteur sur la plupart des prémisses de son raisonnement, voyait celui-ci refuser d’adhérer à sa conclusion, sans que cet interlocuteur ne parvînt à donner de raison explicite à son manque de conviction[10].
Ces différents cas de figure provoquaient un désappointement certain des membres du collectif. En dépit de ces contestations, ceux-ci continuaient à tenir pour vraies les propositions mises en cause, car ils trouvaient censé et évident le raisonnement qu’ils défendaient (à savoir, restituer à la Durance l’eau qu’elle recevait avant l’aménagement de la centrale EDF en 1966 et qui aujourd’hui est nocive pour l’étang). De plus, ces membres n’avaient pas été confrontés à de nouvelles raisons de mettre en cause la confiance qu’ils plaçaient dans le président du collectif lorsqu’il leur garantissait la justesse des éléments factuels et techniques sur lesquels reposait l’argumentaire du collectif. Les membres dépassaient cette dissonance en expliquant les points de vue des contradicteurs par le statut des différents interlocuteurs qui, supposés partager les intérêts d’EDF, en perdaient leur qualité d’expert crédible. Lorsque l’intégrité morale de leur interlocuteur ne pouvait être mise en cause, des raisonnements méta-épistémiques étaient souvent avancés, montrant, par exemple, que les données utilisées par cet acteur pour former son jugement étaient en fait produites par EDF et avaient intégré dans leur mode de production les a priori, sinon les desiderata, de l’entreprise[11]. Parfois encore, l’absence de conviction d’un interlocuteur devant des solutions que le collectif qualifiait de « bon sens » était expliquée par l’entremise dans son raisonnement d’idées fausses véhiculées par la communication à grande échelle d’EDF[12].
Ces modes d’explication sont récurrents dans les différents conflits d’aménagement et plus largement dans toute situation conflictuelle appelant une justification au sein d’un conflit, au point qu’une « grammaire » actancielle a pu être établie sur cette base à la suite de Luc Boltanski et al. (1984). L’élément qui nous importe ici est que le recours à ces logiques de justification répondent directement à des situations de dépendance épistémique des membres du collectif envers ceux d’entre eux qui portent les propositions contestées, d’une part, et de dépendance entre le collectif et leurs interlocuteurs lorsque ceux-ci lui opposent des données testimoniales qui ne permettent pas de répondre sur un plan épistémique, d’autre part. Le fait que le groupe ne révise pas la confiance épistémique qu’il place dans ses membres « autorisés » favorise alors la recherche de réponses non épistémiques à un argument épistémique, servant ainsi de support à des processus proprement sociologiques d’accusation et de dénonciation de confluences d’intérêts.
Par ailleurs, les membres d’un groupe d’opposition peuvent éprouver le besoin d’être assurés, à leurs propres yeux, qu’ils sont fondés dans leur jugement et qu’ils échappent aux erreurs qu’ils décèlent chez les autres. Ne pouvant s’assurer de cela uniquement à partir de raisonnements proprement épistémiques, les membres élargissent leur réflexion à un niveau méta-épistémique, recourant à une épistémologie spontanée ou profane (au sens de « folk epistemology »). Certains des raisonnements précédemment décrits s’inscrivent dans ce cadre en portant sur les circuits menant de la production de données aux conditions de leur utilisation dans une expertise.
La dénonciation de conflits d’intérêts ou l’évocation d’une lecture idéologique des données[13] trouvent dans ce cadre un éclairage nouveau, ne pouvant se réduire à des stratégies de dénonciation ou à des rhétoriques d’opposition. Il apparait, en effet, que les rapprochements que les acteurs opèrent entre des jugements épistémiques et les affiliations axiologiques de ceux qui les émettent ou leur caractérisation morale prennent place plus largement dans une épistémologie spontanée des vertus épistémiques (Zagzebski, 2005). Le groupe évalue, la fiabilité de données testimoniales par exemple, à partir des qualités manifestées par leurs sources, ou encore en identifiant l’objectivité de l’observateur à sa probité intellectuelle.
Suivant cette logique, la rigueur et le sérieux d’un locuteur seront parfois vus comme le gage de la fiabilité des données qu’il communique, l’indépendance financière de tel expert justifiera la confiance épistémique à placer dans ses propos, les grandes capacités d’empathie de tel acteur politique plaideront pour la conviction qu’il aura intégré les intérêts du plus grand nombre dans les propositions sociales qu’il défend. Les propos des contradicteurs de ce groupe pourront être interprétés, non pas simplement en termes d’erreurs de raisonnement, mais d’amateurisme, de légèreté, de corruption, de malhonnêteté, d’irresponsabilité, de vision rendue étroite par l’égocentrisme de ces locuteurs, voire par leur égoïsme. Un désaccord insolvable pourra être lu comme l’entêtement de la partie adverse à ne pas vouloir reconnaître l’évidence par pure fierté personnelle ou par refus de perdre la face.
Un groupe peut ainsi rechercher chez des locuteurs dont il dépend épistémiquement des vertus, des traits de comportement, des raisonnements éthiques qui plaident pour la fiabilité des contenus communiqués. Mais, inversement, ce groupe, s’il souhaite que lui soit reconnue une autorité épistémique pour les propositions qu’il défend, pourra vouloir manifester ces mêmes vertus et traits de comportement. Ses membres les prôneront, les adopteront et les mettront en avant pour convaincre et se convaincre de l’autorité épistémique du groupe. Ils finiront ainsi par promouvoir des valeurs et une traduction de ces valeurs dans des vertus qu’ils exemplifient par des comportements souhaitables. Leur « combat » à leurs yeux n’est plus simplement de faire reconnaître des propositions, mais de s’opposer à des propositions fausses issues de personnes peu vertueuses ou se comportant de façon non acceptable. Cet élargissement du motif de mobilisation à l’opposition contre un acteur qualifié moralement est observé de longue date par la sociologie des mouvements sociaux et de l’action collective[14], mais trouve ici une explication épistémique et méta-épistémique.
Dans le cas du collectif enquêté, les situations dans lesquelles les membres n’avaient d’autres ressources pour évaluer et interpréter des jugements épistémiques que de se rapporter à des vertus épistémiques (ou des « vertus » qu’ils considéraient comme telles) leur offraient régulièrement des occasions pour manifester des traits caractéristiques d’une éthique de conviction (au sens wébérien) sous-tendant une attitude militante du groupe.
En particulier, la fermeté de ses convictions peut apparaître au militant comme une vertu essentielle. Rester fidèle à ses convictions, à ses engagements et aux valeurs que l’on défend est en règle générale tenu pour caractéristique d’un éthos militant. Or la vertu militante de la fidélité à des valeurs était régulièrement retraduite par les membres du collectif dans les termes épistémiques de la constance du jugement épistémique. En effet, les membres étaient fréquemment déstabilisés par la variation des points de vue exprimés par différents acteurs publics au cours de la longue controverse de l’étang de Berre. En particulier, certains élus locaux après avoir soutenu les propositions du collectif adoptèrent finalement une position inverse en plaidant pour la dérivation. Les membres du collectif n’interprétaient que rarement cet état de fait comme relevant de la révision de jugements épistémiques consécutive à la production continue de nouveaux arguments et de nouvelles données à mesure que la controverse s’amplifiait. Ils voyaient davantage dans cette révision des jugements épistémiques soit un « retournement de vestes », selon leurs propres termes, soit la faiblesse morale d’un acteur qui avait fini par se laisser « embrigader », faute d’une vigilance et d’une rigueur de sa réflexion. La révision d’un jugement pouvait être lue également comme une marque d’inconstance, voire d’inconséquence. Tout se passait comme si les membres aboutissaient à une définition militante des vertus épistémiques qui dotait leurs échanges méta-épistémiques d’une double fonction : s’assurer de la validité de leurs jugements et affirmer une identité militante[15].
Ce faisant, les échanges épistémiques et méta-épistémiques qui émaillaient régulièrement l’activité du collectif servaient incidemment à l’affirmation d’un éthos militant.
Conclusion
Lorsque la confiance épistémique devient un des principaux liens réflexifs entre des acteurs placés en situation de dépendance épistémique, des processus cognitifs peuvent rencontrer des processus sociologiques élémentaires pour conduire à des dynamiques collectives qui ne peuvent pas être réduites à une seule de ces deux dimensions. Dans le cas étudié ici, la confiance et l’autorité épistémiques, rencontrant les conditions de défense d’un argumentaire dans l’espace public, participent à ce que des acteurs protestataires en viennent à se ranger sous une ligne commune pro-environnementale et à donner un sens éthique, voire moral, à la défense unitaire de cette ligne.
L’entrée que nous avons privilégiée demeure partielle au regard de la complexité des dimensions entrant dans les relations de confiance (épistémique ou non) ainsi qu’en rend compte l’ouvrage collectif dirigé par Albert Ogien et Louis Quéré (2006). Cette complexité appellerait notamment l’extension de notre propos aux dimensions émotionnelles de la confiance épistémique, rejoignant en cela les réflexions séminales de différents auteurs, notamment P. Livet (2006) ou G. Brun et al. (2008). La dimension morale de l’acte consistant à attribuer sa confiance à un tiers ou, inversement, de recevoir cette confiance mériterait également d’être questionnée dans le cadre du rôle de la confiance épistémique dans les dynamiques d’engagement collectif.
[1] Gloria Origgi (2004) considère que la confiance épistémique est la conjugaison de deux composantes : une confiance élémentaire que nous devons nécessairement attribuer à tout interlocuteur pour que l’acte de communication soit possible et une confiance vigilante (« vigilant trust »), rassemblant les mécanismes cognitifs, les dispositions émotionnelles, les normes héritées, les indices relatifs à la réputation de l’interlocuteur, et que nous mettons en œuvre pour filtrer les différentes informations.
[2] A. Bouvier et B. Conein (dir.), 2007, en offrent un riche panorama
[3] Le présent article n’a pas pour objet de traiter de l’aménagement de l’étang de Berre et des controverses l’accompagnant. Nous nous permettons de renvoyer le lecteur à Allouche (2008) pour des éléments complémentaires portant sur ces aspects
[4] Not In My BackYard, terme qui qualifie, sinon stigmatise, la réaction d’opposition de riverain qui, bien que pouvant reconnaitre l’intérêt d’un aménagement, refuse celui celui dès lors qu’il empiète sur leur espace personnel
[5] Lafaye et Thévenot, 1993 ; Thévenot et al., 2001
[6] La première de ces solutions consiste dans des modalités techniques de restitution des débits de la Durance dérivés par la chaîne hydro-électrique. Elle affirme qu’en jouant sur les fonctions d’écoulement hydraulique et sur les aménagements hydrauliques déjà existants, il est possible de ne conserver qu’un tiers des débits rejetés actuellement dans l’étang sans mettre en péril le fonctionnement d’urgence de la centrale. La seconde proposition consiste dans la conversion d’une partie de la chaîne en circuit fermé. L’installation de turbines spécifique et d’un bassin de retenu à l’intérieur de l’étang de Berre rendrait possible, selon cette hypothèse, de re-turbiner d’aval en amont l’eau turbinée dans la journée, en bénéficiant du courant superfétatoire en heure creuse)
[7] La dépendance épistémique de deux propositions ou de deux faits peut être définie ainsi : « dire que les faits d’une classe B sont épistémiquement dépendants des faits d’une autre classe A, c’est dire que l’on ne peut connaître aucun fait de B à moins qu’il connaisse quelque fait de A qui serve de preuve (« evidence ») pour le fait de B » (« To say that the facts in some class B are epistemically dependent on the facts in some other class A is to say this: one cannot know any fact in B unless one knows some fact in A that serves as one’s evidence for the fact in B. ») Audi (1999) p. 221
[8] Pour Niklas Luhmann (2006), la confiance est un mécanisme social de réduction de la complexité.
[9] On a pu observer cela en raison de la polysémie d’un terme (celui de « lissage ») qui conduisit le groupe à interpréter comme relevant du même cadre d’analyse des propositions très différentes, mais affirmant toutes deux la nécessité de « lisser » les rejets de la centrale
[10] Cette dernière situation s’est observée lors de la rencontre par le collectif de deux commissaires d’enquête publique à l’occasion de la demande d’avenant par EDF pour l’exploitation de la chaîne hydro-électrique Durance-Verdon, en 2006
[11] Lors de la réponse en 2005 de l’Etat français à l’injonction de la Cour européenne de Justice à faire cesser la pollution de l’étang par les rejets de la chaîne Durance-Verdon, le collectif « attaque » les rapports d’expertise de l’Etat au motif qu’ils utilisaient un logiciel créé avec le concours d’EDF par un bureau d’étude, bureau d’étude auquel le GIPREB recourait par ailleurs pour évaluer les scénarios de dérivation
[12] Pour illustrer empiriquement cela, on peut reproduire les propos de l’un des membres : « “l’étang de Berre a été marin puis d’eau douce, d’eau douce puis marin”. Ce n’est pas vrai ça ! Il a toujours été un étang marin. Ça c’est une idée EDF, un mensonge EDF, et avec les moyens qu’ils ont, attention ! Mais EDF, ils ont les moyens de raconter n’importe quoi. Et quand ils racontent n’importe quoi, après ça prend !
[13] Cette accusation étant souvent adressée par les membres du collectif à l’encontre de plusieurs élus locaux, supposés mus par une lecture industrialiste et productiviste du territoire, et d’une association de protection de la nature proche de la CGT
[14] On peut en particulier évoquer l’importance des recherches rendant compte de ce déplacement au travers du concept de « Drama » emprunté à la rhétorique de Kenneth Burke et popularisé par Joseph Gusfield (1981), lequel montrait déjà comment la constitution d’un problème public passait par la substitution d’une définition d’un problème suivant un ordre moral à sa définition factuelle. Le concept de « mise en intrigue » emprunté à Ricoeur (1983) a également permis de nombreuses de recherches mettant en avant l’importance de l’opposition à un acteur dans une définition moralisée et vertueuse de l’action collective. La référence à la sémiotique post-greimasienne a également nourri ces réflexions en ajoutant une dimension virtuellement qualifiante à l’opposition à un acteur (ou plus exactement un actant), ainsi que Landowski (1989) en rend compte.
Bibliographie
Allouche A. (2008). « Comment l’étang de Berre mobilise ses riverains et leurs affects » Cosmopolitiques, no. 17
Audi R. (ed) (1999) The Cambridge Dictionary of Philosophy, 2nd edition, Cambridge, Cambridge University Press,
Boltanski L., Darré Y., Schiltz M.-A. (1984) La dénonciation, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 51, pp. 3-40
Bouvier A. (2004) Choix rationnel et identité. Le cas des conflits nationalistes et ethniques, Revue de Philosophie économique, 2, n° spécial : Le concept d’identité, ss la dir. d’A. Kirman et M. Teschl, pp. 135-160
Bouvier A. (2007) La dynamique des relations de confiance et d’autorité au sein de la démocratie dite « participative » et « délibérative », Revue européenne des sciences sociales, vol. XLV, no 136, pp. 181-230
Bouvier A., Conein B. (2007) (eds.), l’épistémologie sociale : une théorie sociale de la connaissance, Paris, ed. EHESS,
Brun G., Doguoglu U., Kuenzle D. (eds) (2008), Epistemology and Emotions, Aldershot, Ashgate Publishing
Chateauraynaud F. (2007) La contrainte argumentative. Les formes de l’argumentation entre cadres délibératifs et puissances d’expression politiques, Revue européenne des sciences sociales, vol. XLV, no. 136, pp. 129-148
Fourniau J.-M. (2011), « Amateurs de l’intérêt général. L’activité délibérative dans les dispositifs de participation citoyenne » in O. Piriou et P. Lenel, Les états de la démocratie. Comprendre la démocratie au-delà de son utopie, Paris, Éditions Hermann, pp. 219-242.
Fourniau J.-M. (2007) L’expérience démocratique des « citoyens en tant que riverains » dans les conflits d’aménagement », Revue européenne des sciences sociales, vol. XLV, no 136, pp. 149-179
Gusfield J. R. (1981) The Culture of Public Problems: Drinking-Driving and the Symbolic Order, Chicago, The University of Chicago Press
Kitcher P. (1990) The division of cognitive labor, Journal of Philosophy, vol. 87, no 1, pp. 5-22
Landowski E. (1989) La société réfléchie, Paris, Seuil
Lazega E. (2011) Pertinence et structure, Swiss Jounal of Sociology, vol. 37, no 1, pp. 127-149
Livet P. (2006) « Confiance, émotions et manifestation des valeurs » in A. Ogien et L. Quéré (eds.) Les moments de la confiance. Connaissance, affects et engagements, Paris, Economica, pp. 201-216
Luhmann N. (2006) La confiance. Un mécanisme de réduction de la complexité sociale, Paris, Economica,
McCarthy J. D., Zald M. N. (1977) Resource mobilization and social movements: A partial theory, American journal of sociology, vol. 82, no 6, pp. 1212-1241.
Ogien A., Quéré L. (eds.) (2006), Les moments de la confiance. Connaissance, affects et engagements, Paris, Economica
Ollitrault S. (1996) Science et militantisme : les transformations d’un échange circulaire. Le cas de l’écologie française, Politix, vol. 9, no 36, pp. 141-162
Origgi, G. (2004) Is Trust an Epistemological Notion? Episteme, vol. 1, no 1, pp. 1-11
Origgi G., Spranzi M. (2007) « La construction de la confiance dans l’entretien médical » in T. Martin et P.-Y. Quiviger (eds), Action médicale et confiance, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, pp. 227-246
Quéré L. (2006) « Confiance et engagement » in A.Ogien et L. Quéré (eds.) Les moments de la confiance. Connaissance, affects et engagements, Paris, Economica, pp.117-142
Ricoeur P. (1983) Temps et récit. L’intrigue et le récit historique, Tome I, Paris, Éditions du Seuil
Simmel G. (1999) , Sociologie. Etudes sur les formes de socialisation, Paris, PUF [1ère édition 1908]
Simmel G. (1987) , Philosophie de l’argent, Paris, PUF [1ère édition 1900]
Sperber D., Clément F., Heintz C., Mascaro O., Mercier H., Origgi G, Wilson D. (2010), Epistemic Vigilance, Mind & Language, vol. 25, vo. 4, pp. 359–393
Thévenot L., Moody M., Lafaye C. (2000) « Forms of Valuing Nature: Arguments and Modes of Justification in French and American Environmental Disputes », in M. Lamont et L. Thévenot (eds.), Rethinking Comparative Cultural Sociology: Repertoires of Evaluation in France and the United States, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 229-272
Tilly C. (1978) From Mobilization to Revolution, Reading, Addison-Wesley
Trom D. (1999) De la réfutation de l’effet NIMBY considérée comme une pratique militante. Notes pour une approche pragmatique de l’activité militante. Revue française de science politique, vol. 49, no 1, pp. 31-50.
Zagzebski L. (2005) « Les vertus épistémiques » in J. Dutant et P. Engel (eds), Philosophie de la connaissance. Croyance, connaissance, justification, Paris, Vrin
[15] Plus largement sur l’intersection possible de raisonnement épistémique et les dynamiques identitaires, on pourra se rapporter à A. Bouvier (2004)