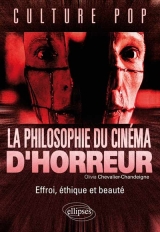Recension – la philosophie du cinéma d’horreur
Olivia Chevalier-Chandeigne, La philosophie du cinéma d’horreur, Paris, Ellipses, « Culture pop », 2014
recension par Hugo Clémot
Près d’un quart de siècle après que Noël Carroll a fait paraître une magistrale Philosophy of horror[1], qui constitue l’origine, et demeure une référence incontournable, du champ de la philosophie anglo-saxonne du cinéma d’horreur[2], paraît en France un ouvrage au titre ambitieux : La philosophie du cinéma d’horreur[3]. Publié dans l’intéressante collection « Culture pop » dirigée par Thibaut de Saint Maurice[4] aux éditions Ellipses, qui ont su, par le passé, publier des textes à la fois accessibles, mais en même temps parfaitement informés des derniers développements « scientifiques » du domaine philosophique étudié – on pense par exemple à la thèse de Philippe de Lara éditée en deux ouvrages, Le rite et la raison[5] et L’expérience du langage[6], au livre d’Élise Marrou sur De la certitude[7], ou encore au Wittgenstein[8] de Sabine Plaud -, on pouvait s’attendre à retrouver, dans cet ouvrage, ces mêmes qualités et se réjouir à l’idée que la sortie de ce livre contribue à légitimer, d’un point de vue institutionnel, l’importance et le sens de ce champ de recherches et l’intérêt du travail philosophique contemporain sur les cultures populaires[9].
Il y a malheureusement fort à craindre que les détracteurs de tous bords, philosophiques comme cinématographiques, de la philosophie du cinéma d’horreur ressortent renforcés par la lecture de cet ouvrage. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser supposer, il ne s’agit pas en effet d’un ouvrage conçu pour introduire à un domaine philosophique spécialisé, la philosophie du cinéma d’horreur, mais une tentative pour montrer que le cinéma d’horreur n’est pas sans lien avec plusieurs thèmes philosophiques qui peuvent intéresser le plus grand nombre. De ce point de vue, l’auteure fait un authentique effort pour mobiliser sa connaissance des films d’horreur et la passion qu’elle nourrit pour eux, afin de présenter quelques thèmes récurrents, en les reliant notamment à la théorie psychanalytique de Freud. L’ouvrage pourra donc intéresser à la fois les passionnés et ceux qui doutent de la valeur et de la richesse thématique du cinéma d’horreur.
En revanche, pour ceux qui s’intéressent à ce que l’on appelle d’ordinaire la philosophie du cinéma d’horreur, le livre se révèlera sûrement décevant parce qu’il ne prend pas suffisamment en compte les débats contemporains[10], parce qu’il ne présente pas assez les problèmes philosophiques posés par le genre et surtout parce qu’il manque souvent de rigueur conceptuelle. Les quelques pages qui vont suivre visent à mettre en évidence ces insuffisances de ce point de vue spécialisé, insuffisances qui pourraient tromper le lecteur sur la nature et la valeur d’une authentique philosophie du cinéma d’horreur. Sans avoir acquis la certitude, à force de travail, de l’importance d’une philosophie sérieuse et rigoureuse du cinéma d’horreur, nous ne nous serions pas sentis obligés de rédiger cette recension, qui prétend ainsi relever d’un usage « public » de la raison au sens où Kant dit, dans Qu’est-ce que les Lumières ?, qu’il est « celui qu’en fait quelqu’un, en tant que savant, devant l’ensemble du public qui lit[11]. »
Les difficultés apparaissent dès l’introduction. En effet, après avoir, de façon très classique, posé la question de savoir pourquoi nous regardons des films d’horreur, l’auteur affirme, sans se justifier, que « [s]usciter des passions et des émotions a toujours représenté la finalité de l’art[12] ». Passons sur le caractère dogmatique et contestable de l’affirmation. La première difficulté pour le lecteur est que la question initiale n’est pas une simple interrogation à laquelle on pourrait répondre aisément et directement par oui ou par non : c’est un authentique paradoxe, connu au moins depuis Aristote. Plutôt que d’avancer directement une réponse, qui mobilise la Poétique d’Aristote et la notion de catharsis, une approche authentiquement philosophique devrait donc exposer la difficulté qui, seule, rend compte de l’intérêt de la « solution » aristotélicienne[13].
L’explication en note ne permet pas de mieux comprendre. En effet, l’auteur avance qu’on peut donner deux interprétations complémentaires[14] de la catharsis et ajoute, sans justification et sans qu’on comprenne pourquoi, que l’imaginaire y aurait un rôle central, en fait nécessaire (« la fonction de l’imaginaire est centrale puisque ce n’est que par lui que s’opère la catharsis[15] »). Pour comprendre l’intérêt de cette remarque, le lecteur est condamné à reconstruire le raisonnement à partir de la phrase suivante qui affirme que « la représentation des passions semble plus proche de la ‘réalité’ avec le cinéma qu’avec la peinture par exemple[16] ». On suppose qu’il faut donc comprendre que les films d’horreur seront peu propices[17] à la catharsis à cause de leur réalisme.
Passons sur les difficultés posées par la notion de réalisme en philosophie comme au cinéma. Admettons, bien que cela soit difficile, qu’un film comme L’exorciste, par exemple, soit réaliste. Ne nous formalisons pas du fait que les deux seuls textes dans lesquels Aristote évoque la catharsis portent sur la musique et la tragédie, plutôt que sur la peinture[18]. Mais comment comprendre qu’on puisse lire ensuite, dans le texte, qu’« [i]l y a certainement d’autres raisons qui n’excluent pas la précédente, mais viennent s’y ajouter[19] » ?
Le lecteur charitable est donc conduit à supposer que l’auteur soutient en fait une conception non-essentialiste de l’expérience spectatorielle de l’horreur selon laquelle les raisons d’aimer les films d’horreur sont diverses et forment une famille[20]. Il s’attend donc également à ce qu’une conception analogue des genres cinématographiques en général, et du genre de l’horreur en particulier, soit soutenue, comme Stanley Cavell nous a appris à le penser depuis son chef-d’œuvre sur le genre de la comédie du remariage, À la recherche du bonheur[21] : les ressemblances et les relations entre les membres d’un genre cinématographique seraient analogues à celles qui lient les membres d’une famille et la famille, comme le genre, évolueraient en fonction des diverses contributions de chaque membre[22]. Or, la suite de l’introduction et du livre nous apprend qu’il n’en est rien : le genre de l’horreur a un « code[23] » que l’on peut résumer en « 20 minutes[24] » de film ; il se distingue nettement du fantastique et de l’épouvante ; on peut le définir « par certaines caractéristiques dominantes […] : du sang, des corps mutilés généralement, et surtout le sentiment de terreur ressenti par le spectateur devant l’innommable[25]. » On lira même plus loin qu’il y a des « critères stricts[26] » de l’horreur, établis « avec la Nuit des morts-vivants[27] ».
À suivre cette définition, un film comme La Reine Margot (Patrice Chéreau, 1994) serait donc un film d’horreur, surtout que ce sentiment, contrairement à Alien (Ridley Scott, 1979) qui devrait, pour cette raison selon l’auteur être rejeté hors du genre, proviendrait « du spectacle d’un massacre ou de celui d’une boucherie[28] ».
L’auteur répondrait peut-être que La Reine Margot, comme Le Silence des agneaux (Jonathan Demme, 1991) selon elle, est un film « à composante, et non à dominante d’horreur[29] ». Seulement, on aimerait en savoir plus sur cette distinction conceptuelle : par exemple, il suffit qu’un liquide comporte, à titre de composant, une molécule d’alcool pour qu’il s’agisse d’un alcool. Pourquoi ne suffirait-il pas que les caractéristiques « dominantes » des films d’horreur soient présentes pour qu’on puisse dire que le film relève du genre ? Quant au terme « dominant », il semble connaître un usage équivoque puisqu’il vient qualifier dans un même paragraphe certaines caractéristiques pour définir un genre (« Nous définirons le film d’horreur par certaines caractéristiques dominantes… ») et le genre d’un film (« …à dominante d’horreur »), de sorte que l’on pourrait parler des caractéristiques dominantes du genre dominant d’un film… Cela soulève au moins la question des critères d’identité de cette « dominance » : seront-ils quantitatifs ou qualitatifs et, dans ce dernier cas, comment en juger de façon objective ? Si l’on admet que Le Silence des agneaux relève du genre du thriller psychologique, un genre qui aurait mérité d’être défini, en quoi un spectateur pourrait-il être empêché de le tenir pour un film d’horreur si, par exemple, il a surtout éprouvé, tout au long du film, un « sentiment de terreur […] devant l’innommable[30] » ?
Les deux autres films cités en exemple ne sauvent pas davantage cette définition : l’auteur suggère qu’Alien devrait être tenu surtout pour de la science-fiction parce que « l’horreur provient moins du spectacle d’un massacre ou de celui d’une boucherie, que de la terreur devant l’Indéterminé[31]. » Passons sur le désir du lecteur d’une distinction entre « la terreur devant l’innommable » et « la terreur devant l’Indéterminé ». Qu’on nous permette de rappeler les réactions provoquées, lors de l’une des premières projections du film à Dallas au Texas, au printemps 1979 :
« On raconte que quelqu’un est tombé et s’est cassé le bras. Des spectateurs se seraient battus pour s’approprier des places plus éloignées de l’écran. La femme de Ladd Jr., devenue son ex-femme depuis, refusa de sortir de chez elle pendant une journée et demie. À un moment, un ouvreur est même tombé à la renverse, terrassé par la scène où Ash se fait arracher sa tête synthétique[32]… »
Si la fameuse scène du chestbuster, où l’alien naît du corps d’un homme en faisant exploser son ventre, qui est l’idée centrale du scénario, ne réunit pas en outre les prétendues caractéristiques dominantes de l’horreur, on se demande ce qui pourrait le faire et on ne comprend alors pas pourquoi Rosemary’s Baby (Roman Polansky, 1968) peut être employé comme exemple de film d’horreur au milieu du livre[33].
Enfin, on ne saisit pas pourquoi les caractéristiques qui permettent à Cube (Vincenzo Natali, 1997) d’être tenu pour un film d’horreur ne pourraient pas être retrouvées, assez aisément, dans un film comme Alien, inspiré notamment, comme on sait, du Nostromo de Conrad :
« la mutilation des corps, l’angoisse devant la mort, la souffrance, de [sic] personnages perdus, devenant paranoïaques, pris au piège dans un jeu où ils ont été littéralement jetés, qui révèle leur nature profonde, dont ils soupçonnent de manière croissante la fatalité et l’absurdité qui en fait la métaphore cruelle du réel[34]. »
On est enfin inquiet de lire la note dont l’appel figure à la fin de ce paragraphe : « Nous nous concentrerons, dans la mesure du possible, sur des œuvres cinématographiques, en évitant les productions trop complaisantes[35]. » L’italique employé pour le mot œuvres semble indiquer ici une opposition entre les films d’horreur qui relèvent de l’art et ceux qui n’existent que pour satisfaire un plaisir coupable. Cette opposition rappelle la vieille distinction entre art authentique et divertissement commercial[36], qui repose sur le même type de préjugés, une distinction qui n’a pas été pour rien dans les difficultés rencontrées par le cinéma pour se voir reconnaître une valeur et qui est évidemment l’une des causes majeures qui empêchent que l’on prenne le cinéma d’horreur au sérieux.
Quant au terme « complaisant », qu’on emploie souvent pour dénoncer un plaisir condamnable auquel on s’attarde, on pourrait se demander s’il ne serait pas approprié pour décrire la longue note de la page 54 qui semble uniquement là pour satisfaire le désir malsain de savoir « [q]uelle fut la barbarie à l’œuvre lors de l’exécution de la famille cannibale[37] [à l’origine du scénario de La colline a des yeux] » ou encore la longue citation qui décrit avec force détails les crimes de Vlad l’Empaleur[38].
L’analyse de ces deux pages et demi, pourtant exercée selon le « principe de charité » cher à Donald Davidson, montre une inadéquation entre le discours produit et les exigences ordinaires de la philosophie. La suite du livre, divisée en trois parties, ne corrige malheureusement pas ce défaut.
La première partie propose « une brève histoire du genre ». Elle s’ouvre sur une évocation du Retable d’Issenheim de Grünewald où la façon dont sont peints les pieds du Christ est décrite comme « une représentation qui aurait toute sa place dans un film aussi cru et réaliste que Hostel par exemple[39]. » On peut pourtant fortement douter que le mot « réalisme » décrive bien ce détail du tableau. L’auteur en tire en tout cas immédiatement une première leçon quant au but du retable et des films d’horreur : « Apprendre à souffrir avec, c’est-à-dire à compatir [40]? » Une deuxième leçon est ensuite tirée de l’examen d’un autre tableau, Les Amants trépassés : il servirait à « constater la vanité des corps et de leur existence temporelle, et [à] condamner les illusions de la vie charnelle[41]. »
La littérature d’horreur poursuivrait une même finalité morale : les deux longs et horribles extraits des contes de Grimm cités suffiraient à le justifier. Pour relier la littérature au cinéma d’horreur, l’auteur avance alors une idée incompréhensible : elle imagine que des parents puissent trouver acceptable de lire ces contes de Grimm à leur fille adolescente, mais refuser de la laisser regarder un film comme Hostel. Ce faux « paradoxe », parfaitement artificiel, lui sert en effet à avancer un lieu commun : la différence serait liée au plus grand réalisme du cinéma.
Reconnaissant, contre toute attente, que l’horreur peut être plus grande encore quand la scène est imaginée, donc lue, l’auteur écrit alors :
« Mais l’autre grand concurrent du film d’horreur est probablement la réalité elle-même. On peut dire qu’elle le surpasse puisque ce qu’elle décrit est vrai et réel. N’importe quel viol, n’importe quelle guerre filmée pour une fiction sera évidemment toujours en deçà du viol ou de la guerre réels et vécus. Filmer la Shoah ne donnerait pas un film d’horreur, car ce n’est pas représentable[42]. »
Les raisons d’être gêné par ces lignes sont nombreuses. Ce n’est pas seulement que l’auteur énonce, de nouveau, un lieu commun, d’ailleurs contestable, qui ne semble pas avoir sa place dans un ouvrage de philosophie : la réalité surpasserait le film d’horreur parce qu’elle est réelle ! C’est aussi que l’auteur semble avoir oublié ce qu’elle a écrit plus haut : si les parents qui lisent des contes de Grimm à leur fille adolescente refusent de lui montrer Hostel, c’est parce que ce film serait trop réaliste. On doit donc désormais comprendre que si les parents qui lisent des contes de Grimm à leur fille adolescente refusent de lui montrer et de lui faire vivre des viols ou des guerres réels, c’est parce qu’ils sont plus réalistes encore que le réalisme du cinéma !
La suite de cette partie découpe l’histoire du cinéma d’horreur en cinq périodes, en évoquant vaguement pour chacune d’elle, un film considéré comme charnière.
L’évocation du Nosferatu (1922) de Murnau donne lieu à une rapide interprétation de la figure du vampire selon un usage de Freud bien éloigné de la richesse des analyses d’un Ernest Jones ou de la théorie que Noël Carroll en a proposée[43].
La deuxième période s’ouvrirait sur une rupture marquée par La Nuit des morts-vivants (1968). Rien n’est dit sur les raisons de ne pas évoquer Psychose (1960) d’Hitchcock, pourtant généralement tenu comme une influence majeure du slasher et donc du renouveau de l’horreur dans les années 1970[44]. Le succès du film de Romero tiendrait à la fois à des causes historiques (les guerres) et à une mode intellectuelle (le freudisme), ce qui relève d’un causalisme des motivations spectatorielles qui mériterait au moins d’être justifié. Quant à « l’analyse » du film, elle consiste essentiellement à opposer une interprétation qui en fait une « critique sociale » et celle qui semble avoir la faveur de l’auteur, à savoir qu’il s’agirait d’un symptôme du traumatisme des guerres de 1939-45 et du Vietnam, sans qu’on sache exactement sur quel critère s’appuie l’auteur, ni si d’autres interprétations ne seraient pas possibles[45].
L’auteur tire alors une leçon « philosophique » de la figure du zombie : le zombie nous apprendrait « ce qu’est la valeur de la vie : rien d’autre, en vérité, que ce qui fait que nous sommes autre chose que des zombies[46] », à savoir la pensée, le fait que nous sommes « une chose qui pense[47] » : « La Nuit peut bien être considéré comme un film dualiste, et Romero comme un cartésien[48] ! » Nous sommes en pleine tautologie, puisqu’après avoir défini le zombie comme un homme dénué de pensée, on prétend que le zombie nous apprend ce qui nous distingue de lui, à savoir la pensée.
Les trois dernières périodes correspondent en gros à une division traditionnelle de l’évolution d’un genre en âges classique (L’Exorciste), « moderniste » (Scream) et « post-moderne » (Saw et Hostel), ce dernier se caractérisant par son rapport parodique à ses conventions et l’intensification de la violence et de la cruauté. Cependant, l’auteur ne semble pas avoir conscience de la théorie esthétique, très répandue et discutée, qui est au principe de la périodisation qu’elle opère.
La deuxième partie propose plusieurs classifications et descriptions des « visages » de l’horreur. Ces visages deviennent des « figures », sans qu’on sache en quel sens on doit entendre ce terme, qui vont faire l’objet d’une liste et ouvrir ainsi le principal procédé formel de la suite du livre. La méthode n’est pas en soi condamnable. Chez Robin Wood, par exemple, elle est justifiée, dans son article « The American Nightmare », par l’effort de théorisation entrepris auparavant pour penser le cinéma d’horreur à l’aide des catégories de Freud, Marcuse et Horowitz[49]. La théorie ainsi formulée chez Wood vient donner sa cohérence et son unité à la liste proposée. Si l’influence de l’article de Wood est incontestable[50], on aurait en effet souhaité que l’auteur justifie mieux ses raisons de ne pas adopter les thèses de son illustre prédécesseur et notamment son insistance sur l’ambivalente valeur politique des films d’horreur à partir des années 1980 et leur fort potentiel réactionnaire[51].
Le problème est en outre que le lecteur cherchera en vain une cohérence et une unité dans les listes qui vont être données. On ne trouvera ainsi pas vraiment de lien entre les figures, sinon un paragraphe qui lie horreur et monstruosité, permet d’introduire le zombie et de distinguer une autre figure, non-monstrueuse de l’horreur : le serial killer dont il est dit que : « Cette fois-ci, c’est l’homme lui-même qui est la cause de l’horreur[52]… » Il est frappant que cette affirmation fasse que le lecteur s’interroge sur sa compréhension du jugement précédemment énoncé sur la même page (60) : « moins la distance sera grande entre les zombies et « nous », moins la menace sera redoutée, moins l’horreur sera forte[53]… »
Que le film d’horreur mette « l’individu devant l’horreur de sa nature[54] » n’a cependant rien d’évident. Faire référence aux tortionnaires d’Hostel en les décrivant comme « de simples pervers blasés, poussés au pire par une pulsion insatiable (désir de jouir toujours plus et autrement, paroxysme de la société de consommation, Hostel[55]) » pour en tirer, sans transition, la conclusion que « [d]ans ce dernier cas, c’est l’homme lui-même qui est entièrement responsable. Et là, la culpabilité est entièrement justifiée, le film d’horreur mettant l’individu devant l’horreur de sa nature inavouable[56] » ne nous permet pas non plus de comprendre pourquoi nous devrions nous reconnaître dans ces affreux personnages.
La justification manquante est peut-être à trouver quelques pages plus loin[57], dans une argumentation dont l’auteur reconnaît qu’elle est largement structurée autour des thèses freudiennes[58], en l’occurrence ici l’idée que la perversion ne serait qu’une exagération d’une tendance ordinaire à un hédonisme sans frein[59], source d’une jouissance « sans borne[60] ». Or, en fait d’argumentation, on ne trouve rien d’équivalent aux nombreuses et puissantes théories psychanalytiques de l’horreur qui ont déjà été proposées et critiquées[61].
Au lieu d’un raisonnement conceptuel, on trouve un paragraphe de Freud cité sans guillemets, ni mise en forme spécifique, mais surtout sans commentaire[62]. Le film cité à titre d’exemple, Eden Lake (John Watkins, 2008), quant à lui, illustrerait mieux la théorie girardienne du désir mimétique que la théorie freudienne[63]. Il est surtout dommage et révélateur que notre auteur ne mentionne même pas l’existence du film original français, dont Eden Lake n’est que le remake : Ils (2006), de Xavier Palud et Didier Moreau, qui comporte en outre une dimension politique intéressante en tant qu’elle est aussi une confrontation entre Europe de l’Ouest et Europe de l’Est[64].
Sans qu’on nous explique pourquoi, ni d’ailleurs sans que l’auteur elle-même ait l’air de le savoir, comme elle le reconnaît presque dans sa « conclusion » qui ressemble à une rationalisation a posteriori[65], une autre classification nous est proposée qui donne l’occasion d’employer de nouveau le procédé de la liste thématique : il va s’agir, cette fois, de définir les différents sens du mal à partir de ses différentes origines. On aura donc droit à plusieurs pages sur le mal naturel, le diable, la société et l’homme, dont la teneur se résume à ce paragraphe :
« Que le mal provienne d’une nature aveugle et sans intention ; ou bien d’une force diabolique capable de diriger la volonté humaine ; ou encore des mécanismes de la société qui rendent l’individu, bon par nature, mauvais ; ou bien d’une pathologie qui le rend inapte à se rendre sensible à la distinction entre bien et mal ; ou encore d’un être conscient, mais non affecté par cette distinction ; l’horreur la plus sinistre n’est pourtant peut-être pas celle que l’on croit : pour qu’on touche au mal absolu, il faut qu’il y ait intentionnalité couplée à la jouissance[66]. »
À la fin de cette sous-partie, on attend donc toujours une définition du mal, qui ne peut pas se réduire, comme l’auteur commence à l’écrire, à la douleur et à « la transformation, ou involution, à un état infra-humain, aussi repoussant physiquement que moralement (le devenir zombie[67]). » Si l’auteur avait travaillé davantage conceptuellement la notion de « monstre » en lien avec celle de téléologie[68], peut-être aurait-elle pu produire une définition plus convaincante. Cependant, ce n’est pas le cas et donner une liste d’exemples de choses qui tombent sous un concept ne permet pas le travail de clarification que l’on attend de la philosophie.
La troisième partie présente, en les accentuant, les mêmes défauts que les parties précédentes. Elle est structurée selon le procédé de la liste thématique, contient de nombreuses redondances[69], et certaines le sont plusieurs fois[70]. On me permettra donc de ne pas poursuivre ma lecture linéaire, faute de place. Je me concentrerai sur trois passages qui réclament d’être corrigés sous peine de laisser les lecteurs, non-initiés à la philosophie de l’horreur cinématographique et même à la philosophie, mal informés.
Le premier passage est un paragraphe consacré à une distinction conceptuelle entre la peur et l’effroi, sentiment reconnu par l’auteur comme spécifiquement visé par le genre de l’horreur cinématographique. Sans parler de la littérature anglo-saxonne très fournie sur la philosophie du cinéma d’horreur, et notamment de la grande richesse des études féministes, on pourrait s’attendre à ce que l’auteur expose correctement le seul ouvrage philosophique anglo-saxon qu’elle daigne citer, le chef-d’œuvre (en son genre) de Noël Carroll : Philosophy of Horror. Or, elle fait un contresens complet sur l’un des éléments essentiels de sa théorie : Carroll définit en effet l’horreur comme le sentiment qui nous saisit quand nous sommes confrontés à ce qui dépasse nos catégories culturelles[71], c’est-à-dire ce qui est inimaginable.
Or, juste avant de définir la peur comme le sentiment qui se rapporte à ce que je peux me représenter et l’effroi comme ce qui est provoqué par l’inimaginable, l’auteur affirme que, pour être en présence d’un film d’horreur, « nous ne devons pas seulement avoir peur, mais nous devons être effrayés[72] », en indiquant en note que Noël Carroll « se concentre sur le sentiment de peur, plutôt que sur l’effroi, ce qui l’amène par principe à exclure de son analyse bon nombre de films qui sont centraux, à commencer par Massacre à la tronçonneuse[73]. »
Le lecteur aura identifié le contresens sur la théorie de Carroll : Carroll est censé définir l’horreur par la peur, plutôt que par l’effroi ! L’ironie de l’histoire est donc que si Carroll, dans Philosophy of Horror, exclut en effet des films comme Massacre à la tronçonneuse, c’est parce que de tels films nous montrent des criminels que nous pouvons imaginer, c’est-à-dire dont nous pouvons avoir peur, mais qui ne sauraient provoquer notre effroi, selon la définition donnée. D’ailleurs, Carroll réintègrera plus tard ce type de films en les faisant entrer dans la catégorie, au demeurant assez suspecte, de « science-fiction psychologique[74] ».
Si l’auteur fait donc un contresens conceptuel complet sur le texte majeur de la philosophie anglo-saxonne du cinéma d’horreur, les exemples donnés ne sont pas plus satisfaisants : dans un film de guerre, j’aurais peur, car je sais ce qui menace le héros, tandis que dans le film d’horreur je ne saurais pas ce qui peut arriver la victime. Pourtant, dans Massacre à la tronçonneuse, à partir du moment où l’un des personnages découvre un cadavre humain suspendu à un crochet de boucher, je sais ce qui pourrait arriver à la victime ! Tandis que dans un film de guerre réussi, je dois être sans cesse surpris et il ne faut pas que je sache exactement ce qui menace le soldat. Pour sauver la distinction, on pourrait aller dans le sens de Carroll en disant que la menace, dans un film d’horreur, doit dépasser nos catégories culturelles, c’est-à-dire être inimaginable. C’est ce que semble vouloir dire l’auteur lorsqu’elle affirme que
« si, dans un film de guerre, une armée est décimée à cause d’un virus qui contamine les soldats un par un, en les rendant paranoïaques et meurtriers, alors le film en question changera de registre : on aura alors affaire à un film d’horreur dans un contexte guerrier[75]. »
Passons sur la faiblesse de l’exemple : que des soldats au combat soient « paranoïaques et meurtriers » ne semble pas tout à fait inimaginable. L’élément important semble tenir au fait que ce comportement est censé résulter d’un virus : mais il n’est pas du tout impossible d’imaginer qu’un virus puisse induire un comportement agressif, puisqu’il y a des cas de rage humaine qui produisent cet effet[76].
Le deuxième passage problématique est celui consacré aux rapports entre humour et horreur. Cette relation apparemment paradoxale fait l’objet de débats riches et techniques en philosophie contemporaine du cinéma d’horreur. Loin de permettre de les comprendre, le passage dresse de nouveau des listes de gags, de genres cinématographiques et de situations prétendument comiques[77] et se conclut sur le paragraphe suivant :
« À la question « Peut-on rire dans un film d’horreur ? », la réponse est donc certainement affirmative. En revanche, il est plus délicat de déterminer si l’on peut rire de l’horreur. À moins qu’il ne s’agisse à nouveau d’une conjuration[78]. »
On attendait d’un livre intitulé La philosophie du cinéma d’horreur qu’il analyse conceptuellement la question posée en vue de faire apparaître le problème et ses multiples dimensions, dont la deuxième phrase a une intuition, mais ne fait que signaler au lecteur une lacune qu’il aurait fallu combler.
Le troisième passage s’inscrit dans une sous-partie consacrée à « l’effet éthique » de la tragédie. On s’attendrait à retrouver une analyse d’Aristote. Or, il n’en est rien. C’est Rousseau qui est d’abord convoqué pour sa réflexion sur la pitié. Plusieurs passages du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes sont longuement cités qui visent à prouver que, « loin de pervertir et de rendre mauvais, le film d’horreur peut avoir l’effet contraire en nous rendant meilleurs[79] ! » Cette idée sera répétée et précisée plus loin en un paragraphe qui pourra rappeler quelque chose aux lecteurs de la Lettre à d’Alembert sur les spectacles :
« Le sentiment de pitié, corrélat de l’amour pour mon prochain, est réconfortant. En effet, le film d’horreur nous fait ainsi retrouver notre humanité à deux niveaux : en nous provoquant un sentiment de terreur […], et en nous faisant découvrir que nous ne souhaitons à personne de subir ce que nous contemplons, nous voulons le bien de l’autre par principe. En somme, l’image que nous obtenons de nous-mêmes est la suivante : vivant (et heureux de l’être !) et charitable[80]. »
En effet, on sait que Rousseau prend position, dans sa Lettre sur les spectacles, contre D’Alembert, en se prononçant pour l’interdiction du théâtre alors en vigueur à Genève. Or, dans un extrait célèbre, il s’en prend précisément à la position défendue ci-dessus :
« J’entends dire que la tragédie mène à la pitié par la terreur ; soit, mais quelle est cette pitié ? Une émotion passagère et vaine, qui ne dure pas plus que l’illusion qui l’a produite ; un reste de sentiment naturel étouffé bientôt par les passions ; une pitié stérile qui se repaît de quelques larmes, et n’a jamais produit le moindre acte d’humanité. Ainsi pleurait le sanguinaire Sylla au récit des maux qu’il n’avait pas faits lui-même[81]. »
La suite du texte, qui aurait mérité d’être analysée dans ce livre afin de corriger le caractère unilatéral des propos tenus par l’auteur sur cette question, soutient que les tragédies produisent une forme d’émotion non seulement trop passagère et stérile pour être une pitié authentique, mais nous permettent aussi de nous donner bonne conscience en nous incitant à être dans la vie aussi inactifs que nous le sommes au théâtre. La tragédie n’aurait donc pas le pouvoir de nous rendre vertueux, mais nous inciterait au contraire à développer les vices de la passivité, du voyeurisme, de l’indolence, de l’émotivité stérile, de l’autosatisfaction et de la bonne conscience facile.
Si l’auteur n’était pas sans connaître cette thèse fameuse de Rousseau, il est regrettable qu’elle ne l’ait pas au moins évoquée au moment où elle se sert de sa définition de la pitié pour construire un raisonnement indépendant sur la valeur morale des films d’horreur. Il y a en effet un risque que le lecteur néophyte se méprenne en croyant que Rousseau a soutenu, dans ce débat, une thèse opposée à celle qu’il a réellement et publiquement soutenue dans un débat analogue.
Or, le même reproche peut être formulé à propos de l’usage qui est fait de Platon dans ces mêmes pages. Citant longuement deux passages du livre III de la République[82], l’auteur conclut que « [s]i l’on continue d’écouter Platon, il semblerait au contraire que le film d’horreur nous offre la bonne distance pour pouvoir juger et condamner le mal, sans risque de nous y laisser entraîner[83]. » Mais il conviendrait de rappeler aux lecteurs que, dans ce même livre III, Platon vient de chasser le poète de sa Cité idéale[84], pour des raisons qui contredisent directement les arguments avancés par l’auteur[85] !
Bref, on aura compris que ce livre ne sera guère instructif pour le spécialiste de philosophie du cinéma d’horreur. Il pourra plaire, en revanche, à un lecteur non-philosophe, même si l’on regrettera l’absence d’une bibliographie plus riche, qui aurait mentionné les textes constitutifs de la philosophie du cinéma d’horreur.
[1] Noël Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, New York, Routledge, 1990.
[2] Voir, par exemple, les références bibliographiques de l’article « Horror » du Routledge Companion to Philosophy and Film, Paisley Livingston et Carl Plantinga (dir.), Londres, Routledge, 2009.
[3] Olivia Chevalier-Chandeigne, La philosophie du cinéma d’horreur (LPCH ensuite), Paris, Ellipses, « Culture pop », 2014.
[4] Les deux tomes de sa Philosophie en séries (2009 et 2010) constituent une ressource précieuse pour l’enseignement de la philosophie comme pour la réflexion philosophique.
[5] Philippe de Lara, Le Rite et la raison : Wittgenstein anthropologue, Paris, Ellipses, 2005.
[6] Philippe de Lara, L’expérience du langage. Wittgenstein, philosophe de la subjectivité, Paris, Ellipses, 2005.
[7] Élise Marrou, De la certitude, Paris, Ellipses, 2006.
[8] Sabine Plaud, Wittgenstein, Paris, Ellipses, 2009.
[9] On ne peut, par exemple, que saluer l’excellente initiative de Sandra Laugier, Sylvie Allouche et Sarah Hatchuel qui, en amont du colloque annuel « Philoséries », ont su organiser un séminaire qui encourage les intervenants potentiels à étudier et échanger autour de la littérature spécialisée existante. Voir le programme en ligne : http://www.series.cnrs.fr/.
[10] De ce point de vue, de même qu’on ne permettrait pas qu’un philosophe écrive sur la méthode cartésienne sans connaître l’ensemble des sources secondaires et sans qu’il prenne position vis-à-vis des interprétations dominantes, de même on ne peut pas laisser un auteur intituler son livre La philosophie du cinéma d’horreur sans qu’il connaisse et se situe par rapport aux conceptions dominantes du domaine de recherche concerné.
[11] Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, trad. fr. J.-F. Poirier et F. Proust, Paris, GF-Flammarion, 1991, p. 45.
[12] LPCH, p. 5.
[13] Nous avons essayé de le faire dans un article intitulé « Le paradoxe de l’horreur épidémique », Igitur – Arguments philosophiques, vol. 3, no 5, 15 décembre 2011, p. 1-56, en ligne : http://www.igitur.org/Le-paradoxe-de-l-horreur.
[14] Cette complémentarité n’est pas évidente.
[15] LPCH, note 1, p. 6.
[16] LPCH, note 1, p. 6.
[17] Voire opposés, on ne sait pas.
[18] Voir Aristote, La Politique, 1341a23 et surtout 1341b32-1342a17 ; Aristote, Poétique, 1449b28.
[19] LPCH, p. 6. L’auteur a raison de sauver ainsi la catharsis d’Aristote, car le paragraphe sur lequel son livre se termine ne semble pas dire autre chose. Que l’on compare, le contenu de la note 1 « le spectateur, devant le tragique ou l’horreur, se libère de ses passions sur la scène de l’imaginaire ; il se soigne aussi, car en regardant se déchaîner les passions, il est désormais apte à les contenir » (p. 6) et le dernier paragraphe « nous avons besoin de récits et de figurations de l’horreur, car ils constituent des forces de structuration individuelle et collective, comme autant d’épreuves face à ce qui nous attend, de la part de l’autre, et de nous-mêmes. » (p. 148)
[20] Voir Dufour, Le cinéma d’horreur et ses figures, p. 61-62 et Clémot, « Une lecture des films d’horreur épidémique », Tracés. Revue de Sciences humaines, 21, 2011/2, p. 169.
[21] Stanley Cavell, Pursuits of Happiness, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1981 ; À la recherche du bonheur, trad. fr. C. Fournier et S. Laugier, Paris, Les cahiers du cinéma, 1993.
[22] Voir Wittgenstein, Recherches philosophiques, trad. fr. F. Dastur et al., Paris, Gallimard, 2004, § 67, p. 64.
[23] LPCH, p. 6.
[24] Id.
[25] LPCH, p. 7.
[26] LPCH, p. 17.
[27] LPCH, p. 17.
[28] LPCH, p. 7.
[29] LPCH, p. 7.
[30] On peut aussi y voir du sang et des corps mutilés…
[31] LPCH, p. 7.
[32] I. Nathan, Alien. Genèse d’un mythe, Paris, Huginn & Muninn, 2011, p. 146.
[33] LPCH, p. 70.
[34] LPCH, p. 7. Pour une lecture d’Alien qui permettrait ce rapprochement, voir Clémot, « Alien ou la menace de l’Autre en moi : l’alien, Ripley et la femme inconnue », Pop-en-stock, 12 juin 2013, en ligne : http://popenstock.ca/dossier/article/alien-ou-la-menace-de-lautre-en-moi-lalien-ripley-et-la-femme-inconnue-1.
[35] LPCH, p. 7.
[36] Voir ce que disait Panofsky de la notion d’art commercial : « si l’on définit l’art commercial comme tout art non produit, de prime abord, dans le but de satisfaire le besoin créateur de l’artiste, mais visant à satisfaire les exigences d’un mécène ou d’un public, il faut préciser que l’art non commercial est une exception plutôt que la règle, exception récente, de plus, et pas toujours heureuse. S’il est vrai que l’art commercial court toujours le risque de se retrouver sur le trottoir, il est également vrai que l’art non commercial court toujours le risque de finir vieille fille. » Voir Erwin Panofsky, « Style and medium in the motion pictures » (1947), repr. in D. Talbot, Film. An Anthology (1959), Berkeley, Los Angeles et Londres, University of California Press, 1966 ; « Style et matière du septième art », dans Trois essais sur le style. trad. fr. Bernard Turle, Paris, Le Promeneur, 1996, p. 138.
[37] LPCH, p. 54.
[38] LPCH, p. 46.
[39] LPCH, p. 12.
[40] LPCH, p. 12.
[41] LPCH, p. 13.
[42] LPCH, p. 16.
[43] Voir Ernest Jones, On the Nightmare, Londres, Hogart Press, 1931 ; Le cauchemar, Paris, Payot, 2002 ; Noël Carroll, « Nightmare and the horror film: the symbolic biology of fantastic beings », Film Quarterly, vol. 34, no 3, p. 16-25. Pour un résumé, voir Clémot, « Le paradoxe de l’horreur épidémique », art. cit., p. 7-9.
[44] Voir Clémot, « Le paradoxe de l’horreur épidémique », art. cit., p. 18.
[45] Pour un exposé plus ouvert des films d’horreur épidémique, voir ma « Lecture des films d’horreur épidémique ».
[46] LPCH, p. 28. Il est remarquable que cette formulation corresponde exactement à la critique rylienne selon laquelle Descartes aurait commis une « erreur de catégorie » : ce n’est pas parce que l’esprit est autre chose que la matière qu’il est une autre chose. Voir Gilbert Ryle, The Concept of Mind, University of Chicago Press, 1949 ; La notion d’esprit, trad. fr. S. Stern-Gillet, Payot et Rivages, 2005.
[47] La deuxième Méditation de Descartes est citée.
[48] LPCH, p. 29.
[49] Voir Robin Wood, Hollywood from Vietnam to Reagan… and Beyond, New York, Columbia University Press, 2003 (1986), chap. 4 et 5.
[50] Qu’on compare, par exemple, les classifications du sommaire (p. 3) avec la liste des cinq motifs dominants des films d’horreur depuis les 60ies : « 1. Le monstre en tant qu’homme psychotique ou schizophrène […] ; 2. La vengeance de la nature […] ; 3. Satanisme, possession diabolique, l’Antéchrist […] ; 4. L’enfant terrible (souvent en relation directe avec le thème précédent) […] ; Cannibalisme… » Robin Wood, « The American Nightmare », Hollywood from Vietnam to Reagan… and Beyond, op. cit., p. 75.
[51] Il est dommage que cette œuvre déterminante pour l’étude sérieuse de la culture populaire ne soit pas titrée correctement dans la bibliographie. On lit seulement, sans références, « Wood R., The American Nightmare », alors que le titre de l’ouvrage est Hollywood from Vietnam to Reagan… and Beyond et que « The American Nightmare » n’est qu’un texte parmi plusieurs autres, qui abordent l’évolution des films d’horreur au cours de cette période.
[52] LPCH, p. 60.
[53] LPCH, p. 60. L’auteur conteste l’idée de Romero de faire évoluer le zombie en le rendant plus humain en arguant de sa moindre efficacité. Mais si l’homme lui-même peut être cause de l’horreur, alors on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas éprouver de l’effroi pour des zombies plus évolués.
[54] LPCH, p. 65.
[55] LPCH, p. 65.
[56] LPCH, p. 65.
[57] LPCH, p. 76.
[58] Nous paraphrasons l’auteur, p. 147.
[59] Un lieu commun, au moins depuis Wood, op. cit., p. 173.
[60] LPCH, p. 76.
[61] Voir, par exemple, Clémot, « Le paradoxe de l’horreur épidémique », art. cit., p. 9-10.
[62] LPCH, p. 76.
[63] Voir l’importance de la théorie de René Girard pour plusieurs films d’horreur contemporains : Antonio Dominguez, « The Cabin in the Woods : de l’horreur cosmique au gothico-postmodernisme », Pop-en-stock, en ligne : http://popenstock.ca/dossier/article/cabin-woods-2-de-lhorreur-cosmique-au-gothico-postmodernisme.
[64] Cela fait penser au lecteur que la filmographie néglige, par exemple, le magnifique et horrifique Les yeux sans visage (Georges Franju, 1959).
[65] « On se demandera certainement alors pourquoi on a réintroduit le Mal, une notion si lourde de présupposés et de conséquences métaphysiques et morales, puisque la théorie freudienne semblait nous en avoir débarrassés. » LPCH, p. 149.
[66] LPCH, p. 74.
[67] LPCH, p. 64.
[68] L’auteur ne semble pas à l’aise avec ce concept comme l’indiquent le fait qu’elle ne relie pas conceptuellement les notions de « monstruosité physique » et de « monstruosité morale » (p. 54), cette dernière notion disparaissant ensuite du livre, au profit de remarques topiques sur le normal et le pathologique (p. 60), ainsi que l’obscurité de l’idée que le monstre de Jeeper Creepers serait une créature « humaine [qui] ne doit sa monstruosité qu’à la nécessité naturelle » (p. 69), qui est complétée par une note qui ne rend pas les choses plus claires : « Cependant, ce monstre n’ayant pas de fin peut être considéré comme une figure diabolique. » Pour un essai de clarification de la notion de monstre en relation avec la littérature philosophique sur la question, voir Clémot, « Le paradoxe de l’horreur épidémique », art. cit., p. 17-23.
[69] LPCH, p. 91 ; 96 ; 98 ; 107 ; 108 ; 110 ; 115 ; 117 ; 123.
[70] On nous dit trois fois que Wes Craven a fait un retour remarqué avec Scream (p. 35, 73 et 110) et que La Dernière Maison sur la gauche est un remake de La Source d’Ingmar Bergman (p. 29, 36 et 115). D’ailleurs, à voir répétée l’idée que jamais un film d’horreur ne pourra être aussi horrible que l’horreur du Vietnam, on ne sait plus si elle vient de Wes Craven, comme l’auteur l’affirme p. 71, ou de Ted Savini, qui est cité p. 116.
[71] Carroll, Philosophy of Horror, op. cit., p. 27.
[72] LPCH, p. 81.
[73] LPCH, p. 81.
[74] Carroll, « Enjoying Horror Fictions: A Reply To Gaut », British Journal of Aesthetics, vol. 35, n° 1, p. 68 .
[75] LPCH, p. 81.
[76] Voir Clémot, « Une lecture des films d’horreur épidémique », art. cit., p. 170.
[77] On peut, par exemple, ne pas vraiment rire en lisant que « [d]ans Maniac, le psychopathe Franck Zito tue pour combler le vide laissé par la mort de sa mère. » LPCH, p. 103.
[78] LPCH, p. 103.
[79] LPCH, p. 128.
[80] LPCH, p. 136.
[81] Rousseau, Lettre à d’Alembert sur les spectacles, Paris, Flammarion, 2003 (1758), p. 72-73.
[82] Platon, République, livre III, 409a-409e.
[83] LPCH, p. 129.
[84] Platon, République, livre III, 398a-b.
[85] On sait que ces raisons sont davantage exposées au livre X, 604e-607c.