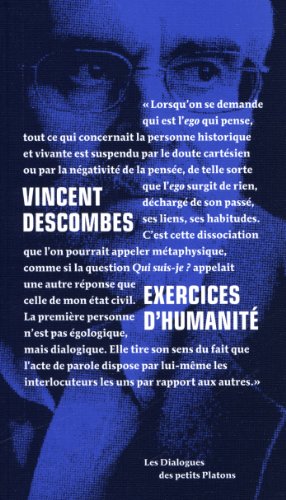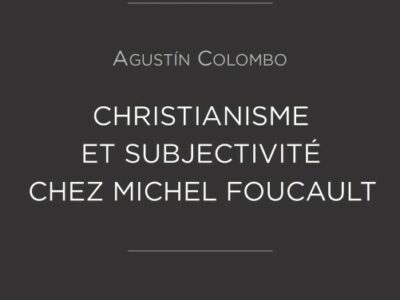Recension – Exercices d’humanité
Vincent Descombes, Exercices d’humanité – Dialogue avec Philippe De Lara, Paris, Les petits Platons, 2013
Pierre Fasula – Paris 1 – ExeCo/Phico
Vient de paraître Exercices d’humanité (Paris, Les petits Platons, 2013), un ensemble d’entretiens de Vincent Descombes avec Philippe de Lara. Avec la parution de Vincent Descombes. Questions disputées (Paris, Cécile Defaut, 2007), on pouvait déjà apprécier les réponses du premier à Bruno Gnassounou et Cyril Michon, au terme d’un recueil d’une douzaine de contributions consacrées à sa philosophie, apprécier la générosité avec laquelle il tenait non seulement à répondre aux objections qui lui étaient faites mais aussi à souligner les grandes lignes de sa philosophie et à entrer dans le détail de l’analyse pour clarifier toujours davantage ses positions. C’est d’autant plus le cas avec cette parution récente, ces nouveaux entretiens abordant de manière plus exhaustive l’œuvre de V. Descombes, y compris ses dernières recherches, ainsi que certains éléments biographiques.
Le premier des huit chapitres est ainsi consacré à Vincent Descombes lui-même, à l’homme devenu philosophe dans un contexte particulier. En effet, la génération à laquelle il appartient n’est plus sous l’influence directe de Sartre, s’apprête, pour partie, à participer à mai 68 et est marquée par de jeunes professeurs tels que Derrida, Ricœur, Lyotard ou encore Deleuze. Ce chapitre nous semble intéressant à deux titres. Tout d’abord, on y trouve une description dans un esprit sociologique des manières dont le savoir s’acquérait : un mélange de cours nouveaux, ceux de Derrida ou Ricœur par exemple, d’enseignements plus conventionnels et de lectures hors université d’une grande diversité, le tout sur fond d’une relativisation de ce l’on pourrait croire importants à l’époque, Heidegger et le structuralisme. De ce point de vue, il est intéressant de rapporter cette description à l’un des premiers livres de V. Descombes, Le même et l’autre (Paris, Minuit, 1979), qui présente une histoire de la philosophie française de 1933 à 1978. Les entretiens récents montrent en partie la réalité académique et sociale de ce qui est décrit dans trois différents chapitres de Le même et l’autre : la sémiologie (chapitre 3), la critique de l’histoire chez Althusser et Foucault (chapitre 4) et la pensée de la différence avec Derrida et Deleuze (chapitre 5). Cette réalité, c’est celle du chevauchement et de l’importance relative et inégale de ces moments de la philosophie française.
En outre, à défaut d’une suite au Même et l’autre, à savoir une histoire de la philosophie française couvrant les années 1979-2013, ces entretiens montrent le trajet original de V. Descombes, dont on ne peut dire simplement qu’il s’est tourné vers la philosophie analytique, et ce pour trois raisons. Premièrement, ce que Descombes découvre avec Tugendhat, c’est une relecture analytique des continentaux ; deuxièmement, la philosophie analytique dont il est question correspond surtout aux pères de la philosophie analytique (Frege, Russell, Wittgenstein) et aux commentateurs de ce dernier (Geach, Anscombe, Kenny) ; enfin, les sciences humaines et notamment la rencontre avec Louis Dumont semblent toutes aussi déterminantes. En forçant un peu le trait, on pourrait dire qu’en un sens Dumont a fourni les problèmes à résoudre, la philosophie française la matière à discuter, et la philosophie analytique (au sens précisé ci-dessus) les moyens de discuter celle-ci et de résoudre celui-là.
Le troisième chapitre, consacré à la métaphysique, est très instructif sur ce point et concernant la nature de la philosophie développée par V. Descombes. Ce dernier qualifie en effet son enquête de « métaphysique » et justifie ainsi l’usage de ce terme : la métaphysique ne serait ni au-delà ni en-deçà de la science, mais une enquête de nature conceptuelle, portant sur les différences logiques ou conceptuelles. Un des passages éclairants de ces entretiens est celui dans lequel V. Descombes marque son opposition à une métaphysique de l’objet en général, dans la lignée de Grammaire d’objets en tout genre (Paris, Minuit, 1983). Il s’agit alors d’opposer le souci de la différence conceptuelle à l’uniformisation conceptuelle de la métaphysique de l’objet en général. On comprend au passage pourquoi V. Descombes peut à la fois qualifier son enquête de métaphysique et la placer dans le sillage de Wittgenstein : elle est métaphysique au sens où elle différencie des catégories (Aristote) ou des concepts (Wittgenstein).
Le point de départ du deuxième chapitre réside dans cette rencontre de la philosophie analytique et de la philosophie sociale autour d’une question particulière, celle des « individus collectifs » et de la totalité. Vincent Descombes présente en effet son projet comme une manière de répondre à ce regret de Dumont selon lequel les philosophes ne s’intéresseraient pas assez à la notion de totalité – réponse développée dans Les institutions du sens (Paris, Minuit, 1996). Il s’agit précisément d’une clarification de la question au moyen d’une distinction particulièrement éclairante entre totus et omnis. Dans le premier cas, il s’agit d’un rapport entre tout et partie, dans le second, entre l’universel et le particulier. Or, dans ce dernier cas, « cette totalité-là, c’est un ensemble d’éléments, une classe d’individus, au sens logique. Ce n’est pas la formation d’une totalité dans le sens d’une réalité » (p. 49). Autrement dit, à la distinction entre omnis et totus se superpose une autre distinction entre nominal et réel.
Cependant, la reconnaissance de cette distinction ne semble possible que si une autre distinction est faite entre une approche métaphysique de la question (au sens défini par V. Descombes) et une approche morale et politique. De la sorte, il ne va plus de soi qu’une position métaphysique reconnaissant des totalités doit tomber sous le coup d’une critique morale et politique : « Pourquoi les totalités seraient-elles forcément totalitaires ? Nous devons distinguer les choses de façon à comprendre que vous pouvez très bien être à la fois holiste et antitotalitaire. Et, inversement, vous pouvez être individualiste et totalitaire » (p. 54). Le point intéressant est qu’une telle distinction permet en retour à V. Descombes d’éclairer l’approche politique de la totalité et de l’identité. En témoigne la fin de ce deuxième chapitre où l’analyse de l’« identitaire », par-delà celle de la totalité, permet de clarifier les termes du débat sur l’identité nationale – point sur lequel Les embarras de l’identité était resté très discret :
En ce qui concerne les controverses contemporaines sur la manière dont il faudrait que nous définissions ce qu’il est convenu d’appeler « nos identités », je dirais volontiers que la contribution du philosophe est de mettre en évidence la nécessité d’avoir des critères d’identité. On n’use pas du même critère pour savoir qui fait partie du village, qui fait partie du club de foot, qui fait partie de la communauté des fidèles, qui fait partie de notre nation dans le sens moderne du mot « nation », dans le sens où les critères de nationalité doivent être purement politiques, ce qui veut dire qu’ils doivent coïncider avec les critères de citoyenneté. (p. 68)
Cette réflexion sur l’identité collective trouve un pendant dans l’analyse de la question de l’identité et du sujet, aux chapitres trois et quatre. Ce ne sont pas les chapitres qui surprendront le plus les lecteurs de V. Descombes, mais ils ont le grand mérite de mettre en relief certaines lignes de pensée développées dans ses dernières parutions, notamment dans Le complément de sujet (Paris, Gallimard, 2004). Nous pensons par exemple à l’insistance, aux chapitres trois et quatre, sur la nouveauté introduite par Wittgenstein par rapport à Descartes, sans commune mesure avec les critiques du sujet censées être radicales, celles de Marx, Nietzsche ou Freud par exemple : « Ce qui est frappant, c’est que ce sont des critiques importantes, qui touchent à des choses importantes, mais aucune d’elles ne remet en cause le nouveau sens que Descartes donne à “penser” » (p. 97). Cette remise en cause est au contraire précisément faite par Wittgenstein, avec l’usage de l’étiquette « verbes psychologiques » :
Il apparaît que cette catégorie de cogitatio qu’invente Descartes n’est pas une catégorie. Elle rassemble toutes sortes de réalités psychologiques qui en fait ne peuvent pas être unifiées. Et c’est là qu’éclate le génie tactique de Wittgenstein philosophe : grâce à cette étiquette des « verbes psychologiques », il peut éviter d’avoir à choisir entre dire « Je parle des actes de conscience », ou « Je parle des états de conscience », ou « Je parle des vécus de conscience ». Il évite de s’enfermer d’emblée dans une voie sans issue. Le mot lui permet de dire qu’il va répartir tous ces verbes psychologiques dans différentes catégories. Bien entendu entre celles d’actes, d’états et d’attitudes, mais elles ne suffisent pas, il y en a beaucoup d’autres. Ce que Wittgenstein combat, c’est justement cette uniformisation qui est une calamité. (p. 85)
Pour autant, comme le développe plus particulièrement le chapitre 4, l’entreprise wittgensteinienne ne participe à aucune surenchère dans la critique de Descartes, par exemple à propos du moi : « Chez Wittgenstein, nous trouvons tout autre chose : sa critique porte sur le moi des philosophes, et elle vise à rétablir la première personne dans la fonction qui est la sienne au sein de notre discours, en dehors de la philosophie » (p. 103). Et cette fonction est de signaler la présence du sujet parlant dans le système syntaxique des trois personnes : dire « moi », c’est prendre une des places, qui a ses spécificités, de l’acte de parole.
Tout l’intérêt des chapitres cinq et six est alors de basculer vers l’intérêt pratique de la question, à partir notamment du retravail de la distinction sujet/objet à partir d’une philosophie de l’action. Il ne s’agit pas de remettre en cause la distinction sujet/objet au nom de la distinction agent/patient, en lui substituant par exemple cette distinction, mais bien au contraire de repenser la première à partir de la deuxième : sujet et objet ne sont pas des entités, mais des fonctions et des positions dans une action. La conséquence est qu’alors le problème n’est plus celui de la dualité entre sujet et objet, mais celui du caractère proprement humain et autonome de l’action :
L’analyse d’une action naturelle quelconque nous donne l’opposition du sujet et de l’objet, de l’agent et du patient. Est-ce le chat qui mange la souris ou est-ce la souris qui mange le chat ? Voilà le sujet et l’objet. Et ce qui nous manque encore pour que nous puissions parler de l’agent humain et de son autonomie, ce n’est pas du tout la dualité sujet/objet, car nous avons cette dualité de l’actif et du passif, mais c’est la dimension de la pensée : l’agent d’une action intentionnelle est quelqu’un qui pense ce qu’il fait, qui exécute une pensée pratique, qui sait pourquoi il fait ce qu’il fait. Cela veut dire que l’opposition formelle d’un sujet et d’un objet ne suffit pas à nous permettre une analyse de ce que requiert l’autonomie d’un agent. (p. 124–125).
La porte est alors ouverte pour le chapitre six qui décrit le type de philosophie de l’action requise et qui se démarque des philosophies de l’autoposition ou de l’autodétermination du sujet.
Mais ce sont les chapitres sept et huit qui tirent le plus les conséquences de la critique du cogito, tout d’abord dans une analyse du rapport entre cogito et modernité. Selon V. Descombes, la philosophie de l’esprit et la philosophie politique classiques sont à comprendre « dans le mouvement plus général de l’individualisme » (p. 150), dont la description doit se faire en deux temps, dans le sillage de ce qu’a proposé Louis Dumont. Il a fallu que se développe d’abord une certaine idée de l’individu, l’« individu-hors-du-monde », puis celle d’une société construite autour de l’individu, devenu alors « individu-dans-le-monde ». Le point important est que cette référence à l’anthropologie permet peut-être de comprendre autrement les philosophies de l’ego et de leur donner un sens :
Un individu-hors-du-monde qui porte le projet même de changer le monde pour le rendre compatible avec nos libertés, c’est peut-être cela l’ego, tel qu’on le trouve dans la philosophie comme acte pur de ressaisie de soi. Cet acte, c’est l’opération par laquelle l’individu se détache de son propre passé, de sa propre généalogie, de sa propre formation, c’est l’initiative qui est censée libérer le sujet de tout ce qu’il devait au monde et le mettre devant lui-même, à pied d’œuvre, pour tout recréer sur une base entièrement neuve. (p. 156)
Cette référence à l’anthropologie semble dans le même temps avoir pour V. Descombes une tout autre fonction : nous rappeler que « nous sommes toujours des êtres humains » (p. 158), c’est-à-dire que, bien que nous nous pensons comme détachés, libres par rapport au monde, si nous voulons être citoyens, alors il nous faut nous « réconcilier avec [notre] propre être social » (p. 161) : nous sommes membres d’une société civile, d’une communauté politique, etc. Ce sont alors les grandes thèses du dernier chapitre des Embarras de l’identité qui sont développées, notamment celles qui portent sur le dépassement de cette communauté et le concept de nation.
Ce volume d’entretiens est donc d’un grand intérêt, tant pour la perspective qu’il offre sur les travaux passés de V. Descombes que pour l’aperçu de développements futurs ; on ne saurait ainsi que le recommander vivement.