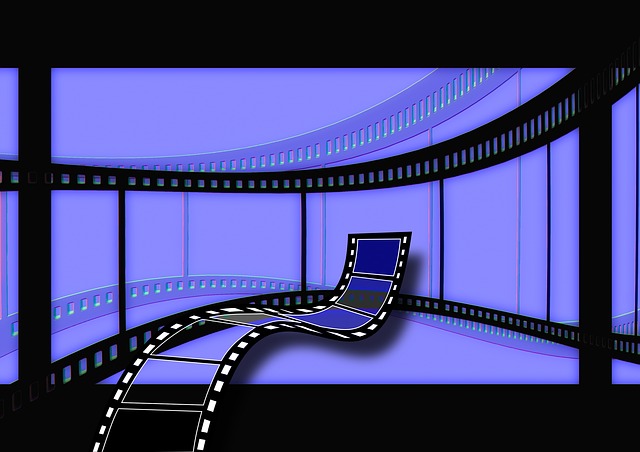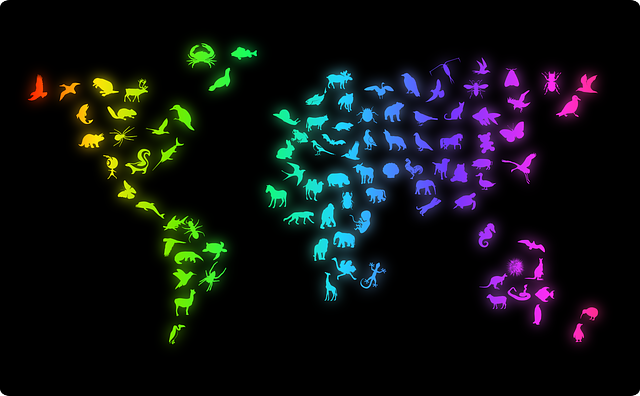« Le regard de la science ». Retour sur la métaphore du cinématographe dans le quatrième chapitre de L’Evolution créatrice (II)
Thomas Carrier-Lafleur, Universités de Laval et Paul-Valéry Montpellier III
Changement de paradigme : du cinématographe au cinéma
Il n’est plus temps d’en douter, nous dit Bergson, le mécanisme cinématographique est l’illusion que le philosophe doit surmonter afin d’offrir à la science moderne la métaphysique qui lui correspond. Une relecture du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice nous incite à évaluer la nécessité d’un tel sacrifice. La science, pour être résolument moderne, a-t-elle réellement besoin de se construire en opposition avec la dynamique cinématographique des images en mouvement ? Un philosophe, et pas le moindre, a, à sa manière, déjà répondu par la négative : « or, ce dont Bergson croyait le cinéma incapable, parce qu’il considérait seulement ce qui se passait dans l’appareil (le mouvement homogène abstrait du défilé des images), c’est ce dont l’appareil est le plus capable, éminemment capable : l’image-mouvement, c’est-à-dire le mouvement pur extrait des corps ou des mobiles[1]. » Les Cinéma de Deleuze – respectivement publiés en 1983 (L’image-mouvement) et 1985 (L’image-temps) – se fondent il est vrai sur le paradoxe qui consiste à penser positivement l’ontologie cinématographique à partir des réticences exprimées par Bergson à l’égard de ce médium. Suivant cette même logique, nous voudrions montrer que le cinéma, s’il l’avait pensé et expérimenté autrement, aurait pu être un allié de taille pour Bergson dans son projet de réviser la science moderne à partir de la philosophie du devenir. Plus important encore, le cinéma doit redevenir pour nous un moyen de connaissance, une expérience du monde privilégiée. Pour ce faire, il suffisait de penser le cinéma non plus comme la simple représentation du mouvement dans les images (le cadre), mais comme des images elles-mêmes irréductibles à tout mouvement spatio-temporellement localisable, des images qui pour la première fois dans l’histoire de la technique peuvent se comprendre en tant que mouvement pur et irréductible.
Soumettons cette thèse hardie, que la suite du présent article tentera de développer : le flux cinématographique des images en mouvement, analogue à celui du « temps-invention » bergsonien, n’est donc plus le contre-exemple face auquel doit s’ériger la science moderne, mais, au contraire, et d’une manière que n’avait pas prévue Bergson, sa véritable méthode. Le cinéma serait également l’allié de la science, comme il est celui du philosophe, puisqu’il est certain que la contemporanéité de la publication des Cinéma de Deleuze et du renouveau des études bergsoniennes ne saurait être qu’un hasard. Le mécanisme cinématographique de la pensée serait ce qui permet de comprendre la science en ce qu’elle a de moderne, au même titre qu’il a su donner à la philosophie de Bergson un nouvel élan. Il existe une dimension proprement scientifique du cinématographe, en ce qu’il est une technique de représentation du monde et une expérience nouvelle de perception. Nous proposons d’appeler « cinéma » cet autre point de vue qu’il est possible de porter sur le médium. Le cinéma s’oppose donc au cinématographe bergsonien, comme un paradigme fait place à un autre. Alors que pour Bergson ne compte que la réduction mécanique de l’art cinématographique, à cause d’une assimilation du mouvement des images au défilement de la pellicule dans l’appareil, pour nous sera mise en avant ce que l’on pourrait nommer son irréduction phénoménologique : il y a une expérience de « spectature » propre au cinéma qui ne peut en rien être réduite à telle ou telle considération strictement technique. S’il fallait trouver une justification sur ce terrain-là, il serait possible de montrer que le regard de Bergson sur le cinématographe, par la trop grande distance temporelle qui sépare les dispositifs d’aujourd’hui de ceux de 1907, n’est tout simplement plus adapté. Avec le tournant numérique du cinéma qui s’effectue depuis une vingtaine d’années, rarissimes sont les films tournés aujourd’hui sur pellicule. L’enregistrement des images n’est plus analogique, mais numérique[2]. Or, dans une caméra ou dans un projecteur numériques, il n’y a stricto sensu aucun mouvement. Rien n’y roule et rien n’y tourne. Le paradigme du défilement des images sur bande pelliculaire, propre au cinématographe qu’a connu Bergson, fait maintenant place à celui de l’interactivité et à celui des flux d’informations. Le concept du flux[3] tel que nous le fait expérimenter le cinéma moderne devrait être le nouveau paradigme pour penser la perception et le rapport de l’homme au monde. Le cinéma, comme l’était le cinématographe pour Bergson, doit à la fois être la scène où se jouent la perception et l’expérience, tout en étant également un acteur privilégié : simultanément scène et acteur, voilà ce que Bergson entend par « méthode cinématographique. » Replacer le cinéma dans son devenir, ne pas considérer le médium comme fixé et immuable devant l’éternel, voilà une première manière de se laisser guider vers une instauration cinématographique de la philosophie et de la science.
Mais sans même se référer au numérique et aux nouvelles manières où le temps n’est plus décomposé géométriquement et restituer de manière artificielle cette illusion suprême du mouvement qu’est le défilement monotone de la pellicule, n’est-il pas envisageable de mettre de côté la dictature mécanique et de, tout simplement, opérer une modification du paradigme « cinématographe » à partir d’un changement de point de vue ? En bref, à l’époque où Bergson écrivait L’Évolution créatrice, aurait-il été possible de penser le cinématographe autrement que par l’illusion mécanistique du mouvement ? Ce paradigme que nous appelons cinéma était-il déjà présent à l’heure du cinématographe ? La réponse bergsonienne à ces questions doit être positive : oui, dans la mesure où le cinématographe et le cinéma sont deux devenirs particuliers qui coexistent au sein du même devenir général, que l’on pourrait appeler Cinéma ou art cinématographique. Il faut ainsi passer du paradigme de la reproduction des images à celui de leur perception, du mouvement mécanique englobé par l’appareil d’enregistrement à celui, englobant, du flux des images et de leur réception. Le cinématographe est pour Bergson une illusion (au même titre que la théorie de Zénon sur Achille et la tortue), mais le philosophe n’en voit pas la vérité cachée derrière. Il s’arrête à la division mécanique du mouvement que propose l’appareil avec ses vingt-quatre images par seconde, sans se soucier de l’effet de projection, c’est-à-dire de l’analyse sensible, de ses images. Nous l’avons dit plus haut, c’est toute l’entreprise deleuzienne dans les Cinéma (et particulièrement dans Cinéma 1), que de peser les conséquences de ce changement de paradigme, à la fois pour le cinéma et pour la philosophie de Bergson. Le brio de Deleuze est d’avoir montré – en utilisant Matière et mémoire comme éperon conceptuel de la pensée cinématographique – qu’il n’y a pas de rapport entre les moyens illusoires de la reproduction et la nature de ce qui est produit. La perception cinématographique, elle, n’est pas illusoire, contrairement peut-être à son moyen de reproduction. À travers une paradoxale reproduction mécanique, le cinéma donne accès au mouvement pur, celui que l’on ne retrouve pas réellement dans la vie habituelle. La « tendance cinématographique » de la connaissance usuelle ne renvoie qu’à l’une des deux faces du cinématographe. Le cinématographe joue avec l’artifice et le faux pour atteindre, là où on les attendait le moins, un temps et un mouvement qui tendent vers le pur. La perception reprend la projection cinématographique et lui permet du même coup d’effectuer un saut incommensurable, de délaisser la mécanique de l’illusion au profit de l’immédiateté de l’expérience des flux cinématographiques. Le propre du cinéma est bien de donner immédiatement et de manière irréductible, comme une donnée de la conscience, une image-mouvement. Cette image qui est elle-même mouvement est analogue au concept bergsonien de coupe mobile de la durée : il s’agit du mouvement de la matière en tant qu’image et de l’image en tant que matière (le double concept d’« image-matière »), ce qui est à l’extrême opposé d’une image à laquelle on aurait ajouté du mouvement, mécaniquement ou grâce à un ordinateur. Une des grandes forces de l’art cinématographique, duquel la science moderne aurait alors tout intérêt à s’inspirer, du moins comme image médiatrice, c’est de faire sentir à travers l’acte même de spectature qu’il y a une durée propre à la matière et une durée propre aux images.
Deleuze tente donc d’opérer un recadrage de Bergson par lui-même, pour montrer la spécificité éminemment cinématographique de certaines de ses thèses les plus importantes : « Il y a d’une part une critique contre toutes les tentatives de reconstituer le mouvement avec l’espace parcouru, c’est-à-dire en additionnant coupes immobiles instantanées et temps abstrait. Il y a d’autre part la critique du cinéma, dénoncé comme une de ces tentatives illusoires, comme la tentative qui fait culminer l’illusion. Mais il y a aussi la thèse de Matière et mémoire, les coupes mobiles, les plans temporels, et qui pressentait de manière prophétique l’avenir ou l’essence du cinéma[4]. » C’est donc en conquérant philosophiquement sa propre essence que le cinéma pourra retrouver les belles promesses que lui réservait inconsciemment Bergson dans Matière et mémoire. Plus encore, « même à travers sa critique du cinéma, Bergson serait de plain-pied avec lui, et beaucoup plus encore qu’il ne le croit[5]. » Dans le monde réel, où il nous manque l’instrument pour en prendre conscience, comme dans l’univers cinématographique, les choses sont des images en soi. Une fois que l’on a fait le saut du paradigme mécanique à celui de la perception, le flux cinématographique de la perception – que Deleuze en bon spinoziste ne tarde pas à qualifier de plan d’immanence – nous permet de concevoir la matière comme « perpétuel écoulement[6] », pour reprendre le vocabulaire bergsonien du quatrième chapitre de L’Évolution créatrice. À la page suivante, on lit d’ailleurs ceci, qui nous permettra peut-être de boucler, momentanément du moins, la boucle qui entoure la philosophie, le cinéma et la science :
c’est toujours provisoirement, et pour satisfaire notre imagination, que nous attachons le mouvement à un mobile. Le mobile fuit sans cesse sous le regard de la science ; celle-ci n’a jamais affaire qu’à de la mobilité. En la plus petite fraction perceptible de seconde, dans la perception quasi instantanée d’une qualité sensible, ce peuvent être des trillions d’oscillations qui se répètent : la permanence d’une qualité sensible consiste en cette répétition de mouvements, comme de palpitations successives est faite la persistance de la vie[7].
Le but de la science, même si celui-ci s’est altéré en chemin, était pour ainsi dire de radiographier le changement pur, sans passer par chacune des qualités qui constituent un changement précis. Or, comment ne pas voir que ce « regard de la science », duquel Bergson dira quelques pages plus loin qu’il n’est encore qu’une utopie, est précisément un regard cinématographique. L’acte de spectature des différents flux cinématographiques, remplissant l’intervalle entre les instants quelconques qui défilent sur la bande pelliculaire, devient ainsi la médiation qui donne, de manière paradoxale il est vrai, accès à l’immédiateté de l’expérience et au changement dans toute sa pureté. La philosophie de la vie telle que tente de l’ériger Bergson, au même titre que les intuitions de la science, doit passer par des médiations, dont la plus puissante est sans doute la médiation cinématographique. Dans le vécu, l’immédiateté de l’expérience est la plupart du temps une utopie, alors qu’avec le cinéma elle semble nous être offerte par principe. La projection du monde rendue possible par le cinéma, indépendamment de ce qui est représenté sur l’écran, correspond à ces « coupes transversales[8] » du devenir dont parle Bergson. « C’est qu’il y a plus dans la transition que la série des états, c’est-à-dire des coupes possibles, plus dans le mouvement que la série des positions, c’est-à-dire des arrêts possibles. Seulement, la première manière de voir est conforme aux procédés de l’esprit humain ; la seconde exige au contraire qu’on remonte la pente des habitudes intellectuelles[9]. » Le cinéma, une fois passé du côté du paradigme de la perception, c’est-à-dire de l’effort intellectuel, offre à tout spectateur ce quelque chose de plus, différent pour chacun de nous, mais faisant malgré tout partie du même devenir.
Conclusion : une écriture cinématographique ?
Les flux cinématographiques sur lesquels vogue notre perception rendent donc possible la philosophie de la vie, cette philosophie immanente qui épouse les courbes du réel. Le regard de la science ne doit pas non plus être un regard impersonnel, qui se donne le temps comme variable indépendante, mais un regard médiatisé. Dans l’expérience cinématographique de la durée en tant que devenir vrai, le spectateur se projette et s’actualise non pas dans l’écran mais dans le mouvement même des images, alors que le monde et la souplesse de la vie se trouvent virtualisés par la pluralité des flux cinématographiques. Là où le cinématographe ne dépasse pas la plate mécanique de l’enregistrement pelliculaire des images qui reproduit les mauvaises tendances de notre connaissance, le cinéma remonte la pente ontologique et offre une exemplification de l’acte même de percevoir en ce qu’il a de plus créateur. L’acte de spectature permet de se « déterritorialiser », de se projeter loin des réflexes de la perception et ainsi de rejouer autrement les rapports de forces qui constituent le réel. L’expérience cinématographique, nous donnant l’immédiateté du réel à coup de flux et de médiations, peut ainsi être comparée à un laboratoire, en ce sens qu’elle n’est faite que de décalages et de transferts.
« De la pensée bergsonienne on peut répéter, en un sens, ce qui a été dit du spinozisme : qu’il n’est pas pour elle de méthode substantiellement et consciemment distincte de la méditation sur les choses, que la méthode est bien plutôt immanente à cette médiation, dont elle dessine, en quelque sorte, l’allure générale[10]. » Pour conclure, nous proposons de prendre au mot cet argument de Jankélévitch, et de le penser conjointement avec ce que William James dit de L’Évolution créatrice (voir notre exergue). Cela nous amène à poser cette question, à laquelle nous n’entendons pas répondre sinon que très sommairement : l’écriture de Bergson est-elle cinématographique ? C’est du moins ce que semble dire James, dont il n’est pas inutile de rappeler les paroles : le philosophe vante l’écriture de son collègue français, en insistant sur « l’écho, le prolongement d’une euphonie durable ; le bruissement d’un fleuve immense, sans remous, ni écumes, ni bancs de sable, mais qui continuait, en coulant à pleins bords, son cours tranquille et intarissable. Et puis cette justesse parfaite de vos images, qui n’accrochent jamais, ne font pas saillie à angles droits dans le discours comme des tableaux, mais invariablement clarifient la pensée et l’aident à s’épancher ! » (l’auteur souligne). Or, de quoi s’agit-il ici ? Ce « bruissement » harmonique et monotone est-il celui du déroulement de la bande cinématographique ou bien plutôt celui du « perpétuel écoulement » du devenir dont parle lui-même Bergson ? Se pourrait-il que, par une curieuse déformation professionnelle, Bergson ait tant écrit sur le cinématographe que sa prose philosophique en ait, involontairement il va sans dire, reproduit certaines caractéristiques ? Voulant faire la lumière sur la face cachée de la réalité, celle où se joue le devenir et où la durée afflue, le philosophe fait-il autre chose que cinématographier le réel ? Par l’enchaînement d’images qui sont comme des purs actes de durée, le philosophe vise à plonger son lecteur dans une expérience totale où coexistent une multiplicité de flux à la fois hétérogènes mais analogues. Par son usage particulier des métaphores et des fictions, il n’est pas impossible[11] de considérer l’écriture de Bergson comme un plan d’immanence discursif, c’est-à-dire une coupe mobile et transversale de la durée dans laquelle se joue une expérience spectatorielle, une certaine science des images temporalisées et temporalisantes. Bergson ne dit pas si la science moderne répondra un jour à ses promesses philosophiques implicites, pas plus qu’on ne peut prévoir l’arrivée d’un cinéma essentiellement bergsonien, à moins qu’il n’existe déjà. À l’instar du « tout » et de la durée, la question reste ouverte.
Bibliographie
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, trad. Daria Olivier, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1978.
Daniel Banda et José Moure, Le cinéma : naissance d’un art. 1895-1920, Paris, Flammarion, coll. « Champs : Arts », 2008.
Henri Bergson, L’Évolution créatrice (1907), édition d’Arnaud François, sous la direction de Frédéric Worms, Paris, Puf, coll. « Quadrige : Grands Textes », 2009.
Nicolas Cornibert, Image et matière. Étude sur la notion d’image dans Matière et mémoire de Bergson, Paris, Hermann, coll. « Philosophie », 2012.
Didier Coureau, Flux cinématographiques. Cinématographie des flux, Paris, L’Harmattan, coll. « Esthétiques/Ars », 2010.
Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1983.
Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’image-temps, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1985.
Luc Fraisse, L’éclectisme philosophique de Marcel Proust, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Lettres françaises », 2013.
Arnaud François (dir.), L’Évolution créatrice de Bergson, Paris, Vrin, coll. « Études et Commentaires », 2010.
Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, Puf, coll. « Quadrige : Grands Textes », 2008 [1959].
Marcel Proust, Le temps retrouvé (1927), À la recherche du temps perdu (1913-1927), t. iv, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1989.
Maxime Rovere, Spinoza. Méthodes pour exister, Paris, CNRS, coll. « Biblis », 2013.
Frédéric Worms (éd.), Annales bergsoniennes III. Bergson et la science, Paris, Puf, coll. « Épiméthée », 2007.
Frédéric Worms et Jean-Jacques Wunenburger (éds.), Bachelard et Bergson. Continuité et discontinuité, Paris, Puf, 2008.
Clélia Zernik, L’œil et l’objectif. La psychologie de la perception à l’épreuve du style cinématographique, Paris, Vrin, coll. « Essais d’art et de philosophie », 2012.
[1] Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris, Minuit, coll. « Critique », 1983, p. 37-38.
[2] Que cela soit dit en passant : on peut vanter la dimension quasi prophétique des intuitions bergsoniennes quant au « cinématographe intérieur », comme si tout être humain était une caméra ambulante, puisque celles-ci sont plus actuelles que jamais, alors que tout le monde aujourd’hui a dans sa poche les moyens techniques de faire son propre cinéma. Le téléphone portable et les « pocket films » sont en quelque sorte la traduction contemporaine de ce que Bergson nomme la méthode cinématographique, du moins en principe (car, d’un point de vue strictement technique, comme nous tentons de le démontrer, il n’y a aucun rapport entre l’enregistrement analogique des images et son équivalent numérique).
[3] Voir Didier Coureau, Flux cinématographiques. Cinématographies des flux, Paris, L’Harmattan, coll. « Esthétiques/Arts », 2010.
[4] Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouvement, op. cit., p. 12.
[5] Ibid., p. 85.
[6] EC, p. 299.
[7] EC, p. 300.
[8] EC, p. 313.
[9] Id., l’auteur souligne.
[10] Vladimir Jankélévitch, Henri Bergson, Paris, Puf, coll. « Quadrige : Grands Textes », 2008 [1959], p. 5.
[11] Et on l’a fait : voir le très beau livre de Nicolas Cornibert, Image et matière. Étude sur la notion d’image dans Matière et mémoire de Bergson, Paris, Hermann, coll. « Philosophie », 2012.