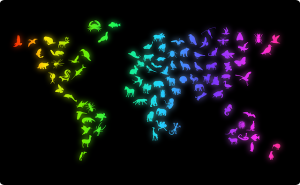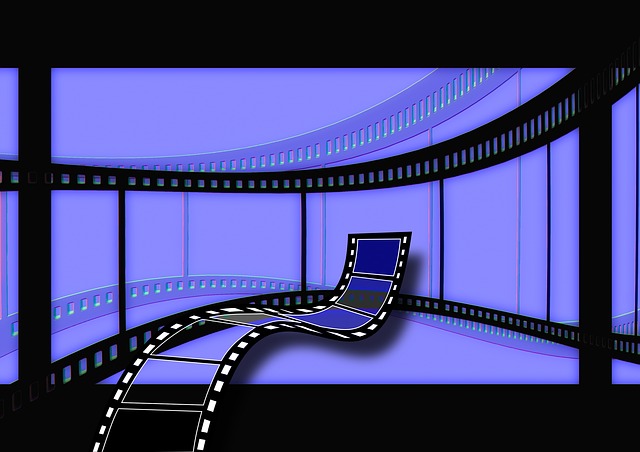L’étude du comportement animal à la lumière du concept de sympathie chez Bergson (II)
Mathieu Frerejouan, Agrégé de philosophie, professeur en lycée
La réhabilitation de la subjectivité animale par Von Uexküll
Si l’on se tourne vers les textes de Bergson il apparaît qu’il considère qu’une connaissance qui dépasse une réduction du vivant au mécanisme, et qui se tourne vers la subjectivité de l’animal, outrepasse les limites de la science en tant que telle. Il instaure ainsi un partage entre connaissance scientifique et connaissance philosophique qui semble faire écho aux insuffisances des pratiques scientifiques observées jusqu’ici. Cette séparation apparaît de manière claire dans L’Évolution créatrice :
Une théorie scientifique ne peut faire appel à des considérations de ce genre. Elle ne doit pas mettre l’action avant l’organisation, la sympathie avant la perception et la connaissance. Mais, encore une fois, ou la philosophie n’a rien à voir ici, ou son rôle commence là où celui de la science finit[1].
Dans cet extrait Bergson distingue la sympathie et l’observation scientifique. Tandis que la première a pour objet l’action, c’est-à-dire le comportement de l’animal dans sa totalité et son unité, la théorie scientifique se réfère à l’organisation, c’est-à-dire au comportement décomposé en mécanismes mesurables et prévisibles. De même, la sympathie comme coïncidence de l’observateur et de l’observé se distingue de la perception qui se limite à connaître la face visible et extérieure du comportement. Toutefois, il ne s’agit pas, pour Bergson, d’un désaveu de la science mais bien d’une répartition des tâches puisque « le rôle » de la philosophie « commence là où celui de la science finit ». En effet, la sympathie ne peut se substituer à l’analyse des éléments physico-chimiques qui sont à l’œuvre dans le comportement de l’animal, et inversement une conception physiologique de l’animal ne peut s’embarrasser des questions concernant le psychisme de ce dernier. Plus encore, cette séparation entre le champ de la philosophie et celui de la science ne peut aboutir à une opposition, puisqu’elles partagent le même objet. C’est ce que rappelle Bergson dans son Introduction à la métaphysique lorsqu’il affirme que dans la mesure où la science ne se distingue de la philosophie que par la traduction de ses intuitions en concepts extérieurs à l’objet, « la science et la métaphysique se rejoignent donc dans l’intuition[2]. »
Cependant, cette idée d’une intuition commune à la philosophie et à la science, qui serait exprimée et abordée différemment par chacune d’entre elles, n’est pas compatible avec l’opposition qui existe entre l’épistémologie béhavioriste et le concept de sympathie. Pour celle-ci la sympathie n’est pas un autre point de vue sur l’animal, mais une illusion purement humaine. Mais, si ce pont entre philosophie et science semble impossible à envisager du point de vue d’un béhavioriste, il reste concevable si l’on se tourne vers une autre tradition épistémologique. En effet, au début du XXe une autre conception du comportement animal et de son étude se développe, même si elle aura une postérité plus morcelée et discontinue que celle de la psychologie béhavioriste. Cette conception est proposée par le naturaliste Jakob Von Uexküll. Dans l’introduction à son ouvrage Milieu animal et milieu humain, Von Uexküll propose deux conceptions opposées de l’instinct animal : celle du « physiologiste », dans laquelle on reconnaît l’épistémologie béhavioriste, et celle du « biologiste », qui représente la position de l’auteur lui-même. Pour le physiologiste l’animal est une machine qui réagit mécaniquement à un stimulus. Dans cette machine, observe Von Uexküll, il n’y a pas de « machiniste » c’est-à-dire de sujet percevant le stimulus et y répondant, de sorte que ce dernier ne se distingue en rien d’un phénomène physique. Au contraire, pour le biologiste « chaque être vivant est un sujet qui vit dans un monde qui lui est propre et dont il forme le centre[3]. » Comme le montre cette citation, l’introduction de la notion de sujet est indissociable de celle de « monde », de sorte que l’animal est un sujet dans la mesure où il possède un monde. En effet, si l’animal est un sujet pour Von Uexküll c’est parce que ce qui se donne à lui comme un « signal » (ce que le physiologiste nomme stimulus) est aussi perçu par lui comme un « signe ». Le signal, tout d’abord, désigne l’effet produit par un objet sur l’organe récepteur, tandis que le signe est l’attribution de ce qui est perçu à l’objet. Ce passage d’un effet senti par l’organisme à une propriété attribuée à l’objet se fait par une unification des signaux en un signe unique. Pour expliciter ce processus, Von Uexküll se réfère à notre propre expérience (rompant ainsi d’emblée avec l’interdit de toute référence à l’état mental) de la perception du ciel comme bleu. La couleur bleue, c’est-à-dire le signal, n’est pas une simple excitation sensorielle mais bien une qualité de l’objet perçu, c’est-à-dire un signe. Or, selon Von Uexküll, il en va de même pour l’animal :
Les signaux perceptifs d’un groupe de cellules perceptives se réunissent en dehors de l’organe perceptif, en dehors du corps animal, en des unités qui deviennent les propriétés d’objets situés en dehors du sujet animal[4].
Ce qui distingue de manière fondamentale le signe du signal, c’est l’extériorité sur laquelle insiste l’auteur. Ce dernier se trouve bien « en dehors du corps animal », formant un milieu qui n’est pas simplement l’excitation de l’organisme mais bien un monde perçu par l’animal en tant que sujet. Par suite, ces transformations des signaux en signe chez l’animal impliquent alors que le comportement de ce dernier ne peut se comprendre uniquement à partir de l’action des signaux sur ses organes récepteurs. A partir de ces signaux l’animal constitue un monde qui lui est propre, auquel Von Uexküll donne le nom de milieu (Umwelt). Tandis que tout objet inerte possède un environnement, seul l’animal possède un milieu car d’une part il ne perçoit de son environnement que ce qui peut constituer un signal pour ses organes, et d’autre part l’animal ne reçoit pas passivement les informations de son environnement mais les constitue en un milieu perçu en tant que tel.
La conséquence de cette nouvelle conception du comportement animal va être une rupture épistémologique semblable à celle initiée par Bergson dans sa réflexion sur l’instinct. Dans la mesure où l’animal est un sujet, la question de la subjectivité animale non seulement ne doit plus être exclue du champ de la science, mais elle constitue un objet d’étude à part entière, indispensable à une compréhension du comportement de l’animal. De cet intérêt pour l’animal en tant que sujet va découler une réelle proximité entre la pensée du naturaliste et celle de Bergson, qui se retrouvent en premier lieu dans l’idée que le principal obstacle à la connaissance de l’animal ne réside pas dans l’anthropomorphisme, mais dans l’anthropocentrisme. En effet, à partir du moment où Von Uexküll réfléchit sur la relation qu’entretient chaque espèce avec son environnement il devient évident que ce que nous observons comme étant l’environnement de l’animal n’est rien d’autre que le milieu humain. Ainsi, lorsque dans le premier chapitre de Milieu animal et milieu humain l’auteur étudie le milieu spatial propre aux animaux, il observe que :
Nous nous berçons trop facilement de l’illusion que les relations que le sujet d’un autre milieu entretient avec les choses de son milieu se déroulent seulement dans le même espace et le même temps que les relations qui nous lient aux choses de notre milieu d’humains. Cette illusion est nourrie par la croyance en l’existence d’un monde unique dans lequel sont imbriqués tous les êtres vivants[5].
L’illusion la plus profonde que peut se faire l’homme sur le comportement animal ne consiste pas tant à attribuer à ce dernier des états mentaux qui nous seraient propres, que de s’imaginer qu’une description du comportement animal ne prenant pas en compte sa perspective propre serait une description neutre et objective. Décrire les relations de l’animal à son environnement uniquement à partir de ce que nous percevons n’aboutit pas à une observation neutre, mais à une observation anthropocentrée. Ainsi, on retrouve chez Von Uexküll l’idée qu’une connaissance véritable du comportement animal commence par la nécessité de décentrer notre point de vue, de passer d’une perception proprement humaine à une perception respectueuse des particularités du sujet animal. Il est donc possible de trouver un point de rencontre entre le concept de sympathie de Bergson et la pratique scientifique de Von Uexküll, qui dépasse ainsi les frontières tracées par le philosophe.
La sympathie comme voie d’accès au milieu animal
Toutefois, on ne peut s’arrêter au constat qu’il existe des similitudes entre les pensées de Von Uexküll et Bergson. Chacun des auteurs ayant été sensible aux limites d’une épistémologie qui réduit le vivant à un mécanisme, il est naturel que leurs pensées se rencontrent sur certains points. En revanche ce sont davantage leurs différences, où ce que chacun d’eux a laissé dans l’ombre, qui peuvent nous permettre de mettre en avant la complémentarité de leurs pensées et qui confère à leur rapprochement un réel intérêt.
De fait, si Bergson présente bien une nouvelle méthode pour connaître l’instinct animal, il ne se donne pas pour but d’aboutir à une connaissance précise de ce dernier, puisque la connaissance de l’animal n’est pas au coeur du projet de L’Évolution créatrice. En effet, après avoir présenté la sympathie comme une méthode distincte de l’analyse, Bergson insiste sur le fait que celle-ci doit nous permettre de connaître « l’intérieur de la vie[6] ». L’objet de ce dernier n’est pas tant l’animal dans sa particularité, que la vie ou l’élan vital qui est à l’origine de la diversité du vivant. Si Bergson se penche par moments sur des organismes précis, ceux-ci ne constituent que des étapes permettant de reconstruire le mouvement global dont ils font partie. C’est sur ce point que la complémentarité des deux auteurs apparaît de manière visible, dans la mesure où si Bergson se tourne davantage vers la vie en général que le vivant, Von Uexküll en revanche se donne pour seul objet l’animal dans sa particularité.
En effet, à la différence Bergson, le dépassement d’une physiologie mécaniste et réductrice du comportement animal ne se fait pas, pour Von Uexküll, en dehors de la science et dans le champ de la métaphysique. Il s’opère par une redéfinition des frontières et des méthodes de l’étude du comportement animal. Ainsi, il s’agit d’abord pour ce dernier d’établir les différentes caractéristiques d’un milieu en fonction de l’espèce qui le constitue. En effet, chaque espèce étant dotée d’organes sensoriels qui lui sont propres, elle constitue un milieu qui lui est propre, et qui constitue en tant que tel un objet de connaissance. Par ailleurs, Von Uexküll s’attache aussi à comparer la manière dont différentes espèces perçoivent une caractéristique commune de leurs milieux. Il s’agit alors de mettre en évidence comment se constitue la perception de l’espace, du temps, du territoire, des congénères, etc. L’essentiel de ce projet est que la subjectivité animale devient un objet d’étude à part entière, c’est-à-dire qui reste sa propre fin.
Mais si la pensée de Von Uexküll peut apporter un cadre au concept de sympathie chez Bergson, qu’est-ce que la philosophie de ce dernier peut à son tour apporter ? Dominique Lestel dans sa préface à Milieu animal et milieu humain observe que Von Uexküll « a peu discuté (…) la façon dont l’homme pourrait vraiment rendre compte des Umwelten des non-humains[7]. » Et, de fait, Von Uexküll insiste particulièrement sur les signaux extérieurs qui doivent permettre la constitution du milieu animal, mais pas sur la question de la constitution du signe qui suppose effectivement de se mettre à la place de l’animal. C’est sur ce point que l’analyse de Bergson peut venir compléter celle de Von Uexküll. Tout l’intérêt du concept de sympathie dans la philosophie de Bergson réside justement dans le fait que ce dernier ne se contente pas d’indiquer la nécessité de faire coïncider notre perception avec celle de l’animal, mais s’interroge sur les conditions de possibilité de cette dernière. Lorsque l’auteur traite ainsi la question de savoir comment nous pouvons sympathiser avec l’instinct animal, il l’aborde par un détour par le thème de l’art :
Qu’un effort de ce genre n’est pas impossible, c’est ce que démontre déjà l’existence, chez l’homme, d’une faculté esthétique à côté de la perception normale (…) C’est cette intention que l’artiste vise à ressaisir en se replaçant à l’intérieur de l’objet par une espèce de sympathie, en abaissant, par un effort d’intuition, la barrière que l’espace interpose entre lui et le modèle[8].
On peut proposer deux interprétations différentes de cet extrait. Une première interprétation possible consisterait à comprendre l’auteur de manière littérale, de sorte que l’art apparaît comme le seul moyen d’accéder au milieu animal. Cette ouverture de la psychologie animale à l’art a été notamment interrogée par Dominique Lestel, dans la préface de Milieu animal et milieu humain, où il met en valeur la capacité que possèdent les artistes à « s’animaliser pour pénétrer dans le monde étrange et merveilleux des Umwelten non humains[9]. » Il prend pour exemple l’artiste Eduardo Kac, principal représentant du bio-art, et son œuvre de 1999, Darker than night. Il s’agit de la mise en place d’un dispositif devant permettre l’immersion du spectateur dans le milieu subjectif d’une chauve-souris. En effet, l’animal est connu pour percevoir son environnement par écholocalisation, c’est-à-dire en détectant les réfractions de ses propres cris sur le monde environnant, que son cerveau relie ensuite à la distance, la forme, le mouvement et la texture de ce dernier. De ce fait, le milieu propre à la chauve-souris semble inaccessible à l’homme, et donc à toute forme de sympathie[10]. Afin de rendre accessible cette perception à l’homme, Eduardo Kac fait porter au spectateur un casque qui transforme les ondes sonores produites par l’animal en sons et images perceptibles par nous. Tout le travail de l’artiste est ainsi de mettre en œuvre un dispositif qui doit permettre à l’homme de quitter son point de vue sur son environnement, et d’adopter celui d’une autre espèce animale.
De fait, cette conception n’est pas entièrement étrangère à Bergson, dans la mesure où ce dernier conçoit l’artiste comme celui qui est capable de percevoir le monde qui l’entoure à partir d’un point de vue différent de celui du reste des hommes. Ainsi, dans Le Rire, Bergson décrit le propre de l’artiste en ces termes :
De loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, systématique, qui est œuvre de réflexion et de philosophie. Je parle d’un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d’entendre ou de penser[11].
Pour Bergson l’artiste ne se définit pas tant par la production de l’œuvre à proprement parler, que par la manière dont il perçoit son environnement. En effet, à la différence du reste des hommes, il ne réduit pas ce qu’il perçoit à ce qui correspond à ses catégories intellectuelles et pratiques. Il est capable de percevoir les choses depuis un point de vue autre que celui proprement humain, que le philosophe présente comme une vision neuve et libérée du monde. Par suite, il n’y a rien de contradictoire dans le fait d’affirmer que l’artiste peut être aussi celui qui est capable de quitter le point de vue de son espèce pour celui d’une autre, et par ce biais (pour reprendre l’expression de Lestel) d’animaliser sa perception. Plus encore, la tâche de l’artiste étant de communiquer cette perception par une représentation – picturale ou acoustique – ce dernier peut aussi devenir celui qui donne à voir aux autres hommes un environnement tel que le perçoit l’animal lui-même. C’est pourquoi une science qui prétendrait connaître le milieu animal aurait à se tourner vers l’art, dont la fonction serait de décentrer notre perception afin de la faire coïncider avec d’autres manières de percevoir.
Cependant, cette référence à une perception esthétique ne doit pas nécessairement s’interpréter comme ouvrant le champ de la science à celui de l’art, ouverture qui, de fait, ne peut que séparer les traditions scientifiques au lieu de les réunir. D’une part, si Von Uexküll est bien l’héritier d’une certaine tradition romantique, cette interprétation nous semble retirer cependant à son projet ce qu’il possède de rigoureux et de concret. L’artiste ne possède ni les connaissances ni la pratique du naturaliste, et les reconstitutions immersives qu’il peut faire des milieux animaux conservent un but esthétique avant tout. D’autre part, la référence bergsonienne à l’art doit elle-même être nuancée. Il s’agit bien pour Bergson d’une comparaison, et non d’une volonté de confondre sur le même plan art, métaphysique et science. Pour reprendre la lettre même du texte, l’auteur insiste sur le fait que l’existence de l’art montre qu’un tel effort « n’est pas impossible », ce qui ne signifie pas que l’art constitue cet effort lui-même. Si l’art atteste de la possibilité pour le scientifique d’accéder à un autre point de vue que le sien, il ne saurait se substituer à la conversion du regard que ce dernier doit accomplir.
Une autre interprétation de la sympathie nous semble alors possible. Celle-ci désignerait la conversion du regard par laquelle celui qui étudie le comportement animal parvient à saisir non seulement ce qui lui apparaît depuis son point de vue, mais encore ce qui est constitutif du milieu animal qu’il observe. La nécessité de cette conversion a été mise en avant à plusieurs reprises dans le champ de la primatologie, où la question de la subjectivité animale est plus visible qu’ailleurs. On en trouve une analyse représentative dans le premier chapitre de Quand les espèces se rencontrent de Donna Haraway, qui étudie de près le témoignage de Barbara Smuts. Cette dernière avait pour projet de recueillir des informations concernant le comportement d’un groupe de babouins vivant dans une réserve au Kenya. Cependant, dès que la primatologue était suffisamment proche d’eux pour les observer, ces derniers s’enfuyaient systématiquement. Afin de résoudre cette difficulté, Barbara Smuts adopte d’abord la méthode classique des primatologues, qui consiste à attendre qu’un phénomène d’habituation se produise, en restant immobile à proximité de l’animal. En effet, on suppose que si l’observateur reste inactif, sa présence finira par ne plus être perçue par l’animal. Mais, justement, dans le cadre de son étude Barbara Smuts constate l’inefficacité d’une telle méthode. Cet échec est significatif puisqu’il met en évidence le présupposé épistémologique d’après lequel une observation juste est une observation neutre se faisant depuis un point de vue surplombant. Pour reprendre les termes de Donna Haraway on retrouve la conception des scientifiques comme ceux qui « apprenant à être invisibles à eux-mêmes, pourraient voir la scène de la nature de près, comme à travers un judas[12]. » On retrouve ici encore la même illusion anthropocentrique qui sous-tend le béhaviorisme, d’après laquelle un point qui n’est pas situé, ou du moins qui ne semble pas situé, serait un point de vue neutre et permettant d’accéder à une observation objective. Or, justement, ce n’est qu’à partir du moment où Barbara Smuts se libère de ce présupposé méthodologique que son observation progresse. Supposant que la fuite des babouins n’est pas tant provoquée par sa présence que par son indifférence simulée, elle décide de se comporter comme ces derniers pour pouvoir les approcher. Autrement dit, plutôt que de tenter de les approcher en restant à distance, elle parvient à le faire en se mettant à leur place :
Le processus permettant de gagner leur confiance, changea presque tout en moi, aussi bien la manière de marcher et de m’asseoir, la manière de me tenir, et la manière dont j’utilisais mes yeux et ma voix. J’apprenais une autre manière d’être au monde – la manière des babouins[13].
Dans cette description du processus qui doit permettre à Barbara Smuts d’observer les babouins, on peut retrouver une interprétation possible du concept de sympathie tel qu’il est pensé par Bergson. Rappelons-le la sympathie est l’acte par lequel nous abandonnons une analyse extérieure pour nous mettre à la place de l’être vivant étudié. Ce changement de perspective s’opère en abandonnant un point de vue humain et anthropocentré, et en accédant à une perception de l’environnement qui coïncide avec celle qu’a l’animal de son propre milieu. On retrouve bien cette idée dans le récit de la primatologue, puisqu’il s’agit pour elle de se défaire de ses présupposés épistémologiques et de quitter une observation extérieure des babouins pour intégrer leur existence et leur manière d’être. Or, tout l’intérêt de sa description est qu’elle met en évidence le fait qu’un tel acte de sympathie n’est pas l’effet d’une inspiration soudaine qui s’accomplirait nécessairement en dehors du champ scientifique. En effet, on notera d’abord qu’il s’agit pour Smuts d’un véritable « apprentissage ». C’est l’effet d’une longue accoutumance qui entraîne une transformation de sa posture physique (sa manière de se tenir, de marcher, de s’asseoir) et de sa perception de son environnement, lui permettant peu à peu de se mettre à la place de l’animal. Cet apprentissage lui-même ne peut être dissocié de la connaissance qu’elle possède de l’animal en tant que primatologue, puisqu’elle ne peut approcher des babouins sans les imiter et elle ne peut les imiter sans connaître au préalable leur manière d’être. Il y a ainsi une complémentarité du savoir positif de l’animal et de la sympathie qui permet sa connaissance. Cet exemple permet ainsi d’ouvrir la voie à une autre interprétation de la sympathie chez Bergson, à savoir comme processus amenant l’observateur à quitter son point de vue propre pour coïncider avec celui de l’animal observé, sans pour autant recourir à un cadre conceptuel qui soit étranger aux principes et aux projets d’une science du comportement animal.
Conclusion
En ce sens, l’analyse que propose Bergson du concept de sympathie permet de penser un aspect essentiel de l’étude du comportement animal. Il remet en question le dogme suivant lequel une observation ou une expérimentation n’est objective que si le sujet connaissant est en dehors de toute situation et surplombe son objet. En effet, ce dogme qui en séparant le sujet connaissant de son objet doit le prévenir de tout anthropomorphisme, aboutit en réalité à réduire le comportement animal à une perception proprement humaine. Au contraire, sympathiser avec l’objet ce n’est pas confondre le point de vue humain et le point de vue animal, mais permettre le passage de l’un à l’autre. Ce passage ne repose ni sur un lien métaphysique préexistant, ni sur une intuition immédiate, mais sur un processus d’immersion, aboutissant progressivement à une conversion du regard. Ainsi, l’analyse de Bergson ne se réduit ni à une substitution de la métaphysique à la science, ni à une réflexion épistémologique détachée de toute pratique effective, elle enrichit bien plutôt une tradition épistémologique déjà existante, qui va de Von Uexküll à la primatologie contemporaine.
[1] Ibid., p.175.
[2] Henri Bergson, « Introduction à la métaphysique » in La pensée et le mouvant, Paris, Puf, 2006, p.216.
[3] Jacob Von Uexküll, Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot&Rivages, 2010, p.33, 1956, traduit d l’allemand par Charles Martin-Freville.
[4] Ibid., p.37.
[5] Ibid., p.49.
[6] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Op.Cit, p.178.
[7] Dominique Lestel, Préface à Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot&Rivages, 2010, p.20, 1956.
[8] Henri Bergson, L’Évolution créatrice, Op.Cit, p.178.
[9] Dominique Lestel, Préface à Milieu animal et milieu humain, op. cit., p.20.
[10] Cet écart entre la manière dont la chauve-souris perçoit son environnement et la manière dont l’homme le perçoit constitue l’argument central de l’article de Thomas Nagel, What Is it Like to Be a Bat, qui tente de mettre en évidence, contre le physicalisme, l’impossibilité de connaître l’expérience subjective d’un autre que soi. L’oeuvre de Eduardo Kac est parfois interprétée comme une réfutation artistique et concrète du philosophe.
[11] Henri Bergson, Le Rire, Paris, Puf, 2007, p.118.
[12] Donna Haraway, When Species Meet, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008, p.24 (nous traduisons).
[13] Ibid., p.25.