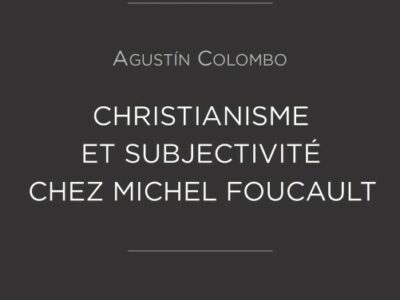Recension. Qu’est-ce qu’une couleur ?
Recension. Qu’est-ce qu’une couleur ? Christophe Al-Saleh
Paru aux éditions Vrin dans la collection Chemins Philosophiques en 2013
Alexandre Couture-Mingheras, Doctorant contractuel à l’Université de Paris 1-Sorbonne, EXeCO
Pourquoi reposer la question de la couleur ? Deux voies avaient été tracées, l’une d’édification d’une grammaire de la couleur qui rendait la perception tributaire du déploiement catégorial d’une langue donnée –ce qu’on ne peut dire, on ne peut le voir (la thèse Sapir-Whorf en fut dernièrement la représentante la plus polémique) ; l’autre, d’obédience phénoménologique et d’inspiration husserlienne, qui ménage à la couleur un champ phénoménal avec une légalité a priori de structuration de l’apparaître qui lui est propre et sur laquelle la science est sommée de garder le silence –le jaune s’indigne de ce qu’on cherche à le réduire à une onde lumineuse (Merleau-Ponty, Marc Richir, Claude Romano entre autres).
Si la couleur fait un retour triomphal sur la scène philosophique, c’est qu’elle pose le problème inlassablement reformulé du gouffre qui sépare la sphère du sujet d’un monde supposé extérieur et indépendant de la prise que nous pouvons avoir sur lui : le bleu se niche-t-il dans l’œil de l’artiste ou dans le ciel lui-même ? Il y va au fond du statut des dites « qualités secondes » et de leur droit à l’objectivité –dire qu’elles sont indépendantes ne revient pas à affirmer qu’elles eussent été telles indépendamment du sujet.
A cet égard, l’auteur aborde frontalement la question de l’assignation de la couleur (sujet/objet), de son lieu d’implantation, autrement dit de sa nature subjective et/ou objective, et se détourne de ces carrefours de réflexions au profit d’une analyse de ce qu’est, au fond, une couleur. Plane ce point d’interrogation noir, selon la formule de Nietzsche, qui nargue de sa position de survol notre prétention à être en contact avec le « réel », et dont l’élimination est appelée de nos vœux.
La première partie de l’ouvrage concerne l’étude proprement dite de la couleur, tandis que la seconde, que nous laisserons de côté, consiste en un commentaire de deux textes, l’un de John Campbell et l’autre de Daniel C. Dennet. Christophe Al-Saleh, dans la veine analytique qui caractérise la collection des Chemins Philosophiques, attaque le problème en trois temps : après avoir exposé la structure du problème philosophique, il présente la solution objectiviste, qui prend en compte l’externalité de la couleur, pour finir par exposer la solution subjectiviste, qui insiste sur son caractère interne, c’est-à-dire sur le lien indéfectible qui unit la couleur au vécu du sujet dans lequel elle entre en guise de sensation.
L’auteur annonce d’emblée qu’il soutiendra in fine la thèse selon laquelle la couleur résulte d’une projection, ce qui permet de tenir les deux bouts, celui de l’ancrage définitionnel de la couleur dans un sujet et celui de sa dimension mondaine. Il n’y a pas de sens à dresser de manière tranchée le subjectif contre l’objectif comme s’ils représentaient deux pôles exclusifs l’un de l’autre, alors même qu’il s’agit de concepts relationnels qui ne tirent leur sens que de leur opposition. Ce qui par la même occasion écarte la tension entre d’une part l’exigence de définition par l’expérience (le vécu), et d’autre part le recours à la science pour ériger la couleur en effet relatif à la structure spécifique de nos appareils sensoriels et cognitifs (l’objet).
La thèse projectiviste n’est dès lors pas véritablement « subjectiviste », en dépit des apparences : son inclusion dans la partie consacrée à la solution subjectiviste aurait de quoi étonner le lecteur si ce dernier ne prenait pas en compte la nature duale d’une projection dont la grammaire implicite requiert la relation entre un sujet et un objet, sans que l’un puisse à bon droit être rabattu sur l’autre. Le la est ainsi donné : la méthode sera mue par le désir d’exposer l’insuffisance des thèses subjectivistes et objectivistes et appellera le maintien d’un entre-deux relationnel, comme lieu d’assignation de la couleur.
Pour commencer, l’auteur s’attaque au premier problème qui se pose, celui de l’ambiguïté de la notion. La cohabitation belliqueuse de « deux images du monde », selon le mot de J. Bouveresse, repose sur le statut amphibie de la couleur : il s’agit d’une sensation qui apporte des informations sur le monde qui nous entoure et tout en même temps d’un vécu spécifique, autrement dit d’une propriété mondaine (nous parlons du rouge du tissu) d’une part, et d’une expérience subjective (le tissu n’est rouge que pour moi) d’autre part. Toute la difficulté consiste en cette position bancale et mitoyenne de la couleur –apatride phénoménale- que l’on souhaiterait circonscrire alors même que sans le monde et sans le vécu, qui en sont des parties intégrantes, elle nous glisserait entre les doigts.
L’auteur formule une dichotomie, comme nœud du problème, qui parcourra en filigrane tout l’ouvrage dans son analyse : il faut en effet distinguer les propriétés avec lesquelles le sujet est mis en relation du fait d’avoir une certaine expérience de couleur de celles avec lesquelles le sujet est mis en relation au moyen de son expérience de couleur.
Pourtant les deux acceptions de la couleur, sensationnelle et mondaine, rencontrent un double obstacle qui tient à ce qu’elle n’est ni sensation ni objet extérieur au sens où nous l’entendons habituellement –elle recèle une étrangeté intrinsèque. Premièrement, l’auteur dresse une analogie entre les objets des sens pour en révéler immédiatement après les faiblesses. Nous sommes tentés d’affirmer que les couleurs sont à la vue ce que les odeurs sont à l’odorat ou les sons à l’audition.
Or l’asymétrie entre la couleur et les autres objets sensoriels est flagrante dès lors que l’on prend en considération les trois points suivants : 1/ la couleur ne dépend pas d’une modification corporelle, du moins cette dernière n’est-elle nullement accessible dans l’expérience, contrairement à ce qui se produit avec le son ou le toucher 2/ la couleur ne figure pas un évènement qui dure ; sans pour autant se donner pour atemporelle, elle relève davantage du point que de l’extension temporelle, dont le son est l’exemple paradigmatique 3/ « enfin, et c’est là ce qui distingue les couleurs des sons, si les sons semblent occuper une position propre dans l’espace, c’est cependant en tant que modifications, que processus affectant d’autres entités plus stables (cas de la vibration d’une corde de guitare, par exemple). » (p.13) Ce triptyque observationnel frappe d’interdit la réduction totale de la couleur à la sensation –car s’il s’agit bien là d’une sensation, elle semble cependant indépendante de l’esprit et être libre du joug de l’interprétation.
Deuxièmement, la couleur s’avère irréductible à une propriété purement mondaine. Christophe Al-Saleh se fonde sur le principe suivant (p. 15) : « P est une propriété mondaine de x si et seulement si la possession de x de P explique que cela fasse une différence que x existe. » La couleur n’est pas objective au même titre que ce que nous considérons comme des « objets », dans la mesure où elle est exempte d’efficience causale. Que mon ordinateur soit rose ou vert aboutit, certes, à une différence psychologique, mais cela n’a aucune incidence dans le monde lui-même.
Le deuxième problème structurel tient à l’irréductible subjectivité de l’expérience de couleur. Christophe Al-Saleh s’appuie à cet égard sur la phénoménologie de la couleur, au sens large, c’est-à-dire non comme méthode historiquement constituée par Husserl mais comme description la plus serrée possible du contenu de l’expérience. Car la couleur ne saurait être totalement objectivable, réduite à une propriété d’objet à laquelle nous aurions accès via la perception, comme si l’objet était en soi de telle ou telle couleur –ce qui soulève le problème épineux de l’accord entre ce qui est et ce que nous percevons-, pour la simple et bonne raison qu’elle contient par essence une part inéliminable de subjectivité. Cela revient à dire que les couleurs sont des qualia.
Mais de quelle manière soutenir l’existence de ces dernières ? L’auteur reprend à cet effet un test, dit « test métaphysique du spectre inversé » (p. 20), inspiré de Locke et de S. Shoemaker. La description de la couleur comporte deux volets : il est tout aussi possible de regrouper sous la même extension, ou dans le même ensemble, les choses rouges (approche extensionnelle) que de distinguer l’application d’un prédicat donné de l’application d’un autre prédicat, le rouge du bleu par exemple (approche intensionnelle). Or que faire si deux individus s’accordent sur l’extension du prédicat rouge, reconnaissent qu’un objet possède une couleur définie, et que tout en même temps aucun ne perçoit la même chose, c’est-à-dire que chacun possède sa propre intension, un vécu idiosyncrasique et solipsiste de l’objet ? L’accord dans le langage masquera le désaccord profond –dissimulé- dans la perception elle-même : ce que tous deux appellent « vert » se dupliquera en deux qualités différentes. L’insuffisance de l’approche extensionnelle et, partant, de l’objectivation totale de la couleur, ne saurait être esquivée, dès lors que l’on pose ici deux perceptions divergentes sans système de normes pour juger que l’une est «fausse » ou « véridique » : le test mis en place ne traite pas du daltonisme –dont la reconnaissance suppose l’intervention d’une tierce instance et d’un jugement reposant sur ce qui est considéré comme relevant de la normalité- ou d’un quelconque déficit chromatique. En somme l’évaluation de l’importance épistémique des qualia est subsidiaire par rapport à l’importance du vécu, qui entre dans la définition de la couleur.
Enfin le dernier problème regarde ce qui est ici appelé « l’indétermination du corrélat informationnel » (p. 24). Une information sur le monde appelle un double réquisit, qu’il y ait effectivement un objet auquel accéder, et que celui-ci soit porteur d’une propriété objective. Lorsque je touche de la soie, je distingue la structure matérielle qui correspond à la description, « c’est de la soie », du vécu lui-même dans sa spécificité. Or la couleur fait ici une pirouette à la logique susmentionnée puisque seul le réalisme naïf, préthéorique, peut croire que s’opère en la matière un recouvrement parfait de la propriété externe (le trait objectif) et de la propriété interne (le phénoménal) : la sensation de couleur n’est pas épistémiquement déterminée. « En voyant le rouge de la surface de la tomate, je ne sens pas que c’est une surface de tomate. Tout au plus, on peut dire que je sens que c’est rouge. » (p 26). Autrement dit l’information est ici circulaire et se traduit par une tautologie : lorsque je perçois du rouge, je perçois du rouge. Cette indétermination est la contrepartie d’une efficacité des couleurs dans nos vies.
Au fond ces trois difficultés structurelles font signe vers le problème essentiel de la relation entre ce qui est vécu et ce qui est dans le monde, entre le sujet et l’objet, avec pour enjeu majeur l’accord, que les solutions qui seront examinées tenteront de comprendre et, surtout, de sauver, entre la propriété interne et la propriété externe. Le partage du subjectivisme et de l’objectivisme recoupe celui du primat octroyé à l’intension (le qualitatif) dans un cas de celui offert à l’extension (l’objectif) dans l’autre.
L’objectivisme, étiquette grossière s’il en est, mais qui possède en l’occurrence une fonction utilitaire de classification, soutient que nos énoncés chromatiques tirent leur sens de l’existence préalable de couleurs dans le monde : l’extension sert de pivot pour la définition de la couleur. Christophe Al-Saleh étudie successivement et brièvement trois sous-classes objectivistes qu’il met rapidement face à leurs défauts internes et aux questions qu’elles laissent en suspens, voire qu’elles nourrissent.
Le physicalisme tout d’abord : la couleur équivaut à une longueur d’onde déterminée par la réflectance d’une surface, c’est-à-dire par sa capacité variable à absorber une partie du spectre lumineux. Or il achoppe sur une triple difficulté : 1/ l’externalisation de la couleur et le rôle accordé au support physique tablent sur l’hypothèse de continuité de la première et sur la stabilité du second. La thèse, contre-intuitive, mène à des absurdités du point de vue de la richesse phénoménale ; en effet deux surfaces peuvent avoir la même réflectance et non la même couleur, et posséder la même couleur mais non la même réflectance. 2/ Le physicalisme achoppe sur la pierre de la norme puisqu’elle recourt à des conditions dites « normales » d’observation dont le caractère arbitraire saute aux yeux : cela a-t-il, en dernière instance, un sens de faire fond sur des conditions dont la normalité relève davantage de l’idéalité et du terme artificiel auquel aboutit une série d’expériences menées dans un monde-laboratoire aseptisé (quid des lunettes ou télescopes) que d’une donnée ? La naturalisation de la norme intègre le cercle de l’auto-réfutation sitôt que l’on relie la normalité à un double axe, celui de la relation entre l’organisme et l’environnement (étrangement appelé « écologie » par l’auteur) et celui des buts et désirs individuels et collectifs (la « téléologie »). 3/ L’idée d’homogénéité et de stabilité de la propriété externe.
La faveur ira-t-elle alors au dispositionnalisme, qui assouplit les règles du jeu objectiviste ? Certes la couleur ne figure plus un atome, un punctum concretum de part en part déterminé et partagé par différents objets, une propriété occurrente, mais un apparaître dont le déploiement repose quant à lui sur des conditions non plus normales (absolues) mais conditionnelles (relatives), sous la forme d’un si…alors. Or le souci d’irénisme d’une telle thèse s’avère responsable de son échec : à éviter le divorce entre subjectivité et objectivité elle débouche sur une position instable –d’équilibriste- qui ne satisfait ni à la solution objectiviste, ni à la solution subjectiviste. Le premier défaut dont elle est grevée relève de l’ordre logique ; il a été vu que la défense de l’externalité de la couleur était couplée à son extension ; dès lors que ce nerf se relâche, celui de la description selon l’extension, l’objectivisme se trouve miné de l’intérieur. Aussi la substitution de l’extension du « sembler-rouge » à l’extension du terme de couleur « rouge » souffre-t-elle d’une confusion de grammaire, mêlant le registre de l’objet au registre de la phénoménalité. L’extensionalité se saurait souffrir de relativisation. Le deuxième défaut quant à lui relève de la plausibilité phénoménologique ; en effet on ne voit pas l’objet puis la couleur, mais le tout, au même moment ; il n’est nul besoin d’attendre que l’ensemble des conditions/dispositions soient réunies pour que la perception chromatique puisse se produire.
Parmi les théories objectivistes, le primitivisme, dont le texte représentatif de John Campbell sera commenté dans la seconde partie de l’ouvrage, parait davantage recevoir les faveurs de l’auteur. Contrairement au physicalisme et au dispositionnalisme, pour qui il est « important que les sujets n’apparaissent pas dans la détermination de la couleur comme propriété mondaine » (p. 45), la présente solution change de cadre conceptuel en soumettant à la révision la notion d’objectivité et en assouplissant le principe de non-indifférence ainsi formulé (p. 45) « P est une propriété mondaine de x si et seulement si la possession par x de P explique que cela fasse une différence que x existe. » D’une part ce n’est pas parce qu’une propriété dépend de l’esprit qu’elle est nécessairement subjective (les qualia peuvent être objectives quoique dépendantes de celui qui en est le détenteur perceptif) ; ainsi si on prend deux points A et B dans l’espace, dire qu’ils n’occupent pas la même place suppose que l’on parle à partir d’un point de vue, cela n’a de sens que pour un percevant dans l’espace ; pour autant le perspectivisme –l’intervention du sujet- ne récuse pas le fait que A et B occupent bel et bien des lieux différents. D’autre part l’objectivité révisée n’est plus définie à l’aune de la théorie physique et des entités admises. « Les couleurs sont donc dans le monde exactement comme nous les rencontrons, et il est pertinent de dire que nous les rencontrons. Elles sont, en ce sens, primitives, d’où l’appellation de primitivisme donnée à cette forme de théorie objective des couleurs. » (p. 49)
Néanmoins le manque de justifications, eu égard à nos croyances et aux conceptions scientifiques, exige que le primitivisme soit lui-même dépassé. Les trois thèses objectivistes présentaient, de façon sous-jacente, une gradation du plus objectif au moins objectif (ou objectif « mou »), avec l’importance croissante du rôle joué par le sujet. Christophe Al-Saleh s’attaque désormais à la solution subjectiviste, qui déboute la couleur de la propriété externe. Il faudra garder à l’esprit qu’il est malaisé de nier le volet objectif de la couleur –cf. sa nature duale- et de faire fi du fait que les couleurs semblent être dans le monde, de manière stable et durable. Nous avons ici affaire à un subjectivisme éliminativiste –ô ironie, après la classique élision du sujet et de son vécu- au sens où les couleurs ne sont plus dans le monde objectif : le primat est enfin accordé à l’intensionnel, à la couleur dans sa dimension qualitativement déterminée.
Tout le monde, à ses heures perdues, s’est amusé à exercer une pression sur les paupières fermées à l’aide de ses doigts. Que se passe-t-il ? Une explosion fantasque de couleurs sans objet extérieur auquel les rattacher. Le ton est donné : « la théorie de l’hallucination » (p. 54) affirme que la couleur est une production subjective sans contrepartie externe. « Toutes les couleurs que nous percevons ne seraient que des effets subjectifs de la stimulation des organes sensoriels par l’environnement. » (p 55). Elle repose d’une part sur la théorie mécanique de la perception, les informations étant transmises mécaniquement par l’environnement et les qualia n’en étant que la traduction isolée et subjective, et d’autre part sur la dichotomie entre les qualités premières (propriétés externes) et les qualités secondes (internes). C’est dire que lorsque je perçois une couleur, je ne perçois rien véritablement, je vois quelque chose qui n’existe pas. La solution hallucinatoire s’ancre dans le principe d’indistinction subjective : « Du point de vue du sujet, il n’y a aucune différence entre halluciner x et voir x » (p 56), principe qui parait difficilement soutenable. En effet non seulement cette solution s’appuie sur des expériences idiosyncrasiques dont elle gonfle l’importance (elle prend pour modèle ce qui est marginal dans notre expérience quotidienne), autrement dit elle explique la perception « normale » de couleurs par la perception hallucinée, mais de plus elle reste aveugle au fait que nous disposons bel et bien de critères pour distinguer, même si cela se fait rétrospectivement (comme en s’éveillant d’un rêve), l’expérience hallucinatoire de l’expérience véridique.
Pour la « théorie de l’erreur systématique » (p. 59), la production subjective n’opère plus au niveau de la sensation même mais sur le plan du jugement : le problème émerge dès lors que nous adoptons une attitude cognitive, que nous sortons de notre sphère propre de qualia en donnant une étiquette chromatique aux objets du monde. « L’erreur systématique consiste à attribuer aux couleurs une existence objective. (…) Cela veut dire que le sujet ne dispose d’aucune règle pour regrouper des objets du monde sous l’extension d’un terme de couleur, règle qui soit indépendante de l’impression subjective.» (p. 60). Eu égard au principe selon lequel aucune correspondance n’existe entre la proposition chromatique et les faits du monde, l’erreur provient de ce que nous traitons la première comme s’il se fût agi d’une proposition classique dont le sens est déterminé par l’extension, c’est-à-dire par un ensemble de propriétés externes. Pourtant, là encore, deux problèmes se posent. Premièrement, comment expliquer une erreur sans faire intervenir une origine, un élément extra-cognitif ? Parce que l’erreur ne se définit et découvre qu’à l’aune d’une vérité, sa systématisation se réfute elle-même d’emblée. Peut-on parler d’erreur « quand il n’y a pas de manière claire de concevoir en quoi ne pas se tromper pourrait consister ? » (p. 63). Deuxièmement, on pourrait s’en sortir avec une grammaire des couleurs, en croyant que les couleurs sont juste des modes d’expression ; or là encore le défaut de justification est frappant. « Pourquoi persistons-nous à adopter, à propos des couleurs, des croyances qui ne sont que le reflet de certains modes d’expression, alors que nous devrions ajuster nos pensées à propos des couleurs en fonction de ce que nous apprenons des couleurs par ailleurs (par exemple avec les sciences) ? » (p 63).
Le subjectivisme jette néanmoins le trouble dans la couleur : il oscille en effet entre deux positions, qu’il tente en vain de concilier -sacrifiant à l’un il étouffe l’autre-, la phénoménalité inhérente à la couleur et le caractère objectif de cette dernière. Tel quel, il « s’appuie sur une théorie scindée en deux parties, il balance, tel un prophète de Baal, d’une jambe sur l’autre. » (p. 64). D’où l’introduction, attendue il faut l’admettre après ce balancement continu entre sujet et objet, de la théorie de la projection, ou « théorie subjectiviste unifiée », qui reconnait que la couleur est un effet subjectif que nous sommes pourtant obligés d’appréhender perceptivement et cognitivement comme objectif, et ce au prix d’un dernier amendement de l’objectivité, non plus maximale mais par défaut. « Une propriété subjective est une projection si elle n’est accessible au sujet qu’en tant que propriété d’un objet. » (p. 66)
Rien ne permettant d’échapper à la tension entre extension et intension, Christophe Al-Saleh emprunte une porte de sortie dont l’accès aura été préparé dès le départ, concoctant une sorte de milk-shake conceptuel susceptible de satisfaire aussi bien le subjectiviste que l’objectiviste dont l’objectif est clairement posé, combler le gouffre entre le sujet et le monde objectif -par une relation ultimement sibylline, qui pose néanmoins des problèmes : d’où part la projection (un sujet sans doute), vers « quoi » (si il y a un objet absolument indépendant de ma prise), de quelle nature est-elle? Il reste qu’en dépit de cette faim qui tenaille encore le lecteur une fois l’ouvrage posé sur la table, nous avons eu le bonheur de lire et à l’écart des partis-pris ontologiques, un ouvrage qui repose à nouveaux frais et avec une clarté exemplaire le problème d’une couleur vagabonde, qui refuse qu’on la cloitre dans l’unique sphère du sujet ou dans la seule sphère du monde.