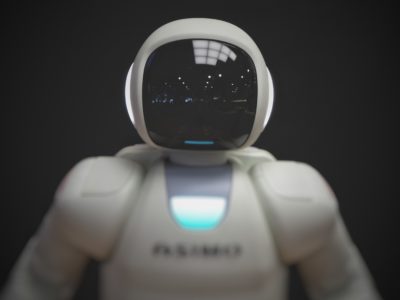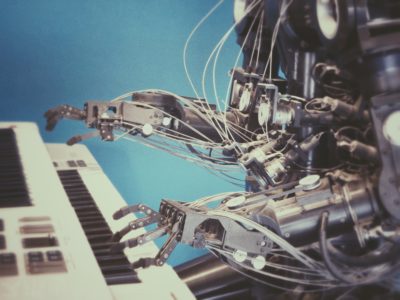Théorie de la justice et constructivisme 1/3
Ophélie Desmons – Université Lille 3, STL (UMR 8163) / Université Laval (Québec)
Pourquoi la théorie politique normative doit s’intéresser à la méta-éthique : le cas de la théorie de la justice et du constructivisme
Durant une bonne partie du vingtième siècle, la réflexion morale a accordé une attention considérable aux questions méta-éthiques. On a même parfois considéré que la philosophie morale devait se concentrer de manière exclusive sur ces questions de second ordre. Considérant que la philosophie morale n’avait rien de valable à dire au sujet des questions normatives, on affirmait qu’elles devaient être définitivement écartées.
La fin du siècle s’est néanmoins caractérisée par un regain d’intérêt pour les questions normatives, arguant notamment du fait que ce qui donne un intérêt à la réflexion morale et politique, c’est qu’elle nous aide à répondre aux questions pratiques qui sont, finalement, les seules questions vraiment importantes : ce qui compte pour nous, c’est bien de savoir ce que nous devons faire, comment nous devons nous orienter dans l’existence. Spéculer sur la nature ontologique du bien ne nous aide en rien à le déterminer.
Mais cet intérêt renouvelé pour les questions normatives doit-il nécessairement se faire aux dépens de la réflexion méta-éthique ? Faut-il, à l’instar de ceux qui avaient condamné la philosophie normative, accepter une séparation stricte entre les questions de premier ordre et les questions de second ordre ? Et faut-il, convaincus de l’importance primordiale des questions normatives, ne voir dans les débats méta-éthiques qu’un ensemble de préoccupations ontologiques, sémantiques ou épistémologiques, qui, certes, ont sans doute en elles-mêmes un intérêt spéculatif, mais qui sont sans rapport avec la réflexion normative et, finalement, sans intérêt pour celui qui estime que ce qui importe, ce sont les normes ?
Mon but est ici de démontrer qu’il importe au contraire de ne pas abandonner la réflexion méta-éthique lorsqu’on entend mener une réflexion normative. Faire un travail méta-éthique, ce n’est pas remettre à plus tard, et finalement à jamais, la réflexion normative. Ce n’est pas un travail dont on peut très bien se passer.
C’est ce que me semblent souligner les rapports de cette position méta-éthique innovante, le constructivisme moral, et de la réflexion politique normative qui s’occupe des questions de justice distributive. Je chercherai tout d’abord à montrer que si le constructivisme moral peut d’abord être défini comme une position strictement méta-éthique dont le mérite est de nous éviter les écueils des positions plus traditionnelles, il constitue également une ressource méthodologique incontournable pour celui qui pose la question de la justice distributive dans un contexte de pluralisme moral. La reconnaissance du fait du pluralisme impose en effet un certain nombre de contraintes à celui qui cherche à définir des normes du juste, au premier rang desquelles le respect d’une forme de neutralité vis-à-vis des valeurs morales. Or, comme je chercherai à le mettre en évidence, le constructivisme s’appuie sur une redéfinition de l’objectivité morale. Il est dès lors possible de parvenir à des normes objectives sans avoir à présupposer une conception indépendante du bien. C’est en ce sens que le constructivisme constitue une ressource méthodologique précieuse pour la philosophie politique normative qui part de la reconnaissance du fait du pluralisme.
Néanmoins, un examen plus minutieux du constructivisme révèle qu’il n’y a pas un constructivisme mais plutôt des constructivismes. Nous sommes, en particulier, confrontés à l’opposition entre constructivisme intégral et constructivisme restreint. Je chercherai alors à démontrer qu’il faut sans doute se résoudre à admettre l’impossibilité d’un constructivisme intégral et que, sur le chemin qui nous conduit à définir des normes du juste, tout n’est pas construit. La pertinence même d’un recours au constructivisme sera alors remise en question puisqu’ayant démontré l’impossibilité du constructivisme intégral, on devra admettre que le constructivisme n’est plus le puissant instrument de justification qu’il semblait être. Je chercherai, finalement, à montrer que le fait d’adopter une position constructiviste, même s’il ne s’agit que d’un constructivisme restreint, produit un certain nombre d’effets vertueux pour une philosophie politique normative libérale.
1. Le constructivisme, une troisième voie méta-éthique innovante
Ce qui caractérise en propre la réflexion méta-éthique, c’est le fait de faire porter l’attention sur les questions de second ordre plutôt que sur les questions de premier ordre[1]. La méta-éthique ne cherche pas, tout au moins pas de façon directe, à trouver des réponses aux grandes questions normatives comme, par exemple, à la question centrale de la morale : « Que dois-je faire ? ». On peut décrire le questionnement méta-éthique en soulignant les quatre questions essentielles auxquelles la réflexion méta-éthique cherche à répondre :
1/ Un questionnement ontologique. La question est ici de savoir quel est le statut ontologique des valeurs morales. On se demandera, par exemple, si le bien, ou le bon, ont une existence séparée, s’ils existent hors de notre esprit, comme c’est le cas des réalités naturelles. On se demandera si les valeurs morales constituent un ordre de réalité indépendant des croyances et attitudes humaines.
2/ Un questionnement épistémologique. On se demandera ici de quelle façon nous avons accès à ces valeurs, et, en particulier, s’il est possible de les connaître. On se demandera également, de façon corollaire, quelle est la faculté qui nous permet d’avoir accès à ces valeurs morales.
3/ Un questionnement sémantique. À propos des énoncés moraux du type « X est bon », on posera la question de savoir si ces énoncés sont susceptibles d’être vrais ou faux, s’ils sont tels qu’il n’y a aucun sens à leur attribuer une prétention à la vérité, ou s’ils sont toujours faux.
4/ Un questionnement psychologique. La question est ici de savoir de quelle façon des jugements moraux parviennent à avoir une influence sur nous, et, plus précisément, comment ils peuvent nous motiver à agir conformément à eux. On cherchera à comprendre pourquoi et comment le fait de dire ou de penser que quelque chose est bon nous pousse à agir.
En réponse à ces questions fondamentales, les positions méta-éthiques traditionnelles se cristallisent autour d’un certain nombre d’oppositions bien tranchées, et en particulier autour de l’opposition entre cognitivisme et non-cognitivisme. Les partisans du cognitivisme soutiennent d’abord une thèse sémantique. Ils affirment que les jugements moraux sont de véritables propositions. Leur intention étant descriptive, ils ont une prétention à la vérité. Dans la forme la plus classique du cognitivisme, cette thèse sémantique est articulée à une thèse épistémologique selon laquelle il est possible d’atteindre une connaissance morale. L’objectivité morale est conçue comme possible. L’une des questions qui se pose alors à un cognitivisme de ce type, c’est la question de savoir quelle est la faculté qui nous permet de connaître ces valeurs morales. On trouvera ici une pluralité de réponses, pluralité qui opère une distinction entre cognitivistes intuitionnistes – qui soutiennent que nous connaissons les valeurs morales parce que nous sommes des agents moraux qui possédons universellement une capacité à saisir ces valeurs par intuition – et cognitivistes naturalistes – qui soutiennent que, si la morale peut être objective, c’est parce que les énoncés moraux sont empiriquement vérifiables.
De plus, il existe classiquement une corrélation plus ou moins naturelle – dont il faut néanmoins reconnaître qu’elle ne constitue pas une nécessité – entre cognitivisme et ontologie réaliste. Il y a une corrélation entre l’affirmation selon laquelle il est possible d’atteindre une forme d’objectivité en éthique et l’affirmation selon laquelle il existe des faits moraux indépendants de nous. C’est en effet, pense-t-on souvent, parce que ces faits moraux existent indépendamment de nous que ce que nous disons à leur sujet est susceptible d’être vrai ou faux. Les énoncés moraux seront vrais lorsqu’ils représenteront ces faits moraux conformément à ce qu’ils sont. On remarque qu’on conçoit alors la vérité de façon tout à fait classique. La vérité est correspondance entre ce qui est dit ou pensé et ce qui existe indépendamment du discours ou de la pensée.
La position développée par G. E. Moore dans Principia Ethica[2] est un bon exemple de ces multiples corrélations. Moore considère que la première question qui se pose en philosophie morale est une question sémantique : la question de savoir ce que « bien » signifie. Il répond que le terme bien est une propriété simple et non naturelle, à laquelle nous avons accès par l’intermédiaire d’une intuition. Selon Moore, les énoncés moraux sont donc susceptibles d’être vrais ou faux, la morale peut être un objet de connaissance, et les faits moraux existent indépendamment de nous. Moore adopte une sémantique cognitiviste, soutient l’objectivité de la morale et assume une épistémologie intuitionniste doublée d’une ontologie réaliste non naturaliste.
Le principal bénéfice de cette position est de parvenir à rendre compte de la façon dont nous utilisons les concepts moraux dans le langage ordinaire. On peut en effet estimer que l’une des tâches de la philosophie morale est de rendre compte du statut que nous accordons spontanément aux énoncés moraux. Or, nous avons spontanément le sentiment que ces énoncés constituent des impératifs, qui s’imposent à nous en vertu d’une caractéristique qui leur est propre et qui diffère de nos préférences subjectives ou de la force de la coutume. Ainsi, quand nous reconnaissons que réduire l’autre à l’esclavage est mal, ou que ne pas tenir sa promesse est mal, nous signifions un devoir qui s’impose à nous, indépendamment de nos caractéristiques particulières. Le sentiment du devoir moral est bien différent de l’expression d’un désagrément ou de la reconnaissance qu’une pratique est tenue pour bonne ou mauvaise dans une communauté particulière. Affirmer l’objectivité de la morale serait ainsi la seule façon de rendre compte de la spécificité de l’obligation morale, et notamment du fait que cette obligation est, ou tout au moins prétend être, universellement valide. Si, en effet, on réduit la morale au plaisir individuel ou à la convention, on fait disparaître l’idée même de morale. Dès lors, si l’on démontre que pour rendre compte du fait moral, il faut rendre compte de son objectivité et qu’on ajoute que pour soutenir l’objectivité de la morale, il faut admettre un cognitivisme intuitionniste et un réalisme non naturaliste, on peut estimer qu’on dispose d’une série d’arguments puissants en faveur de ces positions épistémologiques et ontologiques.
Néanmoins, une position de ce type pose un certain nombre de problèmes ontologiques et épistémologiques importants. Le statut ontologique des valeurs réifiées peut en effet sembler bien énigmatique, tout comme la faculté d’intuition intellectuelle qu’il faut présupposer afin que l’homme puisse connaître ces réalités morales. John L. Mackie met ainsi en avant « l’argument de la bizarrerie »[3]. Il souligne qu’à affirmer que les valeurs morales sont dotées d’une réalité ontologique séparée, on s’engage dans une position ontologique difficile à assumer. On doit alors supposer l’existence de réalités non naturelles, et donc étranges, puisque leur statut ontologique est radicalement différent des réalités sensibles dont nous avons une expérience empirique. De façon corollaire, on s’engage dans une épistémologie peu économe, puisqu’il faut supposer en l’homme une capacité à percevoir ces réalités morales. Mackie écrit :
S’il existait des valeurs objectives, ce serait alors des entités, des qualités ou des relations d’une nature très étrange, complètement différente de tout ce qui existe dans l’univers. Corrélativement, si nous avions accès à ces valeurs, ce serait nécessairement par l’intermédiaire d’une faculté singulière de perception ou d’intuition morale, complètement différente des facultés ordinaires par lesquelles nous connaissons toutes les autres choses[4].
Ainsi, à adopter une position comme celle de Moore, on doit être capable de fournir une explication du statut ontologique des valeurs morales, d’expliquer de quelle façon exactement ces valeurs trouvent leur place dans la réalité métaphysique, et d’expliquer précisément le fonctionnement de la perception ou de l’intuition morale. Tant de difficultés qui peuvent nous conduire à penser qu’il y a là plus de problèmes qu’on ne peut en résoudre et qu’il faut renoncer à fonder l’objectivité morale sur des bases si embarrassantes.
On pourra répondre qu’un cognitivisme naturaliste est possible et qu’il nous permet de fonder l’objectivité de la morale sans engendrer les lourdeurs ontologiques et épistémologiques de l’intuitionnisme. Il y a néanmoins de bonnes raisons de penser que c’est justement l’objectivité de la morale qu’il faut mettre en question.
C’est ce dont on s’aperçoit si l’on prête attention à l’argument sémantique mis en avant par les partisans de l’expressivisme et de l’émotivisme. A. J. Ayer cherche ainsi à montrer dans Language, Truth, and Logic[5], que les énoncés moraux, dans la mesure où ils ne sont ni analytiques ni empiriquement vérifiables, ne sont pas à proprement parler dotés de signification. Dire « tuer est mal », ce n’est pas dire quelque chose à propos du réel, ce n’est pas décrire une réalité qui existe indépendamment de nous, c’est simplement exprimer une émotion. Dès lors, il n’y a pas de sens à chercher à savoir si les énoncés moraux sont vrais ou faux : ils ne sont ni susceptibles d’être vrais, ni susceptibles d’être faux puisqu’ils ne disent rien d’une réalité extérieure à nous. Nous devons dès lors assumer une forme de non-cognitivisme : il faut renoncer à poser la question de la vérité ou de l’objectivité en morale.
Une remarque mérite ici d’être faite : ce qui se produit avec Ayer et le non-cognitivisme qu’il soutient, c’est une radicalisation de la distinction entre morale normative et méta-éthique. Si on a coutume de dire que la méta-éthique se constitue comme un champ d’investigation philosophique indépendant sous l’impulsion des Principia Ethica de G. E. Moore, parus en 1903, c’est seulement avec A. J. Ayer que l’entreprise méta-éthique en vient à être définie comme la seule tâche possible de la philosophie morale. Ainsi, si Moore considérait que la première question de la philosophie était une question sémantique, il ne considérait pas que c’était là la seule question à laquelle, dans le champ de la morale, le philosophe devait s’intéresser. Il pensait au contraire qu’une fois cette question sémantique tranchée, on pouvait s’adonner à un travail normatif. Ayer au contraire condamne la réflexion normative. Puisque les énoncés moraux ne sont pas susceptibles d’être vrais ou faux, il n’y a aucun sens à penser qu’un progrès de la pensée est possible en morale. Si un énoncé moral n’est que l’expression d’un sentiment ou d’une préférence, il n’y aucun sens à se demander si une position morale est meilleure qu’une autre. Le premier rôle de la philosophie morale est de constater l’impossibilité d’une philosophie morale normative. La seule philosophie morale possible, c’est la méta-éthique.
Par ailleurs, le non-cognitivisme présente un certain nombre d’avantages importants. Tout d’abord les difficultés ontologiques et épistémologiques d’un cognitivisme intuitionniste et non naturaliste sont écartées. Si la thèse centrale du non-cognitivisme consiste à affirmer que, lorsqu’un agent moral affirme « X est bon », il ne renvoie pas à une réalité extérieure à lui, en vertu de laquelle son énoncé serait vrai ou faux, mais exprime plutôt un sentiment, on comprend très facilement le type de réalités que les valeurs morales peuvent être. Dans une version subjectiviste, un énoncé moral est simplement l’expression de certaines préférences psychologiques individuelles. Ainsi, par exemple, on appelle bon ou bien ce qui nous apporte du plaisir. Une position non cognitiviste n’est néanmoins pas condamnée au solipsisme, c’est-à-dire à affirmer que « bien » et « bon » ne sont tels que pour l’individu qui les ressent ainsi : on peut très bien montrer que les préférences morales sont toujours une affaire collective – les valeurs morales, ce sont les valeurs de la communauté – ou même qu’il existe une convergence des préférences morales chez tous les hommes : puisqu’ils ont en partage une seule et même nature, ils ont, en général, les mêmes valeurs morales. Des énoncés moraux, on peut donc dire que certains sont, en général, adoptés par les hommes. On renonce néanmoins à accorder toute forme d’indépendance à la morale, et par là, à toute prétention à l’objectivité.
Le non-cognitivisme semble également constituer une position plus attractive que le cognitivisme lorsqu’il s’agit d’expliquer nos motivations morales. Ainsi, penser le phénomène moral, ce n’est pas seulement comprendre de quelle façon nous sommes susceptibles de connaître les valeurs morales, c’est également et peut-être même d’abord et avant tout s’intéresser à nos comportements. Le phénomène moral peut en effet sans doute d’abord être défini en termes d’action. L’une des tâches de la réflexion morale est donc d’expliquer comment le fait d’adhérer à un énoncé moral suscite en nous une motivation à agir. Or, sur ce point, le cognitivisme semble être en défaut et il y a avantage au non-cognitivisme. On accepte ainsi plus spontanément l’idée selon laquelle c’est un désir, plutôt qu’un jugement, qui est à l’origine de l’action. Désirer, c’est par définition être attiré vers un objet et chercher à l’atteindre. Le désir nous met en mouvement.
Le jugement en revanche est une opération intellectuelle. Le lien entre le jugement et l’action n’est nullement évident. Pour l’éclairer, le cognitiviste doit ou bien affirmer qu’un jugement suffit à produire une motivation, ou bien affirmer qu’un jugement moral produit nécessairement un désir ou qu’il contient toujours déjà un désir, qui, lui, constitue une motivation à agir. Chacune de ces affirmations engendre un certain nombre de difficultés. Ainsi, si l’on affirme que le jugement suffit à produire une motivation, comment expliquer la figure de l’amoraliste ? Comment expliquer que certains reconnaissent sincèrement la validité de certains énoncés moraux sans pour autant ressentir de motivation à agir ? On est sans doute condamné ici à formuler des hypothèses ad hoc. Quelle qu’elle soit, une argumentation en faveur d’une position cognitiviste sera toujours plus indirecte, plus embrouillée et plus coûteuse que celle qui fait de l’affirmation morale l’expression d’un sentiment.
Néanmoins, ces nombreux avantages ont un prix. Nous sommes contraints de renoncer, pour la morale, à toute prétention à l’objectivité. Or on court alors le risque de dénaturer le discours et le phénomène moral, c’est-à-dire de leur ôter ce qu’ils ont de spécifique. Comme je l’ai indiqué plus haut, nous vivons le phénomène moral tout autrement qu’une simple préférence individuelle ou collective. Le devoir moral revêt, à nos yeux, un caractère impératif qui le distingue de ces préférences. Pour assumer une position non cognitiviste, il nous faut alors admettre que nous nous trompons dans la façon que nous avons de comprendre le phénomène moral. On doit supposer que la syntaxe nous abuse. Nous expliquons ainsi que puisque l’énoncé moral « X est bon » a la même forme qu’un énoncé du type « Y est rond », nous prenons l’habitude de comprendre l’énoncé moral comme un énoncé descriptif. Nous pensons que cet énoncé dit quelque chose d’une réalité qui existe en dehors de nous alors qu’en réalité il n’est que l’expression d’un sentiment. Lorsque nous adoptons une thèse non cognitiviste, nous devons donc admettre que le langage ordinaire nous trompe et que le phénomène moral est tout autre que ce que nous avons tendance à penser. Il nous faut admettre que la morale ne se distingue en rien des préférences. Mais, encore une fois, à l’admettre, nous devons sans doute renoncer à ce qui fait de la morale un phénomène singulier. Nous devons également renoncer à la possibilité même d’une réflexion morale normative.
Pourtant, ces problèmes normatifs possèdent une importance cruciale pour nous. Ce qui nous importe, c’est bien de savoir ce que nous devons faire, quelle action est meilleure qu’une autre. Or nous pouvons difficilement accepter le fait que la morale soit entièrement relative. Nous sommes, par exemple, sans doute incapables de renoncer à l’idée qu’un système politique qui accorde des droits civiques et politiques égaux à tous les individus est meilleur qu’un système qui repose sur la reconnaissance de l’esclavage ou de la ségrégation. Nous pensons que cette supériorité est objective, qu’elle peut faire l’objet d’une démonstration. Nous refusons de penser qu’il n’y a là qu’une affaire de préférences subjectives. Dès lors, si le non-cognitivisme nous contraint à renoncer à la réflexion normative, nous ne pouvons le considérer comme une option acceptable.
Chacune des deux options traditionnelles semble donc nous contraindre à assumer des positions que nous ne pouvons tenir jusqu’au bout. C’est dans ce contexte que le constructivisme se présente comme une troisième voie. Son ambition est d’éviter les écueils respectifs du cognitivisme et du non-cognitivisme tout en conservant les avantages de chaque position. Plus précisément, le constructivisme prétend sauvegarder l’objectivité de la morale tout en évitant les difficultés ontologiques et épistémologiques du cognitivisme intuitionniste et non naturaliste. Ainsi, Aaron James écrit :
Le constructivisme cherche une « troisième voie », c’est-à-dire une position qui se passe de la métaphysique du réalisme, mais qui continue à expliquer, dans le champ de la morale, la vérité, l’objectivité, la connaissance et la motivation dans des termes ordinaires et non sceptiques[6].
et plus loin :
Il s’agit ainsi de l’espoir d’une troisième voie – une voie où les valeurs sont d’une façon ou d’une autre « construites » et non toujours déjà présentes dans un ordre de choses impersonnelles, mais où elles sont néanmoins entièrement objectives au sens qui, ordinairement, a de l’importance pour nous[7].
Une position constructiviste cherche ainsi à concilier deux affirmations : d’une part, l’affirmation selon laquelle la morale est une construction et d’autre part, l’affirmation selon laquelle, en morale, une forme d’objectivité est possible. Si l’on est attentif à la façon dont Aaron James décrit le constructivisme, on constate qu’il écrit que le constructivisme cherche à affirmer que les valeurs morales sont objectives « au sens qui, ordinairement, a de l’importance pour nous ». Ainsi, l’objectivité de la morale, c’est un type très particulier d’objectivité. Dans une perspective constructiviste, on renonce à l’objectivité entendue comme indépendance ontologique. Pour éviter les difficultés ontologiques et épistémologiques du cognitivisme intuitionniste et non naturaliste, on renonce à faire de la réalité morale une réalité ontologique séparée. On y renonce parce qu’on considère que l’objectivité qui importe dans le champ moral, ce n’est pas une objectivité ontologique : nous n’avons que faire qu’il existe ou non une réalité morale indépendante. L’objectivité qui importe, c’est l’objectivité des énoncés moraux. C’est ce type d’objectivité que nous devons maintenir pour pouvoir affirmer que certains énoncés moraux sont vrais et que d’autres sont faux ou qu’un système de principes normatifs est supérieur à un autre système de principes. Telle est la forme d’objectivité qui nous importe en morale : elle est la condition de possibilité d’une philosophie normative.
Ainsi, le pari du constructivisme, c’est de maintenir cette forme d’objectivité, qu’on pourrait appeler objectivité sémantique, tout en renonçant à une assise ontologique. Mais comment est-ce possible ? Pour mieux le comprendre, citons à nouveau Aaron James. Il affirme :
La thèse générale du constructivisme est la suivante : de façon nécessaire, une proposition morale (ou éthique) est tenue pour vraie, si et seulement si, et parce que, elle sera tenue pour vraie par quiconque serait capable de suivre les normes de la raison pratique, sur la base d’un raisonnement valide et non erroné qui se déroulerait dans des conditions optimales pour la réflexion pratique[8].
Cette définition générale du constructivisme met en évidence l’importance de la notion de procédure pour une conception constructiviste. Ici, si la morale peut être objective tout en étant construite, c’est parce qu’on considère que l’objectivité peut être atteinte lorsqu’une procédure est respectée. On considère qu’une proposition morale est vraie ou objective parce qu‘elle est le résultat d’une procédure. C’est le respect de la procédure qui produit la vérité ou l’objectivité morale. L’idée est la suivante : on pense que si la réflexion suit un certain nombre de règles, si notamment elle se soumet à un certain nombre de contraintes, les propositions morales qui en découleront seront nécessairement vraies. Le constructivisme consiste à penser qu’il est possible de découvrir une procédure qui garantisse un résultat objectif.
L’une des questions essentielles qui se pose au constructivisme est alors la question de savoir comment cette procédure est elle-même établie. Comme je le montrerai plus loin, les diverses réponses possibles à cette question aboutissent à des formes de constructivisme assez radicalement différentes. Mais pour l’heure, l’essentiel est de constater que le constructivisme constitue bien une position méta-éthique innovante et pertinente. Cette position permet de répondre de façon satisfaisante et bien mieux que les positions traditionnelles aux différentes questions méta-éthiques fondamentales. Grâce au constructivisme, l’objectivité morale peut être affirmée sans avoir à assumer des positions ontologiques et épistémologiques problématiques. On peut ainsi conserver le sens que nous attribuons spontanément au discours moral et éviter d’accuser le langage ordinaire de nous tromper. Le phénomène moral conserve sa spécificité.
De plus, puisque la possibilité d’une objectivité morale est réintroduite, la réflexion normative redevient elle-même possible. S’il peut être question de vérité en morale, il redevient légitime de se poser la question de savoir si certains énoncés moraux sont vrais ou, de deux systèmes de principes, quel est le meilleur.
Mais l’intérêt du constructivisme ne s’arrête pas là. Le constructivisme, parce qu’il possède certaines caractéristiques singulières, se révèle être un outil méthodologique particulièrement bien adapté à une certaine forme de philosophie normative : la philosophie politique normative qui se donne pour point de départ le respect du pluralisme.
[1] Pour un exposé très clair de la distinction entre éthique et méta-éthique, on peut se référer à Jocelyne Couture, « Méta-éthique », Cahiers d’épistémologie, Université du Québec à Montréal, 1986, cahier n°8609, p. 1-3.
[2] G. E. Moore, Principia Ethica (1903), trad. Michel Gouverneur, revue par Ruwen Ogien, Paris, PUF, 1998.
[3] John L. Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong, Harmondsworth, Penguin Books, 1977. On se référera en particulier aux pages 38 à 42, dans lesquelles Mackie expose ce qu’il appelle « the argument from queerness ».
[4] Ibid., p. 38. Je traduis.
[5] A. J. Ayer, Language, Truth, and Logic (1936), trad. J. Okana, Langage, vérité et logique, Paris, Flammarion, 1956.
[6] Aaron James, « Constructivism, Moral », The International Encyclopedia of Ethics, éd. Hugh LaFollette, Blackwell, à paraître, p. 1. Je traduis. Le texte est intégralement accessible en ligne : http://www.faculty.uci.edu/profile.cfm?faculty_id=4884, consulté le 13 juin 2013.
[7] Aaron James, « Constructivism, Moral », art. cit., p. 2.
[8] Aaron James, art. cit. p. 3.