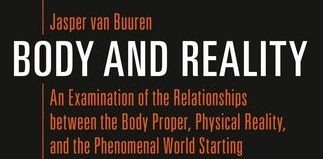L’animalité en question (2)
III. Épochè animale et liberté phénoménologique
Jean-sébastien Philippart
Notre enquête phénoménologique se voit donc relancée. Ainsi, Marc Richir va-t-il exposer les résultats de l’éthologie influencée par von Uexküll, en particulier les travaux de Konrad Lorenz qui privilégia l’observation des animaux dans leur milieu naturel, « en les éprouvant depuis la solidité remarquable des cadres fournis par les analyses heideggériennes. » (p.253) ?

Le regard amusé des animaux
Soit un oiseau qui s’agite et accomplit tous les gestes de la chasse aux insectes, alors qu’il n’y a aucun insecte dans son champ de vision et qu’il n’a jamais été témoin d’un comportement semblable chez un autre oiseau. En terme d’« instinct », on observe de la sorte une activité qui se déroule « à vide » ou est plongée dans la recherche désordonnée d’une configuration de stimuli correspondante (la « clé » du comportement (p. 250)), une exécution donc d’un mouvement instinctif « spontané », en vertu de l’absence de stimulation environnementale. Il en résulte que le comportement apparaît « distendu » par rapport à l’enchaînement contrapuntique des réponses aux stimulations. La distension en question est appelée en éthologie « comportement d’appétence » (cf. p. 256). L’appétence consiste en une recherche de stimuli susceptibles de déclencher un acte consommatoire en attente. Tributaire de l’aléatoire[1], cette « ouverture » par elle-même à l’environnement explique qu’un acte instinctif puisse être exécuté « à vide ». Le « soi » du comportement indivis dessine alors, dans cette situation où l’animal est motivé par l’exécution de l’acte instinctif lui-même, comme l’enroulement d’un « sujet » en tant que le soi a ici de l’appétit pour son appétit.
Situation […] qui s’intègre bien dans le cadre des analyses heideggériennes, sauf qu’elle implique, de la part de l’animal, une recherche de quelque chose, aussi obscure soit-elle, et aussi poussée soit-elle, aussi, par la désinhibition de la poussée correspondante, dont on voit qu’elle peut être strictement endogène. (p. 257)
Mais le « sujet » livré à cette recherche « obscure » que traduit l’agitation motrice ne se sait pas en tant que tel. Le comportement tourné vers lui-même « se cherche sans savoir ce qu’il est. » (p. 258) Le chat qui se débat dans tous les sens avec lui-même, en se mordant la queue, ne recherche en effet une prise (qui déclencherait son instinct de chasseur) que dans la mesure où celle-ci co-appartient à l’acte instinctif (dont l’accomplissement assouvit l’appétence) et ne saurait se révéler comme le dehors qui animerait « à distance » un désir en excès sur soi et dans le déphasage duquel s’ordonnerait une conscience. Situation qui correspond encore une fois à l’orthodoxie heideggérienne. En réalité, la « distension » observée ne remet en cause que le caractère massivement inhibé de la pulsion chez Heidegger. Il convient plutôt d’admettre le caractère endogène d’une attente corrélative à une « horloge interne » structurant une périodicité de l’organisme (se réglant néanmoins, et donc pouvant se dérégler, sur des stimuli environnementaux). L’animal n’attend pas, cela attend en lui.[2]
Richir envisage ensuite le concept d’« imprégnation » qui rend compte du comportement des choucas observés par Lorenz. Ces oiseaux ayant vu et senti l’éthologue en sortant de l’œuf, avant tout autre contact, ne pouvaient plus, à l’âge adulte, s’accoupler avec des congénères. Ils restaient auprès de Lorenz. L’imprégnation est ainsi une sensibilisation précoce et irréversible d’un individu à une stimulation telle qu’elle engage chez lui une réponse spécifique. On observe à nouveau comme un « flottement » de la pulsion animale « en avance » sur son désinhibiteur. Cette avance constitue certes « la contingence d’une rencontre, mais qui n’est pas, justement, réfléchie ou reconnue comme contingence » (p. 259). L’être-pris est disposé à se conformer à l’aléatoire. Jusqu’à ce stade des apports éthologiques donc, la conception heideggérienne demeure indiscutable.
Le problème de l’apprentissage ouvre cependant à quelque chose d’inattendu si nous continuons à prendre en considération le sens de l’être-captivé. Soit un chaton qui joue et exécute rapidement des mouvements de capture, d’agression ou de défense qui paraissent hors du contexte dans lequel ils remplissent habituellement leur fonction. Le comportement ludique indique que sans utilité immédiate un animal peut apprendre « pour apprendre ». A première vue, rien ne semble le différencier d’un comportement d’appétence. Bien que le comportement d’apprentissage soit toujours déclenché par un stimulus, la « finalité » porte sur l’acquisition d’un certain comportement. L’apprentissage, autrement dit, implique la recherche d’un comportement déterminé poussée par la désinhibition d’une poussée en avance sur son environnement. Par ailleurs, il ne se fait pas d’acquisition sans de l’« inné ». Aucun apprentissage ne serait possible s’il n’existait pas de mécanismes « innés » qui permettent d’apprendre. Que l’animal soit capable, rétroactivement, d’apprécier la justesse du comportement exécuté et de retenir la « leçon » c’est-à-dire l’effet rétroactif, suppose une référence qui existe de manière « innée » et assure de la sorte une discrimination spontanée entre réussite et échec. Mais entre l’accomplissement du comportement qui fait l’objet de l’appétence et l’appétence capable de discrimination, s’ouvre « un certain ‘‘délai’’» — qui n’est pas de l’ordre de l’attente périodique à laquelle l’aléatoire donne son empreinte — : la recherche ne s’effectue plus à l’aveugle « en ce qu’elle porte sur la possibilité de son accomplissement » (p. 263), en ce qu’elle vise la modification adaptative du comportement et non l’accomplissement d’un comportement qui pourrait s’exécuter « à vide ». La description doit admettre par conséquent un « comportement médiateur, qui est celui à apprendre, et que l’animal doit littéralement découvrir. » (Ibid.) Si l’effet rétroactif est appris dans la mesure même où il s’intègre à l’être-pris qui sait par avance ce qui est juste, il n’empêche que dans une authentique ouverture de la possibilité, il arrive quelque chose à l’animal qui rend possible ou impossible l’accomplissement du comportement. Ce à quoi s’ouvre l’animal « ne s’établit précisément pas dans l’accomplissement du comportement lui-même, mais ‘‘dans ce qui arrive’’ à l’animal » (Ibid.).
En d’autres termes, l’apprentissage implique, dans sa définition même, que l’animal ne sache rien par avance de la médiation à apprendre, et il faut admettre qu’il y a, ici, une véritable recherche et une véritable découverte. » (p. 264)
Quelque chose « échappe à la capture comportementale » (p. 265). Confrontée au il-arrive-quelque-chose, l’animalité amorce une ouverture à la phénoménalité d’un phénomène-de-monde hors langage. « Et amorce, précisément dans la mesure où cette ouverture est-elle-même prise dans une poussée et ré-inscrite dans une capture comportementale » (Ibid.). Cette découverte qui a échappé à Heidegger se voit renforcée par un autre trait de l’apprentissage : l’animal éprouve souvent de la jouissance à répéter incessamment, en l’absence de récompense, un difficile mouvement qu’on lui a appris. Il exécute le comportement pour le plaisir, c’est-à-dire en vue de rien d’autre que soi, dans l’enroulement sur soi d’une jouissance qui arrive à l’animal et dont le mouvement réflexif en amorce se fait sur la « contingence de la phénoménalisation, par laquelle, seule, quelque chose peut ‘‘arriver’’ à l’animal » (Ibid.). Ce sens esthétique qui émerge dans le plaisir qu’il y a à bien « faire » les choses, s’éprouve tout aussi bien chez le chat qui rampe dans les hautes herbes à l’affût d’une proie.
On constate une même ouverture au monde à travers le comportement de « curiosité » dans lequel l’animal prend du recul par rapport à la capture comportementale. La curiosité implique elle aussi, dans sa définition même, que l’animal ne sache rien par avance de l’« objet » de sa curiosité — qui est plutôt pour la curiosité « un phénomène qui suscite de lui-même sa propre énigme » (p. 269) — et en explore les diverses qualités, s’adonne ainsi « à une véritable variation eidétique, selon tous les comportements dont il dispose » (Ibid.) puisqu’ils sont disposés hors contrainte biologique. Cette variation ne constitue pas à proprement parler un « objet » mais un phénomène-de-monde dont les articulations s’inscrivent à même une exploration impliquant une sorte de mémoire ainsi qu’une sorte d’anticipation — et telle que le senti se trouve du côté de l’animal et le sentant du côté de la chose. Nous pouvons par contre parler ici (du moins pour l’instant) de « perception » où la passivité du sentir et l’articuler (hors langage) ne font qu’un et par quoi s’expliquent les situations dans lesquelles il n’est pas possible de leurrer l’animal en « attente » d’un quelque chose relativement complexe, attente supposant précisément un apprentissage par variation eidétique hors concept.
Afin de préciser les enjeux de ce recul phénoménologique « qui fait passer les appétences et les poussées à l’arrière-plan » (p. 268), Richir revient sur les expériences menées dans les années 1920 par Wolfgang Köhler avec des chimpanzés, qui donneront lieu à l’utilisation en éthologie du concept de l’« insight » (découvert par la psychologie) et que Lorenz commentera en soulignant son rapport avec le phénomène de « curiosité ». Soit une banane accrochée en hauteur et une caisse. Le singe regarde la banane, puis la caisse et se remet à regarder alternativement la banane et la caisse plusieurs fois : il voit la scène d’un seul coup. Ensuite il se gratte la tête, trépigne et crie : la chose fait problème. Il lui tourne le dos, mais la chose ne le laisse pas tranquille : il revient au problème. « Soudain, décrit Lorenz, son visage, auparavant grognon, ‘‘s’éclaire’’…, ses yeux vont maintenant de la banane à l’endroit vide situé au sol sous la banane, puis de cet endroit à la caisse, et revient, de là, à la banane. » (Lorenz cité p. 271) L’instant d’après, le singe qui ne boude pas son plaisir, pousse, sans tâtonner, la caisse sous la banane, monte sur la caisse et l’attrape… L’animal ne se laisse donc pas captiver par la banane : il met entre parenthèse son appétence pour faire face à une situation problématique. Est-ce à dire que la situation ouvre à un projet-de-monde ? Non : ce qui fait que la banane apparaît en tant que banane, l’essence (Wesen) banane, et ce qui fait que la caisse apparaît en tant que caisse, le Wesen caisse, apparaissent « dans leur commune présence », c’est-à-dire comme une énigme « à l’état brut » (p. 273) : les Wesen résonnent l’un avec l’autre en une cohésion sans intelligibilité. (Le terme « Wesen » est d’abord emprunté à Heidegger par Merleau-Ponty et désigne « une certaine manière d’être, au sens actif », un rayonnement « autour d’un centre tout virtuel » qui n’est pas sans tenir aux autres, sans être « une variante des autres comme eux de lui »[3].) L’énigme ne s’articule pas dans l’ouverture éclairante d’un projet-de-monde, c’est pourquoi le singe « fait mine d’abandonner le problème, ce qu’il doit faire pour effectuer une seconde épochè phénoménologique » de telle sorte que « du temps s’introduit dans l’espace et de l’espace s’introduit dans le temps » (Ibid.) et « où donc le temps a ses rétentions et ses protentions et où l’espace [a] ses directions (d’abord celles du regard qui parcours temporellement l’espace) » (p. 274). En d’autres termes, l’énigme éclate en un phénomène qui n’est plus sans temps mort, comporte délai et détour entrelacés sous la forme d’un chiasme — et ouvrant un projet-de-monde qui découvre avec plaisir la solution. Le phénomène s’élève à la temporalisation/spatialisation dont les pivots articulatoires ne sont autres que le vide sous la banane et le vide au-dessus de la caisse, vides s’inscrivant en tant que Wesen entre le Wesen caisse et le Wesen banane, et à travers lesquels se préfigurent l’action de déplacer la caisse et l’action de monter sur elle, préfigurations d’action dont le Wesen de l’une est également articulée au Wesen de l’autre à travers le Wesen vide.
Il y a donc, ici, reconnaissance du problème posé, c’est-à-dire phénoménalisation d’un phénomène-de-monde avec son eidétique sauvage hors langage, et ensuite résolution du problème par temporalisation/spatialisation en un phénomène de langage par phénoménalisation de langage au sein de laquelle surgit un pro-jet, qui est pro-jet de monde […]. (Ibid.)
Mais, si l’on se raccroche encore à Heidegger, qu’est-ce qu’une phénoménalisation d’un phénomène-de-monde « hors langage » ? Et d’autre part, qu’est-ce qu’une phénoménalisation de « langage » qui, comme l’animal, n’a pas la parole ? Afin que le lecteur n’en vienne pas à se perdre complètement dans les méandres et les sinuosités de la pensée richirienne, il convient de procéder nous-mêmes à un détour à travers quelques éléments phares de l’œuvre et grâce auxquels le retour à notre problématique se verra porteur d’une plus large compréhension de ses enjeux.
Intermède[4]
L’un des apports fondamentaux de Marc Richir est d’avoir distingué sous la forme d’un hiatus entre le « phénoménologique » et le « symbolique », hiatus qui traverse toute son œuvre comme un axe de pensée. Dans l’expérience de la parole, les deux dimensions s’intriquent et sont immédiatement à l’œuvre, mais il s’agit à travers la réduction phénoménologique de mettre entre parenthèses la part symbolique qu’il y a dans le langage pour accéder à son origine phénoménologique. À la différence du symbolique en tant que corrélat d’une institution qui apporte des règles, des usages, du sens fixé par avance et découpe le langage en signes qui paraissent d’ores et déjà donnés, le phénoménologique est originairement non codé.
Pour le dire sans plus attendre, le court-circuit de la pensée heideggérienne tiendrait donc au fait que, chez elle, la phénoménalité de l’être-au-monde est d’ores et déjà prise dans un réseau, un système de signes qui n’est pas questionné : la chose en tant que telle y est donnée et perçue, elle est prise au mot.
Le langage comme phénomène n’épuise toutefois pas, par principe, toute la phénoménalité :
[…] le langage paraît comme un champ phénoménologique spécifique de phénomènes — les phénomènes de langage — spécifiques, ayant sa cohésion propre et étant, en droit, tout aussi vaste que le champ phénoménologique tout entier, puisque pareillement indéfini ou in-fini au sens potentiel (apeiron).[5]
Qu’en est-il de la cohésion propre au phénomène de langage ? Et qu’en est-il du champ phénoménologique où il s’inscrit et avec lequel il partage le caractère d’être sans fin ? Précisons d’abord que le champ anthropologique chez Richir est structuré en strates qui ne suivent en rien un ordre chronologique et ne s’établissent pas les unes par rapport aux autres selon un rapport de fondement à fondé ou de cause à effet. L’architectonie n’est pas une archéologie. Une strate se base sur une strate plus profonde en tant qu’elle doit s’appuyer sur elle pour s’établir. Mais les éléments qu’elle lui reprend ne lui sont repris qu’au travers de leur transposition, de telle sorte que persiste un saut entre les strates dont chacune établit un ordre spécifique qui recouvre — mais jamais « en totalité » — un ordre ou un style plus profond. Ajoutons en effet que l’édifice richirien n’a absolument rien de figé ou de fermé, puisque chaque strate est tremblée par une strate plus profonde, jusqu’à une « vibration »[6] originaire qui se répercute ainsi en écho dans les différentes strates. L’édifice est toujours déjà en ébauche. Il ne s’agit donc pas, à la manière de la rage déconstructiviste, de liquider la conscience ou la présence, mais de suivre (« en zig-zag »[7], de transpositions en transpositions, du moins archaïque au plus archaïque et inversement) la genèse de ce qui se nourrit de l’hétérogène. Richir ne se pose donc pas, par ailleurs, en défenseur du « tout » phénoménologique. L’espace géographique et/ou géométrique comme le temps psychologique et/ou physique ne peuvent être déduits du phénoménologique que par un tour de passe-passe non phénoménologique où s’opère illusoirement le passage du constituant — enveloppant le constitué — au constitué. Car c’est précisément le déphasage entre le symbolique et le phénoménologique qui assure l’appréhension de l’un depuis l’autre. Le symbolique peut être mis en question grâce à la trace du phénoménologique qu’il porte et grâce à laquelle nous pouvons remonter en creux du symbolique à du phénoménologique toujours plus archaïque. S’il n’y avait que du phénoménologique, nous ne pourrions tout simplement pas nous situer. La réflexion phénoménologique, pour se faire, rencontre « les termes mêmes de l’institution symbolique »[8] qu’elle met en jeu : elle s’écrit et peut s’écrire dans une langue donnée où elle s’oriente en ce qu’elle est amenée à la renouveler et ce en écho à la question du sens comme telle que rien ne prédétermine.
Eu égard à notre problématique, nous allons dire ici quelques mots, « serrés » il est vrai, de quatre strates : l’institution symbolique, le phénomène de langage, les phénomènes-de-monde (hors langage) et la phénoménalité du phénomène, étant entendu que les allers et venues entre ces trois dernières strates ne sont pas du même ordre (phénoménologique) que le rapport du symbolique à celles-ci et que le rapport entre les éléments symboliques eux-mêmes. Le symbolique n’a pas le sens de l’incarnation.
Commençons par le phénomène de langage. Qu’est-ce qui fait que, lorsque nous parlons, nous ne répétons pas seulement ce que nous pensons savoir ? Qu’est-ce qui fait, autrement dit, l’aventure du langage ? Lorsque nous parlons sans aller trop vite (ce qui n’est pas habituel), le sens se déploie entre une exigence de sens à l’arrière (un passé qui n’a pas encore dit, en quelque sorte, son dernier mot) et une promesse à l’avant (un futur qui a déjà trahi quelque chose de lui-même). Mais la rétention (encore ouverte à la protention) et la protention (déjà ouverte à la rétention) ne coïncident pas, ne reviennent pas au même. La promesse ne se réduit pas à une simple déduction de l’exigence, sans quoi nous ne pourrions jamais être surpris par le sens que peut prendre nos paroles. Il en résulte que le sens se déploie au sein d’un écart, irréductible, à travers lequel se croisent et se recroisent, les unes dans les autres et les unes hors des autres, protentions et rétentions qui ne se coulent pas ainsi en un même présent. Il s’inscrit dans des horizons proto-temporels qui écartent originairement rétention et protention et dont l’exigence et la promesse sont aveugles. Une exigence aveugle qui ne retient rien de déterminé sinon le mouvement. Une promesse aveugle qui ne promet rien de déterminé, elle non plus, sinon le mouvement. Dans cet écart — sans présent — se joue de la sorte une certaine réflexivité, une réflexivité aveugle, qui ne se dispose pas en question, une réflexivité comme une « amorce de sens pluriels indéfinis tout en ‘‘potentialité’’ »[9]. La plurivocité étant le corrélat de l’indéterminité foncière du mouvement et la « potentialité » relèvant de la « transpossibilité »[10], c’est-à-dire de l’imprévisible, de ce qui vient justement surprendre toute attente, de ce à quoi on ne s’attendait pas et pourtant auquel on demeure exposé et tenu. C’est donc cet écart où s’entrelacent exigence et promesse aveugles (« réminiscence » et « prémonition »[11]) que le déploiement de sens va élargir en se donnant une présence, c’est-à-dire en ne se déployant pas à l’aveugle mais en vue de soi-même. Ce qui, cette fois, constitue tout à la fois une réflexivité et une ipséité : « le sens en amorce part à la recherche de lui-même en ‘‘saisissant au vol’’ (en apercevant) l’un des sens transpossibles dans telle ou telle amorce de sens pluriels et ce, en l’installant dans sa propre possibilité »[12]. En vue de soi-même, le sens fait question, question dans la perspective de laquelle se profile précisément une présence. Une présence cependant « inassignable »[13], qui n’est pas chose toute faite : le sens n’a de sens qu’à se déployer, toujours susceptible d’être dévoyé par des amorces de sens transpossibles auxquelles il demeure exposé. Continuellement le sens se voit exposé à sa perte ou à prendre une nouvelle « tournure » dans un rebondissement : il ne peut paraître saturé de lui-même dans l’évidence (à l’horizon symbolique) que sous peine de se fixer en l’illusion d’une identité où tout semble avoir été dit, où l’on croit avoir fait le tour de la chose et où se produit le concept en tant que clôture intemporelle, instantanée, du « sens ».
On l’aura compris, le phénomène de langage en tant que phénomène ne vise pas à signifier un état de chose. Il consiste en une prise de conscience qui n’exprime pas un contenu, mais où du sens cherche à se dire en s’inscrivant dans « un mouvement relativement aveugle, que nous disons schématisme phénoménologique, qui est juste un peu en avance et un peu en retard à l’origine par rapport à lui-même »[14]. La notion de « schématisme », incessante chez Richir, est l’énigmatique dynamique en vertu de laquelle les phénomènes tiennent ensemble, en dehors de toute conception et finalité. La proto-temporalisation (réflexivité aveugle) du schématisme assure par conséquent au langage qu’il puisse dire quelque chose qui ne soit pas la répétition de soi et lui assure par son préarrangement de ne pas être livré au pur et simple chaos. En son ipséité, le schématisme phénoménologique met en forme le sens par un espacement (élargissement) qui demande du temps (qui se temporalise en présence). En somme, le phénomène de langage se glisse « en clignotant » « entre sa réflexivité avec ipséité du sens et sa réflexivité sans ipséité. S’il n’était que la première, il imploserait aussitôt en l’identité d’une significativité [i.e. l’intentionnalité où le déploiement a éclaté d’une part, en une conscience, de l’autre, en son « quelque chose » et où s’annonce le concept en tant que la chose paraît soudainement comme donnée dans l’évidence]. Et s’il n’était que la seconde, il s’évanouirait aux phénomènes de monde hors langage. »[15] En d’autres termes, les conditions transcendantales de la conscience, c’est-à-dire « tout » ce que la conscience ne réalise pas, forme ce que Richir appelle l’« inconscient phénoménologique »[16].
Qu’est-ce donc alors qu’un « phénomène de monde hors langage » ? Il nous faut pour le comprendre introduire une nouvelle distinction. Si le phénomène de langage est une réflexion qui doit se régler sur un agencement (schématisme) de Wesen « formels », le phénomène-de-monde est agencement de Wesen « concrets ».
[…] par exemple, dire que « cette rose est rouge » ne signifie pas certes que le quale rouge se trouve ‘‘plaqué’’ à la rose par le « est », mais que ce phénomène, la rose rouge que je vois dans cette matinée de printemps, est visé par sa décomposition en « cette », « rose » et « rouge », et recomposé par la prédication, selon une ‘‘logicité’’ qui est précisément celle du langage. En elle l’essence de l’indication (« cette »), l’essence de la rose et l’essence du rouge, flottant dans leur élément, se recroisent avec les essences de la chaîne verbale au sein des essences formelles du langage.[17]
C’est dire que les Wesen formels (de langage) reprennent, selon le principe de la transposition, les Wesen concrets (hors langage) en une décomposition/recomposition. Ils feuillètent de l’intérieur les Wesen concrets en les redistribuant en proto-rétentions et proto-protentions que le déploiement du sens, nous venons de le voir, mue en rétentions et protentions. Les Wesen concrets accrochés, « colonisés »[18] et incarnés par les Wesen formels sont agencés, quant à eux, en un phénomène-de-monde qui constitue, en quelque sorte, la « référence » du phénomène de langage. Si le sens se cherche, son écart interne renvoie, dans un écart externe qui lui est corrélatif, à du hors-langage. À ceci près que le monde dont il s’agit n’est précisément pas un objet donné mais un fond (sans fond), l’élément dans lequel flottent des Wesen sauvages, — un « paysage » dont la peinture consiste, et Erwin Straus est le premier à l’avoir éminemment montré, en l’art de rendre visible l’invisible.
Le paysage est invisible, nous dit-il, parce que plus nous le conquérons, plus nous nous perdons en lui. Pour arriver au paysage, nous devons sacrifier autant que possible toute détermination temporelle, spatiale, objective ; mais cet abandon n’atteint pas seulement l’objectif, il nous affecte nous-mêmes dans la même mesure.[19]
Il n’y a donc pas, phénoménologiquement parlant, un seul monde, unique, mais toujours déjà, en vertu de l’indéterminité du phénomène, une multitude de phénomènes-de-monde enchevêtrés les uns aux autres. Gardons à l’esprit, et c’est important pour la suite, que l’aperception de langage qui envisage tel paysage (dans une phase de présence) est trouée par des absences, conditionnée qu’elle est par un agencement d’entre-aperceptions (des amorces de sens) qu’elle saisit au vol — et d’entre-aperceptions qu’elle ne réfléchit pas (qui se font à l’insu du déploiement du sens, se distribuent à l’aveugle dans la phase de langage, agissent « à distance »[20] en portant le risque de son dévoiement) et qui se font à vide, c’est-à-dire dont les Wesen formels ne se sont pas incarnés et renvoient « à distance » à des phénomènes-de-monde. Ceux-ci sont invisibles et ne concernent que des absences. L’écart où retentissent les phénomènes-de-monde n’est plus le déphasage des horizons temporels, l’écart entre rétention et protention, mais le déphasage des horizons proto-temporels. Au lieu d’un entretissage de rétentions et de protentions, nous y trouvons un empiètement de réminiscences (proto-rétentions) et de prémonitions (proto-protentions) qui revirent incessamment les unes dans les autres et les unes hors des autres, sans la moindre possibilité quelconque d’une présence, fût-elle inassignable. La proto-temporalisation a donc une double profondeur : celle des amorces de sens porteuses d’un paysage de monde (qui élargissent l’écart des réminiscences et des prémonitions hors langage) et celle des phénomènes-de-monde qui dépassent, comme par « en-dessous », les Wesen formels qui à leur niveau saisissent « au vol » des Wesen concrets dont l’élément laisse des Wesen formels demeurer formels. Ce dépassement rend compte de la transpossibilité des amorces de sens qui, dans la multitude de leurs agencements, ne collent pas ensemble, ne forment pas la potentialité d’une totalité. Les phénomènes-de-monde sont ainsi porteurs d’un porte-à-faux plus originaire, porteurs de l’« immémorial » et de l’« immature »[21] auxquels le « n’avoir-jamais-eu-lieu » et le « n’aura-jamais-lieu » de la proto-temporalisation de langage ne s’identifient pas. Ils sont en quelque sorte « les témoins »[22] de la transcendantalité du passé transcendantal — le « n’avoir-jamais-eu-lieu » au passé du passé, le passé au passé du passé —, et témoins de la transcendantalité du futur transcendantal — le « n’aura-jamais-lieu » au futur du futur, le futur au futur du futur. À ce niveau, la proto-temporalisation est « aspirée »[23] par la transcendantalité originaire. Les phénomènes-de-monde « apparaissent » en tant que revirement (les unes dans les autres et les unes hors des autres) de réminiscences de l’immémorial et de prémonitions de l’immature, de telle sorte que leur altérité les rend étrangers à l’ordre du langage qui cherche à les « coloniser ». Mais, on l’aura compris, la proto-temporalisation des phénomènes-de-monde ne s’identifie pas, elle non plus, au porte-à-faux originaire.
La phénoménalité en tant que telle, « le phénomène rapporté exclusivement à sa phénoménalité »[24], « le phénomène comme rien que phénomène »[25], clignote entre l’immémorial et l’immature. Cependant, au niveau du porte-à-faux originaire, le revirement ne dessine pas l’écart entre un passé qui est immédiatement passé du futur et un futur qui est immédiatement futur du passé. Aucun des deux pôles « n’est jamais atteint »[26] mais l’attraction se fait « à distance » l’un de l’autre en vertu de la « transpassabilité », notion que Richir reprend à Maldiney[27]. En vertu de celle-ci, le passé absolu rencontre, dans l’insaisissabilité, le futur dont l’altérité révèle à elle-même, en l’écart et par écart, l’altérité du passé. Inversement, le futur absolu rencontre le passé dont l’altérité révèle à elle-même l’altérité du futur. Autrement dit, dans l’écart originaire « où aucun des deux pôles n’est l’antérieur ou le postérieur par rapport à l’autre »[28], le phénomène ne se rapporte à soi qu’à travers l’accueil de l’autre, en dehors de toute capture ou de toute prise — dans la sur-prise de l’événement sans passé ni avenir. Le phénomène ne « touche »[29] au phénomène qu’en se rencontrant comme autre : son rapport à soi est rapport à l’événement. « L’indéterminité foncière du phénomène implique […] que le phénomène, en sa dimension transcendantale, est à lui-même son ouverture à de l’autre que lui-même »[30]. La phénoménalisation du phénomène est l’événement sans créateur/création de ce qui se fait hors de soi, l’émergence non temporelle du devenir-autre « par ses moyens propres »[31]. « Cela signifie que le phénomène paraît du même coup comme prolifération in-finie du phénomène ou de phénomènes »[32]. Infinité qui fait l’infinité des rencontres contingentes entre les phénomènes-de-monde et, du même coup, la multitude des phénomènes de langage.
[1] Cf. Kéramat MOVALLALI, « La pulsion et l’éthologie », in Movallali.fr, Site Internet, Disponible sur : http://www.movallali.fr/.Backup.09/.Backup.09/filer/filer%20ENG/English%20files/IV.theorie%20des%20pulsions.swf (consulté le 03/08/2012), p. 13.
[2] Cf. Ibid., p. 11.
[3] Maurice MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 154.
[4] Nous devons à László Tengelyi de nous avoir permis de maintenir un cap dans l’écriture mouvante de la pensée richirienne. (Cf. László TENGELYI, « La formation de sens comme événement », in Eikasia, Revista de Filosofia, n° 34, « Marc Richir », Site Internet, septembre 2010, Disponible sur :
http://www.revistadefilosofia.com/, pp. 149-172.
[5] M. RICHIR, Phénomènes, temps et êtres. Ontologie et phénoménologie, Grenoble, Millon, 1987, p. 293.
[6] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, Grenoble, Millon, 2006, p. 184.
[7] Cf. Idem, Méditations phénoménologiques. Phénoménologie et phénoménologie du langage, Grenoble, Millon, 1992, pp. 11-23.
[8] Ibid., p. 21.
[9] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, p. 23.
[10] Cf. H. MALDINEY, Penser l’homme et la folie, Op. cit., p. 143.
[11] M. RICHIR, Méditations phénoménologiques, p. 163.
[12] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, p. 24.
[13] Ibid., p. 20.
[14] Ibid., p. 23.
[15] Ibid., p. 28.
[16] Idem, « La mélancolie des philosophes », in Gilbert HOTTOIS (sous la direction de), L’affect philosophe, Paris, Vrin, 1990, p. 29.
[17] Idem, Phénomènes, temps et êtres, p. 299.
[18] Idem, Méditations phénoménologiques, p. 253.
[19] E. STRAUS, Du sens des sens, Op. cit., p. 383.
[20] M. RICHIR, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, p. 24.
[21] Idem, Méditations phénoménologiques, p. 162.
[22] Ibid., p. 216.
[23] Cf. Ibid.
[24] Idem, Phénomènes, temps et êtres, p. 20.
[25] Ibid., p. 22.
[26] Idem, Fragments phénoménologiques sur le temps et l’espace, p. 184.
[27] Cf. H. MALDINEY, Op. cit., pp. 419-425. On le devine, la transpassabilité est transpossible (inopinée) et toute transpossibilité est transpassible à une autre.
[28] M. RICHIR, Op.cit.
[29] Selon la belle expression de Florian FORESTIER. Cf. La version 1 de sa thèse de doctorat, Le Réel et le Transcendantal, Enquête sur les fondements spéculatifs de la phénoménologie et le statut du phénoménologique, Université Toulouse le Mirail, octobre 2011, Disponible sur :
[30] M. RICHIR, Phénomènes, temps et êtres, p. 23.
[31] Idem, Méditations phénoménologiques, p. 49.
[32] Idem, Phénomènes, temps et êtres.