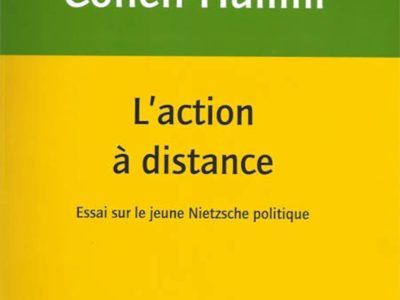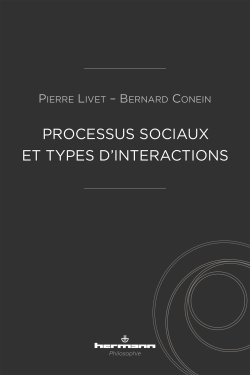Rationalisation et épistémologie sociale III
Olivier Ouzilou
L’identification des cas de rationalisation est-elle épistémiquement pertinente ?
Si, d’un point de vue épistémologique, seule la vérité ou, à tout le moins, la vraisemblance des propos énoncés, c’est-à-dire ici la plausibilité des raisons exposées, m’intéresse, en quoi le fait de savoir si ces dernières sont le fruit d’une forme de rationalisation peut-il s’avérer pertinent ? Lorsqu’une personne expose des raisons en faveur de la croyance que p, deux types au moins d’interrogation peuvent surgir : d’une part, les énoncés qui constituent les arguments exposés en faveur de telle idée sont-ils en eux-mêmes corrects ? D’autre part, ces énoncés, s’ils sont corrects, justifient-ils réellement telle idée, autrement dit constituent-ils de véritables raisons en faveur de telle idée ? Il existe en effet une différence entre le fait de récuser certaines propositions qui sont censées constituer des raisons et celui de contester le fait même qu’elles puissent constituer des raisons. La croyance à défendre peut naturellement être vraie quand bien même seraient défaits la croyance portant sur l’état de chose censé la justifier et/ou la relation de justification entre l’état de chose et la croyance en question. Pourquoi, outre cela, se demander si l’individu « rationalise » ou non lorsqu’il livre des raisons – interrogation qui semble essentiellement psychologique ? Il existe en effet plusieurs raisons de douter de la pertinence d’une telle interrogation.

Source : Stock.Xchng
Tout d’abord, dire qu’une personne rationalise, c’est certes affirmer que les raisons qu’elle expose n’ont pas le statut explicatif qu’elles prétendent avoir mais nullement qu’elles ne sont pas en elles-mêmes valables. Ce constat n’affecte dès lors pas la valeur des arguments, qui, seule, importe. Nous pouvons parfois défendre par d’excellentes raisons des idées auxquelles nous adhérons, même si ces raisons n’entretiennent aucune relation avec le fait que nous adhérions à ces idées. Se focaliser sur la question de la rationalisation ne revient-il pas à identifier l’explication génétique et l’évaluation épistémique ? Confondre la question de l’origine avec celle de la validité, n’est-ce pas précisément le propre de ce que l’on nomme le « sophisme génétique » ? L’enquête sur la rationalisation potentielle de mon interlocuteur n’offrirait ainsi au mieux qu’une description psychologique de ses motivations. Considérons par exemple ce jugement de Toynbee sur le marxisme et le type de révolution apocalyptique qu’il croit y déceler :
Chez Marx, la déesse « nécessité historique » est une déesse toute-puissante qui remplace Jéhovah et substitue au judaïsme le prolétariat du monde occidental moderne, tandis que le royaume messianique est représenté par la dictature du prolétariat. Malgré cela, les traits distinctifs de l’apocalypse juive traditionnelle apparaissent derrière ce déguisement transparent, et c’est en fait le judaïsme pré-rabbinique que notre philosophe impresario présente en accoutrement occidental[1]
Cette description peut être lue comme l’affirmation implicite selon laquelle la théorie marxiste ne constituerait que la rationalisation de convictions religieuses non assumées comme telles par Marx. Elle est sans doute intéressante et, peut-être même, plausible : il est en effet possible qu’une influence de ce type ait opéré sur les analyses de Marx et que ces dernières constituent en partie une transposition rationnelle des conceptions religieuses auxquelles l’auteur adhérerait implicitement. Par conséquent, on peut imaginer, même si Toynbee est très loin d’en fournir la preuve, que certaines des thèses marxistes sont implicitement guidées par ce type de principes. Mais on comprend également en quoi, à partir de cette description, elle-même rendue possible par la mise en oeuvre de l’hypothèse de rationalisation, ce que l’on peut appeler des « glissements normatifs » sont susceptibles d’avoir lieu : dire que le marxisme procède d’un certain impensé messianique, n’est-ce pas en un sens le décrédibiliser d’un point de vue épistémique (surtout si l’on garde à l’esprit la charge antireligieuse de la théorie marxiste) et insinuer que cette origine contamine sa prétention à la validité ? Initialement conçue comme un outil descriptif, la présomption de rationalisation peut aisément devenir une arme de disqualification théorique. D’un point de vue strictement argumentatif, cette exégèse n’invalide toutefois aucunement les idées marxistes. Elle ne fait au mieux qu’éclairer un cheminement intellectuel.
La focalisation sur la rationalisation peut dès lors provoquer une tendance à la psychologisation du débat et ainsi à son appauvrissement. De tels procédés, qui relèvent assez souvent de la paresse intellectuelle, ne permettent-ils pas de contourner les exigences argumentatives minimales ? Il n’est pas rare de voir nos essayistes les plus médiatisés glisser, de manière imperceptible, au cours d’un débat, de considérations épistémiques concernant la vérité ou la plausibilité d’une idée à la tentative généalogique de déceler ce que l’adhésion à cette idée traduirait. Malgré leur apparence de profondeur, de telles considérations nous éloignent de l’échange argumenté. Suite à leur ouvrage Impostures intellectuelles, Sokal et Brickmont se sont ainsi étonnés d’un certain type d' »objection » qu’on leur fit : l’attaque concernant leurs motivations. Ces dernières étaient pensées soit comme conscientes (lorsqu’on les accusait de mener délibérément une campagne économique et diplomatique anti-française ou une « opération commerciale » visant à transférer des crédits de recherche vers les « sciences dures »), soit comme potentiellement inconscientes, lorsqu’on expliqua leurs propos par leur haine secrète de la philosophie et de la pensée libre et créatrice, auquel cas l’hypothèse de rationalisation fait son apparition. La quête des raisons exposées dans leurs livres aurait été silencieusement déterminée par cette hostilité, ces raisons ne constituant dès lors qu’une forme de rationalisation de ces affects négatifs. La réponse des auteurs fut dans les deux cas similaire et, semble t-il, de pur bon sens : » même si les accusations étaient vraies, en quoi cela affecterait-il la validité ou l’invalidité de nos arguments ? »[2].
Ces procédés psychologisants peuvent ainsi, au cours d’un débat, constituer une véritable stratégie de diversion qui consiste à passer de l’examen des contenus à l’herméneutique, souvent sauvage, des postures. Il n’est ainsi pas rare d’entendre un individu accuser son interlocuteur, qui, par exemple, s’émeut au cours de telle discussion sur un sujet particulier, de hiérarchiser de manière sélective ses objets d’indignation. Or l’accusation d’indignation sélective est souvent la voie royale pour alimenter la présomption de rationalisation. Après avoir montré l’asymétrie dans l’évaluation, il est en effet aisé de mettre en place une grille de lecture « rationalisatrice » des raisons exposées et de tenter de déchiffrer les motifs psychologiques profonds, et nécessairement inavouables, censés présider à cette hiérarchisation : si tel état de chose vous scandalise alors que tel autre, analogue, vous laisse indifférent, c’est donc bien que ce qui est en jeu excède leurs propriétés objectives communes et, par conséquent, les bonnes raisons de s’indigner. L’ennui est que ce type de réplique semble souvent conçue comme une réfutation de la position adverse, ce qu’elle ne peut par principe pas être. La « vocation à faire parler l’inconscient des autres »[3] est malheureusement muette sur la question de la vérité des énoncés dont elle livre l’exégèse psychologisante. Ici encore l’herméneutique des postures détourne de l’analyse des contenus et constitue une arme rhétorique, et redoutable, de disqualification des discours. CS. Lewis[4] a, à ce propos, forgé le concept de bulverism afin de qualifier, plus généralement, toute attitude consistant non pas à examiner la valeur de vérité d’une doctrine mais à partir plutôt du principe qu’elle est fausse pour tenter d’en faire l’étiologie. Ce type de procédé peut conduire à une régression à l’infini : il est toujours possible de tenter de dévoiler les motivations inconscientes du discours qui prétend lui-même dévoiler les motivations inconscientes, etc.[5]
On pourrait ajouter que, très souvent, la focalisation sur la rationalisation s’adosse à un projet réductionniste, en l’occurrence à ce que Boghossian[6] nomme le « constructivisme de l’explication rationnelle », c’est-à-dire l’idée selon laquelle les raisons épistémiques de croire sont par principe impuissantes à expliquer l’émergence d’une croyance. On peut imaginer une version forte de ce constructivisme qui dirait qu’une authentique explication doit substituer à ces raisons apparentes les véritables motivations (pragmatiques, sociales, pulsionnelles, etc.). Une version faible se limiterait, quant à elle, à affirmer que de telles explications doivent être complétées par l’examen de ces motivations. Quoi qu’il en soit, on retrouve dans les deux cas l’idée selon laquelle la pure exposition de raisons n’est qu’une reconstruction avantageuse, c’est-à-dire épistémiquement acceptable, de nos processus cognitifs. L’hypothèse de rationalisation peut ainsi conduire à une forme de « scepticisme motivationnel », pour reprendre l’expression de Korsgaard[7], qui consiste à penser que les bonnes raisons en faveur de la croyance que p ne peuvent par elles-mêmes inciter à croire que p.
Or, qu’il s’agisse de la version forte ou de la version faible, un tel réductionnisme est peu vraisemblable. Comme on l’a souvent remarqué[8], un tel projet semble être auto-réfutant puisqu’il s’appliquerait également au discours sceptique lui-même : si toute exposition de raison n’est qu’une forme de rationalisation, les raisons qu’expose le sceptique sont elles-mêmes des rationalisations. Le sceptique serait parvenu lui aussi à ses conclusions sceptiques d’une manière irrationnelle, ce qui n’est certes pas une objection contre la validité de ce qu’il avance mais plutôt contre l’idée, qui semble sous-jacente à sa démarche, de nous convaincre par ces raisons, aussi impeccables soient-elles. On peut également remarquer que l’adoption d’un tel principe déstabiliserait tout un pan de notre vie intellectuelle et sociale : on ne pourrait ainsi, par exemple, plus exiger d’une personne qu’elle croie que p sur la seule base des preuves en faveur de p. Il deviendrait en ce sens inutile d’exposer des raisons. Nous serions par principe insensibles aux données, c’est-à-dire incapables de nous conformer à ce qu’elles nous « enjoignent » de croire. Remarquons également que notre conception ordinaire de la conversation serait profondément transformée : on n’écouterait plus, la plupart du temps, les contenus (ou les raisons) exposées pour eux-mêmes mais on chercherait toujours à déchiffrer ce que traduisent ou trahissent les jugements émis. Ce dernier argument est toutefois de portée limitée car la présomption de rationalisation ne semble pas en elle-même impliquer le constructivisme de l’explication rationnelle.
[1] Arnold Toynbee, A study of History, vol. II, Oxford, Oxford University Press, 1934, p. 178
[2] Jean Brickmont, Alan Sokal, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 25
[3] Guy Hocquenghem, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary, Marseille, Agone, 2003, p.172
[4] Clive Staples Lewis, God in the dock : Essays on Theology and Ethics, ed. Walter Hooper, (Grand Rapids, MI : William N. Eerdmans Publishing Co), 1970
[5] Eugene H. Sloane, « Rationalisation », The Journal of Philosophy, 41 (1), 1944, pp. 12-21
[6] Paul Boghossian, La peur du savoir, Marseille, Agone, 2006
[7] Christine M. Korsgaard, « Skepticism about Practical Reason », The Journal of Philosophy, 83 (1), 1986, pp. 5-25
[8] Hilary Putnam, Raison, vérité et histoire, Paris, Minuit, 1984 ; Larry Laudan, La dynamique de la science, Bruxelles, P. Mardaga, 1977