Rationalisation et épistémologie sociale I
Olivier Ouzilou – Université de Provence – CEPERC
Dans son ouvrage Les imposteurs de l’économie, Laurent Mauduit[1] avance l’idée selon laquelle l’absence de discernement que manifestèrent, dans leurs interventions médiatiques, un certain nombre d’économistes français face aux prémices de la crise financière de 2008 était en partie due à leur proximité avec les milieux d’affaire. Certains critiques se sont empressés de brandir face à cette thèse une arme rhétorique de disqualification fort prisée : l’accusation de conspirationnisme. Ce dernier reposerait sur deux croyances naïves : la première consiste à penser que les marchés financiers dictent aux économistes ce qu’ils doivent écrire ; la seconde considère ces derniers comme des individus obéissant mécaniquement à de telles injonctions explicites. On peut adresser plusieurs objections à ce type de critique, qui procède parfois plus de l’automatisme mental ou verbal que de la considération réelle des propos critiqués. La première consisterait à dire que l’imputation de conspirationnisme ne suffit pas à délégitimer un propos, à moins de décréter que l’existence même d’actions concertées est a priori inenvisageable. La seconde ferait valoir que toute une catégorie d’ajustement des comportements à certaines attentes réelles, potentielles ou fictives ne tombe pas sous ce qualificatif, comme l’autocensure ou ce que Krugman, cité par Mauduit, appelle la « corruption douce », à savoir le fait, par exemple, de taire certaines choses pour des raisons pragmatiques, et ce sans qu’aucune pression directe n’ait été faite. Un troisième type d’objection, qui nous intéressera plus particulièrement ici, pourrait s’appliquer à un grand nombre de cas où cette arme de disqualification est brandie. La fragilité de cette forme de critique tient au fait qu’elle semble souvent reposer sur une confusion conceptuelle : ce type d’objection est en effet souvent formulé à l’encontre de thèses portant sur l’influence qu’une certaine proximité sociale peut exercer sur la formation de certaines croyances. Or les critiques en question insinuent que ce dernières dénoncent l’expression de certains contenus, autrement dit l’action consistant à ajuster ce que l’on dit à ce que certains aimeraient qu’on dise (ou à ce qu’on pense qu’ils aimeraient qu’on dise). Il est toutefois évident qu’on ne peut parler au sens strict de « conspirationnisme » que dans le second cas.

Source : Stock.Xchng
Dès lors, de deux choses l’une : soit la thèse critiquée porte sur les motifs qui président à l’expression de certaines croyances – ce qui semble être, il est vrai, la plupart du temps le cas dans le livre de Mauduit. Elle revient alors à dire que la proximité des économistes avec le monde de la finance incite ces derniers à dire ou à taire certaines choses, et ce parce qu’il est dans leur intérêt de le faire. La critique consiste ici à évaluer certaines actions, leurs motivations et ainsi le type de rationalité pragmatique ou instrumentale qu’elle mettent en oeuvre : elle peut ainsi consister à dénoncer ou blâmer le fait que certains individus disent ce qu’ils pensent que leurs sources de financement veulent qu’ils disent ou ce que ces dernières ont explicitement fait savoir qu’elles aimeraient qu’ils disent. L’accusation de corruption peut dans ce contexte avoir un sens, même s’il s’agit de « corruption douce ». Soit la thèse consiste à affirmer que la proximité avec ces milieux biaise les jugements des économistes et que leur position est ajustée à ce qu’ils ont intérêt à penser. Le sens du verbe « ajuster » diffère dans ce cas de celui qui gouvernait son usage précédent : il ne s’agit plus ici d’une conformation consciente à ce que des considérations intéressées dictent explicitement de faire. L’idée d’une production de mes croyances sur la base de raisons pragmatiques présupposerait en effet une forme de « volontarisme doxastique », à savoir la thèse selon laquelle il est possible de produire ses croyances à volonté. Or, cette thèse semble à première vue peu vraisemblable : d’une part, nous ne faisons jamais l’expérience d’une consécution entre telle intention de croire et l’avènement immédiat de la croyance en question suite à cette intention au sens où nous faisons celle, très ordinaire, de la consécution entre, par exemple, l’intention de lever la main et le fait de la lever conformément à cette intention ; d’autre part, comme l’a montré Williams[2], le volontarisme doxastique enferme une impossibilité conceptuelle : je ne peux en effet pas croire que p et croire simultanément que ma croyance que p provient de mon intention de croire que p en partie parce que considérer que ma croyance que p provient de mon intention de croire que p la relativise à mes propres yeux. La croyance est un état qui par nature vise la vérité. Or, savoir que je crois que p parce que je l’ai décidé pour des motifs pragmatiques implique la conscience du fait que je crois que p indépendamment de la considération de sa vérité. Si on considère que ma position sociale influence non pas mes actions mais, de manière imperceptible, ma pensée, le type de rationalité, ou plutôt dans ce cas le défaut de rationalité, dont il est question est non plus pratique mais de nature épistémique. Il s’agit, afin de comprendre cette contamination, de reconstituer le processus biaisé de formation de croyance au sein duquel mon intérêt s’est infiltré. Si le second cas de figure existe, ce qui semble peu contestable, il est tout simplement faux de considérer que les pressions prennent nécessairement la forme d’impositions directes comme si l’intérêt ne pouvait agir sur ma vie mentale que s’il était explicitement représenté comme tel.
Si l’on peut légitimement parler dans certains cas d’une influence insensible de l’appartenance sociale, et plus précisément ici de l‘intérêt social, sur les contenus auxquels l’économiste (ou n’importe quel autre agent) adhère, il est vraisemblable que, dans ces cas précis, lorsque ce dernier tente de justifier ses croyances et d’en énoncer les raisons, il livre ce que l’on appelle une « rationalisation » de sa position. L’un des problèmes centraux de l’épistémologie sociale consiste à savoir à quelles conditions les individus sont justifiés à croire en la fiabilité des émetteurs d’idées auxquels ils sont socialement exposés. Or, la rationalisation semble constituer une source potentielle de distorsion dans la diffusion d’idées. Cette éventualité ne doit-elle pas, dès lors, être thématisée par ce type d’épistémologie ? Toutefois, si la seule valeur objective des données ou des raisons importe, le fait de savoir si ces raisons qu’expose l’émetteur d’idées ne sont pas les causes réelles de son adhésion peut-il avoir une réelle pertinence épistémique ? Afin de répondre à cette interrogation, nous tenterons, dans un premier temps, de définir plus exactement le concept de « rationalisation ».
Qu’est-ce que la rationalisation ?
Le terme aura ici une acception différente du sens que lui donne Weber[3], pour qui la rationalisation désigne le devenir rationnel de notre compréhension du monde ainsi que l’extension de notre emprise sur lui. Nous l’entendrons, également, différemment de Davidson[4], selon qui la rationalisation renvoie à un certain type d’explication de l’action, à savoir celui qui mobilise les raisons qui constituent ses causes adéquates (les raisons pour lesquelles l’action a été entreprise) et qui, par conséquent, explicitent sa dimension rationnelle. Ici, le terme sera entendu selon le sens qu’il revêt assez couramment en sciences sociales. Le concept de « rationalisation » s’y réfère également à l’exposition de raisons mais en un sens opposé à celui que lui donne Davidson : il désigne l’activité de reconstruction des raisons d’une croyance, reconstruction qui implique la substitution de certaines raisons aux vraies causes ou déterminants de cette croyance, généralement conçus comme épistémiquement irrationnels. Plus précisément, la rationalisation peut être définie comme la reconstruction épistémiquement acceptable d’un processus de formation de croyance. On pourrait ajouter que cette reconstruction est également socialement acceptable : il est, par exemple, socialement plus valorisé de baser ses croyances sur des motifs épistémiques plutôt qu’affectifs et la non-conformité d’un discours à des normes épistémiques élémentaires peut avoir des conséquences sociales néfastes. On peut imaginer l’effet que produirait le discours d’un homme politique exposant des raisons très fragiles de croire aux idées en faveur desquelles il milite et affirmant, en guise d’explication de la fragilité de ces raisons, que ses convictions politiques reposent très vraisemblablement sur des considérations affectives. Le fait, toutefois, que la violation par un individu des normes d’acceptabilité épistémique puisse être un facteur de discrédit social n’implique nullement que les exigences, normes ou critères d’acceptabilité épistémiques puissent être réduits à des exigences, normes ou critères d’acceptabilité sociaux.
Retournons à notre définition. Pareto semble avoir fourni le mode de description paradigmatique de cette notion. Dans son Traité de sociologie, le sociologue italien parle du « vernis logique » par lequel nous recouvrons l’absence de rationalité de nos adhésions, c’est-à-dire l’absence de rationalité qui caractérise la manière dont elles se sont formées. Ces dernières auraient la plupart du temps pour origine des instincts et des sentiments. Cependant, l’homme, animal plus raisonneur que rationnel, éprouve le besoin de substituer des raisonnements, que Pareto nomme des « dérivations », à ces modes de formation affectifs ou instinctifs, c’est-à-dire de donner une forme épistémiquement acceptable à ces processus non-rationnels. Comme il l’écrit, « l’homme a une si forte tendance à ajouter des développements logiques aux actions non-logiques, que tout lui sert de prétexte pour s’adonner à cette chère préoccupation »[5]. Cette conception de la rationalisation en fait une activité postérieure à l’acquisition de la croyance, activité liée à l’exigence de justification. Cette exigence est, comme nous l’avions remarqué, épistémique et sociale. On peut ici reprendre l’idée, propre à Elster, selon laquelle la « hiérarchie normative des motivations » suscite « une tendance à présenter – à soi-même ou à autrui – une motivation située en bas de l’échelle comme occupant une place plus élevée »[6]. L’intériorisation de cette hiérarchie influerait donc sur la manière dont nous représentons nos motifs d’action. Cette idée peut être appliquée aux croyances, à cette différence près qu’en ce qui les concerne les motifs épistémiques ne sont pas les plus acceptables mais les seuls acceptables et que la hiérarchie normative des raisons de croire ne semble pas, contrairement à celle des raisons d’agir, intrinsèquement dépendante de facteurs sociaux. On comprend toutefois dès lors comment l’acceptation de cette hiérarchie normative suscite cette transmutation des raisons qu’est la rationalisation, c’est-à-dire comment elle nous incite à former une croyance de second niveau selon laquelle nous avons acquis telle croyance d’une manière épistémiquement irréprochable, ou, pour reprendre les termes de Alston[7], en ayant rempli nos obligations intellectuelles. Ainsi conçue, la rationalisation consiste en une adjonction rétrospective de raisons et n’a aucune incidence sur l’émergence de la croyance.
Toutefois, certains travaux de psychologie sociale[8] ont affiné notre conception de la manière dont se forment les croyances irrationnelles et nous permettent d’enrichir notre compréhension de la rationalisation. Selon ces auteurs, la contamination de nos croyances par nos désirs repose très souvent sur des processus inférentiels et implique un traitement sélectif des données. Ce traitement sélectif peut prendre la forme d’une attention moins vive aux raisons opposées à la croyance que l’on désire croire, d’une aisance moins grande à se remémorer tous les éléments qui pourraient constituer de telles raisons, d’un défaut dans l’évaluation de la plausibilité des données contraires mais également d’une faible propension à considérer spontanément des hypothèses alternatives à ce que l’on aimerait croire, d’une tendance à arrêter la collecte des données lorsque la croyance désirée est suffisamment établie et, plus généralement, d’une vivacité critique asymétrique[9]. On voit dès lors qu’une médiation épistémique est nécessaire. Cette médiation épistémique constitue une véritable contrainte cognitive : non seulement, comme nous l’avons vu plus haut, nous ne pouvons pas immédiatement croire que p du simple fait que nous le désirons mais il est n’est également pas possible de croire « à volonté » que p à travers ce type de processus indirects. Si nous ne disposons pas de données sur lesquelles notre traitement sélectif peut s’appuyer, nous sommes alors dans l’incapacité de former telle croyance désirée. La médiation est donc bien une contrainte. Dès lors, même à un niveau non-conscient, le désir n’agit pas mécaniquement et directement sur la croyance et les modes d’actions imperceptibles du désirs ne semblent pas illimités. Cette caractéristique ne remet donc pas en cause l’idée selon laquelle l’homme est en général sensible aux raisons et aux exigences épistémiques puisqu’une telle réceptivité, certes biaisée, se manifeste dans le processus de formation de la croyance. Ainsi, selon l’exemple de Klein et Kunda[10], si je m’attends à coopérer avec un individu appartenant à un groupe stigmatisé, mon désir de croire que l’interaction sera efficace et harmonieuse (qui est une conséquence de mon désir que cette interaction soit efficace et harmonieuse) influe sur mes croyances concernant cette coopération. Mais le façonnement de ces croyances par mon désir implique la modification de mes croyances concernant mon futur partenaire d’interaction lui-même. Admettons que je ne possède aucune autre information sur cet individu que son appartenance au groupe socialement stigmatisé. Je vais trier de manière sélective dans mon stock de croyances celles qui sont favorables au groupe, ou, du moins celles qui ne sont pas négatives, de façon à pouvoir inférer de cette croyance concernant le groupe certaines croyances particulières positives concernant mon futur partenaire d’interaction. Ce type d’étude tend d’ailleurs à montrer que la création de perspectives de coopération entre des groupes sociaux différents favorise la réduction des stéréotypes négatifs.
Quelles sont les conséquences d’une telle analyse sur le concept de rationalisation ? Si les processus biaisés de construction de croyance nécessitent une certaine médiation épistémique, on peut imaginer que les raisons exposées par la rationalisation ne peuvent être le fruit d’une pure reconstruction artificielle. Selon son sens classique, l’exposition « rationalisatrice » de raisons est la réinterprétation rétrospective du processus de formation de croyance : elle consiste essentiellement à y insérer artificiellement des raisons. Si les analyses exposées sont correctes, il est cependant plus vraisemblable de penser que la rationalisation reflète plutôt le processus biaisé de formation de croyances. Le raisonnement qu’expose la rationalisation ne serait ainsi pas postérieur à l’émergence de la croyance mais constituerait plutôt une composante du processus de construction de la croyance elle-même, processus de construction qui consisterait dès lors en un assemblage biaisé de données en vue d’établir la croyance désirée.
La construction de justification est dès lors interne à la formation de la croyance. L’irrationalité opère au niveau du traitement des raisons. La seule différence entre cette conception de la rationalisation, qu’adopte, entre autres, Kornblith[11], et le sens classique de ce terme est que l’exposition des raisons qu’est la rationalisation consiste non pas en une reconstruction mais en une restitution et, surtout, en une restitution partiellement adéquate des raisons qui ont présidé à l’émergence de la croyance. Cette restitution est toutefois fallacieuse car elle est incomplète : elle se focalise sur la dimension épistémiquement acceptable de son objet et demeure aveugle au fait que son processus est biaisé, à la nature des biais ainsi qu’à ce qui motive ces biais, par exemple le désir de croire quelque chose de réconfortant. Elle demeure en ce sens aveugle au caractère sélectif de cette sensibilité.
3. Quelques remarques à propos de cette notion
Nous pouvons tirer plusieurs conséquences de cette définition. Ces conséquences auront une importance pour la suite de notre propos.
Tout d’abord, la rationalisation implique une forme d’erreur. Cette erreur porte directement sur l’explication de ma croyance. En effet, la restitution rationalisante ainsi décrite est accompagnée d’une croyance spécifique : la croyance en l’autonomie explicative des raisons exposées, autrement dit la croyance selon laquelle elles constituent non seulement les vraies raisons mais également les seules raisons de la croyance en question. Il s’agit ainsi d’une croyance causale : pour reprendre l’exemple des économistes, et en admettant que leur intérêt social à croire certaines choses ait imperceptiblement opéré sur eux, ces derniers croient faussement qu’ils croient que la crise financière n’adviendra pas du fait de certaines raisons. Cette erreur caractérise ainsi, comme nous l’avons entrevu dans la seconde section, ce qu’on peut appeler une croyance de « second niveau », croyance qui prend précisément pour objet la croyance initiale. Cette croyance a un double dimension : en tant que croyance causale, elle est explicative et, en ce sens, descriptive. Elle porte en effet sur les raisons qui expliquent ma croyance, raisons auxquelles on accorde un rôle motivationnel. Mais en tant qu’elle porte sur des raisons, elle comporte également une dimension normative : les raisons justifient ma croyance. En donnant des raisons, j’accorde également un poids épistémique à ce que je pense, je ne me contente pas d’expliquer l’avènement de ma croyance mais je montre que ce qui m’a incité à croire milite également (ou pouvait sembler militer) en faveur de la vérité de la croyance en question – ce qui n’implique nullement que je pense que ma croyance est (ou était) de ce fait nécessairement vraie. Lorsque j’expose mes raisons présentes de croire que p, je peux ainsi espérer susciter chez autrui la croyance que p précisément parce que je montre à autrui que la croyance que p est épistémiquement légitime : l’aspect normatif des raisons est donc au moins potentiellement motivationnel.
De plus, si cette croyance causale de second niveau est une composante de ce qu’on appelle la rationalisation, alors seuls des êtres capables d’avoir des attitudes « méta-propositionnelles »[12] sont aptes rationaliser. Pour pouvoir se livrer à ce type d’activité, il ne suffit pas de pouvoir avoir des croyances. Il faut également être capable de les thématiser, par exemple de les expliquer, de les évaluer ou d’en rendre raison. Or cette capacité méta-propositionnelle implique bien, dans le cas qui nous occupe, l’aptitude à thématiser et à évaluer nos raisons de croire ou ce que nous pensons être nos raisons de croire. Dès lors, des êtres dont les croyances seraient causées par des raisons mais dont les raisons de croire ne pourraient jamais être identifiées comme telles, c’est-à-dire des êtres qui ne pourraient être affectés par des raisons en tant que telles, seraient inaptes à se livrer à l’activité de rationalisation : les raisons exerceraient sur eux une force motivationnelle dépourvue de tout poids normatif et leur incapacité à rationaliser proviendrait de leur inaptitude à mettre en oeuvre la forme de réflexivité épistémique requise.
Ensuite, l’idée de rationalisation implique une forme de sincérité chez le sujet qui rationalise : cette activité est en effet bien liée, comme nous l’avons observé, à une croyance causale. En cela, elle se distingue du mensonge : la substitution que nous évoquions précédemment n’est donc pas intentionnelle[13] puisque l’influence motivationnelle est imperceptible. On peut dès lors parler du processus de rationalisation comme d’une activité mais non pas comme d’une action mentale au sens strict puisqu’il n’est pas possible de « décider » de rationaliser : je peux bien décider de chercher consciemment des raisons qui vont dans le sens de ce que je désire croire afin de susciter de manière indirecte la croyance désirée mais, et nous retrouvons ici la réfutation du volontarisme doxastique, je ne peux pas décider de croire que ces raisons expliquent ma croyance en espérant que la croyance succédera immédiatement à cette décision.
En outre, la rationalisation est censée masquer l’irrationalité au moins relative d’une croyance. Lorsque nous disons d’une croyance qu’elle est irrationnelle, nous caractérisons ici son processus de formation. Cette composante dynamique de l’attribution d’irrationalité est cruciale. On considère en effet la plupart du temps une croyance comme irrationnelle en examinant la manière dont elle a été acquise. Une croyance obtenue, par exemple, par whisful thinking sera en effet considérée comme irrationnelle quand bien même l’individu possèderait par ailleurs les croyances qui auraient pu constituer une base épistémique adéquate pour la croyance en question. La rationalisation est dès lors souvent conçue comme la justification d’une croyance dont la possession nous procurerait une forme de plaisir immédiat, du fait, par exemple, du confort psychique qu’elle permet- ce qui ne signifie naturellement pas que nous ayons intérêt, sur le long terme, à faire nôtre cette croyance. Il est toutefois possible que nous conformions également, dans certaines situations, ce que nous pensons à des affects dominants déplaisants. On a pu ainsi montrer que la réduction de dissonance cognitive pouvait parfois, notamment dans le cas de l’adhésion au contenu d’une rumeur, passer par l’émergence de croyances justifiant des affects négatifs, comme la peur ou l’angoisse[14]. Afin de couvrir tous ces cas, nous parlerons plus généralement, et conformément à l’usage, de « croyances motivées ». Le type de motivation ici en jeu est d’origine affective et renvoie à des besoins psychiques non conscients. Il ne caractérise donc pas les motivations dites « épistémiques » qui peuvent, par exemple, inciter un individu à s’engager dans une délibération doxastique au cours de laquelle il évalue les raisons qui s’offrent à lui dans le but de former la position la plus juste sur tel sujet donné. C’est précisément cette dimension à la fois motivationnelle et affective que la rationalisation est censée recouvrir.
Il nous faut enfin distinguer la rationalisation épistémique, qui concerne principalement les croyances (et éventuellement d’autres états mentaux comme, par exemple, les acceptations, les suppositions, ou certaines émotions), et qui nous intéressera plus particulièrement ici, de la rationalisation pragmatique, qui concerne principalement nos actions, désirs ou intentions. La rationalisation pragmatique peut consister, par exemple, en la réinterprétation des raisons pour lesquelles j’ai désiré ou eu l’intention de faire quelque chose[15]. La substitution inintentionnelle porte ici directement sur une finalité : je pense que mon désir de X visait à produire tel état de chose alors qu’il visait en réalité à produire autre chose. Une réflexion de type psychanalytique sur mes faits et gestes peut m’amener à penser que je n’ai pas allumé la télévision pour regarder un film mais, inconsciemment, pour importuner mon père. Il existe dès lors une véritable asymétrie entre les deux types de rationalisation : si la rationalisation pragmatique masque les finalité véritables de mes désirs, intentions ou actions, la rationalisation épistémique recouvre la plupart du temps le fait que ma croyance était en réalité soumise à ce qui ressemble fort à une forme de finalité non-consciente, comme dans le cas où ma croyance que p est secrètement ajustée à mon intérêt à croire que p et où les raisons fallacieuses que j’exhibe n’ont servi qu’à rendre plus plausible à mes yeux et à consolider épistémiquement cette croyance dont la raison d’être réside en réalité dans cette conformité implicite. Or c’est précisément du fait de cet ajustement lui-même que ma croyance est épistémiquement irrationnelle[16]. On peut en ce sens dire que si la politesse est, comme l’écrit La Rochefoucauld, un « hommage que le vice rend à la vertu », la rationalisation est également une forme d’hommage rendu à la rationalité en ce qu’elle mime les vertus épistémiques, c’est-à-dire la sensibilité aux raisons[17]. En quoi ce phénomène peut-il toutefois intéresser l’épistémologie sociale ?
[1] Laurent Mauduit, Les imposteurs de l’économie, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, 2012
[2] Bernard Williams, « Deciding to believe » in Problem of the self, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, pp. 136-151
[3] Max Weber, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1964
[4] Donald Davidson, Actions et évènements, Paris, Vrin, 1993
[5] Vilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Paris, Droz, 1968, §180
[6] Jon Elster, L’irrationalité, Traité critique de l’homme économique II, Paris, Seuil, 2010, p. 100
[7] William P. Alston, « Concepts of Epistemic Justification », The Monist, 68 (1), 1985, pp. 57-89
[8] William M Klein, Ziva Kunda, « Motivated Person Perception : Constructing Justifications for desired Beliefs », Journal of Experimental Social Psychology, 28 (1), 1992, pp. 145-168
[9] Ziva Kunda, « The Case for Motivated Reasoning », Psychological Bulletin, 108 (3), 1990, pp. 480-498
[10] William M Klein, Ziva Kunda, « Motivated Person Perception : Constructing Justifications for desired Beliefs », op. cit.
[11] Hilary Kornblith, « Distrusting reason », Midwest Studies in Philosophy, 23 (1), 1999, pp. 181-196
[12] Philip Pettit, « Rationality, Reasoning and Group Agency », Dialectica, 61, (4), 2007, pp. 495-519
[13] Thomas S Knight, « A Note on « Rationalization » », American Speech, 34 (3), 1959, pp. 238-239
[14] Jon Elster, L’irrationalité, Traité critique de l’homme économique II, op.cit., p. 132
[15] Jonathan L. Cohen, An essay on Belief and Acceptance, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 65
[16] Le fait que le contenu d’une croyance soit façonné par des besoins psychiques inconscients est un exemple paradigmatique de processus irrationnel de formation de croyance. La caractérisation comme irrationnelle d’une telle téléologie inconsciente ne doit pas être confondue avec la réfutation de la conception téléologiste de la rationalité épistémique. Cette dernière consiste à nier que l’évaluation épistémique d’une croyance dépend de la finalité, épistémique ou non, que poursuit l’individu auquel elle est attribuée. Cf. Thomas Kelly, « Epistemic Rationality as Instrumental Rationality : A Critique », Philosophy and Phenomenological Research, vol. 66 (3), 2003, pp. 612-640.
[17] Nous nous concentrons dans ce travail sur la rationalisation entendue comme exposition verbale de raisons. Notre analyse ne portera donc pas sur ce qu’on a pu appeler la « rationalisation en acte » (Jean-Léon Beauvois, Robert-Vincent Joule, « A radical point of view on dissonance theory », in E. Harmond-Jones, J.Mills (sous la direction de), Cognitive Dissonance : progress on a pivotal theory in social psychology, Washington, American Psychology Association, 1999, pp. 43-70), c’est-à-dire le fait qu’une décision (ou une action) antérieure soit rationalisée non pas par des justifications idéelles mais par une nouvelle décision (ou une nouvelle action) qui atteste du bien-fondé de la précédente et tend donc à la faire apparaître comme rationnelle.









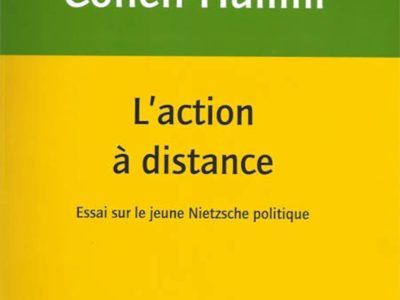
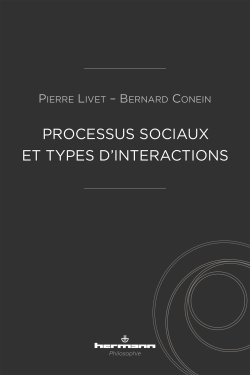




De Husserl à Satre en passant par Heidegger, ça sent bon l’épistémologie et l’existence d’être…