recension – le consentement meurtrier
« En ces temps terribles où la démence règne au nom de la gloire des États, des nations et du bien universel, en ce temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s’agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes et les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu[1] »
Florian Forestier • Docteur en philosophie de l’Université de Toulouse (Labo de rattachement : Équipe de Recherche sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (ERRaPhis, EA 5031)
Marc Crépon Le consentement meurtrier
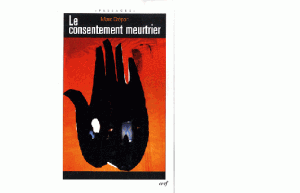
Notre existence, par sa simple quotidienneté, semble à la fois refouler et admettre l’invincibilité de la violence et de la mort. Les stratégies de cette accommodation sont multiples : ne pas y penser ou les penser indépassables – autre manière d’en nier le caractère abyssal en le peignant aux couleurs de l’état de chose – les dissimuler par des questions de droit… Cette concession à la violence peut être inconsciente ou affirmée avec bonne conscience. L’acceptation seule, en effet, est un premier degré du consentement, lié à la finitude. Par la passivité qu’elle implique, elle conduit à la revendication du bon droit qui affirme, en sus du caractère indépassable de cette violence. Si le monde est imparfait, il faut bien admettre que le bien soit lui-même toujours partiel, qu’il ne puisse exister sans contreparties… Dès lors cependant, la tentation est aisée d’affirmer que la fin en quelque sorte justifie les moyens, que nos mains sont nécessairement sales, qu’au fond le moindre mal étant ce que nous pouvons espérer de mieux, nous sommes coupables d’une bien plus grave compromission en refusant de l’accomplir. Les personnages de Camus, dans Les Justes, sont aux prises avec ce dilemme : si vous ne voulez pas tuer, dit l’un d’eux, c’est que vous ne croyez pas à la révolution ! Mais que sauvons-nous cependant avec ce moindre mal s’il n’advient qu’en faisant siens les voies et les chemins du mal ? Que penser, précisément, de cette révolution qui exige le sacrifice du présent à l’avenir – ne contredit-elle pas sa vocation même, en déniant ainsi le poids de l’existence immédiate et présente ? En fin de compte, « Comment (re)donner aux idées de justice, de liberté et de vérité quelque chance ou quelque possibilité de faire sens, sans qu’aussitôt elles « tournent mal » ou se retournent en leur contraire ?[2] »
Le monde imparfait et la responsabilité
Le monde est imparfait. Il est en quelque sorte blessé, brisé. Cette incomplétude évidemment nous appelle – mais cet appel vient bien aussi de ce que le monde manifeste, en tant que monde. C’est du monde que vient le cri qui nous invite à le restaurer – cette restauration, cette réparation, ne peut donc se faire contre la possibilité même du monde. Le plus grande violence selon Frédéric Worms, rappelle ainsi l’auteur, est l’acte de briser une relation humaine de l’intérieur de cette relation[3]. L’acte ultime du bourreau est de nier la singularité de sa victime, de lui dire : « tu n’es rien pour moi, il n’y a pas de monde en toi ». Le monde nous requiert parce qu’il est vulnérable – c’est ici, au présent, que cette vulnérabilité nous affecte, c’est en tant que présent que nous y sommes exposés, c’est l’exigence de notre présent même que la blessure aiguise. Comprendre les fondements du consentement meurtrier, esquisser une voie pour aller au-delà, ne relève donc pas de la problématique du soin, du Care (qui est plutôt de demander comment perpétuer et réparer notre monde) mais en découle, le prolonge. Elle revient à examiner la blessure même, à demander ce qui est cassé, disjoint, hors de ses gonds dans notre monde, et ainsi de comprendre en quoi cette blessure en manifeste une dimension essentielle, et révèle du même coup une modalité pour l’habiter.
La recherche de cette modalité invite, pour Crépon, au passage à la littérature. Celle-ci pense en effet sans assujettissement aux catégories philosophiques. Elle « fait vivre dans la langue l’espoir d’un lien qui prend le contre-pied de ces destructions[4] ». La singularité idiomatique de toute existence se manifestant dans la littérature (selon une formule de l’auteur qui en appelle aussi par-là aux résultats d’un autre pan de ses recherches), exprime la question du mal en ce qu’elle conjoint l’enracinement inextricable de la parole dans une singularité et l’espace de sens qui s’y ouvre pourtant. Parmi les auteurs cités ainsi, on comptera Freud, Levinas, Derrida, mais aussi bien Karl Kraus, Zweig, Camus, et de façon insistante, Vassili Grossmann. L’ensemble de l’œuvre et du questionnement de l’écrivain russe sont en effet emblématiques de ce qu’interroge Marc Crépon.
Les forces du consentement et la graine d’humanité
Pour Freud[5], guerres et atrocités nous ramènent à l’homme primitif. Le consentement meurtrier fait lui-même partie de la trame de notre relation à autrui : il procède de quelque chose d’organique, d’archaïque, d’une monstrueuse inertie végétative en nous-même. Il est à la fois fascinant et terrifiant, écrit Freud, de constater avec quelle facilité l’interdit du meurtre est levé par l’état de guerre, et avec quelle ferveur et quel enthousiasme les peuples se précipitent à l’holocauste. L’humanité, pour Freud, vit « au-dessus de ses moyens » en se contentant de refouler la mort qui l’habite. En écho d’ailleurs, dans Vie et Destin, on évoquera le dialogue entre les physiciens Strum et Tchépyjine, le second croyant en l’épanouissement infini de la vie et de la liberté qu’elle ouvre, le premier craignant qu’en s’épanouissant la vie déploie aussi démesurément le pouvoir de faire le mal, ne laisse derrière elle aussi bien Dieu que le diable. Mais alors, que fait-on, une fois reconnues ces « motions inconscientes » de notre rapport à la mort ? Peut-être, comme l’écrit Freud à Einstein, chercher ce qui nous lie à la communauté des mortels, comprendre la nature de ce lien qui implique une forme d’identification qui ne soit pas exclusive ou meurtrière…
Un exemple d’une telle identification apparaît dans Vie et Destin avec le manifeste d’Ikonnikov. Celui-ci retient l’attention de l’auteur, autant peut-être par sa propre force que pour la fascination qu’il a déjà exercée sur Levinas. Prisonnier avec d’autres d’un camp d’extermination, Ikonnikov préfère mourir qu’aider à construire une chambre à gaz. Avant d’être exécuté, il laisse un manifeste au vieux bolchévique Mostovksoï qui, avec d’autres dignitaires du parti communiste, méprise cette mort idéaliste et faible. Plus tard, au cours d’un dialogue resté célèbre, Liss, le chef SS du camp, explique à Mostovksoï que ce mépris, cette commune négation de l’homme, les rend symétriques l’un de l’autre. De fait le manifeste ne contient pas de théorie de l’histoire et du salut : il exalte une bonté gratuite, insensée, presque nuisible : la bonté d’une vieille femme qui nourrit le prisonnier responsable de la mort de ses enfants, d’une mère qui épargnerait la tarentule qui vient de piquer son enfant… Une bonté sans motif, fragile, fugace, éphémère qui ne suscite d’abord que la raillerie du vieux combattant, mais qui donne peut-être la clef de la pensée que Marc Crépon développe dans l’ouvrage, parce qu’elle procède, en son caractère infondé, absurde, insensé, d’une communauté et d’une fraternité engendrées par la vulnérabilité et la blessure. Elle donne une illustration de ce que signifie l’expression « nous les mortels » et exprime la forme de responsabilité qui s’y trouve impliquée[6]. Elles donnent également la mesure de ce que Marc Crépon appelle un « être contre la mort ».
L’histoire des hommes, écrit en effet Grossmann, n’est pas l’histoire de la lutte du Bien contre le Mal mais l’histoire du Mal luttant pour écraser la minuscule graine d’humanité. Ainsi, la petite et absurde bonté d’Ikonnikok manifeste qu’il y a, dans la relation entre les humains, quelque chose qui vient d’en deçà de la violence. Il y a peu, dès lors, de cette « bonté de grand-mère » à l’hyperbole levinassienne qui me rend responsable des actes mêmes du bourreau qui me torture. Le sens profond du renversement levinassien est en effet d’abord que quelque chose outrepasse et déracine mon enracinement dans l’existence ou plutôt que cet enracinement est toujours déjà travaillé par l’autre. Entremêlant Freud, Levinas, Derrida pour questionner le texte de Grossman, Crépon insiste ici sur ce qu’il y a de pulsionnel, de vital à cette forme de sensibilité à la vulnérabilité d’autrui : en quelque sorte, il s’agit de concrétiser la pensée levinassienne en insistant, plus encore que Levinas ne le fait, sur la façon dont la vie même nous expose à l’altérité. La vie nous charge en deçà de nos existences distinctes de liens de solidarité : elle ouvre une trame de la complicité qu’il s’agit de saisir comme disposition ou modalité existentielle fondamentale. Hospitalité, éthicité, participent d’un mouvement vital au même titre que le consentement meurtrier. Il s’agira aussi dès lors de comprendre la nature des forces qui engendrent la soumission, font taire l’appel de cette co-vulnérabilité pour rabattre les tendances vitales sur ce qu’il y a de plus morbide et exclusif en elles.
L’ère atomique
La méditation menée par Gunther Anders sur l’arme atomique et sur Hiroshima permet enfin de prolonger ces perspectives en les ouvrant sur l’espace de l’humanité tout entière. L’arme atomique constitue en effet l’apogée de la désindividuation du mal. Arme d’extermination anonyme qui prive bourreau et victime de tout face à face, détruit et défigure les hommes au-delà de toute trace d’humanité : ces ombres, ces tas de centres gémissants, ces gros lézards qui se trainent ne sont plus les amis que nous avons connus, les parents que nous avons aimés, ils sont devenus impropres à toute pitié, à toute empathie. Devant la bombe plus encore peut-être que devant les camps, donc, l’imagination fléchit. On peut être horrifié de tuer un homme, comment se représenter le fait d’en tuer un million ? L’usage de l’arme atomique se situe dans un espace où la conscience est aveugle, parce que hors de tout ce qui peut se lier à nos émotions, nos représentations, notre nature et notre conscience d’homme.
Ce faisant cependant, elle fait voler en éclat les anciennes frontières, l’ancienne image du monde, l’organisation géographique de la terre. En faisant de chacun le voisin de chacun, elle ouvre la possibilité d’une autre pensée du monde, d’un autre sens de la mondialité – une mondialité où tout lieu est contigu de tout autre dans la menace, une mondialité sans horizon. Cette médiation esquisse de cette façon peut-être le cadre d’un vivre avec qui chercherait à rassembler, à rapprocher les hommes autrement – dans l’ombre d’une vulnérabilité universelle.
C’est bien répétons-le la modalité même du rapport à soi-même qui doit subir une conversion. Nous sommes au monde, au hasard, au risque : nous ne pouvons être des anges, mais ne devons non plus être des bêtes. Que nous soyons jetés dans la violence et que nous y prenions part n’implique pas que nous en ayons le droit – que nous soyons justes, que nous fassions le bien. La préfiguration de cette communauté du monde et de l’humanité blessée pose cependant à son tour la question redoutable de notre relation aux animaux, et de la façon dont nous pouvons étendre jusqu’à eux la disposition qui a été dégagée : il ne fait aucun doute en tout cas, conclut l’auteur en évoquant Derrida, que « le spectacle que l’homme se donne à lui-même dans le traitement des animaux[7] » risque de devenir de plus en plus insoutenable.
La littérature et le partage de l’impartageable
Le consentement meurtrier donne en fin de compte une bonne illustration de ce que Marc Crépon entendait en appelant à entretenir un « Être-contre-la-mort », en retournant la formule heideggérienne de l’ « Être-pour-la-mort » et soulignant ainsi toute son ambiguïté sémantique[8]. Nous avouerons ici qu’un tel programme nous a d’abord laissé dubitatif lorsque nous avons pour la première fois entendu Marc Crépon l’exposer, lors d’une conférence proposée pour le colloque « Heidegger, le danger et la promesse » de Strasbourg, et de la table ronde qui suivit avec Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. À ce moment, certes, les thématiques de la substituabilité dans l’insubstituabilité ou de la comparution nous semblaient philosophiquement plus porteuses – en ce qu’elles défont de l’intérieur la logique de l’analyse heideggérienne pour y amener l’altérité. Le présent ouvrage nous fait cependant prendre la mesure de ce qu’une pensée de l’Être-contre-la-mort apporte d’inestimable à la question de la communauté. Si ces principaux ressorts – la singularité, le monde comme mondialité, contiguïté, espacement, réticulation – y apparaissent en effet, ils sont cependant repolarisés. Le monde post-atomique n’est pas seulement un monde dérangé, disloqué : il est un monde blessé, concrètement et effectivement blessé sur cette terre-là au prix de cette histoire-là. La rencontre des singularités n’est pas un effleurement, une croisée des regards : la question du mal polarise la singularité en l’envisageant à partir de ce qui pèse sur elle, de sa souffrance effective, de sa mortalité effective, en d’autres termes encore, de sa vulnérabilité réelle.
On pourra se demander, cependant, si une telle modalité de l’être-ensemble peut effectivement être appelée et cultivée. L’être-contre-la-mort n’a-t-il pas besoin d’une pesée exceptionnelle de la mort pour se déployer ? La fraternité des vulnérables ne luit-elle pas précisément qu’au creux de la tornade et du déchaînement du mal ? Ne naît-elle pas d’une lourde et franche pesée de l’ombre du mal – reproduisant contre son gré peut-être quelque chose de la logique du sublime kantien ? Peut-elle effectivement s’instiller au sein de l’anonymat ordinaire, indifférent du consentement meurtrier, sans qu’une crise manifeste ne la réveille ? Les exemples discutés par l’auteur sont à ce sujet parlants : guerres, batailles, famines… et le manifeste d’Ikonnikov est écrit dans un camp d’extermination… Les considérations conclusives sur la pensée d’Anders traduisent bien cette ambiguïté : il s’agit bien de dévoiler les conditions pour qu’une telle disposition s’active, mais celle-ci procède précisément de l’ombre permanente de la menace nucléaire, d’une possibilité d’anéantissement qui vient redoubler et dramatiser l’existence quotidienne… On pourra aller jusqu’à se demander si refuser tout consentement meurtrier, exiger qu’on vive désormais dans un monde blessé, où rien ne sera « plus jamais comme avant », ne risque pas précisément de consacrer la victoire du mal et de la mort, en les admettant au cœur et à la racine d’une vie qui risque de n’être plus que survie. Il y aurait en tout cas ici un débat très fin à mener sur le sens même d’un refus du consentement meurtrier et d’une assomption de la vulnérabilité du monde : assomption sans reste de la vulnérabilité, ou plutôt assomption d’une vulnérabilité à la vulnérabilité, refusant à la fois de refouler la mort et le mal et de les loger au cœur focal d’une disposition existentielle. Une confrontation de la perspective de Crépon à la lecture proposée par Alain Cugno[9] de Le concept de Dieu après Auschwitz[10] de Hans Jonas serait sans doute fructueuse pour cela. Elle permettrait de mettre en regard une perspective dédiée à la vulnérabilité et à la blessure, comme celle de Marc Crépon, à une approche comme celle de Cugno misant sur le risque et l’assomption du possible et de la promesse dans ce qu’ils peuvent avoir de plus inanticipable.
On pourra dans la perspective d’un tel affinement se demander si la réflexion sur la littérature ne pourrait pas, dans cet horizon, être poussée encore plus loin qu’elle ne l’est[11]. Son caractère exemplaire pour la problématique abordée vient, on l’a dit, de la puissance de témoignage qui l’habite, de sa façon de lier l’ouverture d’un espace d’intelligibilité à son inscription au creux de la singularité qui s’y loge – à la fois s’y dévoile et s’y retire, cœur clos nocturne du sens qui s’y dit et ne se dit qu’en faisant signe vers cette provenance. La littérature permet ainsi de dire ce qui ne se résume pas, ne se reformule pas, ne s’explique pas – qui se reçoit, s’entend : l’énigme du mal comme lamentation, comme appel, et la formulation de cet appel qui ménage par son seul dire l’espace de son dépassement. En cela, elle constitue peut-être déjà en elle-même une réponse au consentement meurtrier, exprime quelque chose qui vient d’en deçà et va au-delà de lui. La répétition du mal dans l’écriture témoigne de ce que sa victoire est impossible parce qu’il est impossible de consentir à cette victoire[12]. La littérature manifeste en d’autres termes à l’intérieur du mal la force qui le conteste, refuse l’écrasement – consentement qui est aussi consentement au silence, à un « ça va de soi » qu’il n’est même plus nécessaire de dire. L’art et la littérature, en rompant le silence au cœur de la langue, permettent une circulation de l’autre qui n’est pas l’être, de l’autre instillé dans l’être et refusent, en tous les temps, le triomphe du consentement meurtrier.
Florian Forestier
• Docteur en philosophie de l’Université de Toulouse (Labo de rattachement : Équipe de Recherche sur les Rationalités Philosophiques et les Savoirs (ERRaPhis, EA 5031)
Autres rattachements
• Membre titulaire du Centre d’études de la philosophie classique allemande et de sa postérité (CEPCAP, rattaché à l’EA 3552, Université Paris-Sorbonne)
• Conservateur chargé de collection à la Bibliothèque nationale de France (département littérature et art)
[1] Vassili Grossman, Vie et Destin, extrait du « Manifeste d’Ikonnikov. », traduction de Alexis Berelowitch, Paris : Flammarion, 2005
[2] Le consentement meurtrier, Paris : Editions du Cerf, 2012, p. 19
[3] Le moment du soin, Suivi de A quoi tenons-nous ? Paris : Presses Universitaires de France, 2010
[4] Le consentement meurtrier, p. 27
[5] « Considérations actuelles sur la guerre et la mort « (1915) in Essais de psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris : Payot, 1981
[6] Le consentement meurtrier, p. 28
[7] De quoi demain, Jacques Derrida, Elisabeth Roudinesco, Paris : Flammarion, 2003, p. 119
[8] Et développée en détail par Marc Crépon dans Vivre avec la pensée de la mort et la mémoire des guerres, Paris : Hermann, 2008
[9] L’existence du mal, Paris : Seuil, 2002
[10] Le concept de Dieu après Auschwitz, traduction Catherine Chalier, Paris : Rivages, 1999
[11] La forme même d’exposition mériterait, pour un tel sujet, d’être interrogée. Il y a une signification programmatique évidente à choisir la forme d’un traité philosophique plutôt que celle d’un essai : précisément, sans doute, de tenter d’ouvrir ce que révèle la « singularité idiomatique » de l’écriture sur une universalisation possible ; de ne pas se contenter d’appeler, mais de proposer
[12] On renverra encore au très bel ouvrage d’Alain Cugno, L’existence du mal : l’art, en sa capacité de nouer singularité et sens dans l’entre-deux du partage et de l’impartageable, atteste que nous n’évoluons pas dans un réel muet, mais au sein de « la plus narquoise et la plus mystérieuse des réponses ». D’une intelligibilité que le mal conteste, dont le choc en retour conteste à son tour le mal














