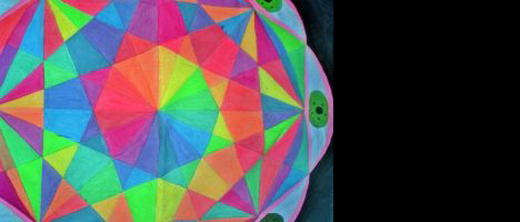L’identité menacée
L’identité est mise à mal dans le vécu particulier de la maladie d’Alzheimer, dans la mesure où elle est bouleversée par l’amoindrissement de l’emprise sur le réel. En tant qu’elle implique une dépendance effective et à venir, la maladie d’Alzheimer interroge la possibilité d’une survivance de l’identité dans la perte progressive de l’autonomie.
Peut-on penser un maintien, voire une évolution identitaire, dans le cas du vécu de la maladie d’Alzheimer ? La présente réflexion l’envisage par le biais de l’accompagnement, et notamment par la prise en charge dans une unité de soins spécialisée.

L’environnement de la personne.
Dans l’ouvrage Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer-Ethique, sous la direction de Emmanuel Hirsch et Catherine Ollivet[1], il est fait référence à une étude[2] selon laquelle un environnement enrichi aurait des conséquences favorables et diminuerait significativement les dépôts de peptides amyloïdes, c’est-à-dire les plaques séniles décrites par Aloïs Alzheimer. De plus, il stimulerait l’activation de gènes impliqués dans le processus d’apprentissage, de mémorisation et favoriserait la croissance neuronale.
Si d’une part l’environnement familier de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer lui est favorable car chargé de repères, et si d’autre part un environnement enrichi permet de retarder les effets de la maladie, il convient de penser que l’enrichissement de l’environnement familier de la personne est idéal pour son bien-être et le ralentissement de l’évolution de la maladie.
L’entrée d’une personne en institution semble dès lors ambivalente. Dans quelle mesure est-elle bénéfique à la personne en tant qu’elle bouleverse ses repères ? L’identité de la personne est-elle respectée lorsqu’elle est extraite de son environnement familier et habituel ? Est-il éthiquement correct qu’une personne puisse accéder aux soins présents dans une institution par le fait de ses possibilités financières ; considère-t-on une personne pour son identité et sa dignité ou ses moyens financiers ?
La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer nécessite des repères, des lieux familiers, stables pour éviter certaines situations d’angoisse et ne pas accélérer l’évolution de la maladie. Or, le lieu le plus familier et chargé de repères reste le lieu de vie, le logement de la personne. L’unité de soins spécialisée Alzheimer est de fait en marge d’un espace de soins traditionnel car elle implique d’intégrer le familier. La discrétion est de rigueur dans la prise en charge, afin que celle-ci reste une béquille et permette aux résidents de mettre en pratique le plus possible leur sens de l’initiative et que l’estime de soi demeure la plus préservée dans cette dépendance. Une telle structure pose la question de la liberté, la dépendance liée à la maladie impliquant un « enfermement ». La personne devient prisonnière d’elle-même car prisonnière d’une dépendance qui s’accentue et il s’opère alors une lente négation de toute de liberté. Avec l’évolution de la maladie, la personne, vivant dans le silence, ne peut plus faire entendre sa volonté, elle devient de ce fait totalement dépendante et est condamnée à dépendre des attentions qu’elle aura, ou non, et ce sans avoir décidé d’une relation de confiance.
De plus, l’environnement semble d’autant plus important que la personne n’est plus ou ne sera plus en mesure de le décrypter. En perdant la mémoire se perd également la compréhension d’un lieu. Lorsque tout un chacun arrive dans un espace, il s’habitue à cet espace, prend ses repères, le perçoit selon ses habitudes, centres d’intérêts, et il devient finalement son espace. Avec la maladie d’Alzheimer, cet espace ne serait jamais véritablement intégré et ne deviendrait jamais véritablement l’espace de la personne. Il est un peu comme un entre-deux entre l’espace familier où la personne a vécu et un espace étranger. La souffrance occasionnée du fait de la perte de la capacité de décrypter et mémoriser l’environnement peut être en partie comblée par son agencement dans le cas d’une unité de soins. Mais elle peut aussi être atténuée par la relation avec les soignants qui précisent par exemple la fonction des lieux et des objets dans leurs demandes.
L’accès aux institutions n’est pas permis à tous car il implique un engagement financier important de la personne ou de ses proches. Mais jusqu’où le rapport entre les moyens et l’humain est-il respectueux de l’humain lui-même ? En effet, la qualité de l’accompagnement et l’adéquation avec la maladie ne dépend pas toujours de la personne et de sa pathologie, mais de ses moyens, c’est-à-dire la fortune personnelle, l’attachement familial, la considération familiale. Selon la charte Alzheimer Ethique et Société 1997 « Toute personne atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée doit bénéficier des conseils, des compétences, des soins et des aides qui lui sont nécessaires. Les discriminations liées à l’âge ou à la maladie d’Alzheimer sont contraires à l’éthique médicale et à la loi. » [3] .Selon le principe catégorique kantien, une personne ne doit pas être considérée comme un moyen, mais une dignité ; si elle a un prix, il n’est pas financier. Or pour bénéficier de toutes les chances afin de retarder le processus de la maladie d’Alzheimer il faut pouvoir se les offrir. La chance n’est pas issue du hasard ici mais bien de l’aspect financier. Si nous pensons la personne en tant que dignité, il reste à savoir si elle est traitée comme telle si son accès aux soins est limité par ses moyens.
C’est ici un rapport à l’identité assez complexe. En effet, est-il possible, pour le système de santé et notamment les structures, d’envisager le patient sans considérer ses moyens financiers ? Le premier rapport à la personne est établi selon ses moyens, dans la mesure où cette personne va bénéficier d’un service, dans un premier temps elle est un patient éventuel aux moyens suffisants ou non. Mais toute la complexité réside dans le fait que ce service concerne le bien-être par l’accès aux soins, la sécurité, la considération, etc. L’identité personnelle n’est prise en compte qu’après avoir passé la sélection des moyens et de la pathologie dans la mesure où ils doivent correspondre à la structure. L’étude du dossier permet de définir si la personne correspond au profil, ce qui semble louable afin de pouvoir agir efficacement, selon la pathologie que le personnel connaît du fait de sa formation spécifique. Mais avant cela, la personne, pour pouvoir bénéficier des meilleurs soins, doit posséder les moyens de se les offrir. Toute cette ambiguïté dans l’accès aux soins réside peut-être dans le fait que c’est une relation d’accompagnement et non pas une thérapie curative. Les personnes ne sont pas accompagnées dans le but de guérir, mais en vue de ralentir le processus. L’inégalité se situe dans la notion du « prendre soin ». En effet, pour les personnes souhaitant être accompagnées ou pour les proches désirant passer le relais, l’inégalité entre ceux possédant les moyens de le faire dans les meilleures conditions et les autres se situe dans la dimension du « prendre soin » lié à l’accompagnement. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, la vie de la personne est engagée ; la notion d’inégalité repose donc sur le bien-être et le fait de prendre soin de la personne malade. Cette dimension est fondamentale dans la mesure où nous nous situons dans le cadre d’un accompagnement, voire du palliatif, et non curatif. Peut-on dès lors considérer le prendre soin tel qu’il est envisagé ici comme relevant du simple bien-être ou luxe en ce qu’il ne guérit pas ?
Peut-on, dans ce domaine de la santé, perdre sa dignité par la perte de ses moyens financiers ? Il existe une réelle ambiguïté dans le système de santé ici, manier ensemble impératifs économiques et souci éthique demeure complexe. Il convient d’être respectueux des personnes en ne les considérant ni comme des pathologies, ni des moyens, tout en étant dépendant de l’économie du système.
Le partage de la vie dans l’accompagnement.
Dans une institution, l’équipe, en tant que groupe de personnes ayant en charge des personnes vulnérables, possède une place et une importance primordiales. Ces professionnels, pratiquants ou en devenir, sont avant tout un groupe de personnes avec des caractères et des sensibilités différents mais allant dans une même direction, ce qui semble nécessaire à la complémentarité. Il paraît nécessaire de prendre soin de soi au sein de l’équipe afin de prendre ainsi soin de l’équipe pour pouvoir au mieux prendre soin des résidents dont le bien-être dépend largement. Le rapport au sein de l’équipe est fondamental dans l’accompagnement, il dépend de différentes interactions avec les familles et leurs membres, les professionnels constituant l’équipe et les personnes formant le groupe de résidents. L’accompagnement et sa réussite sont tributaires d’un environnement global.
La maladie d’Alzheimer donne lieu à des troubles du comportement ; une personne peut être souriante, agréable et devenir agressive ou dépressive l’instant d’après sans raison évidente. Il est donc nécessaire pour le soignant d’avoir un certain recul et une formation spécifique afin de ne pas prendre cette réaction « pour soi ». Chacun possède ses limites, et en tant que responsable de personnes vulnérables il paraît indispensable de les connaitre et de pouvoir avoir une relève lorsqu’éventuellement cette limite est atteinte, afin que le malade ne soit pas considéré comme objet de soins, mais comme sujet de soin(s). Le défi est peut-être de savoir et pouvoir jouer avec les parties professionnelle et personnelle constitutives de la personne soignante, en vue de préserver le bien-être du résident, mais aussi celui du soignant.
La confrontation à la maladie d’Alzheimer implique une relation de soins particulière dans laquelle les valeurs personnelles occupent, implicitement ou non, une place, et peuvent être sollicitées. Il est possible de trouver ici un parallèle avec l’éthique du care ou de la sollicitude, plus particulièrement concernant la place donnée aux émotions ainsi que l’idée de souci et de l’autre. Cette relation de soins implique le fait de prendre soin de la personne nécessitant également des soins médicaux. Les deux notions de soin sont présentes. Et si la relation entre la personne malade et la personne soignante reste inégale, un échange est possible, et cette dimension est présente dans la notion même du « prendre soin ». La relation possède une part d’asymétrie, mais elle ne va pas uniquement dans le sens du soignant vers le malade, dans « prendre soin » est présente la notion de prendre. En prenant soin, la personne dont on a soin bénéficie d’un service, et la personne soignante peut certainement en tirer un enseignement.
Un lieu de vie.
Dans le cas d’une unité de soins spécialisée, nous nous situons dans un lieu de cohabitation où les personnes sont hébergées de manière souvent permanente pendant un temps relativement long, écourté occasionnellement seulement. Par conséquent, résidents et soignants se connaissent petit à petit, et il ne semble pas incohérent de dire qu’ils partagent un bout de leur existence : existence professionnelle au moins pour le personnel, existence personnelle pour les résidents. Certains moments de la vie quotidienne sont partagés, notamment le moment de la toilette. Ce cas particulier constitue un moment très intime, et même si le soignant n’est qu’un accompagnant et doit autant que possible stimuler la personne pour qu’elle conserve son autonomie, cela n’est pas toujours possible. Ce moment de la toilette représente un moment de partage dans la mesure où le résident donne d’une certaine manière la permission au soignant de rentrer dans son intimité, permission que le soignant respecte en retour. Le fait de considérer d’emblée la personne dépendante comme dépossédée de ses moyens reviendrait à une forme de violation de l’espace intime et, de ce fait, de l’identité ; comme si son corps ne lui appartenait plus de par sa difficulté à le gérer. Respecter une forme d’autonomie de la personne et prendre le relais de manière discrète représente ici une réelle forme de respect. Et ce, même s’il est évident que l’autonomie se dégrade, qu’une tentative de préservation de celle-ci ne peut être que provisoire et qu’elle se perdra nécessairement et continuellement dans la maladie. Le traitement ressemble davantage à une forme d’accompagnement palliatif que curatif du fait de l’impossibilité de passer outre la maladie.
Parler de respect de l’autonomie peut paraître hors contexte dans le cas d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer en relation de dépendance lourde. Ce respect de l’autonomie en tant qu’elle se perd se situe au cœur de la relation de soins. En mettant en place un lieu de vie plutôt qu’un pur lieu de soins est permise une forme d’autonomie encadrée.
L’importance accordée aujourd’hui à l’autonomie fait que parler de sa perte nous dur, comme si cette notion déterminait la valeur d’une personne. Mais cette perte est d’une certaine mesure comblée par l’évolution commune dans un lieu structuré et adapté, permettant aux malades de se sentir capables d’évoluer, de prendre part à la vie de la collectivité, malgré toutes les défaillances provoquées par la maladie. Veiller au maintien d’une certaine vie sociale, même si principalement restreinte à l’unité, permet le maintien d’une estime de soi, d’un sentiment de dignité et permet d’éviter la « mort sociale ». D’une part, les personnes peuvent conserver une partie de leur vie personnelle « comme avant »,par le respect notamment de leurs heures de coucher habituelles. D’autre part, un certain sentiment de sécurité est présent dans la mesure où certaines situations angoissantes sont évitées par le guide que représente la personne soignante. Car il convient de parler de guide : la personne est accompagnée dans ses gestes et entreprises plutôt que remplacée et spectatrice d’une existence sur laquelle elle n’a plus d’emprise. Et c’est peut-être ici que se jouent le maintien du sentiment de dignité et de l’identité de la personne.
La division du soi, le soi et le soi social.
L’un des nombreux enjeux d’une structure est de savoir préserver une dimension sociale à la personne malade, dont l’autonomie très restreinte l’empêche de vivre « comme avant », dans un espace clos et sécurisé. Comment intégrer ces deux aspects et maintenir à la fois l’identité personnelle et sociale tout en prenant en compte la forte dépendance et tendance à perdre la faculté de communication, garante de l’existence sociale ?
C’est en ce sens que ces structures sont « limites ». D’une part elles tentent de conserver la notion de soi de la personne avec le respect de l’histoire personnelle, des habitudes. D’autre part la notion de soi social est considérée. Cependant, il semble difficile d’admettre que le soi et le soi social puissent être totalement préservés. La dépendance en elle-même semble aliéner une part du soi dont la personne aidante se fait la garante. Et le soi social est fatalement réduit dans la mesure où la personne malade vit dans un milieu sécurisé et entourée de personnes non choisies. L’idéal serait donc de maintenir un équilibre entre les deux, équilibre qui ne pourra être ni stable ni garanti du fait de l’évolution de la maladie.
Deux facettes du soi se distinguent. L’une pouvant être qualifiée de personnelle, ne semble pas véritablement modifiée ; à un certain stade de la maladie néanmoins la perte de l’expression orale sera un signe de son altération. Cette part du soi correspond au « je » et s’illustre par exemple par une expression particulière pour une situation particulière. Ainsi, si nous disons « allons-y » à Madame M, elle rétorque « en avant les braves ! » de manière systématique. Cette part personnelle du soi semble toujours présente, l’humour, partie du caractère, demeure.
Le soi social semble également subsister, mais plus difficilement. Une personne se construit de par son passé et son présent. Le présent étant ici flou et incertain, il semble primordial d’avoir des points d’attaches. Pour le soi social, ces points d’attaches sont sans doute des personnes, des situations qui ne sont pas présentes dans l’unité. De fait, certaines personnes reproduisent intérieurement ces situations passées en faisant l’amalgame avec des situations présentes. Pour justifier ce présent en perte de sens, elles font appel au passé par le biais d’associations. Ainsi, Madame D, ayant eu une vie sociale assez développée, considère le moment de la collation journalière comme une invitation chez des amies, et s’excuse en repartant dans sa chambre de se retirer dans ses appartements. C’est comme une tentative de maintien de l’identité sociale, dans la mesure où il semble compromis de continuer à la construire. La menace porte peut-être dans un premier temps sur le soi social avant de porter sur le soi « je ». Ceci implique que les autres représentent une aide, une nécessité à la continuation de la construction de soi. Ici apparaît l’importance de l’identité narrative[4], l’importance du se raconter soi-même, d’une part dans le maintien de cette identité sociale, même s’il passe par des associations. D’autre part dans le maintien de l’identité personnelle, car se raconter soi-même implique un sujet actif, parlant à la première personne du singulier.
L’identité menacée.
La perte de mémoire dans la maladie implique notamment la perte de l’histoire personnelle, de l’emprise sur le réel et de la possibilité de se raconter au terme de la maladie. Sans garder cet aspect en tête, ou s’il n’est pas connu, il est possible de penser que la personne répète volontairement des phrases, ou encore qu’elle « oublie ce qu’elle veut ». Elle est dans la souffrance de ne plus pouvoir gérer son quotidien, ses activités habituelles, et les moments de « lucidité »[5] représentent une réelle souffrance. Concernant cette perte d’emprise et de jugement sur le réel un passage de Devant ma mère est assez parlant :
« Puis ses activités se raréfièrent, elle n’y parvenait plus seule, cessait de pouvoir distinguer les jours de la semaine (…) et quand le calendrier flotte, comment la pensée pourrait-elle se maintenir au poste d’une vie ? Il faudrait accepter ; elle s’y refusait toujours ; de se confier à la sollicitude de quelqu’un d’autre qui prendrait en charge l’organisation de votre temps. Je la cueillais, essoufflée, dans la rue où elle traînait un chariot à provisions trop lourd pour elle, dans la supérette où elle errait, ne distinguant pas les rayons ni les produits. Puis elle se mit à imaginer qu’elle avait des rendez-vous, s’y dirigeait à des heures absurdes, devenait inapte à mener sa vie seule, refusait de l’accepter. »[6]
Cette perte de la mémoire et de soi dans son indépendance est désormais au cœur de l’existence de la personne. La conversation ne peut plus être alimentée de faits nouveaux qui sont oubliés, elle tourne autour de faits anciens, parfois rapportés au présent. Il n’est pas rare que des personnes présentes prennent le rôle de personnes absentes ou décédées. Les moments du passé se substituent à ceux du présent, faute de mieux, pour combler le vide dû à l’absence de la mémoire à court terme.
Dans la maladie, c’est le moi lui-même qui est mis en péril. Il est un passage où la maladie pose la question de la possible ou impossible conservation du soi dans la perte de la mémoire. Cet aspect est peut-être plus présent pour la famille qui commence à trouver son parent changé, ses gestes incohérents, ses paroles étranges. Selon P-M Charazac[7] il existe dans les déterminismes de l’histoire subjective de la maladie des dynamiques qui travaillent l’histoire individuelle et familiale, notamment le déni. Tout d’abord survient le déni de la maladie, ensuite des moments de levée de ce déni qui sont généralement deux. La première est « lorsque la maladie fait passer de la conservation de la mémoire à la conservation de soi »[8] et la seconde « lorsque la communication avec le malade se retire de la parole pour se rabattre sur le comportement »[9], ces moments sont donc plutôt vécus par la famille et l’entourage. Le déni serait un mécanisme de défense, peut-être afin de se défendre contre un glissement, une certaine perte identitaire. Parfois, au moment de l’aide pour sa toilette, madame D. disait être chanceuse de n’avoir pas besoin d’aide, et avoir de la compassion pour les personnes ne pouvant « se débrouiller seules ».
Ce refus d’accepter la maladie par la personne malade est peut-être un refus de cette partie de soi sur laquelle elle perd le contrôle. La particularité de cette maladie est qu’elle porte sur l’identité, dans la mesure où cette partie de soi sur laquelle le contrôle diminue correspond à l’histoire personnelle, au vécu propre, à des années de vie dans lesquelles d’autres personnes sont intégrées, et durant lesquelles l’identité personnelle se construit. La souffrance est la perte elle-même de cette histoire identitaire personnelle. C’est en ce sens que l’identité semble menacée, d’une part par ce que l’histoire passée de sa construction et son évolution se perd, et d’autre part du fait que son évolution présente dans la capacité à intégrer les évènements est mise en péril.
Histoire et identité sont étroitement liées, et c’est peut-être ici que se joue, par le maintien de l’une, la conservation de l’autre.
L’histoire personnelle et l’histoire de vie dans un dossier.
L’histoire personnelle de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est composée d’unions, de ruptures… de tous les évènements marquants d’une vie, c’est l’histoire que chacun possède. En discutant avec Madame D., on s’aperçoit qu’elle raconte toujours les mêmes anecdotes, certaines actions ou certains mots renvoient toujours aux mêmes histoires. Ces discussions semblent nécessaires dans le but d’apprendre à connaître la personne autant que possible afin d’accorder au mieux la relation de soins, en évitant les situations sources de stress ou d’angoisse.
La discussion est un moyen d’exister, de se raconter, de réaffirmer son identité et, pour le soignant, elle permet de ne pas réduire l’histoire de la personne à une histoire de vie dans un dossier. Réduire la personne à ses informations civiles, sa mutuelle ou encore une grille d’évaluation de la dépendance ne suffit pas. Se référer seulement à cette évaluation reviendrait à enfermer la personne dans sa pathologie et ne la considérer que comme une pathologie. Le dossier est une composante importante dans la mesure où il informe sur la personne et contient des informations personnelles et officielles. Mais ce dernier correspond principalement à l’histoire évolutive et actuelle de la maladie plutôt qu’à celle de la personne elle-même.
L’identité de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer semble construite de trois histoires. La première correspond à son histoire personnelle et antérieure à la maladie, des souvenirs, des anecdotes, etc. La seconde correspond à l’histoire de la maladie, son évolution, ses constantes. La dernière est une histoire en construction, une histoire floue mêlant un peu les deux autres, une histoire pleine de doutes, d’interrogations, et parfois un peu fuyante, c’est l’histoire personnelle du vécu de la maladie d’Alzheimer, celle qu’il s’agit de construire dans l’accompagnement.
Il semble nécessaire pour les personnes malades de pouvoir parler d’elles-mêmes pour conserver l’identité personnelle, le premier type d’histoire évoqué, mais aussi pour continuer à construire l’identité dans la maladie, cette identité qui continue d’écrire et de raconter une histoire. Se raconter peut apparaitre comme un moyen de ne pas se perdre, de maintenir son identité, comme une prise sur le réel. Cela implique évidemment une possibilité de narration qui devient de moins en moins évidente. Et si ses propos n’ont une cohérence que pour la personne malade, des termes et des idées sont bien récurrents. Il semble donc que, malgré l’incohérence extérieure, la personne continue à se raconter, se maintient à l’aide d’images familières. L’interaction de l’échange est rompue, mais pas la communication. Malgré une forte atteinte à la mémoire, les personnes malades paraissent être en mesure de situer l’expérience de la maladie dans leur propre histoire, et cette imbrication des deux histoires est peut-être une façon de maintenir le sens de l’identité. Même si le sujet est quelque peu difficile et délicat à aborder avec les personnes, celles avec qui j’ai eu l’occasion non provoquée de le faire ont parlé de leurs problèmes de mémoire, et de leur dégradation intellectuelle. Elles ne semblent pas dupes, même si Alzheimer n’est pas employé. Et la perte, la diminution est d’autant mieux tolérée si l’accompagnement est suffisant et ne fait pas ressentir la dépendance comme source d’une perte de temps ou d’un stress. La personne n’a donc pas le sentiment d’être indésirable du fait de sa dépendance, elle est moins susceptible de subir une baisse d’estime de soi ou un repli. Elle peut, par le respect de son identité et de son soi, maintenir son estime, continuer son histoire et préserver son identité façonnée par son passé personnel, par son présent avec la maladie et ses conséquences.
L’histoire de vie présente dans le dossier ne serait qu’un point de départ pour la connaissance de la personne et pour encourager les soignants à l’aider à se raconter. La notion d’écoute, parfois même face à une certaine incohérence narrative, semble primordiale, chaque parole étant l’expression d’une identité. Laisser la personne se raconter, de quelque manière que ce soit, parait indispensable dans le but de permettre le maintien d’une histoire passée, mais aussi avec l’intention de construire une histoire présente. En somme, en vue de respecter l’identité de la personne avec ses failles.
La modification du rapport à la temporalité.
La perte de la mémoire liée à la maladie d’Alzheimer modifie le rapport à la temporalité engageant un passé, un présent et un futur. Le passé se mélange parfois avec le présent dans la confusion, la notion de temps entre les faits passés de longue date et ceux plus récents est floue. Le temps n’est plus clair et utile afin de se situer, mais problématique, source d’angoisse et de confusion. Les évènements ne se suivent plus de manière logique du fait de l’oubli ou de la mauvaise situation temporelle. Le temps possède donc une part d’absurdité et la narration des évènements souffre de ce fait d’une certaine incohérence. La notion du temps est perdue.
La souffrance est ici la soumission à l’absolu présent dans la mesure où le passé devient confus, et la notion de devenir perd de sa probabilité. Il devient difficile de se raconter soi, l’identité est mise à mal du fait de ce rapport compliqué au temps. La souffrance en elle-même modifie le rapport à la temporalité, et dans le cas de la maladie d’Alzheimer elle est aussi conséquence de la perte d’emprise sur la temporalité.
Nous pouvons distinguer deux présents dans le cas du vécu de la souffrance liée à la maladie, d’une part le présent statique, un oubli du soi soumis à l’absolu présent, et d’autre part le présent du devenir, celui de la projection. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, c’est la rupture temporelle qui est source de souffrance et il semblerait que la rupture temporelle précède et provoque la souffrance. La soumission à l’absolu présent est telle que la notion de projection devient difficilement envisageable. Les trois histoires identifiées précédemment prennent ici toute leur importance. En effet, s’il ne semble plus envisageable pour la personne de continuer la construction de son soi dans la continuité de l’histoire précédant la maladie, elle continue à se construire et évoluer dans le cadre de l’histoire avec la maladie. La personne atteinte de la maladie avance avec de nouveaux repères dans une dimension floue, pleine d’interrogations, de doutes et à l’aide de diverses béquilles. C’est en ce sens que l’accompagnement est une manière de préserver son identité. Cette aide n’est pas seulement physique, c’est aussi la garantie du maintien de l’identité dans ce qu’elle a d’évolutif. En ce sens, l’enjeu de l’accompagnement est majeur, il devient en quelque sorte le garant de l’identité et de sa continuelle construction. La souffrance est ici véritablement la soumission à l’absolu présent, souffrance de soi, de n’avoir plus la maîtrise. Le refuge du soi est condamné, il devient impossible de s’y retrancher, car c’est bien ce soi qui fait souffrir. C’est pourquoi l’accompagnement devient primordial afin d’aider à la conservation du soi et de l’identité personnelle.
Une relation d’équilibre.
La maladie d’Alzheimer implique une relation de soins particulière où il est indispensable de trouver un équilibre afin d’une part de préserver une forme d’autonomie et l’identité de la personne souffrante, et d’autre part d’assurer sa sécurité. Le respect de l’autonomie est ici problématique, il concerne le respect des avis de la personne, même si dans l’évolution de la maladie il devient difficile de pouvoir parler honnêtement de consentement éclairé. Il ne semble pourtant pas légitime d’opter pour un comportement purement paternaliste. C’est ici que se joue tout l’équilibre de la relation de soins : prendre soin de la personne très vulnérable sans pour autant prendre les devants et décider pour elle. Ne pas consulter la personne, de quelque manière que ce soit, revient à bafouer ses droits.
Il s’agit d’agir au nom de personnes ne parlant plus en leur propre nom sans pour autant agir à leur place. La nuance se trouve peut-être dans le fait d’agir avec elles et non pas à leur place, agir main dans la main et en respectant leur identité individuelle. Il convient alors de s’adapter à la personne vulnérable et fragilisée intellectuellement, à ses actuelles compétences afin de lui permettre d’utiliser son pouvoir de décision. Il est de fait nécessaire d’adapter la communication afin de rendre l’information accessible et les choix envisageables.
Mais lorsque la communication devient trop difficile, comment respecter ce droit de décision de la personne ? Il est peut-être envisageable de n’avoir plus véritablement un accord ou un désaccord prononcé mais un assentiment ou une forme de protestation. Dans ce cas, la personne est toujours prise en compte, même si son consentement n’est pas clairement exprimé. Selon Fabrice Gzil[10] :
« Lorsqu’il s’agit de savoir si le patient est en mesure de choisir entre deux alternatives de traitement, on cherche ainsi à déterminer (1) s’il comprend qu’il a un pouvoir de décision et s’il veut l’exercer, (2) s’il apprécie correctement la situation médicale, la nature des soins recommandés, les bénéfices et les risques de chaque alternative, (3) s’il est en mesure de rendre raison de son choix en prenant en compte les risques et les bénéfices, (4) si la décision est relativement stable dans le temps et globalement cohérente avec les valeurs et les intérêts du patient. »
Dans les faits la question de la limite entre respect de l’autonomie, capacité décisionnelle de la personne et prise en charge par le soignant se pose fréquemment. Par exemple, lors des soins donnés aux personnes malades l’une ou l’autre ne souhaite pas prendre ses médicaments d’ailleurs souvent destinés à soulager une douleur quelconque ou à soigner des pathologies antérieures à la maladie. Quel comportement avoir alors ? Laisser la personne ne pas prendre son traitement car tel est son choix ou bien la forcer à le prendre en estimant que c’est pour son bien ? En admettant que la personne, en tant que personne ayant le pouvoir de décision, est libre de décider, il conviendrait de se soumettre à sa décision, aussi potentiellement nuisible soit-elle. En admettant que pour son bien, il est indispensable qu’elle prenne son traitement, que cela relève de la responsabilité professionnelle du soignant d’assurer sa régularité, alors il convient de faire usage de la contrainte. Il s’agit d’allier d’un côté la bienveillance liée à la volonté de faire au mieux et le respect de l’autonomie amoindrie. En considérant la personne comme sujet de désirs, d’envies, de volonté il convient de les prendre en compte, c’est pourquoi une écoute est nécessaire. Une explication de personne soignante à personne souffrante, de personne à personne, de l’utilité de ce traitement peut être une solution dans la mesure où la capacité décisionnelle de la personne ainsi que son autonomie sont respectées. La personne n’est dès lors pas considérée comme simple objet de soins. Mais il faut admettre la possibilité d’une telle communication. La relation de soins équivaut aussi à une discussion, une prise en considération de l’autre, un dialogue perpétuel, parfois au-delà des mots, une relation dialogue afin de prendre soin tout en ayant soin. Ce dialogue est en quelque sorte le soin lui-même en tant qu’il est prise en compte de la personne ; il implique que ces trois notions : respect, dignité, respect de la personne en tant qu’identité, font nécessairement partie du soin lui-même.
Dans un premier temps il semble plus envisageable de parler de maintien de soi plutôt que d’envisager toute forme de construction identitaire dans la maladie d’Alzheimer. Or, en admettant les différents temps, impliquant différentes histoires (évolution de la maladie, avant la maladie, celle incertaine et floue de la personne présentement), ce maintien semble finalement posséder une dynamique. Par la sauvegarde de l’identité en tant que respect de la personne en souffrance mais aussi en devenir, la personne qui accompagne permet au malade de continuer la construction de son soi. Même si le malade se raconte de manière différente, il se raconte et se pose en sujet dans ce récit, et tant qu’il est considéré comme tel, et même si lui-même ne le fait plus, il reste le sujet de son existence. Là où les personnes qui accompagnent, deviennent la garantie du respect de la personne en tant que dignité, en tant qu’identité même en proie à l’oubli, comme un devoir de mémoire.
L’avancée dans la maladie implique nécessairement la perte d’autonomie, le but est bien de retarder le plus possible cette perte, mais elle est incontournable et survient petit à petit. L’accompagnement permet un passage de relais progressif, respectueux de la dignité alors qu’une communication devient très difficile à établir. La relation entre la personne souffrante et celle qui accompagne ne se limite pas à une relation où le soignant répond aux besoins du souffrant. Toute l’importance des personnes accompagnantes réside peut-être dans le fait qu’elles portent la responsabilité de la cohérence des trois histoires de la personne malade et permettent de faire le lien logique alors que celui-ci paraît absent. En ce sens, la relation de soins repose largement sur le fait de prendre soin de la personne en la respectant pour ce qu’elle a été, ce qu’elle est, et ce qu’elle sera, en somme pour son histoire et son identité.
Anabelle Benoit
[1] Emmanuel Hirsch et Catherine Ollivet, Repenser ensemble la maladie d’Alzheimer-Ethique, soin et société Paris, Vuibert, 2007, p. 90.
[2] Lazarov O, Robinson J, Tang Y, Hairston I, et al., Environmental Enrichtment Reduces Abeta Levels and Amyloid Deposition in Transgenic Mice, Cel, 2005.
[3] Voir annexe A : Charte Alzheimer Ethique et Société 1997. « 1/ Assurer à la personne malade l’accès aux soins, la compensation des handicaps et la prévention des facteurs aggravants. »
[4] Voir Paul Ricœur à ce sujet.
[5] Le terme lucide n’est pas compris comme l’inverse de la folie, nous entendons ici le fait de se rendre compte de la perte, difficile à vivre, de ses capacités, et notamment ici de la perte de mémoire et d’adaptation à la vie quotidienne.
[6] PACHET Pierre, Devant ma mère, Paris, Gallimard, 2007, p. 98-99.
[7] Pôle de gérontopsychiatrie, C.H. Saint Jean de Dieu, 290 route de Vienne à Lyon, dans la revue Francophone de gériatrie et de gérontologie, tome XVI, avril 2009, numéro 154.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Gzil Fabrice, Collège de France, article « Consentement et autonomie dans la maladie d’Alzheimer », revue PSN, Springer Paris, Vol. 6, Num. 2, mai 2008.