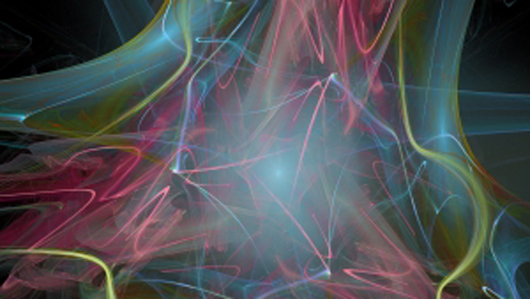Éternelle modernité de la démocratie athénienne
Dans le cadre du partenariat avec NonFiction.fr, vous pourrez trouver ci-dessous la recension (légèrement modifiée) par Romain Karsenty de Thucydide, la force et le droit, paru au Seuil
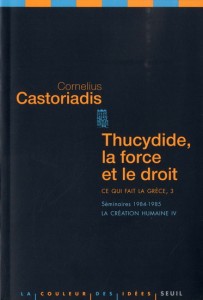
Sous le titre Thucydide, la force et le droit, les éditions du Seuil publient douze séminaires que Castoriadis a consacrés à la Grèce ancienne en 1984-85. Ils forment le troisième et dernier volume de « Ce qui fait la Grèce », ouvrage qui reprend l’enseignement que l’auteur de L’Institution imaginaire de la société a dispensé entre 1982 et 1985 à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) où il professa pendant quinze ans.
Philosophe, économiste et psychanalyste gréco-français, Cornelius Castoriadis (1922-1997) était aussi militant révolutionnaire (fondateur du groupe Socialisme ou Barbarie et animateur de la revue du même nom de 1949 à 1967) et la perspective dans laquelle il se place est explicitement politique. Son point de vue n’est donc pas celui d’un historien de la Grèce ou de la philosophie, malgré sa maitrise remarquable de ces deux domaines. Le programme qui guidera jusqu’au bout sa lecture des Grecs anciens est clairement énoncé : « Comment s’orienter dans l’histoire ? Comment juger et choisir ? C’est de cette question politique que je pars – et dans cet esprit que je m’interroge : la démocratie antique présente-t-elle quelque intérêt politique pour nous ?[1] »
Entre 1982 et 1985, l’attention de Castoriadis s’est tout particulièrement portée sur la Grèce du VIIIe au Ve siècle avant J.-C., segment spatio-temporel « privilégié » de notre histoire, disait-il volontiers, puisque c’est à ce moment et cet endroit précis que sont apparues pour la première fois, conjointement et simultanément, la philosophie (comme mise en question des représentations et croyances admises) et la démocratie (comme mise en question des institutions et règles sociales établies). C’est donc à partir de cette double création historique décisive – à la fois au niveau de la pensée et au niveau de la collectivité ou de l’institution – que Castoriadis orchestre son « recours » (et non son « retour ») aux Grecs anciens : poètes, sophistes, historiens, philosophes ou simples citoyens « amants de la cité », selon la belle expression de Périclès.
Pour Castoriadis, « le juger et le choisir, en un sens radical, ont été créés en Grèce », et c’est à Athènes au Vè siècle (et non à Rome, Sparte ou Alexandrie) que nous trouvons le premier exemple d’une société où les questions de la vérité et de la justice ont été ouvertes sans être immédiatement refermées et verrouillées par une prétendue source extra-sociale de la loi (héros fondateurs, dieux, Dieu, Nature, Raison, Marché, etc.). Contre la situation d’aliénation ou d’« hétéronomie » (la plus fréquente dans l’histoire des sociétés humaines), la philosophie et la démocratie de la Grèce antique ouvrent une brèche dans la « clôture du sens ». Le « projet d’autonomie » dont la démocratie athénienne fut une première incarnation historique – partielle et imparfaite – enjoint donc à l’humanité de reconnaître et d’assumer enfin la paternité de toute institution et de toute signification, et de se donner conséquemment les moyens effectifs d’une reprise lucide, et en droit illimitée, de ses propres créations (qu’il s’agisse des valeurs qui donnent sens à l’activité humaine, des institutions politiques ou encore des théories scientifiques ou philosophiques).
Ce qui fait la Grèce de Castoriadis : le germe philosophico-politique de l’autonomie
L’interprétation castoriadienne de l’histoire de la Grèce ancienne, ainsi que sa lecture singulière des poètes, historiens et philosophes de l’Antiquité grecque, témoignent de sa volonté de rendre pleinement justice à une dynamique sociale et historique dont le trait essentiel réside dans le lien maintenu et renforcé pendant quatre siècles (VIIIè – Vè) entre, d’une part, l’interrogation illimitée sur le vrai et le juste (philosophie) et, d’autre part, l’activité collective visant la transformation consciente de l’institution (politique). C’est une seule et même création humaine – le « projet d’autonomie individuelle et collective » – qui, dès son apparition dans l’histoire, se déploie simultanément au niveau théorique et au niveau pratique ou politique. Philosophie et démocratie sont donc profondément liées, en fait et en droit, et c’est cette thèse fondatrice que Castoriadis ne cessera de développer sous diverses formes au fil des séminaires de 82 à 85.
Dans cette perspective, il est remarquable que le IVè siècle de Platon et d’Aristote apparaisse, à rebours des vues classiques, comme l’aube d’une dégénérescence de la philosophie. C’est que le lien si fort qui unissait jusqu’alors le philosophe aux « affaires humaines » de la cité a été en grande partie rompu par la défaite d’Athènes en 404 av. J.-C. et la disparition concomitante d’une véritable polis démocratique. Une fois ce lien défait, la philosophie, désormais séparée de la vie politique et sociale qui la nourrissait et constituait son horizon, commence alors à se replier sur elle-même et se trahir, à se dégrader en « théologie rationnelle » ou « onto-théologie », entreprise (dont les effets seront dommageables pour toute l’histoire ultérieure) tendant à refermer, sous couvert de « rationalité », la brèche d’autonomie ouverte par la période précédente.
Conséquence d’une thèse si radicale : pour Castoriadis, la véritable philosophie (après sa « première naissance » et avant sa « torsion platonicienne ») se déchiffre moins dans la lettre des philosophes que dans « l’esprit des institutions » dans lequel on peut reconnaître le peuple (dèmos) athénien tout entier, en tant précisément qu’il tente (situation improbable, fragile et extraordinaire dans l’histoire) de « s’auto-instituer explicitement », de se donner à lui-même (autos) sa propre loi (nomos) en toute conscience. La philosophie à laquelle Castoriadis veut rendre justice est donc avant tout une philosophie en acte : « lorsque le dèmos instaure la démocratie, il fait de la philosophie : il ouvre la question de l’origine et du fondement de la loi. Et il ouvre un espace public, social et historique de pensée, dans lequel il y a des philosophes, qui pendant longtemps (jusques et y compris Socrate) restent des citoyens[2] ». Dès lors, on comprend mieux que l’attention se porte sur « des historiens, quelques présocratiques, des tragédiens et même des poètes lyriques » qui, souvent mieux que les philosophes, restituent la pensée politique et sociale grecque dans sa pleine mesure. Dans la même perspective, Castoriadis verra dans les lois et institutions concrètes de la démocratie athénienne un objet d’étude majeur en tant que « pensée politique instituée, matérialisée, incarnée » et définira symétriquement la philosophie comme partie intégrante d’une pratique politique.
La figure du « philosophe-citoyen » (Socrate discutant dans l’agora, par opposition à Platon fuyant délibérément la cité, « s’extrayant de la société pour parler sur elle ») est donc constamment interrogée, défendue et incarnée par Castoriadis lui-même lorsqu’il tente, dans ses séminaires, d’entretenir « un rapport autre que passif avec le passé ». Ni nostalgie déplacée qui tendrait à faire de la Grèce ou d’Athènes un âge d’or, un horizon idéal de la Raison voire un « modèle » à imiter ; ni simple approche « empirique » (sociologisante ou ethnologisante). Ni « modèle » ni « spécimen parmi d’autres » donc, la Grèce constitue ce que Castoriadis appelle un « germe » philosophico-politique.
En parlant de « germe », Castoriadis exprime simplement son intention d’interroger le passé à la lumière des enjeux du présent. Il ne s’agit pas de se mettre « en quête de recettes » mais de chercher à « connaître notre propre histoire pour nous transformer nous-mêmes ». Ainsi, dans cette activité singulière consistant à étudier le passé pour y trouver des germes féconds d’autonomie, « ce que nous sommes comprend en un sens cet objet que nous examinons » puisque « c’est bien cet objet lui-même, cette histoire de la Grèce et qui commence avec la Grèce, qui a créé ce projet de compréhension que nous assumons aujourd’hui[3] ».
Le travail d’élucidation et d’interprétation du passé est par conséquent partie intégrante d’un travail politique d’autoréflexion dont l’enjeu est éminemment actuel : en interrogeant la naissance de la première société autonome connue à ce jour, nous interrogeons en fait la genèse de l’exigence qui nous guide dans ce travail même, et qui nous guide chaque fois que nous tentons de réfléchir et de délibérer lucidement tant sur le plan individuel que collectif.
Thucydide et l’invention de l’histoire
Comme l’indique le titre retenu par ses éditeurs, l’année d’enseignement 1984-1985 accorde une place centrale à Thucydide, citoyen athénien et historien du Vè siècle av. J.-C. qui fit le récit, dans sa célèbre Histoire de la guerre du Péloponnèse, de la défaite tragique d’Athènes contre Sparte – défaite qui fut aussi celle de la démocratie contre l’oligarchie. Castoriadis achève ainsi son panorama de « ce qui fait la Grèce » par un événement antérieur au siècle de Platon, mais aussi antérieur à la « restauration démocratique » d’Athènes en 403 av. J.-C. (celle dont Aristote présentera et commentera plus tard la Constitution). Nous l’avons dit, ce parti pris est délibérément politique et nécessairement partial sans être pourtant assimilable à une quelconque « manipulation » historique. Trente ans plus tôt, le jeune militant gréco-français disait déjà que les quelques semaines que durèrent la Commune de Paris ou les conseils ouvriers hongrois en 1956 « ne sont pas moins importantes et significatives pour nous que trois mille ans de l’histoire de l’Égypte pharaonique[4] ». Il ne s’agit donc pas de hiérarchiser les sociétés ou les époques mais bien de « choisir notre histoire », de discriminer les faits selon leur intérêt et leur pertinence pour nous, pour notre projet politique.
Le récit de Thucydide est par conséquent, pour Castoriadis, l’occasion de parler une nouvelle fois de la démocratie antique (de son imaginaire propre, de son éthos) mais, cette fois ci, à un moment littéralement « tragique » de son histoire, où la liberté du dèmos athénien va, en quelque sorte, se retourner en hubris (démesure, excès) et le mener à sa propre perte. Pourtant, même dans la défaite, Athènes ne cessera jusqu’au bout d’affirmer son identité profonde et ce qui, aux yeux de Castoriadis comme de Thucydide, fait sa grandeur proprement « éternelle » : son amour de la liberté, de la beauté et de la sagesse. L’Oraison funèbre que prononce Périclès après la première grande défaite militaire d’Athènes, et dont Castoriadis nous livre ici un long et lumineux commentaire, témoigne de cette véritable « passion » démocratique qui, davantage que les lois, les institutions ou les victoires militaires, constitue le ciment de la collectivité et fonde l’identité et la fierté des Athéniens.
Pourtant, ce qui intéresse fondamentalement Castoriadis chez Thucydide est moins la somme d’informations, certes très précieuses, qu’il fournit sur l’histoire d’Athènes, que la manière dont il produit, pour la première fois ou presque, un récit historique qui ne prenne pas la forme du poème mythique (comme c’était exemplairement le cas chez Homère) mais qui ne se réduise pas non plus à un simple « enregistrement des faits », une chronique ou une collection d’évènements « bruts ». Au-delà de savoir (question incontournable) « comment les choses se sont vraiment passées », Thucydide assume pleinement, comme Castoriadis à sa suite, la nécessité de « choisir, trier, hiérarchiser, interpréter ».
Une autre dimension fondamentale de cette « invention de l’histoire » au sens fort est l’« intérêt » non-instrumental que les historiens grecs – à la suite, une fois encore, des grands poètes tragiques – manifestent pour les autres sociétés (leurs coutumes, leurs institutions, leur passé). C’est que celles-ci sont d’autres matérialisations de la potentialité créatrice illimitée de l’imaginaire humain. Ainsi, explique Castoriadis, l’histoire véritable « commence, chez Hérodote, simultanément comme histoire et comme géographie-ethnographie[5] » et cela est dû au fait que « la mise en question des institutions propres de la tribu, leur relative relativisation, est condition d’un regard sur les autres tribus capable d’y voir des semblables ou des équivalents ». Pour le dire encore autrement, « le véritable intérêt pour les autres est né avec les Grecs, et cet intérêt n’est jamais qu’un autre aspect du regard critique et interrogateur qu’ils portaient sur leurs propres institutions[6] ».
Castoriadis met enfin l’accent sur la conception « tragique » de l’histoire chez Thucydide, qui l’éloigne significativement d’Hérodote. Si ce dernier considère en effet comme un principe naturel et éternel (une moira, un destin de l’histoire) que « ce qui est petit devienne grand, et ce qui est grand devienne petit », Thucydide, au contraire, affirme avec force que l’histoire connait des régularités mais non point de lois éternelles. Il y a pour lui « une irrationalité immanente à l’histoire, une imprévisibilité dans la nature même des choses et des actions humaines et qui est au-delà de tout progrès technique[7] ».
Ainsi, si la conception grecque ancienne de l’histoire n’est en aucune façon « cyclique », elle n’est pas non plus « progressive » au sens moderne d’un Progrès linéaire et inéluctable. Si Thucydide reconnaît l’existence d’une certaine progression « technique » (dans les moyens de production et de destruction), il ne voit là aucun progrès moral dans notre rapport au bien et au mal. La seule constante qu’on puisse finalement trouver dans l’histoire, c’est, d’un côté, « un progrès dans les moyens de la puissance », et, de l’autre, « une lutte entre ceux qui possèdent cette puissance ». La guerre – qui n’est pas un phénomène simplement « irrationnel » (imprévisible) mais véritablement « producteur d’irrationalité » – illustre parfaitement ce cours non-linéaire ou non-progressif de l’histoire.
Et Castoriadis de se demander « si nous sommes beaucoup plus avancés que Thucydide sur tous ces points. Car s’il est évident qu’il y a toujours progrès dans les instruments de production et de destruction, qu’un microprocesseur vaut infiniment plus qu’un silex et qu’une bombe H vaut infiniment plus qu’une flèche, même empoissonnée, personne n’osera dire que nous sommes »meilleurs » que les chasseurs ou les paysans néolithiques souvent rencontrés dans nos expéditions sur les autres continents[8]. »
Il serait pourtant « absurde de s’en tenir là », ajoute-t-il immédiatement, et en réalité la conception de l’histoire proposée par Thucydide lui-même ne se limite pas à ce sombre panorama d’une lutte perpétuelle entre puissances et d’une évolution exclusivement « technique » de l’humanité. Il y a sans doute des créations humaines plus proches du bien que du mal, peut-être même certaines capables d’ouvrir à long terme une dynamique historique positive, et ainsi, Athènes n’est jamais une puissance ou un régime « parmi d’autres ». Il y a des « floraisons extraordinaires, inattendues et resplendissantes, comme la politeia des Athéniens » et qui sont, affirme Castoriadis, « explicitement reconnues » et « pleinement comprises » par Thucydide au moment même où il dépeint pourtant leur flétrissement, « avec amour, exactitude et désespoir maîtrisé[9]».
Il conclut ainsi son séminaire du 6 février 1985 :
« Certes, il y a des floraisons partout – mais si nous nous arrêtons sur celle de la Grèce ancienne, et aussi sur la création européenne moderne, force est de constater que c’est grâce à elles que nous pouvons voir le reste et réfléchir sur lui. Elles font certainement une différence – mais rien ne garantissait qu’elles seraient là, et rien ne garantit qu’elles seront toujours là[10]. »
Et en effet, comme nous l’apprend le destin tragique d’Athènes, rien ne garantit qu’une cité, si remarquable et « autonome » soit-elle, ne succombe jamais à l’hubris (démesure) qui mène à la némesis (destruction), et surtout pas une cité démocratique qui, plus que toute autre, doit accepter et affronter ce risque, se tenir « au bord de l’Abîme ». C’est pourquoi Castoriadis ne cesse de répéter que la démocratie est « le plus fragile des régimes ». Il souligne que rien n’est plus difficile, exigeant et éprouvant que l’exercice de l’autonomie et fait résolument sien le mot de Thucydide : « Il faut choisir, se reposer ou être libre. »
Romain Karsenty
[1] C. Castoriadis, « La polis grecque et la création de la démocratie » in Domaines de l’homme – Les carrefours du labyrinthe II, Paris, Éditions du Seuil, collection Points, 1999, p. 325.
[2] C. Castoriadis, « La polis grecque et la création de la démocratie », op. cit., p. 314.
[3] C. Castoriadis, D’Homère à Héraclite – Ce qui fait la Grèce 1 – La Création humaine II, Paris, Éditions du Seuil, 2004, p. 52.
[4] C. Castoriadis, « La source hongroise » in Le contenu du socialisme, Paris, Union Générale d’Éditions, collection 10/18, 1979, p. 388.
[5] C. Castoriadis, Thucydide, la force et le droit (séminaires 1984-1985) – Ce qui fait la Grèce III – La Création humaine IV, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p. 112.
[6] C. Castoriadis, « La polis grecque et la création de la démocratie », op. cit., p. 326.
[7] C. Castoriadis, Thucydide…, op. cit., p. 123.
[8] ibid., p. 124.
[9] ibid., p. 322.
[10] ibid., p. 124.