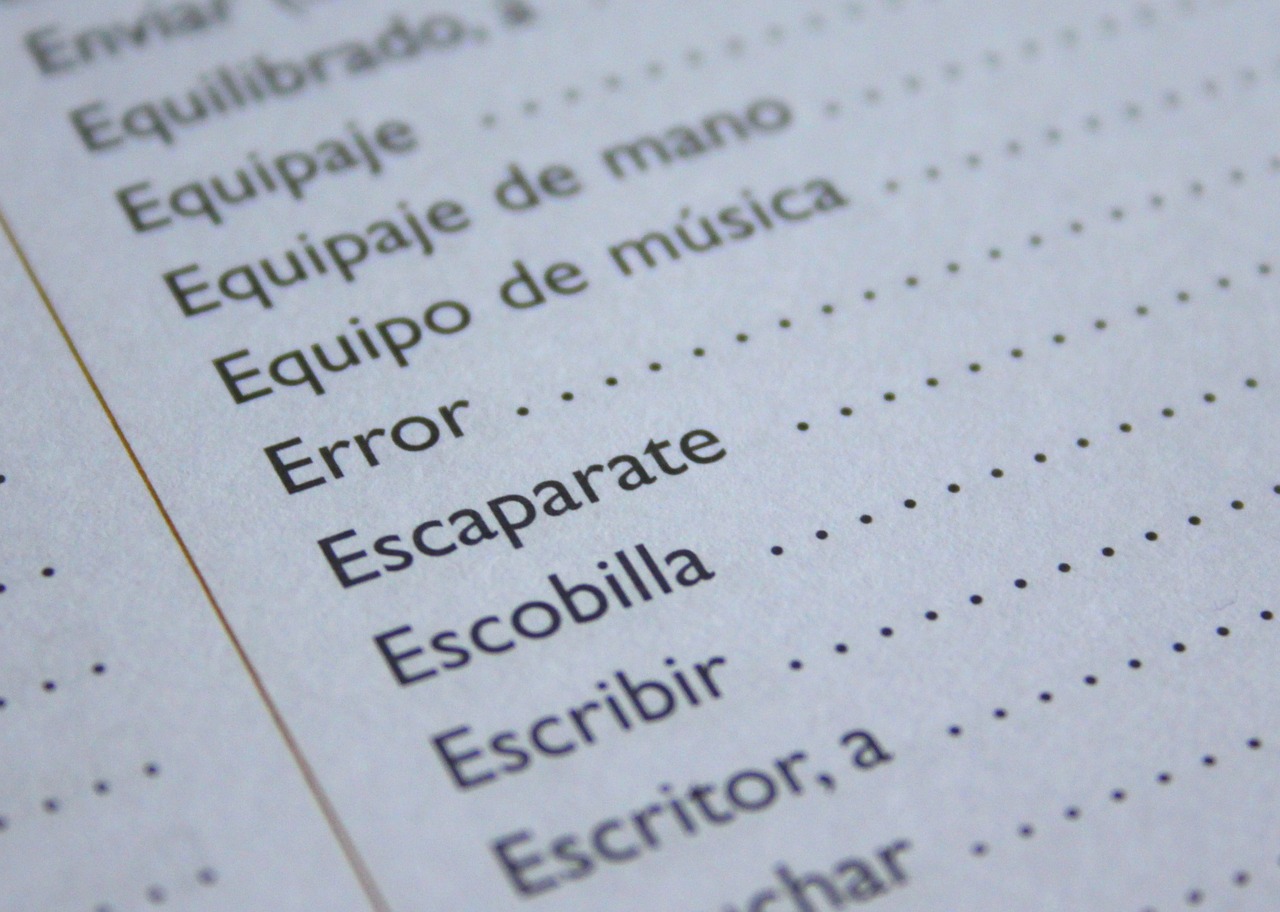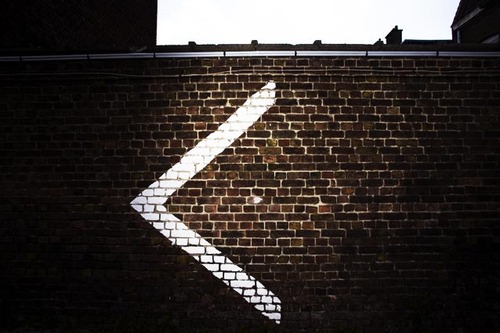Dire et vouloir dire
Autour de « Must we mean what we say ? » de S. Cavell
Introduction :
« Devons-nous vouloir dire ce que nous disons ? ». Question déroutante au premier abord. Il ne s’agit plus ici de questionner le « sens », dans son rapport canonique à la référence mais envisager une autre dimension de ce que l’on dit, à savoir « son vouloir ». Mais Que peut-on entendre par « le vouloir » d’un dire ? Est-ce seulement sa capacité à suggérer (indiquer) quelque chose qui n’est pas énoncé explicitement dans ce que j’ai dit ? Dépend-il simplement l’intention (le « vœu » du locuteur)? Sur quels chemins nous mène cette recherche sur ce que nous voulons dire, et quelle nuance apporte la question de savoir si nous devons ou non « vouloir dire ce que nous disons » ?
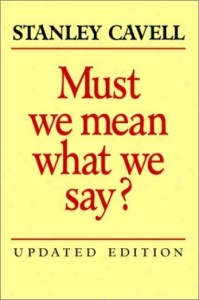
C’est là un vaste champ problématique, d’autant plus vaste qu’il ne faut pas minorer la portée « provocatrice » de cet acte de naissance philosophique de Stanley Cavell. Cette conférence[1], prononcée en présence d’Austin lors de la réunion de l’Association Américaine de Philosophie de décembre 1957 « est explicitement une défense du travail de [son] maître, Austin, contre une attaque qui rejetait ce travail comme non-scientifique, refusait de l’inclure dans les rangs de la philosophie »[2]. C’est pourquoi il nous faut avant toute chose présenter le « contexte » d’énonciation de ce texte si fondamental chez Cavell puisqu’il est « un article qu’[il] utilise toujours, c’est-à-dire celui dans lequel [il a] trouvé [sa] voix philosophique (ou sa trace) » (Idid.), pour introduire et comprendre tous les enjeux du problème posé par le vouloir dire ce que nous disons.
L’appel cavellien de la prise en compte de la philosophie du langage ordinaire, lancé cette année-là et réaffirmé lors de la parution de Must We Mean What We Say en 1969, s’est fait à une époque où la philosophie analytique régnait sans partage sur le monde universitaire anglo-saxon. Héritière[3] de l’empirisme logique viennois, qui a placé la logique et le vérificationnisme sur un trône, la « critique institutionnelle » tend à disqualifier les procédures de la philosophie ordinaire en les plaçant tout simplement hors du champ philosophique, en déclarant ces dernières irrecevables du fait de leur refus de se fonder sur des données empiriques, c’est-à-dire comme ne remplissant pas les conditions de vérifiabilité empirique.
Positionnement du problème :
Le contentieux porte sur ce que doivent être les données du langage (pour l’analyse philosophique), ou plutôt, dans quelle mesure le langage peut être lui-même pris comme donné, sur ce qui fonde ce recours au langage. La tradition analytique ne prend en considération que des propositions dont l’analyse logique nous dit si elles sont pourvues de sens ou non, c’est-à-dire si elles décrivent correctement ou non la réalité. La fonction primordiale des énoncés serait de décrire la réalité, et en ce sens, le premier Wittgenstein est exemplaire de ce type de démarche. Dans le Tractatus logico-philosophicus[4], il nous montre que la mise en forme logique nous dit si une proposition est pourvue de sens, si elle est vraie ou fausse, c’est-à-dire si elle « dépeint » ou non la réalité. La totalité des faits sont le monde[5], que nous nous figurons[6] suivant un schème logique[7]. Cette image logique – la pensée – est celle qui est pourvue de sens[8], et la proposition est ce qui exprime cette pensée : « Le signe par lequel nous exprimons la pensée, je le nomme signe propositionnel. Et la proposition est le signe propositionnel dans sa relation projective au monde » (3.12). La proposition est donc une image ou un modèle de la réalité telle que nous nous la figurons (cf. 4.01) et elle nous « montre » le sens, elle « montre ce qu’il en est des états de chose quand elle est vraie. Et elle dit qu’il en est ainsi » (4.022).
Tout le problème de ce modèle descriptiviste ou propositionnel[9] est le glissement opéré vers sa catégorisation (prétendument univoque) en termes de vérité, car on peut seulement demander à une proposition si elle est vraie ou fausse. Si la réalité est comparée à la proposition (4.05) et qu’elle ne peut être vraie ou fausse que dans la mesure où elle est une image de la réalité (4.06), alors « comprendre une proposition, c’est savoir ce qui a lieu quand elle est vraie » (4.024). L’activité philosophique se résume alors à « la clarification logique des pensées », et « doit rendre claires, et nettement délimitées, les propositions qui autrement sont, pour ainsi dire, troubles et confuses » (4.112).
À la suite de Wittgenstein, la démarche analytique se définit donc comme devant éliminer ces énoncés dépourvus de sens, par clarification logique du langage, ce qui signifie – et c’est là l’héritage de l’empirisme logique – en analyser le contenu empirique. De ce fait, on conçoit mieux pour quelle raison les énoncés concernant l’éthique et l’esthétique ont soulevé de nombreux problèmes. Ce n’est pas qu’on puisse les analyser comme dépourvus de sens, ils ne sont simplement pas des propositions du tout[10]. Ces énoncés sont exclus non seulement des limites du sens, mais du domaine du langage pourvu de sens. Une solution a été de faire une distinction à l’intérieur du langage, entre une capacité cognitive et non cognitive (ou émotive[11]). On aurait deux types de sens, et seules sont vraies ou fausses les phrases qui décrivent un état de choses ou renvoient à un contenu empirique, c’est-à-dire qui ont un contenu cognitif.
Même si cette distinction est contestable, elle ouvre une porte à l’intelligibilité et à la compréhension des faits relevant du domaine éthique et esthétique. Ogden et Richards clarifient le concept de signification en y introduisant la possibilité d’une double dimension pour tout énoncé, celle cognitive (symbolique) et celle non-cognitive (émotive). D’une certaine manière, le langage n’est plus envisagé dans sa seule dimension cognitive, dans ce qu’il dit, mais dans ce qu’il veut dire : la fonction symbolique descriptive relève du statement, alors que la fonction émotive est « l’usage des mots pour exprimer ou susciter des sentiments ou des attitudes »[12]. Le meaning, ne se réduit plus au dire propositionnel (son aspect scientifique), mais « com-prend » tout ce qui est impliqué dans le langage. Pour F. Récanati[13], Ogden et Richards ont, par leur réhabilitation du non-cognitif (non-sens) permis d’assurer une « transition » entre le positivisme logique et la philosophie du langage ordinaire ; or c’est justement cette distinction entre cognitif et émotif[14], et le « représentationnalisme » (la proposition est image de l’état de choses) de la « philosophie analytique classique » que Cavell, suivant l’enseignement d’Austin et le second Wittgenstein[15], récuse. L’effort d’Ogden et Richards vise en fait à montrer de quelle façon l’on peut tenter d’étendre la « méthode scientifique » à des questions qui y sont, au premier abord, soustraites. C’est pourquoi on peut les associer plus fortement à la démarche de clarification propositionnelle du Tractatus.
La critique de la philosophie ordinaire :
Austin définit cette démarche analytique comme étant sous le joug de « l’illusion descriptive ». Tout l’effort du philosophe d’Oxford est de montrer qu’il existe d’autres usages du sens que la description, ou plutôt que le meaning d’un énoncé, c’est son usage. L’appréhension propositionnelle n’est pas le seul mode d’appréhension du sens (meaning); et plus qu’en termes de « correspondance au réel », les philosophes du langage ordinaire montrent ce que l’on a à gagner en envisageant les énoncés en termes d’adéquation. Comme le souligne Austin, « ce dont on a besoin, c’est d’une doctrine nouvelle, à la fois complète et générale, de ce que l’on fait en disant quelque chose, dans tous les sens de cette phrase ambiguë, et de ce que j’appelle l’acte de discours, non pas sous tel ou tel aspect seulement, mais pris dans sa totalité »[16]. Austin évacue d’emblée la notion de proposition, qui se concentrait sur le rapport de l’énoncé (ou de la phrase) à un état de choses, en n’envisageant que des sentences (des phrases) et statements (des affirmations, des énoncés déclaratifs), et dénonce l’idée que les phrases sont des statements qui décrivent des états de choses. Précisément « l’illusion descriptive » consiste à supposer que la fonction première du langage est de décrire des états de choses. « Même si une partie du langage est maintenant purement descriptive, le langage ne l’était pas à l’origine, et en grande partie ne l’est toujours pas. L’énonciation de phrases rituelles évidentes, dans les circonstances appropriées, ce n’est pas décrire l’action que nous faisons, mais la faire (« I do »)[17] ».
Dans ces circonstances, on peut prendre toute la mesure de la formule traduisant How to Do with Words : « Quand dire, c’est faire ». Mettre en cause la fonction descriptive du langage, c’est mettre en cause le rapport entre meaning et état de choses. Par le fait de dire quelque chose, en disant quelque chose (by saying, in saying), nous effectuons quelque chose, nous la faisons. Peut-être paradoxalement, Austin impute la fascination qui a cours pour les statements, non pas aux « positivistes », mais à Kant[18] et à son dualisme entre le factuel et le normatif (constatif-performatif si on veut[19]). Austin ne souscrit pas à ce dualisme kantien repris par les tenants de la philosophie analytique, comme on peut le voir dans la dernière conférence de Quand dire, c’est faire :
Il y a sans doute plusieurs moralités à tirer de tout cela et je voudrais plus particulièrement en signaler quelques-unes :
A) L’acte de discours intégral dans la situation intégrale de discours est en fin de compte le seul phénomène que nous cherchons de fait à élucider.
B) Affirmer, décrire, etc. ne sont que deux termes parmi beaucoup d’autres, qui désignent les actes illocutionnaires ; ils ne jouissent d’aucune position privilégiée.
C) Ils n’occupent en particulier aucune position privilégiée quant à la relation aux faits – et qui seule permettrait de dire qu’il s’agit du vrai et du faux. Vérité ou fausseté, en effet, sont des mots qui désignent non pas des relations, des qualités (que sais-je encore) mais une dimension d’appréciation. [je souligne]
D) Du même coup, il nous faut éliminer, au même titre que d’autres dichotomies, la distinction habituellement établie entre le “normatif et l’appréciatif ” et le factuel. [je souligne]
E) Nous pouvons aisément prévoir que la théorie de la “signification” dans la mesure où elle recouvre le “sens” et la “référence”, devra être épurée et reformulée, à partir de la distinction entre actes locutoires et illocutoires (si cette distinction est fondée : elle n’a été qu’esquissée jusqu’ici) [20].
On peut d’emblée souligner que s’attaquer au « fétiche vrai-faux » ne revient pas chez Austin à détruire la vérité, mais bien au contraire à l’étendre plus largement. En envisageant « l’acte de discours intégral dans la situation intégrale de discours », il nous montre qu’il existe une dimension d’acte dans l’ensemble du langage. Il fait du langage un acte. Et cette généralisation aboutit progressivement à un effacement de la dichotomie initiale entre performatif et constatif : un même énoncé peut être performatif et constatif. À la première distinction (performatif-constatif) semble se substituer celle entre acte locutionnaire et illocutionnaire : « tout acte de discours authentique comprend les deux à la fois » (Ibid. p. 148). Ce qui est en jeu par cette distinction au cœur de l’appréhension des actes de langage, c’est la définition même du normatif. En passant de la proposition à l’idée d’usage on change de dimension.
L’usage du langage étant fondé, comme toute activité humaine (institutionnalisée), sur des règles, son essence est normative. « Ce qui est normatif, c’est précisément l’usage ordinaire lui-même » note Cavell (MWM, p.21). Et ce n’est pas confondre fait et norme lorsqu’on dit qu’un énoncé descriptif tel « la fenêtre est ouverte » peut être soit constatif (je décris une situation), soit normatif (on souhaite ou m’ordonne de la fermer). C’est pourquoi les énoncés descriptifs ne sont pas strictement opposés aux énoncés normatifs. On comprend alors l’agacement de Cavell à propos de cette confusion :
Quand je dis ici que parler d’une opposition générale entre énoncés descriptifs et normatifs constitue une confusion, je ne pense pas avant tout au simple fait que les règles ont des énoncés (descriptifs) qui leur correspondent, mais plutôt à ce que signifie ce fait, à savoir, que ce que décrivent ces énoncés, c’est des actions (et non pas, par exemple, des mouvements de corps, qu’ils soient animés ou inanimés). Le fait le plus caractéristique quant aux actions, c’est qu’elles peuvent – de diverses manières particulières – mal tourner, qu’elles peuvent être accomplies de façon incorrecte. Cela n’est pas là, en aucun sens restreint du terme, une affirmation morale, quoiqu’elle indique la morale de l’activité intelligente. Et elle est aussi vraie de la description que du calcul, de la promesse, du complot, de l’avertissement, de l’affirmation ou de la définition… Voilà des actions que nous accomplissons, et que cette exécution soit réussie dépend de ce que nous adoptions et suivions les manières dont l’action en question est faite, dépend donc de ce qui est normatif pour cette action. Les phrases descriptives ne sont donc pas opposées aux phrases normatives, mais en réalité les présupposent : nous ne pourrions faire la chose que nous appelons décrire si le langage ne fournissait pas (si l’on ne nous avait pas appris) des manières qui sont normatives pour l’action de décrire (pp.21-22).
Ce qu’il faut retenir ici, c’est la richesse que recèle l’action, richesse niée – entre autres – par la conception réductionniste du Cercle de Vienne pour qui toute action est mouvement physique. Comme le souligne Austin,
On a encore trop peu enquêté sur ces expressions pour elles-mêmes, tout comme en logique on néglige encore avec trop de légèreté la notion générale de dire quelque chose. Il y a en effet à l’arrière-plan l’idée vague et rassurante que, en dernière analyse, accomplir une action doit revenir à faire des mouvements avec des parties de son corps ; idée à peu près aussi vraie que celle qui consiste à penser que, en dernière analyse, dire quelque chose revient à faire des mouvements avec la langue[21].
Ce domaine de l’action devient alors un centre de recherches qui permet de nous apprendre quelque chose à la fois sur le langage et sur nous-mêmes (en plus de faire redécouvrir aux philosophes « le plaisir de la découverte »). Le langage est comme un prisme révélateur : les différences dans le langage révèlent des différences du monde. « Quand nous examinons ce que nous dirons quand, quels mots employer dans quelles situations, nous ne regardons pas seulement les mots, mais également les réalités dont nous parlons avec les mots » (Ibid, p. 144). Il s’agit donc de montrer, pour Austin comme pour Cavell, qu’à partir du langage ordinaire – qui est source infinie de distinctions[22] que le langage philosophique (ou l’usage philosophique du langage) a effacées –, on peut comprendre quelque chose de la nature et des classifications des actions.
Les dernières conférences de Quand dire, c’est faire, nous montrent que les énoncés peuvent être appréhendés suivant les trois dimensions d’actes qu’il a distingués : les actes locutoires, illocutoires et perlocutoires (dans leur contexte d’énonciation propre). Cette tripartition, aussi problématique soit-elle, fait la force de la philosophie austinienne. Si « tout acte de discours authentique comprend les deux à la fois », ce n’est pas la distinction entre ce qui est dit et le fait que c’est dit que l’on met en évidence, mais on prête véritablement attention à ce qui est dit comme un tout (« l’acte de discours total »). Le langage devient performance, sans qu’on puisse pour autant tracer une limite entre acte et contenu au sein de chaque énoncé. Et ne pas négliger la dernière dimension de l’acte de parole présentée par Austin, c’est se prémunir de « retomber » dans cette distinction contenu-acte qu’illustre d’une certaine manière la partition sémantique-pragmatique[23]. Cette dernière nous conduit à penser l’acte comme « force additionnelle[24] », or pour Austin, s’il s’agit de « performe an action », alors la performance ou le faire est indissociable de l’action elle-même, c’est-à-dire qu’il est fonction (au sens de fonction grammaticale), et non pas simple conséquence.
Cette idée de conséquence renvoie également à la conception traditionnelle d’action. Pour celle-ci la réponse à la question : « Qu’est-ce qu’une action humaine ? » est « Une action volontaire ». On entend souvent par là trois choses : (1) Une action est généralement un mouvement du corps ; (2) qui est précédé d’une volition (événement mental rendant compte d’une décision) ; (3) elle-même causée par cet événement mental. John Stuart Mill résume cela en ces termes : « Qu’est-ce qu’une action ? Ce n’est pas une seule chose ; c’est un composé de deux choses successives, l’état d’esprit appelé volition, et l’effet qui le suit. La volition ou l’intention de produire l’effet est une chose ; l’effet produit en conséquence de l’intention en est une autre ; les deux ensemble constituent l’action »[25]. Cette conception est évidemment problématique, et G. Ryle s’est employé à dénoncer cela dans La Notion d’esprit[26], même si sa solution entre partiellement en conflit avec la conception austinienne. Cavell souligne que
De fait, il avait perçu le problème : l’usage philosophique de “volontaire” étend l’idée de volition jusqu’à la déformer et à la rendre méconnaissable. Et son diagnostic du problème était bon : à cause d’une conception déformée de l’esprit, les philosophes s’imaginent que le terme de “volontaire” doit s’appliquer à toutes les actions qui ne sont pas involontaires (ou non-intentionnelles), alors qu’il ne s’applique que là où il y a une raison particulière de soulever la question (MWM, p. 7).
« L’usage philosophique » est précisément le cœur du problème pour Cavell, et un des motifs de sa réflexion sur la critique. Il s’agira donc, après cette synthèse introductive au problème du « vouloir dire », de suivre au plus près le détail du texte de Cavell afin de montrer la non-pertinence de certains arguments avancés par B. Mates[27], qui « se soucie moins de critiquer spécifiquement certains des résultats des philosophes d’Oxford que de mettre en cause les procédures qui ont amené ces philosophes à les revendiquer » (MWM, p.2).
Delphine Dubs
[1] Cavell, « Must We Mean What We Say? »[MWM], 1969, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, (trad. C. Fournier & S. Laugier, Dire et vouloir dire, Paris, Cerf, 2009), pp. 1-43. (Toutes les références dans le texte renvoient à la pagination de la version originale de l’article)
[2] Cavell, Un Ton pour la philosophie, op. cit., p.35.
[3] Il faut noter que prendre « l’institution analytique » comme un milieu homogène n’est pas rendre justice à la philosophie américaine dans son ensemble ; tout comme les différences de pratiques des philosophes d’Oxford peinent à être cantonnée sous le terme « d’école ». Pour des raisons de commodité, nous n’envisageons ici que certains points de la tendance analytique dominante.
[4] Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 1922, trad. G-G. Granger, Paris, Gallimard, 1993.
[5] Ibid, cf. 1.11. Le monde est déterminé par les faits, et par ceci qu’ils sont tous les faits ; ou 1.13. Les faits dans l’espace logique sont le monde.
[6] Cf. 2.12. L’image est un modèle de la réalité ; 2.151. La forme de représentation est la possibilité que les choses soient entre elles dans le même rapport que les éléments de l’image ; 2.1511. L’image est ainsi rattachée à la réalité ; elle va jusqu’à atteindre la réalité ; 2.1512. Elle est comme une règle graduée appliquée à la réalité.
[7] Cf. 2.18. Ce que toute image, quelle qu’en soit la forme, doit avoir en commun avec la réalité pour pouvoir proprement la représenter – correctement ou non – c’est la forme logique, c’est-à-dire la forme de la réalité ; 3. L’image logique des faits est la pensée.
[8] Cf. 3.3. Seule la proposition a un sens ; 4. La pensée est la proposition pourvue de sens.
[9] Cf. 4.023. La réalité doit être fixée par oui ou par non grâce à la proposition. Il faut pour cela qu’elle soit complètement décrite par la proposition. La proposition est une description d’un état de choses.
[10] Cf. 6.42. « Il n’y a pas de proposition éthique ». Et cela conduit Wittgenstein au silence final du Tractatus…
[11] Cette distinction est proposée par c. k. ogden & i. a richards, The Meaning of Meaning : a Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, Londres, Harcourt Brace Jovanovich, 1923. Cavell ne cite pas directement ce texte, mais des philosophes, comme Stevenson, chez qui elle a été fortement reprise.
[12] c. k. ogden & i. a richards, The Meaning of Meaning, op. cit.
[13]« La théorie émotive permet de sauver la thèse néopositiviste selon laquelle tout jugement synthétique est empiriquement vérifiable du contre-exemple apparent que constituent les énoncés éthiques». «Du positivisme logique à la philosophie du langage ordinaire : naissance de la pragmatique », postface de Quand dire, c’est faire, 1962, trad. G. Lane, Paris, Le Seuil, 1970, p.192-193.
[14] Du fait de sa compatibilité avec la vérifiabilité empirique des énoncés synthétiques.
[15] Cavell souligne ainsi le passage entre les deux « moments » de Wittgenstein : « Si je comprends bien, Wittgenstein demandait, dans le Tractatus : “Pourquoi la forme logique d’une proposition est sa forme réelle ?” Mais dans sa seconde philosophie, sa réponse est en fait : “ce n’est pas le cas”. Et il pose ensuite la question : “Pourquoi pensons-nous (ai-je pensé) que cela était le cas ?” et : “que nous dit la forme réelle (grammaticale) d’une proposition?” », « The Availability of Wittgenstein’s Later Philosophy », MWM, Op. Cit, p. 56.
[16] Austin, « Performatif-Constatif », Colloque de Royaumont, in La Philosophie analytique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1962, p. 280.
[17] Austin, Écrits philosophiques, 1961, trad. L. Aubert & A-L. Hacker, Le Seuil, 1994, p. 103.
[18] Référence que Cavell reprend en envisageant un « déclaratif catégoriel ».
[19] Les deux « dichotomies » se recouvrent à peu près au début du texte, mais il semble qu’Austin affine cela au fur et à mesure du texte.
[20] Austin, Quand dire, c’est faire, op. cit., pp.151-152.
[21] Austin, Écrits philosophiques, op. cit., p. 139.
[22] Cavell pour illustrer la présence de cette richesse use d’une « métaphore culinaire » (ou presque) qui est très révélatrice : «Si vous faisiez la cuisine à la manière dont vous parlez, vous n’utiliseriez plus des instruments particuliers pour des fonctions différentes, et vous utiliseriez le même couteau pour peler, vider, racler, couper en tranches, découper, hacher, et scier. La distinction est bien là, dans le langage (comme les instruments sont là pour qu’on s’en serve), et vous ne faites qu’appauvrir ce que vous dites en le négligeant. Et il y a dans le monde quelque chose qui vous échappe». p. 35.
[23] On rabattrait alors le locutoire sur « le contenu de l’énoncé » et l’illocutoire sur « ce que fait cet énoncé ».
30 C’est sans doute là un héritage de « l’émotivisme ».
[25] John Stuart Mill, Système de logique, I, 3, §5, trad. fr. L. Peisse, Mardaga, 1988, p. 58.
[26] Gilbert Ryle, La Notion d’esprit. Pour une critique des concepts mentaux, 1949, trad. S. Stern-Gillet, Paris, Payot, 2005, pp.141-166. Ryle soumet trois arguments pour montrer les difficultés de cette conception : (1) Pour des actions normales ou ordinaires, on ne peut attribuer des volitions, parce que personne ne peut soutenir qu’on décrit notre conduite ordinaire de cette manière. (2) Rien ne garantit l’effectuation de la volition : le lien entre volition et mouvement physique est contingent. (3) Sachant qu’il existe des « actions mentales », comme calculer, on peut se demander si la volition est elle aussi volontaire ou non. De ce fait, l’analyse nous conduit à une régression infinie, qui rend intelligible la notion d’action. C’est pourquoi pour Ryle, le problème de « volontaire » ne doit pas s’articuler autour du partage entre physique et mental (ou externe/interne) mais réside dans la question de savoir si une action doit être précédée d’un « acte de volonté » pour exister. C’est là une question que traitait déjà Wittgenstein. Doit-on présupposer un acte de volonté derrière chaque action ? Si mon bras se lève, c’est que je veux qu’il se lève. Mon corps obéit à une volition. Mais n’arrive t-il pas que mon bras puisse bouger sans que je le veuille, quand je suis pris de convulsion par exemple ? Ou parfois, j’ai beau vouloir bouger mon bras, celui-ci « n’obéit » pas, il reste comme paralysé. Comment l’expliquer ? La conception dualiste (partition mental-corporel) n’est pas, comme on le voit satisfaisante. C’est pourquoi, on ne doit pas envisager l’action en termes de volonté (comme acte séparé) mais en termes de « volontaire » et d’ « involontaire ». Et l’analyse doit se caler sur l’action elle-même c’est-à-dire le « jeux de langage » dans lequel elle s’inscrit. Prenons un exemple : si un élève lève le bras au moment de l’appel, il se soumet à une convention, à une pratique dont il connaît la signification (l’usage). Mais lorsqu’il lève le bras pour répondre à une question, ou en poser une, il le fait volontairement, et il sait ce à quoi il s’expose en le faisant : donner une réponse ou soumettre une question.
[27] Benson Mates, «On the Verification of Statements About Ordinary Language», 1958, in V. C. Chappell, dir., Ordinary Language, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc., 1964, pp.64-74.