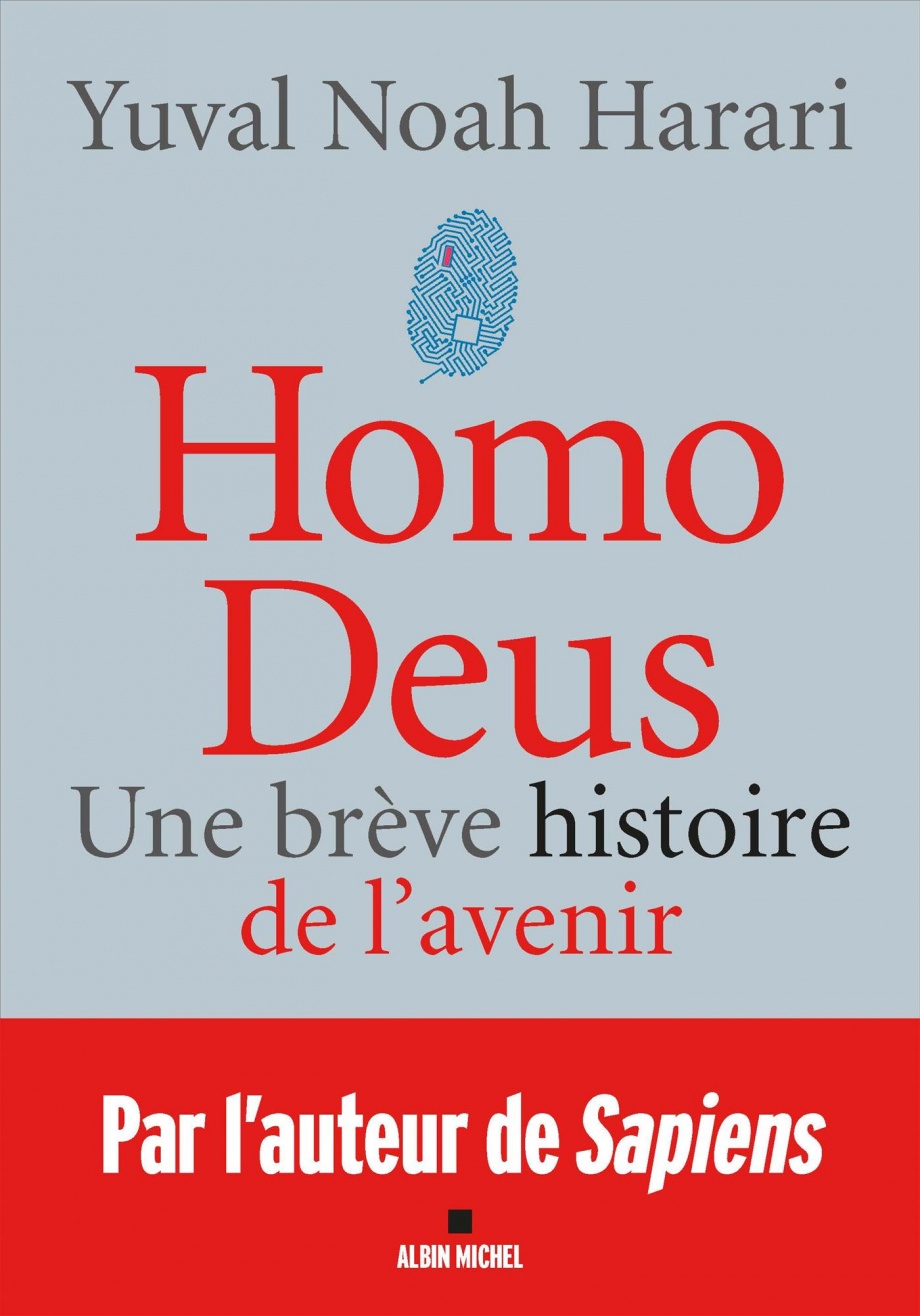La gouvernance globale confrontée au problème de la justice climatique
Entretien avec Daniel Innerarity (Propos recueillis, annotés et traduits par Dominic Desroches)
Dominic Desroches : Je commencerai notre entretien par un constat à la fois incontournable et peut-être un peu trop simple : la mondialisation tend à supprimer les frontières. Le pouvoir ne semble plus connaître de clôtures physiques ou de frontières nationales. Évidemment, cette idée d’effacement des frontières pose des questions nouvelles pour la justice. D’où vient le pouvoir aujourd’hui ? Un discours mondialisant dit qu’il n’y a plus de frontières alors que la politique demeure nécessaire voire indispensable pour régler les conflits. Le pouvoir, qui s’exprime sous de nouvelles formes, est-il à chercher dans l’obsolescence des mécanismes de surveillance ?
Daniel Innerarity : Dans le cadre de la mondialisation, la question que tout le monde se pose est la suivante : qui est responsable de quoi ? Dans le passé, cette question ne se posait pas ainsi. Elle trouvait sa réponse dans la recherche de la personne dont les signes visibles correspondaient à l’action posée ou qui était située dans une position d’autorité. Ce n’est plus le cas aujourd’hui car le pouvoir a beaucoup changé dans les États Nations ; il s’est déplacé vers les conglomérats anonymes se situant dans des localisations incertaines qui échappent aux obligations de contrôle politique et qui n’ont de compte à rendre à aucun électorat. Quand, par exemple, les « marchés » réagissent nerveusement, il n’y a pas d’interlocuteur clairement défini qui pourrait les rassurer ou les critiquer. Les pouvoirs eux-mêmes sont invisibles, sans imputabilité et, au mieux, peut-on protester devant les conférences internationales ou démolir le World Trade Center. Mais le système en sort indemne précisément parce que l’organisation de gouvernance n’est pas régie par un pouvoir central visible. C’est là la nouvelle configuration de notre monde qui fait qu’il est aussi difficile de protester que de gouverner.

Source : Stock.Xchng
Il ne peut s’agir ici de formuler une morale parce que le problème n’est pas que quelqu’un ait délibérément caché quelque chose quelque part. Il s’agit plutôt d’une propriété du monde dans lequel nous vivons en vertu de laquelle les pouvoirs sont désormais invisibles, les représentations inexactes et les preuves trompeuses. Cette invisibilité relève de l’interdépendance systémique d’acteurs qui se trouvent dans l’économie, la politique, la science ou le Droit, et elle se caractérise par l’absence de causes identifiables et de responsabilités correspondantes. Dans ce contexte nouveau, la mondialisation signifie que tous se passe entre nous, alors que les attributions au mérite et les prises de responsabilité sont très difficiles à décerner (et généralement à comprendre, surtout lorsqu’on critique le bien-fondé économique d’un gouvernement qui a simplement fait bon usage de la conjoncture dont il disposait, ce qui n’est pas rien, et qui a voulu relever les défis de la gouvernance, lesquels sont plus exigeants que jamais et ce, dans un contexte où les erreurs, elles, apparaissent visibles, surtout en politique). À la division complexe du travail appartenant à la mondialisation correspond aussi une complicité générale et une certaine irresponsabilité généralisée (dans le sens le plus innocent de l’expression). Comme Thomas Friedman l’a relevé, la vérité la plus fondamentale de la mondialisation est désormais que « personne n’est responsable » (no one is in charge).
Dominic Desroches : En parallèle aux efforts de Niklas Luhmann qui a valorisé l’horizontalité contre la verticalité, Zigmunt Bauman a montré dans ses ouvrages que le monde moderne est à trouver dans sa fluidité. C’est évidemment une image, une métaphore. La vie moderne liquide correspond pour lui à la consommation. Les rapports humains sont fluides, changeants, variables, c’est-à-dire sujets de consommation, ce qui entraîne des crises, de nouvelles inquiétudes et davantage de vulnérabilité. Que pensez-vous de cette thèse ? En quoi permet-elle de mieux comprendre la crise actuelle et pour quelles raisons, peut-être, le cas échéant, convient-il de la dépasser ?
Je pose ces questions sur Bauman parce que vous avez écrit, dans votre article intitulé Un monde gazeux[1], ces lignes pour le moins significatives : « Il est plus difficile de contrôler les émanations gazeuses que la circulation d’un liquide. » Que voulez-vous dire et à quoi faites-vous référence ici ? Voulez-vous dire que les États ne peuvent plus contrôler la liberté de mouvement des individus et que la spéculation est le modèle des échanges contemporains ? Est-ce que les frontières sont ainsi devenues « injustes » ?
Daniel Innerarity : Pour séduisante que soit la métaphore de la liquidité, nous ne pouvons pas, grâce à elle, décrire adéquatement à mon avis toute la réalité de processus sociaux, et c’est la raison expliquant les échecs des tentatives de réglementation des États et des organisations internationales, comme en témoignent le contrôle de l’émigration, l’évasion fiscale, le problème des changements climatiques, problématiques où l’on voit émerger de manière évidente les limites mêmes de la métaphore liquide. Malgré son caractère homogène, la métaphore de la liquidité ne rend pas bien compte des turbulences des médias à l’échelle planétaire et de l’effet de « buzz » qui se créant autour de certains événements, d’abord explosifs, mais qui peuvent aussi rapidement se dégonfler. Elle n’explique pas non plus suffisamment le phénomène des bulles financières, l’instabilité économique et la spéculation. S’il faut choisir une image suggestive, celle des « bulles » de Peter Sloterdijk a sans doute un meilleur pouvoir explicatif pour comprendre les phénomènes atmosphériques mais aussi un monde de mensonges, de rumeurs, de nébuleuses, de risques, de panique, de spéculation et de confiance.
Or les explications courtes ont tendance à entraîner des échecs stratégiques et les théories insuffisantes sont souvent converties en actions inefficaces. Depuis quelque temps, nous savons que le contrôle des canaux par où passent les échanges ne garantit pas le contrôle du contenu. Bien que la Russie, par exemple, contrôle une grande partie du transit mondial de pétrole et de gaz, la fixation finale du prix se fait sur le marché à New York ou de Londres. Les pays où les acteurs n’ont pas de pouvoir physique sur les canaux (liquides) par lesquels se réalise le transport ont tout de même une influence considérable sur la formation de ces prix. Il y a aujourd’hui un décalage croissant entre les flux commerciaux, les flux de capitaux et la supériorité du commerce. Les volumes, en ce qui concerne certains produits, sont basés sur la croissance spectaculaire dans les options et les marchés à terme, voire la spéculation, ce sont des phénomènes économiques qui sont plus proches de l’air que de l’élasticité d’un liquide. Ils sont également de plus en plus déconnectés intrinsèquement de la valeur « liquide », comme le veut la métaphore, de ce qui circule dans les tubes (gaz, les flux financiers, l’information, etc.) et de la valeur d’usage pour les utilisateurs, une valeur qui peut se « contracter » ou «exploser » dans les oscillations spéculatives.
Dominic Desroches : Dans un monde sans frontières, de plus en plus virtuel, vous ne croyez plus à la valeur du billet, de l’héritage et de la réputation, qui seraient d’anciens symboles de la modernité possessive, j’allais écrire bourgeoise…, donc de la métaphysique des solides. Cette nouvelle réalité ne rend-t-elle importante et actuelle l’idée de la future « justice climatique » ?
Daniel Innerarity : Le contrôle des canaux n’est pas toujours couronné de succès. Cela est particulièrement évident lorsque vous essayez de mettre des barrières à l’émigration en considérant qu’il ne s’agit que d’une question de flux et les canaux, comme si celle-ci n’avait pas rien à voir avec les conditions économiques générales. L’émigration ne se produit pas parce qu’il y a des voies de passage d’un pays à l’autre, mais parce qu’il y a des inégalités et que le mouvement des travailleurs tend à rééquilibrer la situation, comme cela se passe avec la pression atmosphérique. Ainsi, le contrôle strict des frontières modifie à peine le résultat des flux migratoires qui ne se freine pas par ces barrières, mais qui témoignent seulement du dégonflement des possibilités économiques.
Dominic Desroches : N’est-il pas raisonnable de penser que la politique est désormais « climatologique » ? Comme l’enseigne la climatologie, il y a de grandes tendances et l’essentiel des changements rapides échappe encore à notre contrôle direct. La météo varie, on prédit à court terme et localement, mais les tendances décisives demeurent fortes. Les crises sont un peu comme les tornades et les autres phénomènes extrêmes : impuissants, nous les regardons de loin et ramassons ensuite les dégâts ! Les cycles sont beaucoup plus forts que les hommes. D’ailleurs ces hommes, à l’intérieur de ce qu’ils appellent la démocratie, procèdent au « design » de l’agenda politique en commençant par mesurer l’atmosphère sociale, mais sans réussir à le contrôler. À l’instar du climat pour les hommes, la politique ne traduit-elle pas davantage notre fragilité que nos capacités de contrôle ?
Daniel Innerarity : Oui, mais plutôt qu’un monde liquide, le processus de mondialisation a conduit à un monde « gazeux ». Cette métaphore gazeuse répond mieux à la réalité actuelle des marchés financiers et du monde des médias, qui se caractérisent, comme les volumes qui se contractent et s’étendent selon les cycles d’expansion et de contraction, d’expansion et de récession. De même le gaz répond mieux aux échanges contemporains, immatériels, vaporeux, volatils, qui sont loin des réalités que les nostalgiques appellent l’économie réelle, car l’économie est désormais plus complexe que le débit des flux de liquide. Le gaz est aussi une image très appropriée pour décrire la nature de plus en plus incontrôlables de la réalité sociale, le fait que le monde financier, le monde des médias et des communications soient davantage basés sur les renseignements volatils que sur la vérification des faits.
Dans le nouveau contexte de ce monde gazeux, la capacité des États ou des organisations internationales pour organiser est aussi souhaitable que difficile. La métaphore proposée peut nous aider à comprendre la raison de cette complexité. Il est plus difficile de contrôler les émanations d’un gaz que la circulation d’un liquide, je crois l’avoir dit. Le grand problème politique du monde contemporain est de savoir comment organiser l’instable. Pour cela, il n’est pas suffisant de contrôler les conteneurs et les canaux de transmission, car une part croissante du commerce a lieu au-delà des canaux traditionnels et sa valeur d’usage dépend de plus en plus sur les conditions particulières imposées par l’utilisateur final.
Toute tentative de législation devrait se concentrer sur les conditions et les contextes qui mènent à la dilatation ou la contraction des formes gazeuses de la spéculation. La tâche politique fondamentale est de créer une ambiance de marché dont les principaux paramètres seront régis d’une certaine façon. L’action classique dans la canalisation rigide devrait être remplacée par une configuration flexible, car le champ magnétique entourant les particules électriques est exercé à partir d’une distance définissant les limites dans lesquelles les mouvements sont libres et non contrôlés. Cette souplesse permettrait de concilier les libertés individuelles avec les réglementations qui semblent nécessaires afin que ces mouvements libres ne détruisent pas les possibilités du système au sein duquel elles peuvent être exercées sans provoquer des situations catastrophiques.
Dominic Desroches : Sur les changements climatiques, une question relève de la politique et doit nous intéresser. Comment parviendrons-nous à créer des consensus sur les changements climatiques ? Existe-t-il une justice en ce domaine inédit ?
Daniel Innerarity : Les difficultés à parvenir à un accord en matière de lutte contre le changement climatique trouvent leur origine dans trois propriétés relativement nouvelles de ce phénomène inédit : son caractère anthropo-génétique, son universalité et la densité des interactions en jeu. Malgré cela, a surgi un nouvel espace de discussion et d’intervention sur ce qui était vu comme une fatalité et sur laquelle on ne prenait aucune décision. La météo et le climat, les paradigmes de ce qui est donné, forment une réalité partiellement modifiée par l’homme et, par conséquent, sont maintenant objets de litige. Le climat est en train de changer et l’appréciation est similaire à celle d’autres réalités de même nature, comme la santé, l’intimité ou les inégalités : ils doivent êtres inévitables pour devenir des variables dépendantes de nous, et devenir ensuite une affaire de citoyenneté démocratique. Le temps était auparavant, pourrait-on dire, un sujet de conversation d’ascenseur insipide et il est devenu un sujet de débats passionnés.
La deuxième caractéristique de ce nouveau problème est son universalité, à savoir le fait que cela nous affecte tous, bien qu’il y ait des zones davantage protégées des changements climatiques ou qu’il existe des stratégies régionales pour en limiter la portée. S’il est aussi vrai que cela ne nous affecte pas tous exactement de la même manière, si nous vivons par exemple dans un espace ou dans un autre, si nous sommes riches ou pauvres, ou citoyens de pays en voie de développement qui ne se fixent pas eux-même d’auto-limitations. Si l’universalité du problème est une raison qui nous force à accepter cette réalité, l’inégalité des conditions est toutefois la cause des différends et des difficultés à s’accorder sur la résolution de ce problème.
La troisième caractéristique provient du réseau mondial et des liens d’interdépendances auxquels nous sommes contraints. Il ne s’agit pas du nombre d’auteurs qui interviennent, mais de la complexité des critères de justice qui sont affirmés dans ces négociations. Ce type d’arrangement auquel nous parvenons est une preuve de la capacité de l’humanité à s’entendre, à trouver des compromis qui équilibrent les intérêts concurrents et les revendications différentes de la justice. Et que les dommages ne soient pas répartis géographiquement sur une base égale, ce n’est pas là une question neutre ou banale, car certains perdent plus que d’autres. Le changement climatique est devenu par là une partie de la sphère politique.
Dans les négociations pour les accords sur le changement climatique, on ne discute pas sur le climat parce que personne ne s’interroge sur la nécessité d’intervenir pour lutter contre le changement climatique. Les États ne semblent pas s’entendre sur le principe d’une action spécifique contre le réchauffement de la planète, ils restent profondément divisés sur la manière de répartir les efforts entre les pays avancés et pays en voie de développement. Ce qui est en cause, ce sont les critères de justice à partir desquels ils doivent prendre les décisions appropriées, autrement dit qui, comment et de quelle manière répartir la charge qui pèse sur la protection de l’environnement, ce qui a beaucoup moins à voir avec eau, l’air et les arbres qu’avec l’emploi et le bien-être. Les pays les moins avancés ne comprennent pas pourquoi ils devraient assumer les coûts de développement irresponsables des pays industrialisés. Les pays d’Asie ou de l’ancien bloc soviétique ne veulent pas menacer le processus de reprise économique, alors que les économies plus avancées refusent de payer pour le reste du monde. Et la plupart des pays développés croient qu’ils seront injustement touchés par les restrictions. Les conflits d’intérêts empêchent de faire des progrès dans les compromis à faire ici.
Dominic Desroches : Face aux défis importants consistant à intégrer la Chine et le Brésil, des grands émetteurs de gaz à effet de serre, on se contentera d’agir dans un « esprit de justice », écrivez-vous dans un article sur le projet d’une « Justicia climática »[2]. Il semble donc manquer un chapitre à la Théorie de la justice, celui portant sur les changements climatiques…
Daniel Innerarity : La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été élaborée sur un principe de responsabilité commune, mais adaptée selon les situations de chaque pays. Cette disposition a donné lieu, en fait, à un alibi permettant l’absence d’engagements de réduction par les pays en voie de développement et les pays émergents, position qui a été confirmée dans le protocole de Kyoto. Les pays émergents comme la Chine, et surtout l’Inde, n’ont pas jusqu’ici montré de volonté de renoncer aux avantages de ces concessions, même si un tel engagement ne devrait pas être antérieur à dix ou vingt ans. Dans le même temps, ils ont suspendu toute initiative dans cette direction parce qu’elle demeure conditionnelle à ce que les pays industrialisés, et en particulier les Etats-Unis, fassent la démonstration qu’ils réalisent aussi des efforts substantiels pour réduire les émissions.
Les pays en voie de développement ont mis au point deux types d’arguments à cet égard. Le premier concerne la « responsabilité historique » pour le carbone qui a été proposé par les économies développées jusqu’ici. Ces pays avancés ont épuisé en grande partie la capacité de l’atmosphère à absorber le carbone et devraient compenser les pays en voie de développement pour cette « expropriation ». L’argument est sérieux, mais n’empêche pas certaines objections. Les pays riches n’ont pas agi en connaissance de cause ; ils se sont développés avec la conviction, jusqu’à tout récemment universellement partagée, que l’atmosphère était une ressource inépuisable. En outre, les « expropriateurs » sont morts et enterrés. Leurs descendants, bien qu’ils soient identifiables, ne devraient pas être tenus responsables des actes qu’ils n’ont pas commis. Ces objections n’annulent pas du tout l’argumentation de la « responsabilité historique » et les économies en développement bénéficieront énormément de l’industrialisation passée.
La deuxième ligne argumentaire des pays en voie de développement concerne la répartition équitable des futures émissions de carbone. Supposons que les émissions mondiales sont contrôlées par des permis d’émission. Alors les pays en développement estiment que ces permis ou autorisations devraient être distribués sur la base de la population ou du revenu par habitant. Si on prend comme critère la population, le raisonnement est d’abord d’ordre juridique : chaque être humain a le même droit d’utiliser le carbone global. Sur la base du revenu par habitant, l’argument est cette fois égalitaire : les autorisations doivent être accordées aux plus pauvres afin de rejoindre le niveau des autres. Ces deux principes impliquent que ces licences ou permissions soient accordées aux économies en voie de développement, soit parce qu’elles représentent la plus grande partie de la population mondiale, soit parce qu’elles représentent la majorité des plus pauvres du monde. Le problème est que ces principes ne sont pas généralement reconnus dans les relations internationales. S’il n’existe pas, par exemple, d’accord sur le principe du partage des ressources naturelles, pourquoi devrait-il y en avoir un sur l’atmosphère?
Pour sortir de ce labyrinthe, l’économiste Vijay Joshi propose d’appliquer un principe qui est largement accepté comme une condition minimale d’impartialité, à savoir agir sans faire des dégâts. Dans le contexte du changement climatique, l’application de ce principe reviendrait à permettre aux pays en voie de développement de réduire leurs efforts climatiques jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à éliminer la pauvreté. Cela reviendrait à accepter le maintient du rythme actuel de croissance pendant un certain temps (pour l’Afrique plus que pour la Chine, par exemple), après quoi l’octroi de ces permis d’émission se verrait progressivement réduit. Pour accélérer le mouvement de convergence, on pourrait favoriser le transfert de certaines technologies vers les pays les moins avancés afin qu’ils puissent réduire le coût de leurs efforts.
Les négociations sur le changement climatique sont si importantes que personne ne peut se permettre de camper sur ses positions. La réussite de ces négociations, où il est question d’adaptation, doit inclure des accords avec des pays comme la Chine, l’Inde ou le Brésil, car ils représentent, dans le proche avenir, la plus grande partie des émissions mondiales. Et il est encore essentiel d’y parvenir dans un esprit de justice. Ce sera difficile, bien entendu, car les conceptions de la justice sont aussi diverses et aussi controversées que les intérêts de chacun. C’est pourquoi enfin l’habileté politique est indispensable à la tâche de construire un compromis entre les différentes parties.
Dominic Desroches : Peut-être une dernière question pour conclure ce court entretien consacré au problème de la justice climatique. L’erreur, dans les temps difficiles, est d’abandonner. Si nous devions commencer par accomplir un tout petit pas pour améliorer la gouvernance mondiale en période de haute mondialisation, que devrions-nous faire précisément ?
Daniel Innerarity : Je propose de prendre au sérieux la métaphore qui dit que nous vivons désormais dans un « monde sans alentours ». Qu’est-ce que cela signifie?
D’abord que nous partageons un destin commun en raison de la présence de risques qui nous menacent tous et dont la menace relativise la distinction entre le particulier et le commun. Or, comme ces risques indésirables ne respectent pas les frontières, ni les zones de responsabilité connues, le monde commun se constitue avec la suppression rigide de la différence entre soi et les autres ; de plus en plus d’ailleurs, l’affrontement entre les intérêts privés et les biens communs devient inutile, et, de la même manière, se brouille le contraste entre ce qui est ici et ce qui est là-bas. On peut expliquer cette curieuse constellation avec la métaphore voulant que le monde soit désormais sans alentours, sans frontières, sans extérieur, sans banlieues. Est global, ce qui ne laisse rien hors de soi, ce qui contient tous les liens et les intègre de manière à ce que rien ne soit abandonné, isolé, indépendant, perdus ou protégés, sauvés ou condamnés de l’extérieur. L’expression le « reste du monde » est une fiction ou une manière de parler lorsqu’il n’y a rien qui ne participe pas à notre monde commun. Dans un monde sans alentours, la proximité (ou les environs immédiats) devient ce qui est disponible et l’horizon temporel s’étend de manière significative. La tyrannie de la proximité se détend et d’autres considérations peuvent alors entrer en jeu. On peut comprendre cela avec l’expression exacte de Martin Shaw: « there are no others ».
La suppression des marges implique également la fin de deux opérations courantes qui sont comme les deux faces d’une même médaille : assurer sa propre immunité et déplacer vers l’extérieur ce qui est indésirable. Quand existait un « autour », existait un ensemble d’opérations qui nous permettait d’utiliser ces espaces marginaux à certaines fins. On pouvait s’échapper, s’ignorer, se protéger. Il y avait alors un sens dans l’exclusivité du même, la recherche d’une clientèle particulière et les raisons d’État. La disparition des environs, dans la mesure où elle annule la distinction entre intérieur et extérieur, entraîne la perte d’une zone de confort à partir de laquelle on observait le naufrage des autres. Cette disparition implique aussi, par conséquent, la fin de toute immunité garantie. Il est devenu difficile et précaire d’établir des périmètres de sécurité, dans le temps ou l’espace, qui nous permettrait définitivement de nous protéger contre certains problèmes déterminés.
D’autre part, quand nous disposions d’un « autour », presque tout pouvait se résoudre dans la simple opération visant à externaliser les problèmes, à les transférer vers une marge, c’est-à-dire loin de la vue, dans un endroit éloigné, et même les repousser à un autre moment. Un « autour » est justement un lieu où l’on dépose pacifiquement les problèmes non résolus, ce dont nous cherchons à nous débarrasser, nos déchets, nos ordures. La théorie moderne de l’État national souverain s’est configurée de manière explicite en déplaçant les problèmes vers l’extérieur, en se débarrassant de l’encombrant : Hobbes a réclamé l’ordre interne au moyen d’un concept de souveraineté qui impliquait l’ « exportation » de l’anarchie à l’extérieur, une configuration politique qui a débouché ainsi sur un système international concurrentiel et exclusif.
Peut-être qu’avec cette idée de la suppression des alentours peut se formuler aussi le vœu d’un processus civilisateur apportant des bénéfices plus avantageux et un progrès dans la construction d’espaces habitables dans le monde commun. Pour cela, il n’est pas nécessaire de punir des personnes et la chose est suffisamment difficile comme cela : « passer la mort » aux autres, dans les régions éloignées, aux générations futures, vers d’autres secteurs sociaux. La mondialisation (globalización) revient à l’incapacité d’expulser l’autre, de le sortir d’un pas seulement de notre portée. Nos plus grands progrès prennent la forme d’une obligation d’intérioriser et de s’interdire l’externalisation.
Dominic Desroches : Merci, Daniel Inerarity, d’avoir bien voulu répondre à mes questions.
Biographies
Né à Bilbao, Daniel Innerarity est un penseur espagnol original dont l’œuvre connaît, depuis quelques années déjà, un écho important. Il est actuellement chercheur Ikerbasque et membre fondateur de l’Institut de gouvernance démocratique basé à San Sebastian (Esp.), dont le mandat est de réfléchir aux nouveaux enjeux de la gouvernance mondiale. S’il propose une interprétation stimulante des transformations de la politique, il s’est aussi intéressé à la Théorie critique, à la sociologie des systèmes, au Romantisme allemand ainsi qu’à certaines questions relevant de l’éthique, de l’esthétique et de la théorie littéraire. Il a déjà fait paraître une dizaine d’ouvrages, une centaine d’articles scientifiques et publie encore, sur une base régulière, des analyses politiques dans deux grands quotidiens espagnols.
Dominic Desroches est professeur de philosophie à Montréal. Après un doctorat en philosophie et des études en Allemagne et au Danemark, il a publié aux Presses de l’Université Laval un ouvrage intitulé Expressions éthiques de l’intériorité portant sur l’éthique de Kierkegaard. En avril 2009, il a fait paraître sur La Vie des Idées un article intitulé « La politique du temps » dans lequel il y discutait les contributions de Sloterdijk (Colère et temps, 2007) et d’Innerarity (Le Futur et ses ennemis, 2008) au problème du temps politique. Il travaille depuis sur le projet d’une climatologie politique qui, inspirée des avancées de ces derniers, veut montrer comment la politique est tributaire du temps compris globalement comme horizon temporel, ambiance et climat.
[1] Innerarity, D., « Un mundo gaseoso », in Diario Vasco, 10/05/2010.
[2] Innerarity, D., « Justicia climática », in El País, 14/12/2009.