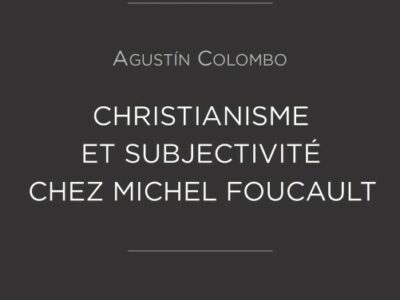recension – La pensée extrême
Recension de l’ouvrage de Gérald Bronner, La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques
La pensée extrême constitue un vrai défi pour l’individualisme méthodologique : l’adhésion à des idées fanatiques peut-elle être expliquée par l’imputation d’une rationalité cognitive aux agents concernés ? L’ouvrage de Gérald Bronner tente en partie de répondre positivement à cette interrogation. Plus généralement, il se propose de définir la « pensée extrême », les conditions sociocognitives de son émergence et de sa diffusion à partir d’une réflexion sur la rationalité et sur son fonctionnement au sein des divers contextes sociaux.
Une « enquête cognitive »
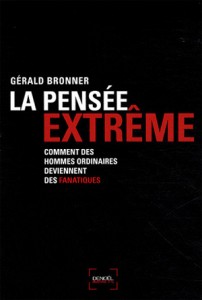 L’originalité de la démarche de l’auteur est de s’écarter de ce que l’on pourrait nommer, au sens nietzschéen du terme, l’a priori symptomatologique qui guide souvent l’analyse des croyances extrêmes et qui consiste à dériver mécaniquement ces mêmes croyances des affects supposés fondamentaux qu’elles sont censées trahir. Ce présupposé méthodologique, que l’on peut interpréter comme une version forte de ce que Boghossian nomme le « constructivisme de l’explication rationnelle » (Boghossian, 2009, p.28) consiste à considérer que nos raisons épistémiques de croire sont par principe inaptes à expliquer l’émergence de nos croyances et nous invite ainsi à dissocier radicalement la question de l’explication de nos adhésions du problème de leur justification. On peut d’ailleurs remarquer que cet a priori interprétatif est omniprésent jusque dans l’analyse médiatique des évènements sociaux : une grève semble souvent trouver son explication et sa condition d’intelligibilité dans le « malaise » des grévistes dont les revendications, soigneusement déconnectée des justifications qui les sous-tendent, constitueraient le « symptôme ». Ainsi décrit, ce type de mouvement social ne peut, par conséquent, qu’exiger un « traitement » particulier. Au contraire, l’auteur entend procéder à ce qu’il nomme une « enquête cognitive », soucieuse de comprendre ces adhésions à la lumière des systèmes de raisons dont les acteurs ont une conscience plus ou moins claire. C’est dire que la reconstitution des raisons cognitives de croire peut avoir une portée explicative et que la justification des croyances ne saurait ainsi être réduite à une simple rationalisation, autrement dit à une reconstruction artificielle mais socialement et épistémiquement acceptable du processus d’adhésion.
L’originalité de la démarche de l’auteur est de s’écarter de ce que l’on pourrait nommer, au sens nietzschéen du terme, l’a priori symptomatologique qui guide souvent l’analyse des croyances extrêmes et qui consiste à dériver mécaniquement ces mêmes croyances des affects supposés fondamentaux qu’elles sont censées trahir. Ce présupposé méthodologique, que l’on peut interpréter comme une version forte de ce que Boghossian nomme le « constructivisme de l’explication rationnelle » (Boghossian, 2009, p.28) consiste à considérer que nos raisons épistémiques de croire sont par principe inaptes à expliquer l’émergence de nos croyances et nous invite ainsi à dissocier radicalement la question de l’explication de nos adhésions du problème de leur justification. On peut d’ailleurs remarquer que cet a priori interprétatif est omniprésent jusque dans l’analyse médiatique des évènements sociaux : une grève semble souvent trouver son explication et sa condition d’intelligibilité dans le « malaise » des grévistes dont les revendications, soigneusement déconnectée des justifications qui les sous-tendent, constitueraient le « symptôme ». Ainsi décrit, ce type de mouvement social ne peut, par conséquent, qu’exiger un « traitement » particulier. Au contraire, l’auteur entend procéder à ce qu’il nomme une « enquête cognitive », soucieuse de comprendre ces adhésions à la lumière des systèmes de raisons dont les acteurs ont une conscience plus ou moins claire. C’est dire que la reconstitution des raisons cognitives de croire peut avoir une portée explicative et que la justification des croyances ne saurait ainsi être réduite à une simple rationalisation, autrement dit à une reconstruction artificielle mais socialement et épistémiquement acceptable du processus d’adhésion.
L’auteur part d’un constat : nos réactions spontanées face aux croyances extrêmes ou apparemment délirantes et aux actes qui en découlent manifestent une certaine ambivalence. Nous sommes, d’un côté, tentés d’attribuer une forme d’irrationalité aux agents (attribution d’irrationalité dont la méthode préconisée par l’auteur nous enjoint de trouver la rationalité partielle) et d’analyser leurs actes en s’interrogeant sur la pathologie éventuelle qu’ils manifestent. On se demande, à titre d’exemple, ce que traduisent les croyances conspirationnistes, de quelle pathologie ou détresse morale souffrent leurs partisans. Cette souffrance dont la croyance n’est que le symptôme est ainsi censée éclairer de manière quasi exhaustive ce mode spécifique de perception du monde social qu’est le conspirationnisme. L’invocation de ces réalités affectives que constituent le ressentiment, la haine ou la paranoïa (Joffrin, 2009) etc. suffiraient ainsi à rendre raison de ces croyances sans, malheureusement, nous renseigner sur le processus de détermination affectif et intellectuel en jeu. Nous ressentons toutefois, d’un autre côté, une certaine indignation face à ces croyances extrêmes et aux actes qu’elles inspirent, sentiment difficilement compréhensible si l’on présuppose que les agents sont réellement victimes de pathologie et/ou en proie à des mécanismes irrationnels. C’est à cette seconde face de nos réactions que l’auteur accorde du crédit : il s’agit, en un sens, d’explorer ce qu’implique ce sentiment d’indignation.
Tout d’abord, comment comprendre ce premier réflexe interprétatif, qui consiste à expliquer l’émergence de ces croyances en termes strictement causaux et non rationnels ? D’une part, l’auteur fait implicitement sienne l’analyse boudonienne du sociocentrisme spontané du sens commun (Boudon, 1992, p. 32). On pourrait résumer cette idée, certes un peu schématiquement, de la manière suivante : les attributions de rationalité d’un observateur sont inversement proportionnelles à la distance sociale, culturelle ou intellectuelle que ce dernier entretient avec les individus observés. Le sentiment d’étrangeté que nous pouvons avoir face à un individu aux convictions dites « déviantes » neutralise en quelque sorte notre aptitude à l’identification ainsi que notre interprétation en termes de raisons. L’asymétrie épistémologique est patente lorsque l’on compare, par exemple, le fonctionnalisme (sélectif) par lequel nous expliquons les croyances d’individus fort éloignés de nous culturellement et la charité auto-interprétative dont nous savons faire preuve quand il s’agit d’expliquer nos propres cheminements intellectuels (Dennett, 1987, p.120-121). En ce sens, et comme l’affirme l’auteur, la tentative de reconstruction des raisons cognitives nous détache de certaines évidences initiales, dont celle de l’irrationalité irréductible de certains comportements, évidences que viendrait dès lors conforter l’idée d’une toute-puissance des déterminants sociaux.
Une approche sociologique de la croyance
L’auteur approfondit toutefois les raisons de cette suspension de nos critères ordinaires d’attribution de sens et formule les règles d’une méthode censées nous permettre d’éviter de succomber à ces imputations systématiques d’irrationalité. Ces règles sont pertinentes en ce qu’elles mettent en lumière certains éléments constitutifs de nos croyances.
Résumons les brièvement. Nos croyances sont tout d’abord l’objet d’une triple limitation : culturelle, spatiotemporelle et cognitive. L’idée de limitation cognitive semble la plus intéressante en ce qu’elle désigne la confiance excessive que nous pouvons avoir en certaines routines mentales qui, par le passé, ont prouvé leur efficacité mais qui peuvent aisément nous conduire à des erreurs. A ce titre, la réinterprétation des résultats des expériences de Kahneman et Tversky (Kahneman, Tversky, 1973) auquel s’est livré l’auteur, dans le sillage de Boudon, est éclairante.
Deux autres aspects inhérents à nos acquisitions de croyances doivent ensuite être pris en compte. D’une part, le caractère progressif de nos adhésions nous rappelle que toute croyance extrême est le produit d’un cheminement mental et que la reconstruction du processus partiellement rationnel d’élaboration d’une croyance lui fait souvent perdre son apparente absurdité. La plupart des sectes utilisent cette mécanique incrémentale pour provoquer l’adhésion de leurs futurs adeptes à des idées dont l’extravagance les aurait rebuté au premier abord. Toute leur stratégie consiste précisément à opérer cette « préparation cognitive » (Bronner, 2009, p.189) destinée à faciliter l’acceptation de la doctrine sectaire et c’est cette stratégie minutieuse qui rend, une fois le système de croyances installé, si difficile la réévaluation de la doctrine de la part du croyant. Or, il importe de souligner que ladite préparation consiste très souvent à exhiber des informations apparemment plausibles (concernant le gourou, ses exploits, la renommée de la secte, etc.) et qu’elle s’appuie donc sur nos modes ordinaires d’acceptation rationnelle qu’en un sens elle mime. D’autre part, l’auteur insiste sur ce que l’on pourrait nommer le « principe de conditionnalité » qui exige de dissocier le contenu propositionnel d’une croyance du rapport que nous entretenons à ce contenu et, ainsi, de désactiver l’hypothèse implicite selon laquelle nos actes traduiraient nécessairement une adhésion inconditionnelle aux contenus crus. Il s’agit en réalité d’introduire la notion de « croyance minoritaire » (Bronner, 1998) : les agents sociaux adhèrent le plus souvent de manière probabiliste et non radicale à des idées apparemment délirantes et ces croyances ne catalysent, la plupart du temps, des actions que sous l’effet de situations à forte teneur anxiogène. Ce simple constat est ainsi censé nous conduire à réviser notre propension initiale à les considérer comme dépourvus de raison.
L’extrémisme en question
Comment, armé de ces acquis théoriques, caractériser la pensée extrême ? Après avoir montré que celle-ci n’est pas étrangère à la rationalité cognitive et que les actes qu’elle dicte présupposent une forme de rationalité instrumentale, l’auteur propose deux critères. Tout d’abord, la pensée extrême manifeste une adhésion inconditionnelle à des contenus, adhésion qui neutralise au moins temporairement toute concurrence intra-individuelle entre idées et, par là, toute capacité à réévaluer les raisons d’une adhésion. L’extrémiste est en ce sens remarquable par sa cohérence : la meilleure illustration de ce que l’auteur nomme l’« incommensurabilité mentale », c’est-à-dire la subordination rigoureuse et non négociable de tout un système mental à un ensemble d’idées, est l’affirmation de l’anarchiste russe Netchaïev selon lequel « il n’y a de moral que ce qui contribue au triomphe de la Révolution » (Bronner, 2001). Nous pourrions cependant rétorquer que l’homme ordinaire semble également adhérer sur un mode inconditionnel à certains contenus : ne sommes nous pas inconditionnellement opposés à la torture ou à l’esclavage ? Cette radicalité, quoi qu’invisible du fait de sa conformité aux valeurs des sociétés dans lesquelles nous vivons, semble essentielle. Si elles étaient contredites par la réalité, ces adhésions axiologiques pourraient en effet nous amener à entreprendre de actions contraires à nos intérêts immédiats et ce type de sacrifice constitue précisément un puissant révélateur de valeurs.
Le second critère va permettre de remédier à cette insuffisance : l’extrémiste « adhère radicalement à une idée radicale » (Bronner, 2009, p.130). La radicalité recouvre deux aspects de ce type d’idées. Elle concerne tout d’abord leur faible transsubjectivité, c’est-à-dire leur faible capacité à respecter nos critères rationnels d’acceptabilité et donc à s’exporter au sein d’un « marché cognitif où la concurrence entre idées serait pure et parfaite » (Ibid. p.134). Cette affirmation doit toutefois être nuancée car la vérité de certaines théories est parfois difficile à percevoir lorsqu’elle contrarie les limites de la rationalité humaine. L’auteur prend ainsi l’exemple du caractère contre-intuitif du darwinisme et de la difficulté que nous pouvons avoir à combiner dans nos tentatives d’explications de phénomènes biologiques les concepts de fonctionnalité et de hasard (Ibid. P.139-148). La transsubjectivité d’une idée n’est donc nullement équivalente à son attractivité psychologique puisque la triple limitation de nos croyances tend parfois à faciliter la diffusion de croyances objectivement fausses et explique en partie pourquoi des croyances vraies ou infiniment plus vraisemblables s’imposent difficilement. Quoi qu’il en soit, l’adhésion d’un individu à une idée faiblement transsubjective crée très souvent chez l’observateur le sentiment de son incompréhensibilité et nécessite par conséquent un effort de reconstruction afin de dépasser la commodité théorique initiale qui consiste à la déduire d’une culture, d’une mentalité ou d’un imaginaire spécifique. On pourrait alors comprendre le sens de la citation, mise en exergue de son ouvrage par l’auteur, de La Rochefoucauld qui affirmait qu’« on n’a plus de raison quand on n’espère plus de trouver aux autres » (La Rochefoucauld, 1977, p. 94) de la manière suivante : c’est faire preuve d’une insuffisante activité (indissociablement) rationnelle et interprétative que de tenter de reconstruire l’univers mental d’autrui en lui ôtant toute rationalité cognitive. Remarquons que l’homme ordinaire adhère également à des contenus faiblement transsubjectifs mais que ses croyances en question ne sont que conditionnelles : serions-nous prêt, en effet, à sacrifier une partie de nous-mêmes pour défendre la vérité de certaines superstitions, vérité à laquelle nous semblons au moins partiellement croire lorsque nous nous conformons à certaines pratiques superstitieuses ? Le second critère d’identification de la radicalité d’une croyance concerne son caractère sociopathique : du point de vue de ses implications pratiques et/ou de ses composantes conceptuelles, ce type de croyance débouche sur l’ « impossibilité pour certains hommes de vivre avec d’autres » (Bronner, Op. cit, p.259). La radicalité, et donc le caractère extrême d’une adhésion est ainsi également définie par son potentiel agonistique.
Croyances extrêmes et contexte social
La seconde partie de l’ouvrage se concentre plus spécifiquement sur le problème de l’acquisition de ces croyances et envisage différentes modalités d’adhésion qui ne sont, bien évidemment, pas exclusives l’une de l’autre : le processus d’adhésion incrémentiel, l’adhésion par transmission (lorsque l’individu est enserré par ce que l’auteur nomme un « oligopole cognitif »), l’adhésion « par frustration » et l’adhésion par « révélation/dévoilement ». Faute de pouvoir analyser une à une ces diverses figures, remarquons que l’un des aspects les plus importants de ce chapitre est la redéfinition implicite du concept de socialisation qu’il opère : l’auteur y conçoit en effet la croyance comme le résultat d’une hybridation entre des invariants cognitifs et des variables sociales. Autrement dit, la prise en compte du fait que les contenus auxquels adhèrent les agents sont étroitement liés aux différentes positions sociales qu’ils occupent n’implique nullement que les normes d’acceptabilité épistémique qu’étudie l’épistémologie classique n’aient aucune pertinence pour expliquer ces mêmes adhésions puisque, dans une certaine mesure, les agents s’y conforment et reconnaissent au moins implicitement, leur validité.
Selon l’auteur, la manière dont un système d’idées se diffuse au sein des membres d’un groupe social déterminé n’équivaut donc pas à l’incorporation aveugle de schèmes essentiellement pratiques mais dépend de notre situation sociale d’exposition préférentielle à des systèmes d’idées concurrentiels. Autrement dit, les contenus « ne s’imposent pas mais se proposent » (Ibid. p. 222). L’agent social ne saurait être réduit à un « automate cognitif » : n’avons nous pas, malgré le véritable complot dont nous étions l’objet et le quasi-monopole cognitif qui nous enserrait, cessé de croire au père Noël en partie du fait de raisonnements que, bien qu’ils soient suscités, nous avons individuellement mené (Bronner, 2006, p.109-127) ? L’utilisation que fait l’auteur des notions d’« univers sociocognitifs » et de « monopole » ou d’« oligopole cognitif » permettent de penser la transmission de croyances sur un mode non mécanique en s’attachant, par exemple, à souligner le fait qu’endosser une croyance a un coût social et cognitif, que l’on ne saurait donc, comme nous l’avons mentionné, réduire l’un à l’autre. Ces concepts permettent aussi de montrer que l’isolement social qu’utilisent et favorisent les sectes constitue également un isolement proprement épistémique au sens où ces dernières visent soigneusement à éloigner leurs adeptes des relations affectives ou des espaces sociaux incarnant et diffusant des systèmes de raisons concurrents. De même, les interactions sociales sont redéfinies et appréhendées, d’une manière assez originale, sous l’angle de la « négociation cognitive » (Bronner, op.cit, p.289) qu’elles favorisent : cette analyse nous rappelle, entre autres, que les diverses conversations que nous entretenons au sein des différents univers sociocognitifs que nous fréquentons constituent une part importante de ce qu’on nomme la socialisation (Ribak, 1997) et que la conditionnalité de nos croyances est souvent liée à nos fréquentations plurielles, ce qui explique a contrario l’inconditionnalité des adhésions extrêmes et l’homogénéité du système mental de l’extrémiste. En un sens, cette démarche appréhende à sa manière et munie de ces outils conceptuels spécifiques l’idée d’une pluralité interne à l’agent social (Lahire, 2001) mais l’interprète sous un angle plus strictement cognitif – ce qui ne doit, à notre avis, évidemment pas faire oublier les autres faces de ce phénomène complexe qu’est la socialisation. L’auteur s’attache globalement dans cet ouvrage à décrire le fonctionnement contextuel de notre rationalité et réengage ainsi le débat concernant le statut de l’imprédictibilité du comportement humain en réaffirmant son caractère irréductiblement stochastique (Bronner, op.cit, p.222).
Le problème de l’incommensurabilité mentale
L’avant-dernier chapitre, plus technique, s’interroge sur la possibilité de l’incommensurabilité mentale. Il s’attache à réfuter les tentatives d’explication des actes terroristes qui invoquent une « éclipse des convictions morales » (Pharo, 1997, p.171) et propose, en partie, une interprétation intéressante de notre vie axiologique, de la mise en balance des intérêts et des valeurs que nous opérons quotidiennement ainsi que de la concurrence intra-individuelle que se livrent ces mêmes valeurs. Plus précisément, l’auteur réfute l’idée même d’un « paradoxe de l’incommensurabilité mentale » en montrant qu’elle repose sur l’hypothèse implicite fallacieuse, que partagent certaines théories de la dissonance cognitive, selon laquelle l’évaluation de nos valeurs serait nécessairement proportionnelle à celle de nos intérêts. Autrement dit, il s’oppose à l’idée selon laquelle « il y aurait toujours un niveau d’offre suffisant pour qu’un individu accepte de produire un acte que, par ailleurs, il réprouve » (Ibid., p.283) S’inspirant de la solution fournie par Bernoulli au paradoxe de Saint-Pétersbourg, l’auteur s’attache à montrer, sur la base d’expérimentations fondées sur le « jeu de l’ultimatum », et qu’il a lui-même menées, que cette hypothèse se base sur une mécompréhension de la dynamique mentale en jeu : un certain niveau de violation de nos valeurs (auxquelles nous pouvons adhérer conditionnellement, comme l’idée, impliquée dans le « jeu de l’ultimatum », d’une répartition égalitaire des biens) nous détache de la défense de nos stricts intérêts. L’accroissement d’un coût en valeur affecte donc généralement la représentation des gains matériels et, par conséquent, de leur vertu compensatoire. Notre vie mentale ordinaire admet ainsi l’incommensurabilité : la corruptibilité humaine semble bel et bien limitée.
L’auteur propose ensuite, à titre spéculatif, de fournir une explication de l’existence de ce niveau d’adhésion inconditionnelle. Il avance l’hypothèse selon laquelle cette disposition mentale pourrait bien appartenir au patrimoine biologique de l’humanité et dérive, de ce fait, d’un mécanisme darwinien/sélectif. L’existence de cette zone d’incommensurabilité entre les intérêts matériels et les valeurs s’est peut-être révélée utile voire nécessaire à la vie sociale – qu’il suffise de penser au sacrifice de soi qu’exigent et ont toujours exigé les confrontations guerrières entre groupes sociaux.
Enfin, la conclusion de l’ouvrage, intitulée « Peut-on faire changer d’avis un terroriste ? » porte sur les facteurs permettant de neutraliser l’incommensurabilité mentale. L’auteur s’interroge en effet sur les conditions sociales, affectives et cognitives de ce qu’il nomme le « rétro-jugement », c’est-à-dire de l’abandon de ses propres adhésions par le terroriste, en exposant et évaluant ces différentes méthodes que sont, entre autres, la « tactique analogique », la stratégie « du contre-feu », la technique de « réassociation » ou celle dite du « deprogramming ». L’auteur en conclut, en conformité avec la dimension cognitive de son enquête, que c’est en ménageant coûte que coûte l’accès à des systèmes de raisons concurrents que l’on peut espérer provoquer chez l’extrémiste les révisions de croyances tant espérées et, ainsi, réintroduire une forme de commensurabilité axiologique dans son esprit. L’approche cognitive en question de ce phénomène social qu’est l’extrémisme ne constitue donc pas une simple option spéculative mais promeut également, par ses instruments théoriques, une certaine orientation thérapeutique.
Olivier Ouzilou,
doctorant en philosophie à l’Université de Provence, école doctorale : « Cognition, Langage et Education »
BIBLIOGRAPHIE
Boghossian P, La peur du savoir, Marseille, Agone, 2009
Boudon R, L’art de se persuader, Paris, Seuil, 1992
Bronner G, « le paradoxe des croyances minoritaires », Information sur les sciences sociales / Social Science Information, 37, n°2, 1998, 299-320
Bronner G, « Fanatisme, Croyance axiologique extrême et rationalité », L’ Année sociologique, 51, n°1, 2001, 137-160
Bronner G, Vie et mort des croyances collectives, Paris, Hermann, 2006
Bronner G, La pensée extrême, Paris, Denoël, 2009
Dennett D, La stratégie de l’interprète, Paris, Gallimard, 1987
Joffrin L, Média-Paranoïa, Paris, Seuil, 2009
Lahire B, L’homme pluriel, Paris, Armand Colin, 2001
La Rochefoucauld, Maximes, Paris, Flammarion, 1977
Pharo P, Sociologie de l’esprit, Paris, PUF, 1997
Ribak R, « Socialization as and through conversation Political Dicourse in Israeli Families », Comparative education revue, 41, 1, 1997, 71-96
Tversky A, Daniel K, « Availability : a heuristic for judging frequency and probability », Cognitive Psychology, 5, 1973, 207-232