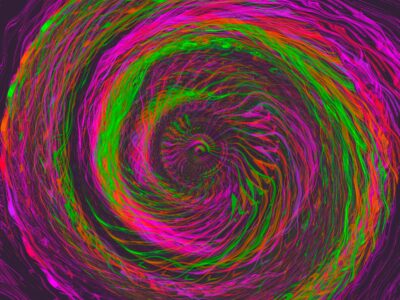Recension – L’Ère du toxique. Essai sur le nouveau malaise dans la civilisation
Samantha Lemeunier est doctorante en poésie américaine à l’ENS.
Clotilde Leguil, L’Ère du toxique. Essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, PUF, 2023.
L’ouvrage est disponible ici.
Le mot « toxique » est aujourd’hui sur toutes les lèvres : collègues, amants ou encore parents seraient susceptibles de nous instiller, petit à petit, un poison mortel. Au milieu de cette masse d’information et de désinformation, Clotilde Leguil, psychanalyste et philosophe, critique cette surutilisation du terme tout en liant cette prolifération à un phénomène plus large : la manière dont notre rapport au langage devient lui-même toxique à l’ère contemporaine. Dans L’Ère du toxique (2023), elle analyse les évolutions non seulement sémantiques de ce mot mais également comment il s’est transformé dans la psyché collective. L’autrice part des théories du Phèdre de Platon, où le terme « pharmakon » désigne le discours, perçu à la fois comme remède et poison. À l’ère contemporaine, le remède au toxique résiderait dans l’élaboration d’un « nouveau rapport à la parole » (p. 192). Cette recension suivra ainsi le cheminement de l’autrice qui divise son travail en douze chapitres. Les premières sections de l’ouvrage se penchent sur l’origine étymologique et théorique du concept de « toxique ». Ensuite, elle s’appuie sur le roman intitulé Les Désarrois de l’élève Törless (1906) de Robert Musil pour montrer comment ce qu’elle nomme « la flèche du toxicon » (p. 39) vient contaminer un individu. Cette conception du toxique est conséquemment appliquée à l’amour au travers d’une étude de Madame Bovary (1857) de Flaubert, Emma s’élevant comme l’une des premières victimes de l’amour toxique. Pour terminer, l’autrice analyse le toxique à l’ère hypermoderne, époque définie par une accélération frénétique des modes de vie, la surconsommation, et un individualisme exacerbé, qui intensifient les vulnérabilités émotionnelles et psychiques. Face à ce « nouveau malaise dans la civilisation » (p. 7), elle propose un antidote fondé sur la redécouverte d’un rapport plus sain à la parole.
Un « nouveau » malaise dans la civilisation : l’héritage freudien
 Le toxique vient du latin toxicon (« poison dont on imprègne une flèche » p. 42). Le toxique s’inscrit donc dans le champ lexical de la guerre. Néanmoins, l’usage de ce terme est subtil : les Grecs ne l’employaient pas pour parler de leurs propres techniques de combat mais considéraient que cette pratique venait des peuples qu’ils désignaient collectivement comme Barbares, c’est-à-dire des étrangers en « marge de la civilisation » (p. 43). Le toxicon semble donc, à l’origine, être « une substance venue de l’Autre » (p. 50). C’est justement cette pensée que Clotilde Leguil remet en cause dans L’Ère du toxique : si originellement, le toxique émane de l’autre, sa monographie démontre que le sujet contemporain empoisonné participe à sa propre intoxication. Cela a notamment lieu au travers du langage, car, si les toxiques étaient des substances chimiques au XXe siècle, aujourd’hui ce concept désigne « la façon nouvelle dont le corps se sent pris en otage par des mots » (p. 50). D’ailleurs, les mots eux-mêmes ont évolué : si dans Malaise dans la civilisation, Freud parle des toxiques au pluriel, il est aujourd’hui question du toxique au singulier. Les « toxiques », mot pluriel synonyme de « stupéfiants » chez Freud, est progressivement devenu le « toxique », au singulier. C’est principalement l’avènement d’une conscience écologique qui a contribué à donner une nouvelle signification au terme : au XXe siècle, le toxique est « le propre d’une industrie polluante, qui finit par ravager la diversité du vivant » (p. 19). Puis au XXIe siècle on parle de « toxique » pour parler de la vie intime mais ce terme est galvaudé : « le malaise s’éprouve, il se ressent, il dérange, sans pouvoir être défini clairement. C’est le propre du toxique […] qui s’éprouve comme en une épreuve » (p. 56). Tout est comme si le langage lui-même était intoxiqué. Dès lors, pour étudier ce « logos empoisonné par le toxique » qui fait que « les paroles se plantent en notre chair comme des flèches empoisonnées » (p. 58), Clotilde Leguil s’appuie sur la littérature, art qui met en scène le langage et ses dérives.
Le toxique vient du latin toxicon (« poison dont on imprègne une flèche » p. 42). Le toxique s’inscrit donc dans le champ lexical de la guerre. Néanmoins, l’usage de ce terme est subtil : les Grecs ne l’employaient pas pour parler de leurs propres techniques de combat mais considéraient que cette pratique venait des peuples qu’ils désignaient collectivement comme Barbares, c’est-à-dire des étrangers en « marge de la civilisation » (p. 43). Le toxicon semble donc, à l’origine, être « une substance venue de l’Autre » (p. 50). C’est justement cette pensée que Clotilde Leguil remet en cause dans L’Ère du toxique : si originellement, le toxique émane de l’autre, sa monographie démontre que le sujet contemporain empoisonné participe à sa propre intoxication. Cela a notamment lieu au travers du langage, car, si les toxiques étaient des substances chimiques au XXe siècle, aujourd’hui ce concept désigne « la façon nouvelle dont le corps se sent pris en otage par des mots » (p. 50). D’ailleurs, les mots eux-mêmes ont évolué : si dans Malaise dans la civilisation, Freud parle des toxiques au pluriel, il est aujourd’hui question du toxique au singulier. Les « toxiques », mot pluriel synonyme de « stupéfiants » chez Freud, est progressivement devenu le « toxique », au singulier. C’est principalement l’avènement d’une conscience écologique qui a contribué à donner une nouvelle signification au terme : au XXe siècle, le toxique est « le propre d’une industrie polluante, qui finit par ravager la diversité du vivant » (p. 19). Puis au XXIe siècle on parle de « toxique » pour parler de la vie intime mais ce terme est galvaudé : « le malaise s’éprouve, il se ressent, il dérange, sans pouvoir être défini clairement. C’est le propre du toxique […] qui s’éprouve comme en une épreuve » (p. 56). Tout est comme si le langage lui-même était intoxiqué. Dès lors, pour étudier ce « logos empoisonné par le toxique » qui fait que « les paroles se plantent en notre chair comme des flèches empoisonnées » (p. 58), Clotilde Leguil s’appuie sur la littérature, art qui met en scène le langage et ses dérives.
L’expérience toxique : l’exemple de Törless
Clotilde Leguil entreprend de raconter comment le toxique s’immisce dans l’individu au travers de son analyse du personnage principal de Robert Musil dans Les Désarrois de l’élève Törless (1906). Il s’agit d’un roman psychologique qui se déroule dans un pensionnat militaire. Si, de l’extérieur, le pensionnat semble être un endroit où les règles et la morale sont respectées, de l’intérieur, Törless est le témoin forcé des abus infligés par deux autres élèves, Beineberg et Reiting, à son camarade Basini. Ils le torturent la nuit, alors que tout le monde dort, car Basini est en fait un voleur. Basini accepte de devenir leur bouc-émissaire pour acheter leur silence. D’abord contraint à assister aux tourments de Basini, puis fasciné par les dynamiques de pouvoir que cela suppose, Törless se retrouve pris au piège entre son désir de rester neutre et son sentiment de complicité passive. Il finit par prendre part à la torture, comme s’il avait été intoxiqué par ses deux camarades. Clotilde Leguil explique ce changement de comportement en trois points.
Premièrement, « Törless se voit intoxiqué par un discours […] sur le Bien et le Mal » (p. 70) : les deux bourreaux ne cessent en effet de répéter à Törless que Basini mérite d’être torturé car c’est un voleur. Ainsi, bien qu’il soit animé par la méchanceté, ce discours fait « miroiter la dimension du devoir » (p. 71). Pour mieux comprendre, revenons au lieu où les notions de Bien et de Mal sont intériorisées par le sujet, nommément le surmoi freudien. Il contrôle et régule les impulsions et les désirs du ça et joue donc un rôle important dans le développement de la conscience morale et de la culpabilité. Néanmoins, pour Törless, dans le cas du toxique, « la dialectique du bien et du mal déraille » (p. 96). Cela amène Clotilde Leguil à noter que « le nouveau malaise dans la civilisation implique une reformulation du surmoi » (p. 96). Selon elle, il ne s’agit plus pour le surmoi de devoir soumettre le moi aux exigences morales : il y a eu un glissement des exigences du surmoi, qui peut désormais aussi porter une injonction à la jouissance. Dès lors, « ce qui est toxique, c’est un discours qui promeut la nécessité de forcer l’accès à la jouissance, ouvrant sur une expérience qui conduit à céder à ce forçage » (p. 99). C’est au travers de « Kant avec Sade » (1966) de Jacques Lacan que Clotilde Leguil va plus loin dans son explication du discours toxique qui brouille la limite entre le Bien et le Mal. Kant, dans sa Critique de la raison pure, affirme « la souveraineté de la loi morale en chacun comme seule voie éthique » (p. 102). Lacan, qui commente ce texte, interprète conséquemment que « l’obéissance à la loi morale peut nous faire un peu mal. Lorsque je souffre à faire le bien, que le bien produit une douleur, alors je sais que je fais mon devoir » (p. 103). C’est de cette manière que le psychanalyste rapproche la philosophie de Kant des écrits de Sade. Ainsi, dans cette conception des choses, le mal que je ressens est en fait un bien, et « on tire une jouissance de se faire du mal à faire le bien » (p. 104). De cette articulation naît le discours toxique qui, sous couvert du devoir, brouille le clivage entre le Bien et le Mal. Dans Les Désarrois de l’élève Törless, s’ensuit ce que Musil nomme la « sujétion intérieure »[1] : Törless n’est plus seulement forcé de participer à la torture de Basini mais est intérieurement convaincu qu’il s’agit de son devoir, et qu’il doit donc se soumettre aux deux bourreaux au nom du « Bien ».
Deuxièmement, « Törless devient pur regard. Sans le savoir, il est l’œil qui jouit de ce qu’il voit » (p. 73). Cela l’amène, troisièmement, à être « intoxiqué par sa propre jouissance » (p. 74), et il se met à participer à la torture. Cette intoxication dépasse toute limite : Törless va plus loin que ses deux compères puisqu’il ne se contente pas d’insulter Basini mais veut le faire participer à sa propre torture, il veut qu’il se dénigre lui-même. Alors il lui demande de dire « je suis un voleur », c’est-à-dire « de se définir lui-même selon la jouissance des autres. […] Törless exige de Basini qu’il se détache de son ‘je,’ de son identité, de son humanité » (pp. 75-76). Grâce à ce stratagème que Clotilde Leguil qualifie de « contre-cogito » (p. 78), Törless intoxique à son tour Basini.
C’est in fine le dégoût qui permet à Törless d’échapper à sa dérive toxique. Beineberg veut tuer Basini. Pour Törless, c’en est trop, et il prévient secrètement Basini. Törless échappe ainsi au toxique car il atteint sa limite. Le toxique est donc la recherche d’une « jouissance qui fraie une voie vers l’absence de limite » (p. 90). Donc, si le discours sur le devoir s’érige comme origine du toxique, le dégoût serait, quant à lui, son antidote.
Vers une jouissance toxique : amour, excès et dépendance
Clotilde Leguil note que l’on pourrait toutefois objecter que ce qu’il manque à Törless, c’est l’amour. Si selon Lacan, une jouissance illimitée est impossible en amour (« seul l’amour permet à la jouissance de condescendre au désir »[2]), cela n’est pas vrai de l’amour passion, mythe au sein duquel l’être aimé devient celui ou celle à qui l’on adresse son discours, et donc, celui ou celle que l’on empoisonne. Partant de cette hypothèse, Clotilde Leguil fait subir « une torsion à l’aphorisme lacanien en considérant depuis l’amour toxique que seul l’amour conduit à sacrifier son désir pour se soumettre aux conditions de jouissance d’un autre. Seule la jouissance de l’amour au-delà du désir conduit à céder au toxique » (p. 122). Pour illustrer cette idée, l’autrice explore Madame Bovary (1857) de Flaubert, roman au sein duquel l’adultère d’Emma Bovary la conduit à consommer un poison, de l’arsenic, pour se suicider. Dans le roman, la jouissance de l’amour d’Emma prend origine dans les romans d’amour qu’elle lit. À tel point que sa belle-mère conseille de la priver de lecture : « N’aurait-on pas le droit d’avertir la police si le libraire persistait quand même dans son métier d’empoisonneur ? »[3]. Le mythe littéraire de l’amour passion s’érige ici comme toxique duquel Emma est dépendante. C’est par ce détour, cette illustration de la dépendance amoureuse, que Clotilde Leguil dépasse les théories de Simone de Beauvoir. Dans Le Deuxième Sexe, Beauvoir plaide pour la réciprocité amoureuse qui sortirait les femmes de leur état de sujétion : « la relation réelle est de réciprocité ; […] elle est reconnaissance des libertés qui se confirment l’une l’autre »[4]. Néanmoins, Clotilde Leguil explique que la situation est plus complexe, il faut plus qu’une réciprocité car le toxique n’est pas uniquement l’Autre : « Si une femme peut se perdre dans l’addiction à l’amour, c’est aussi qu’elle en éprouve une jouissance dont elle ne parvient plus à se passer. Ce n’est pas tant qu’elle est sujette à l’autre, mais qu’elle est le jouet de sa propre jouissance » (p. 132). L’Autre n’a besoin que d’instiller le discours empoisonné pour qu’ensuite il perdure, de manière autonome, dans ma psyché et fasse dérailler mon surmoi. En d’autres termes, il y aurait deux phases dans l’amour toxique : une première étape où la personne intoxiquée éprouve une jouissance excessive, puis une deuxième phase de réalisation et de dégoût.
La dernière partie de l’ouvrage de Clotilde Leguil porte sur des formes encore plus contemporaines de toxicité, et notamment celle du toxique à l’ère hypermoderne : dans quelle mesure le sujet participe-t-il à son propre empoisonnement au travail ? Pour elle, le burn out correspond au « forçage de ses propres limites » (p. 140). Les stratégies managériales contemporaines sont toxiques en ce qu’elles incitent les employés à s’auto-évaluer (et, par là même, à participer à leur propre dévaluation) ; les salariés sont donc conditionnés à dire qu’ils sont prêts « à faire toujours plus » (p. 141). Dans cette configuration, « le sujet ne peut se révolter, ni résister à la pression, puisqu’il se la met lui-même » (p. 141). Il faut donc, à en croire l’analyse de Clotilde Leguil, une limite au progrès, ou plutôt une limite à la jouissance procurée par le progrès productiviste. Un exemple de cette éventuelle limite apparait dans l’œuvre dystopique de David Cronenberg intitulée Les Crimes du futur (2022), film de science-fiction dans lequel la douleur a disparu. Dans ce futur proche, les êtres humains peuvent digérer le plastique et en jouir en guise de « punition » (p. 175). La dernière question de Clotilde Leguil, qui reste alors sans réponse, est : « Existe-t-il une alternative à ce cauchemar d’une humanité ingérant le toxique qu’elle est devenue pour elle-même ? » (p. 178).
Somme toute, dans L’Ère du toxique, l’autrice met en lumière la manière dont le langage, notamment le discours sur le Bien et le Mal, peut agir comme un agent toxique déclenchant des réactions en chaîne qui conduisent à des comportements autodestructeurs. En tant que psychanalyste, elle préconise ainsi la parole comme antidote : « je me suis séparée de ce bout de mon corps marqué par la flèche en trouvant comment le dire » (p. 192). D’un point de vue plus critique, il faut noter que Clotilde Leguil adopte toutefois une posture difficile tant elle pourrait être interprétée comme culpabilisante envers les victimes intoxiquées. La psychanalyste écrit par exemple que puisqu’elle accepte l’adultère, Emma donne « son consentement » (p. 123) pour être intoxiquée. En insistant sur l’idée que l’individu participe activement à son empoisonnement, Leguil semble ainsi négliger les dynamiques de pouvoir et les structures sociales qui conditionnent les expériences vécues des victimes. Une telle simplification pourrait renforcer des narratifs déjà dominants qui marginalisent la voix des victimes, en occultant la complexité des contextes historiques et culturels qui sous-tendent leur situation. L’autrice répond néanmoins à cette critique dans une interview donnée sur France Inter en septembre 2023[5] et explique que son objectif n’est pas de culpabiliser les victimes mais de mettre en lumière des dynamiques psychanalytiques. Il serait toutefois précieux de concevoir la perspective de Clotilde Leguil en regard d’autres travaux qui privilégient une approche empathique et interrogent les conditions systémiques sous-jacentes aux souffrances individuelles. Pensons, entre autres, aux écrits de Judith Butler qui traitent de concepts tels que la précarité et la vulnérabilité et mettent en lumière les dimensions collectives et systémiques de la souffrance individuelle tout en soulignant l’importance des conditions sociales et politiques qui façonnent l’expérience humaine[6].
[1] Musil, Robert, Les Désarrois de l’élève Törless (1906), tr. fr. Philippe Jaccottet, Paris, Seuil, 1960, p. 62.
[2] Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre X, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, « Champ freudien », 2004, p. 209.
[3] Flaubert, Gustave, Madame Bovary. Mœurs de province (1857), Paris, Gallimard, « Folio Classique », 2001, p. 190.
[4] De Beauvoir, Simone, Le Deuxième Sexe I (1949), Paris, Gallimard, 1976, p. 291.
[5] Leguil, Clotilde, « Le mot ‘toxique’ a changé de sens entre le XXe et le XXIe siècle », France Inter, 17 septembre 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=30ZFeu4PktY>.
[6] Butler, Judith, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Londres, Verso, 2006.