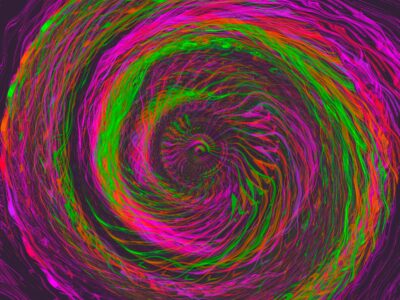Compte-rendu critique – Terres frontalières/La Frontera. La nouvelle mestiza
Marie-Lou Reymondon est doctorante en philosophie des sciences au laboratoire « Sciences, Normes et Démocratie » de Sorbonne-Université. Elle travaille sur les apports épistémiques de la diversité sociale en sciences sous la direction de Cédric Paternotte.
Gloria Anzaldúa, Terres frontalières/La Frontera. La nouvelle mestiza, Traduit de l’anglais (États-Unis) et de l’espagnol (États-Unis/Mexique) par Nino S. Dufour & Alejandra Soto Chacón, Préface de Paola Bacchetta, Éditions Cambourakis, 2022.
L’ouvrage est disponible ici.
Résumé :
La traduction française de l’œuvre Terres Frontalières/La Frontera, est l’occasion de lire l’épistémologie de Gloria Anzaldúa à la lumière des concepts de l’épistémologie du positionnement dont elle fut l’une des premières contributrices. En partant de l’expérience de la Frontera comme lieu de connaissances minoritaires, nous verrons comment les minorités qui habitent ces terres frontalières, les mestiza·os, sont dans une situation épistémiquement paradoxale : iels subissent de fortes injustices épistémiques du fait des mécanismes de silenciation et d’une structuration binaire de la pensée qui les invisibilisent, tout en pouvant développer des capacités épistémiquement privilégiées, qu’Anzaldúa nomme la facultad. Mais l’éveil de leur conscience requiert de la décoloniser des figures et concepts occidentaux, ce qui passe chez Anzaldúa par l’usage des images et de la spiritualité autochtones. Par l’épreuve de la domination et de l’exclusion, mais aussi par l’écriture et la réflexion, la nouvelle mestiza surmonte la binarité et émerge en tant que nouveau positionnement. Cette émergence est également politique dans la mesure où les terres frontalières sont aussi l’espace de la réconciliation potentielle entre les catégories sociales et la mestiza est celle qui pourra traduire les expériences dominées dans une nouvelle langue hybride. Les dominant·es doivent cependant parcourir à leur tour la moitié du chemin pour retrouver la part d’elleux-mêmes qu’iels ont rejetée de l’autre côté de la frontière.
Mots clés : Gloria Anzaldúa, queer, épistémologie du positionnement, mestiza, métisse, frontière, frontera
Abstract :
The French translation of Borderlands/La Frontera, gives an opportunity to read Gloria Anzaldúa’s epistemology in the light of the concepts from the standpoint epistemology to which she was one of the first contributors. Starting from the experience of la Frontera as a place of minority knowledge, we will see how the minorities who live on these borderlands, the mestizo-as, are in an epistemically paradoxical situation: they suffer strong epistemic injustices, due to the silencing mechanisms and the binary thinking erasing them, while at the same time, they are able to develop epistemically privileged capacities, which Anzaldúa calls la facultad. But the awakening of their consciousness requires to decolonize it from Western concepts and figures, which in Anzaldúa’s case implies the use of indigenous images and spirituality. Through the experience of domination and exclusion, but also through writing and thinking, the new mestiza overcomes binarity and emerge as a new standpoint. This emergence is also political, since borderlands is a space of potential reconciliation between social categories, and the mestiza is the one who will be able to translate the dominated experiences into a new hybrid language. But, the dominants are called to go halfway in order to meet the part of them that they rejected to the other side of la Frontera.
Key words : Gloria Anzaldúa, queer, standpoint epistemology, mestiza, mixed-race, borderland,
Introduction
La traduction en français, trente-cinq ans après sa parution, de Terres Frontalières/La Frontera : La nouvelle mestiza de l’écrivaine queer et féministe chicana Gloria Anzaldúa est l’occasion de (re)lire un texte dont la réception francophone mérite d’être élargie. Anzaldúa est présentée par les spécialistes français·es comme une autrice de référence pour la pensée décoloniale et intersectionnelle et comme une des premières théoriciennes à se qualifier de queer et à théoriser le queer dès 1981 dans son texte « La Prieta »[1], puis dans Terres frontalières/La Frontera en 1987. La réception francophone, notamment les travaux de Camille Back et de Paola Bacchetta qui a préfacé l’ouvrage, s’est jusque-là principalement intéressée à la façon dont les travaux d’Anzaldúa, et plus généralement des queers of color, ont été occultés de la généalogie des études queer au profit d’auteur·rices blanc·hes[2]. Si la traduction de Terres frontalières/La Frontera participe à corriger cette injustice épistémique, son étude ne doit pas s’arrêter aux portes des études queer, mais doit au contraire servir de pont entre des domaines qui ne communiquent pas toujours en France. En effet, ses travaux sont également précurseurs d’un autre courant de la philosophie qui voit le jour dans les années 1980, l’épistémologie du positionnement ou l’épistémologie des savoirs situés, puisque dans ses écrits, « queer apparaît comme une catégorie identificatoire et comme une positionnalité »[3]. Cette recension ne vise pas à synthétiser de façon exhaustive les différentes dimensions poétique, historique, linguistique d’une œuvre riche dont l’étude est encore en cours, mais à considérer Anzaldúa en tant qu’épistémologue.
Dans son article fondateur « Situated knowledges »[4], publié en 1988, soit un an après Terres frontalières/La Frontera, Donna Haraway mentionne elle-même l’ouvrage d’Anzaldúa dans une parenthèse aux côtés de Nancy Hartstock et Sandra Harding. Tout en étant acclamée pour son œuvre, Anzaldúa se voit refuser son entrée en doctorat d’histoire de la conscience à l’Université de Californie à Santa Cruz, dans un programme où enseignait pourtant Donna Haraway et Teresa de Lauretis, avant d’être acceptée en doctorat de littérature[5]. Ce refus proviendrait d’une réticence vis-à-vis des dimensions biographique et spirituelle de sa philosophie : à une époque où il valait mieux être « cyborg que déesse »[6], les références à la « madre naturaleza » (50) et aux différentes vierges mexicaines et déesses aztèques étaient certainement mal reçues, rattachées à une vision essentialisante du féminin. Pourtant, la nouvelle mestiza a bien des points communs avec le·a Cyborg de Haraway, puisqu’iels sont tous·tes deux des figures du dépassement de la binarité[7]. Quant à la nature, loin d’être stabilisée, elle est le terreau de l’hybridité et de la transition permanente dans l’œuvre d’Anzaldúa. Différence cependant notable, si Haraway s’inspire des récits de science-fiction, Anzaldúa ancre sa théorie dans une biographie de l’intime : son histoire familiale, son désir sexuel, la douleur de son corps, le travail dans les champs de pastèques, les gardes-frontières (la migra), ses rêves nocturnes, tout ceci dans des langues qui s’entrecroisent et s’hybrident et dont seul l’anglais a été traduit dans le corps du texte par Nino S. Dufour et Alejandra Soto Chacón. Nous tâcherons de montrer en quoi ces deux dimensions – spirituelle et biographique – renforcent plus qu’elles ne font obstacle à la puissance philosophique d’un texte, qu’on peut considérer comme le paradigme de ce que veut dire philosopher depuis une situation sociale dominée.
I. Une philosophie située : du particulier vers l’universel
« Ce livre, donc, parle de mon existence. » (48)
Terres Frontalières/La Frontera : la nouvelle mestiza est une « autohistoría-teoría » (36), c’est-à-dire un récit auto-référentiel produisant un savoir théorique à partir d’éléments biographiques replacés dans une histoire sociale. Anzaldúa part d’une description de la vie des Chicana·os, un peuple aux origines mexicaines mais de nationalité états-unienne, « annexé en même temps que les terres conquises » lors de la guerre du Mexique. Ce peuple, dont elle retrace l’histoire dans le premier chapitre « Notre Terre, Aztlan : el otro Mexico » (p. 53), vit plus spécifiquement dans la vallée du Rio Grande à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis dont les terres fertiles furent majoritairement accaparées par « los gringos ». De l’autre côté du fleuve où vivent « los Mexicanos del otro lado », la traversée de la frontière est une question de survie. À l’époque d’Anzaldúa, le mouvement politique chicano s’opposait à l’État-Nation et au capitalisme états-uniens. Mais parce qu’il se désintéressait de la condition des femmes, un mouvement féministe chicana vit le jour dans lequel Anzaldúa fut partie-prenante.[8] Elle fut également active dans la coalition des féministes et queers of color, en éditant avec Cherríe Moraga This Bridge Called My Back.[9]
Ce contexte militant et biographique est central pour comprendre la théorisation par Anzaldúa des deux concepts majeurs de l’œuvre, la Frontera et la mestiza. Anzaldúa dresse des ponts, tisse des liens entre différentes expériences qu’elle traverse, si bien que son livre devient « un motif en mosaïque (de type aztèque), un motif tissé » (138). Avec elle, nous cheminons vers une théorisation ancrée dans le réel en repérant des similarités entre différents positionnements dominés et entre différentes structures de pouvoir. Ainsi, la Frontera désigne la frontière physique entre le Texas et le Mexique, toutes les autres frontières physiques, et en même temps ces frontières sociales fondées sur le binarisme : homo/hétéro, homme/femme, riche/pauvre, Mexique/Etats-Unis, anglais/espagnol, anglos/latinos etc. Elle le précise dans le passage suivant :
Les terres frontalières psychologiques, les terres frontalières sexuelles et les terres frontalières spirituelles ne sont pas spécifiques au Sud-Ouest. En effet, les Terres frontalières sont présentes physiquement partout où deux cultures ou plus se bordent, où des gens de différentes races occupent le même territoire, où les classes populaires, moyennes et supérieures se touchent, où l’espace entre deux individus est rétracté par leur intimité. (49)
Quant à la mestiza, la « femme de frontière » (49), elle est la figure du dépassement de la binarité produite par la frontière. Elle ne renvoie pas seulement à l’expérience chicana, mais elle fait écho à d’autres expériences trans-frontalières :
los atravesados : les gens louches, les pervers, les queers, les pénibles, les métis, les mulâtres, les sang-mêlé, les demi-morts ; bref, ceux qui traversent, qui outrepassent, qui franchissent les confins du “normal”(56).
L’expérience métisse et l’expérience queer d’Anzaldúa sont donc interprétées ensemble, comme des expériences anormales, tordues, bizarres (le sens originel de l’insulte « queer »). La lecture d’Anzaldúa élargit donc notre compréhension du queer à la question raciale et nationale, ainsi qu’à la question de la classe et du handicap[10], soulignant ainsi que d’autres groupes que les minorités sexuelles occidentales, blanches et valides, expérimentent la stigmatisation et peuvent la renverser.
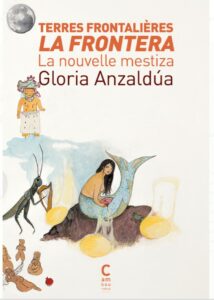 Le·a lecteur·rice est ainsi invité·e à relier l’histoire d’Anzaldúa à sa propre histoire, à sa propre situation vis-à-vis des frontières. Anzaldúa adresse notamment son livre à celleux qui « habite[nt] une terre frontalière semblable à la [s]ienne » (47) et décrit son œuvre comme « vivante, animée », « une entité rebelle » qui échappe déjà à sa volonté et à laquelle elle donne « le moins d’instructions possibles » (139). Loin d’enfermer son texte dans la singularité de son expérience vécue, philosopher depuis une perspective située, ancrée, corporelle et vivante, sans prétendre à une objectivité venue de nulle part, permet une montée en généralité, en montrant que des expériences différentes, qui sont l’objet d’énumérations appelant à être prolongées, répondent à des logiques d’oppression communes.
Le·a lecteur·rice est ainsi invité·e à relier l’histoire d’Anzaldúa à sa propre histoire, à sa propre situation vis-à-vis des frontières. Anzaldúa adresse notamment son livre à celleux qui « habite[nt] une terre frontalière semblable à la [s]ienne » (47) et décrit son œuvre comme « vivante, animée », « une entité rebelle » qui échappe déjà à sa volonté et à laquelle elle donne « le moins d’instructions possibles » (139). Loin d’enfermer son texte dans la singularité de son expérience vécue, philosopher depuis une perspective située, ancrée, corporelle et vivante, sans prétendre à une objectivité venue de nulle part, permet une montée en généralité, en montrant que des expériences différentes, qui sont l’objet d’énumérations appelant à être prolongées, répondent à des logiques d’oppression communes.
Ainsi, la figure de la mestiza devient dans une certaine mesure une figure universelle, même si elle décrit aussi une situation de minorisation spécifique. Tout d’abord, les catégorisations binaires, loin de différencier des entités ontologiquement pures, correspondent davantage à des découpages nominalistes dans le spectre du vivant. Les espèces vivantes (par exemple les espèces de maïs) ne sont pas des ensembles d’individus clairement isolés, mais sont le résultat d’un processus de spéciation (par sélection naturelle ou artificielle) permettant des croisements entre les individus qui peuplent les frontières floues du « continuum de l’évolution » (161). La comparaison avec les phénomènes biologiques d’hybridation s’étend aussi à la langue des terres frontalières, ce lieu où « les langues se pollinisent les unes les autres » (50) pour former d’autres langues « batardes » comme l’espagnol chicano. Dans ces terres frontalières, les catégories sont brouillées, confondues, mélangées et l’hybridité est la règle :
Autochtone comme le maïs, comme le maïs, la mestiza est un résultat de l’hybridation, conçue pour résister en toutes circonstances.(156)
Or, l’hybridité est rendue possible par les traits communs entre différentes catégories de population en apparence opposées et l’existence des mestiza·os et des queers signalent une universalité humaine (et peut-être au-delà) que la domination sociale dissimule : « Le mélange que nous sommes prouve que tous les sangs sont étroitement tissés les uns aux autres et que nous sommes né·es d’âmes similaires » (161).
Avec des accents hégéliens, Anzaldúa note que si les dualités se construisent en miroir, c’est qu’elles se contiennent l’une et l’autre. Plus spécifiquement, c’est la conscience dominante qui « scinde des parties d’elle-même et en transfère le “négatif” sur nous [les minorités] » (163). Cette conception fait écho aux travaux d’Edward Saïd sur L’Orientalisme[11] – courant culturel occidental nous éclairant davantage sur ce qu’est l’Occident que sur un Orient qui n’est que projection fantasmatique – ou ceux de María Lugones à propos de la « perception boomerang » des blanc·hes, c’est-à-dire une perception narcissique qui, lorsqu’elle regarde l’autre, revient directement à soi[12].
Pour penser la réconciliation ontologique et politique, Anzaldúa prend, comme Haraway, des accents prospectifs et dresse la figure de la nouvelle mestiza en destinée humaine. La mestiza désigne alors une « nouvelle conscience » qui est appelée à venir, dans une projection utopique dont s’inspireront d’autres écrivain·es queer of color.[13] Si nous sommes tous·tes issu·es du métissage, l’hybridation – la « créolisation » dirait Glissant[14] – est, encore davantage que notre passé, l’avenir de l’humanité : « En unas pocas centurias, l’avenir appartiendra à la mestiza. Dans la mesure où l’avenir repose sur la dissolution des paradigmes, il repose aussi sur le chevauchement de deux cultures ou plus » (155).
Mais revenons un peu en arrière. Cette nouvelle conscience mestiza n’étant pas encore advenue, la condition mestiza désigne pour l’instant une position bien spécifique dans l’ordre social et dans l’espace physique : celle des habitant·es des terres frontalières.
C’est chez elle
cette mince arête de
fil barbelé. (69)
II/ La condition chicana comme mort herméneutique
Malgré cette projection vers l’universel, il n’est pas question de perdre de vue les rapports de domination qui structurent l’ici et maintenant autour de la Frontera et la spécificité des vécus de celles·eux qui vivent dans les terres frontalières. Certes, chaque vie se déploie dans un espace structuré par la Frontera, mais pour certain·es, la Frontera n’est pas une réalité lointaine qu’on peut oublier : c’est à travers leurs corps, à travers leurs terres, qu’elle se dresse, creusant une plaie ouverte, une « herida abierta » (56), en elleux.
Parmi ces êtres qui peuplent l’entre-deux, les Chicana·os sont réduit·es au silence par l’imposition des catégories de pensée occidentales et de la langue anglaise. Ce processus de silenciation s’exerce d’abord sur leur langue natale, l’espagnol chicano, dont le chapitre 5 « Comment mater une langue sauvage » décrit à la fois la vitalité et l’oppression. Anzaldúa théorise donc déjà ce que Miranda Fricker conceptualisera plus tard sous le nom d’injustices épistémiques[15]. José Medina nommera l’expérience chicana théorisée par Anzaldúa une « mort herméneutique », c’est-à-dire une forme d’injustice épistémique si puissante qu’elle entraîne « la perte de sa propre voix, de ses propres capacités interprétatives, ou de son statut d’agent participant à la production et à la diffusion de significations »[16]. Anzaldúa pose déjà les prémisses d’une épistémologie de l’ignorance en éclairant le rôle joué par l’ignorance des dominant·es, à la fois de l’expérience dominée et de la domination elle-même, dans cette mort herméneutique des dominé·es (« la culture blanche dominante nous tue lentement à force d’ignorance », p. 163).
Les Chicana·os ne subissent pas seulement une négation de leur capacité d’agents épistémiques et un effacement de leur langue : c’est leur existence même qui est niée par le binarisme, projetant sur les terres frontalières l’image d’un no (wo)man’s land : « J’ai tellement intériorisé le conflit frontalier que je me sens parfois comme si l’un annulait l’autre et que nous étions zéro, rien, personne. » (134). Leur existence ne peut être reconnue dans la mesure où elle remet en cause un binarisme qui fonde l’ordre établi. Par la seule formulation de ces deux mots « j’existe », Anzaldúa entre ainsi en résistance contre le binarisme :
Je suis visible – regardez ce visage indien – et je suis pourtant invisible. Je les aveugle avec mon nez en bec, tout en étant leur point aveugle. Mais j’existe, nous existons. (163)
De même, le simple usage de la langue tex-mex est déjà un « terrorisme linguistique » (127) contre la domination de l’anglais et de l’espagnol : « El Anglo con cara de inocente nos arrancó la lengua. On ne peut mater les langues sauvages, seulement les couper » (122). Mais le simple fait d’exister en tant que mestizo·a et de le dire dans une langue inaudible d’un côté comme de l’autre de la Frontera, entraine déjà un renversement de la binarité qui habite de façon hégémonique notre psychisme collectif.
III/ Entre anéantissement et créativité : l’exercice périlleux de l’écriture mestiza
Par l’existence de ce cri, là où il devrait y avoir du silence, le texte nous met face à un paradoxe : la Frontera est à la fois le lieu du silence et de la parole dominée qui résiste, elle est à la fois le lieu effacé et une terre à part entière, fertile en hybridité, là où « le sang vital des deux mondes se mélange pour former un troisième pays » (56). De même, dans le corps des mestiza·os, la « herida abierta », plaie de la domination, est à la fois source de souffrance et de créativité. Par une comparaison continue entre la terre frontalière et le corps de la mestiza, tous deux espaces où Anzaldúa se situe, espaces signifiants et douloureux, l’autrice creuse le paradoxe d’une double spatialité qui lui « impose d’écrire, et [la] bloque du même coup » (147). Elle décrit son expérience d’écrivaine, de chicana et de queer à la fois comme une expérience d’enfermement et d’indétermination : « souvent on se contorsionne et on se cogne à des murs. Ou bien l’inverse : rien n’y est défini ni définitif, un état d’incertitude, vague, fluctuant » (147).
Ces murs désignent les catégories limitantes qui empêchent de (se) penser, qui écrase son existence entre deux postes de garde-frontières, dans l’« ambiguïté culturelle », dans le « lieu de la contradiction » (49). Dans ces espaces de l’entre-deux où il n’y a pas de place pour l’expression d’un troisième terme, il est dans un premier temps impossible d’exprimer sa voix :
Dépossédée de sa culture maternelle, “alien” à la culture dominante, la femme of color n’est pas même en sûreté dans sa propre vie intérieure. Pétrifiée, elle ne peut répondre, le visage coincé dans los intersticios, les espaces séparant les différents mondes qu’elle habite. (78)
Anzaldúa nomme cet état où l’on est assiégé·e entre plusieurs perspectives conflictuelles, « l’état de Coatlicue » qu’elle décrit dans le chapitre 4. « La tension interne des opposés » peut avoir deux effets contraire sur l’écrivaine mestiza : soit l’anéantir, soit « l’en faire sortir nahual : force de transformation » (149). Si elle échappe à l’anéantissement, La Frontera devient alors pour l’écrivaine l’espace de la créativité puisqu’il est l’espace où « rien n’est défini » où aucune pensée n’a encore été fixée et où l’utopie queer peut advenir : « Une terre frontalière est un lieu vague et indéterminé formé à partir du résidu sensible que laisse une limite contre-nature. Un lieu en transition constante » (56).
Ce basculement de l’état de pétrification à l’état de créativité, de l’état de silenciation à l’état de résistance, requiert un processus de désaliénation de la conscience mestiza. Premièrement, l’écriture mestiza suppose de se confronter à la souffrance et requiert ainsi une forme de sacrifice de soi (et de son innocence). Il demande de regarder en soi à l’endroit le plus douloureux et le plus caché. Ici, Anzaldúa puise dans les images du sacrifice humain aztèque :
C’est seulement par le corps, en arrachant la chair, qu’on peut transformer l’âme humaine. Pour que les images, les mots, les histoires aient cette puissance de transformation, il faut qu’elles viennent du corps humain, chair et os, et du corps terrestre, pierre, ciel, liquide, boue. Cette œuvre, ces images, qui transpercent ma langue ou mes lobes d’une épine de cactus, sont mes offrandes, mes sacrifices de sang aztèques. (149-150)
Deuxièmement, la résistance passe par une décolonisation de la pensée. C’est notamment ici qu’entre en jeu la dimension spirituelle de son œuvre, habitée non seulement par le corps de l’écrivaine, mais aussi par « des présences, incarnations de dieux, d’ancêtres ou bien des puissances naturelles et cosmiques » (140). Cette dimension spirituelle du texte a pu et peut encore heurter l’esprit rationnel du/de la lecteur·rice, mais elle est pourtant riche en enseignement épistémique : d’abord, elle s’inscrit dans un travail de ré-ancrage de la philosophie dans « l’âme mythologique de ce continent » par une archéologie de la pensée autochtone précédant la colonisation : « Arrêtons une fois pour toutes d’importer la mythologie grecque et le dualisme cartésien des occidentaux et ancrons-nous plutôt dans la boue et dans l’âme mythologique de ce continent » (142). Il s’agit pour Anzaldúa de retrouver cette « culture maternelle », culture qu’elle dépeint comme féminine et dominée, et dont l’Occident est venu anéantir les références et les langues en imposant les siennes. Elle fait donc œuvre de décolonisation de sa propre pensée et de sa langue, ce qui explique en partie son rejet du terme « lesbienne » issu lui aussi de la culture gréco-latine[17].
Ensuite, en éloignant la conscience de la mestiza des « configurations habituelles », « d’un raisonnement analytique qui privilégie la rationalité et vise un objectif unique (mode de pensée occidentale) » (154), le détour par la spiritualité éloigne l’écrivaine des sentiers préétablis du binarisme. Enfin, les figures spirituelles constituent le substrat qui nourrit l’imaginaire d’Anzaldúa. Or, l’image a une place centrale dans son épistémologie : « mon travail, ma vocation, est de me livrer au trafic d’images » (143) analyse-t-elle dans le chapitre 6 « Tlilli, Tlapalli. Le chemin de l’encre rouge et noire ». Les images ont chez elle une visée heuristique, elles servent à défricher les territoires de l’inconscient avant que les mots et les concepts ne puissent s’y frayer un chemin :
Une image est un pont entre une émotion évoquée et le savoir conscient ; les mots sont les câbles qui tiennent le pont. Les images sont plus directes, plus immédiates que les mots et plus proches de l’inconscient. Le langage imagé précède la pensée verbale ; la pensée métaphorique précède la conscience analytique. (143)
Le processus de désaliénation de la conscience mestiza est troisièmement transformation de soi et de la réalité : la simple expérience vécue est transformée par l’écriture en une pensée située et politique, consciente de ses intérêts et de ses spécificités, pouvant donner lieu à une action révolutionnaire transformatrice de la réalité. Dans la terminologie marxienne, l’écriture permet le développement d’une conscience mestiza, c’est-à-dire le passage d’une existence en soi à une conscience pour soi.
Quand j’écris, j’ai l’impression de sculpter de l’os. J’ai l’impression de créer mon propre visage, mon propre cœur : un concept nahuatl. Mon âme se fabrique elle-même au cours de l’acte créatif. Constamment, elle se recrée et accouche d’elle-même à travers mon corps. Apprendre à vivre avec la Coatlicue : voilà ce qui transforme ce cauchemar qu’est la vie dans les Terres frontalières en expérience sacrée. C’est toujours un chemin/état vers autre chose. (147)
Cette transformation par l’acte d’écriture mestiza est aussi une processus de synthétisation : le métissage n’est pas un entre-deux, mais un troisième terme qui émerge de la confrontation entre les opposés – ce qui n’est pas sans rappeler l’« Aufhebung » hégélien, le dépassement de la contradiction, mais qui, à l’instar de la pensée marxienne, s’ancre d’abord dans le corps, le travail et la douleur physique.
Ce point focal ou d’appui, cette conjoncture où se tient la mestiza, c’est là que les phénomènes se percutent. C’est l’endroit où il est possible d’unir tout ce qui est séparé. Cet assemblage n’est pas une simple union de morceaux sectionnés ou séparés. Ni un contrebalancement de puissances opposées. Dans sa tentative d’élaborer une synthèse, le soi a ajouté un troisième élément, plus grand que la somme de ses parties segmentées. (154)
IV/ Du privilège épistémique de la « facultad » à la destinée politique de la mestiza
La pensée d’Anzaldúa est une pensée de la souffrance et de la domination, mais elle se renverse aussi en joie politique et en exaltation créative. La mestiza se trouve dans cette « conjoncture » spécifique que je nomme paradoxe de la connaissance minoritaire : elle fait face à de nombreux obstacles dressés sur son chemin par l’imposition de la Frontera, ce qui l’empêche d’être entendue et de transmettre sa connaissance, elle doit mettre en place tout un travail de décolonisation et de décatégorisation de sa conscience pour pouvoir penser de façon autonome, et pourtant, elle dispose d’un positionnement épistémique et politique privilégié, la position à partir de laquelle peut émerger une nouvelle conscience plus clairvoyante et plus juste.
Anzaldúa développe son propre concept de privilège épistémique qu’elle nomme « la faculté/la facultad », dans le chapitre 3 « Entrer dans la serpente » : « La facultad est l’aptitude à voir dans des phénomènes externes la signification de réalités plus profondes, à voir la structure profonde sous la surface » (102). Plus sensible que raisonnée, cette perception supérieure n’est pas pour autant une « intuition naturelle », mais s’acquiert du fait de l’expérience de la domination et de la résistance, en traversant les états de confrontation et de violence analysés plus haut. Elle est un savoir pratique avant d’être théorique, puisqu’elle est d’abord « une tactique de survie ». Parce qu’elle est liée à la souffrance, l’activation de cette faculté est plus souvent présente chez les victimes de violences, les parias et les queers :
Celles et ceux qu’on bannit de la tribu à cause de leur différence sont plus susceptibles d’être sensibilisé·es (à moins qu’on les brutalise jusqu’à l’insensibilité). Celles et ceux qui ne se sentent pas en sûreté dans le monde, psychologiquement ou physiquement, sont plus enclin·es à développer cette sensibilité. Celles et ceux sur qui on s’acharne la possèdent au plus haut degré : les femmes, les homosexuel·les de toutes les races, celles et ceux à la peau sombre, les parias, les persécuté·es, les marginalisé·es, les étrangèr·es. (….) C’est une tactique de survie que l’on cultive inconsciemment lorsqu’on est pris entre les mondes. (102)
Cette conceptualisation de la facultad est à mettre en parallèle avec le concept de « double conscience » de W.E.B. Du Bois.[18] Pour ce dernier, les Noir·es-Américain·es, du fait de leur domination par la suprématie blanche, sont doté·es d’une « double conscience », parce qu’iels ont dû apprendre à (se) voir à travers les yeux des dominant·es. Malgré ce parallèle, les deux situations de privilège épistémique doivent être distinguées car elles ne décrivent pas la même position sociale. En effet, Anzaldúa ne part pas de la situation d’un groupe minoritaire bien défini, mais au contraire de la situation de celleux qui se trouvent dans l’entre-deux, ni dans le groupe dominant, ni dans le groupe dominé majoritaire – l’expérience métisse. Tandis que chez Du Bois, les dominé·es sont situé·es d’un côté de la « ligne de partage des couleurs » – bien que leur conscience puisse se placer de l’autre côté – Anzaldúa s’intéresse à une condition trans-frontalière, c’est-à-dire à celleux qui traversent les lignes (de couleur) et qui transcendent les dualismes. Cette catégorie transfrontalière peut disposer de ressources matérielles et épistémiques dont ne disposent pas celleux qui se trouvent « del otro lado » : par exemple, les Chican·o·as bénéficient de la nationalité états-unienne, et donc ont théoriquement un meilleur accès aux espaces de pouvoir que les Mexicain·es. Iels font également l’expérience du passing, c’est-à-dire à la capacité volontaire ou involontaire de se voir attribuer une place sociale qui n’est pas la sienne, ce qui les amènent à circuler d’un côté à l’autre de la ligne frontalière (comme ce Chicano qui n’a pas ses papiers sur lui et qui est pris pour un immigré et jeté du côté mexicain par la migra).
Ce terme de passing est aussi bien mobilisé par les métisses que les queers, et peut donner lieu à une épistémologie spécifique : en passant, on peut aussi apporter avec soi un savoir jusqu’alors retenu d’un seul côté de la frontière. Si les queers franchissent également les frontières, et sont métaphoriquement mestiza·os, c’est qu’iels ont souvent été rejeté·es par leur communauté natale, queer (ou jota) désignant dès 1981 l’insulte que sa famille jette au visage d’Anzaldúa et qui fait qu’elle n’appartient à aucune culture[19] :
En tant que mestiza, je n’ai pas de pays, ma patrie m’a bannie ; et pourtant je suis de tous les pays car je suis la sœur ou l’amante potentielle de toutes les femmes. En tant que lesbienne, je n’ai pas de race, mon propre peuple me rejette ; mais je suis de toutes les races car ce qui est queer en moi existe dans toutes les races. (156)
Le rejet des queers participe au dédoublement de leur conscience, signifié par la folie (la loquería) : une conscience critique vis-à-vis des communautés qui les ont rejeté·es et élevé·es dans la honte, tout en étant soucieuse de ne pas trahir une communauté dominée en rejoignant des espaces dominants (77). Ce qu’analyse Anzaldúa, ce n’est donc pas la simple condition dominée, mais la condition des dominé·es qu’elle qualifiera plus tard d’ « other-sider » en considérant une fois encore son propre parcours : « j’écris depuis la position d’other-sider, à mi-chemin entre une complète outsider et une insider »[20]. Si Du Bois, du fait de son parcours académique, apparaît lui aussi comme un other-sider, il n’a pas – à ma connaissance – écrit sur le privilège épistémique spécifique du transfuge, ou de la transfrontalière.
Le privilège épistémique de la mestiza est aussi une destinée politique, qu’elle développe dans le chapitre 7, « la consciencia de la mestiza, vers une nouvelle conscience ». « Vivre sur la frontière », c’est aussi « vivre en tant que frontière »[21], c’est-à-dire être en position de traduire, transmettre, réunir ce qui a été séparé. La frontière est « à la fois un entre-deux, un trait d’union et une séparation »[22], ou plutôt, ce sont les mestiza·os qui peuvent joindre ensemble les deux rives de la frontière. C’est alors l’image du pont qui prédomine :
« Yo soy un puente tendido
del mundo gabacho al del mojado,
lo pasado me estirá pa’ ‘trás y lo presente pa’‘delante. » (56)
Le corps et la voix de la mestiza deviennent ce pont jeté par-dessus les divisions entre les catégories binaires, le lieu de la rencontre. Mais ceci ne peut s’écrire qu’au futur, comme dans la citation suivante :
À un certain point, en route vers une nouvelle conscience, ayant soigné d’une façon ou d’une autre la blessure qui sépare les ennemis mortels, il nous faudra quitter la berge opposée, afin de nous tenir sur les deux rives à la fois et afin de regarder en même temps par les yeux de la serpente et par les yeux de l’aigle.(153)
Pour se tenir sur les deux rives, Anzaldúa travaille à l’hybridation des langues. Les enjeux linguistiques du texte et les enjeux de traduction sont développés par la préface de Paola Bacchetta et la note de traduction. L’anglais, langue de la domination, est aussi la langue qu’il est nécessaire de parler pour être entendu·e, pour être lu·e dans les sphères académiques et pour tendre la main à de potentiel·les allié·es – auxquels il est nécessaire de parler (162). Pourtant, Paola Bacchetta rappelle que :
Travailler à l’intérieur de l’anglais dominant, c’est travailler à l’intérieur de son épistémè, et ainsi le renforcer involontairement, par inadvertance, même lorsque simultanément on se révolte contre lui et qu’on crée un ou plusieurs ailleurs en son sein. (25)
Pour court-circuiter l’hégémonie de la langue colonisatrice, Anzaldúa incorpore d’autres langues, l’espagnol castillan, le tex-mex, et des mots de nahuatl. Leur non-traduction dans le corps du texte est le fruit de sa volonté. De cette façon, elle contraint les dominant·es à effectuer le chemin inverse vers la réconciliation par un effort de compréhension d’autrui, nécessaire à une sortie de l’ignorance volontaire : « aujourd’hui, nous demandons qu’on nous rejoigne, à mi-chemin » (50).
Cette oscillation dans la langue témoigne de la radicalité d’Anzaldúa vis-à-vis de la domination. Sa stratégie politique oscille entre deux projections utopiques : soit « dresser des ponts », soit « traverser la frontière » pour rejoindre le camps des dominé·es, et inventer un monde queer, el Mundo Zurdo :
Ou peut-être déciderons-nous de nous retirer de la culture dominante, de tourner le dos une fois pour toutes à cette cause perdue et de traverser la frontière pour entrer dans un territoire entièrement distinct et nouveau. (153)
Les dominant·es qui ne sauront pas écouter la parole de la mestiza, celle qui a pourtant traversé de multiples souffrances pour parvenir à crier « j’existe », sont donc « cause perdue ». Il n’est pas question de s’égarer en route, lorsqu’on a face à soi une lutte aussi longue que de « déraciner massivement la pensée dualiste de la conscience individuelle et collective » (155).
En partant d’un récit autobiographique et d’une expérience de minorisation très spécifique, l’épistémologie d’Anzaldúa éclaire les notions centrales d’injustice épistémique, de privilège épistémique et de savoirs situés. Ces concepts, aujourd’hui mobilisés largement, sont souvent tirés d’une épistémologie blanchie, tout comme l’ont été les études queers. L’épistémologie de la frontière de Gloria Anzaldúa permet pourtant de reconceptualiser l’épistémologie du positionnement en sortant d’une opposition binaire dominant/dominé, de façon à penser ce qui se situe dans l’entre-deux et qui permet la circulation des savoirs d’un espace à l’autre. Sa lecture oblige également la philosophie à faire preuve de réflexivité sur son propre positionnement, et sur la façon dont ses savoirs – mais aussi ses silences – ne peuvent être compris qu’à partir des rapports de pouvoir qui structurent notre discipline.
[1] Anzaldúa, Gloria. « La Prieta ». This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color, Gloria Anzaldúa et Cherríe Moraga (éds.). 4ème édition, New York: SUNY Press, 2015 (1981).
[2] Back, Camille, Rosso, Karine et Dawson, Nicholas. « Trialogue autour de l’œuvre de Gloria Anzaldúa ». Études francophones, 2020, pp. 146-167.
[3] Back, Camille. « “We are the queer groups” : de “la Prieta” à Bordelands/La Frontera, lire l’autohistoria-teoria comme performance et “nouvelle” perspective critique sur la théorie queer ». Epistemological Others, Languages, Literatures, Exchanges and Societies, 2019, 10.
[4] Haraway, Donna. « Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective ». Feminist Studies, 1988, 14(3), p. 575.
[5] Back, Camille. « The Other-Sider: Gloria E. Anzaldúa, ”Inappropriate/d Other” in Academia ? ». InterLetras, 2022, 10 (36).
[6] Haraway, Donna. « Manifeste Cyborg : Science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle », in Manifeste cyborg et autres essais, Paris : Exils éditeurs, 2009 (1991), p. 29-92.
[7] Ce parallèle est par exemple noté par Thierry Hoquet, Cyborg philosophie : Penser contre les dualismes, Paris, Le Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2011 : « Dresser la cartographie des usages de Cyborg dans la pensée contemporaine implique de passer par des figures comme la mestiza, l’hybride, le subalterne. »
[8] Bacchetta, Paola, Falquet, Jules et Alarcón, Norma (dir.). « Introduction aux “Théories féministes et queers décoloniales : interventions Chicanas et Latinas états-uniennes” ». Les Cahiers du CEDREF, 2011, 18.
[9] Pour davantage d’éléments biographiques, on peut notamment lire le portrait que Camille Back dresse d’Anzaldúa : Back, Camille. « Gloria Anzaldúa, une lutte de frontières. Une penseuse oubliée aux origines de la théorie queer ». Revue du Crieur, 2023, 22 (1), pp. 142-159.
[10] Elle est ainsi une référence des études crip qui étudient le handicap dans une perspective queer, Pitts, Andrea J. « Gloria E. Anzaldúa and Crip Futurity in the Americas. » Disability and American Philosophies. Routledge, 2022, pp. 138-158.
[11] Saïd, Edward. L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris : Le Seuil, 1980.
[12] Lugones, María. Peregrinajes/Pilgrimages: Theorizing Coalition Against Multiple Oppressions. New York: Rowman & Littlefield Press, 2003, ch.7.
[13] Par exemple Muñoz, José Esteban. Cruiser l’utopie : L’après et ailleurs de l’advenir queer. Paris : Brook, 2021 : « Lorsqu’Anzaldúa nous enjoint à rechercher la joteria [la queerness], elle nous appelle à déployer un récit du passé pour permettre une meilleure compréhension et une critique plus efficace d’un présent en faillite. En ce sens, son appel à une conscience métisse est un regard jeté vers un non-plus-conscient fécond, au servir d’un advenir qui résiste aux diverses asymétries violentes dominant le présent. » (p.156)
[14] Glissant, Edouard. Traité du Tout-Monde (Poétique IV). Paris : Gallimard, 1997.
[15] Fricker, Miranda. Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing. Oxford : Oxford University Press, 2007.
[16] Medina, José. « Chapter 3 : Varieties of Hermeneutical Injustice ».: The Routledge handbook of epistemic injustice. Ian James Kidd, José Medina et Gaile Jr Pohlhaus. (eds.). London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
[17] Anzaldúa, Gloria. « To(o) Queer the Writer — Loca, escritora y chicana ». The Gloria Anzaldúa Reader, AnaLouise Keating (éd.). Durham : Duke University Press, 2009.
[18] Du Bois, W.E.B. Les âmes du peuple noir. Paris : La Découverte, 2007.
[19] Anzaldúa, Gloria. « La Prieta ». This Bridge Called My Back. Writings by Radical Women of Color, Gloria Anzaldúa et Cherríe Moraga (éds.). 4ème édition, New York : SUNY Press, 2015 (1981).
[20] Anzaldúa, Gloria. Light in the dark/Luz en lo oscuro: Rewriting identity, spirituality, reality. Durham : Duke University Press, 2015, p182. Voir aussi Back, Camille. « The Other-Sider: Gloria E. Anzaldúa, “Inappropriate/d Other” in Academia? ». InterLetras, 2022, 10 (36).
[21] Butler, Judith. Undoing Gender, Londres et New York : Routledge, 2004, p. 227 : « [Anzaldúa] clearly crosses the border between academic and nonacademic writing, emphasizing the value of living on the border, living as the border in relation to an array of different cultural projects ».
[22] Bacchetta, Paola, Falquet, Jules et Alarcón, Norma (dir.). Introduction aux « Théories féministes et queers décoloniales : interventions Chicanas et Latinas états-uniennes ». Les Cahiers du CEDREF, no. 18, 2011.