Recension – Du mode d’existence de Notre-Dame. Philosophie de l’art, religion et restauration.
Andy Serin est agrégé de philosophie, doctorant contractuel en philosophie de la religion à l’EPHE et l’université Paris 1.
Roger Pouivet, Du mode d’existence de Notre-Dame. Philosophie de l’art, religion et restauration, Cerf, 2022.
En analysant diverses opinions d’architectes (Roland Castro, Jean-Michel Wilmotte, Paul Goddard, Pierre Roussel), le premier chapitre montre que le débat est loin de se réduire à une simple alternative : faut-il refaire à l’identique ou proposer du nouveau ? Mais, identique à quoi ? Quel concept d’identité ? N’est-ce pas mentir en faisant croire à l’original ? Déjà, la « flèche » de Notre-Dame avait pu opposer Eugène Viollet-le-Duc à John Ruskin : s’agit-il d’être fidèle à l’intention des bâtisseurs ou à la chose matérielle ? Selon Pouivet, cela mobilise deux ontologies concurrentes de l’art : Notre-Dame est soit une idée ou forme platonicienne, soit un composé aristotélicien où la forme est inséparable de la matière (p.46-48). La restauration est donc bien affaire d’ontologie.
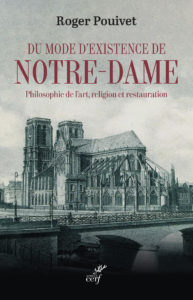 Dans le deuxième et troisième chapitre, R. Pouivet se livre alors à une « enquête ontologique » sur l’identité. Qu’est-ce qui fait notamment l’identité du bateau de Thésée dont toutes les parties ont peu à peu été changées ? Est-ce le même ou un autre bateau ? Or, le bateau est un artefact au sens aristotélicien, une chose qui n’a pas en soi le principe de son changement et qui est produite par l’intelligence humaine en vue de remplir une certaine fonction. Un artefact resterait dès lors le même, alors qu’il change, si et seulement s’il conserve l’identité fonctionnelle qui constitue toute son essence (ch.2). Mais d’un côté, si Notre-Dame ne remplit plus sa fonction, par exemple que la messe y soit dite, elle ne serait plus la même ; et d’un autre côté, Notre-Dame demeure bien numériquement la même. Or, si l’identité numérique de Notre-Dame tient à la composition de ses parties, resurgit à nouveau la difficulté du bateau de Thésée. Le concept sous-jacent d’identité, et a fortiori l’identité d’un artefact, est voué à l’incertitude, et prête ainsi à débattre de tout projet de restauration. Néanmoins, l’auteur cherche une solution dans un usage « souple » de l’identité (ch.3), tels que Leibniz, Reid, et Hume[2] ont chacun pu le penser, et qui permettrait de dire qu’une chose restaurée reste effectivement la même. Cet usage souple pourrait naturellement conduire à une « [thèse] pragmatiste, antiréaliste et fictionnaliste » (p.81) selon laquelle l’identité n’est qu’une fiction de l’esprit au gré des conventions sociales et pratiques d’identification, impliquant donc une ontologie instable ou évanescente des artefacts. Ce que récuse R. Pouivet, parce que l’antiréaliste tire une « conséquence indue » (p.71) de la dépendance ontologique de l’artefact à l’idée de son irréalité. Bien au contraire, l’artefact est un « continuant »[3] qui a une « souplesse réelle d’identité » (p.82) car c’est son mode d’existence d’avoir des propriétés constitutives et d’autres qui peuvent se perdre et s’acquérir. C’est pourquoi, un risque ontologique est inhérent à la restauration, qui est de supprimer les propriétés constitutives de l’artefact sans lesquelles celui-ci n’est plus le même. Si l’on considère que le continuant est une chose matérielle, qui reste le même tout en perdant et acquérant des propriétés, il s’agit d’une thèse « matérialiste » (p. 84) qui a certes l’avantage d’être « souple ». Mais il est difficile pour le restaurateur d’identifier les propriétés constitutives, parce qu’elles aussi sont dans le temps. L’auteur prend l’exemple de la patine d’un bronze qu’il serait inimaginable de retirer. Il y a aussi des propriétés acquises qui sont devenues constitutives, comme la flèche de Notre-Dame. Cependant, la thèse « idéaliste » (p. 92) pour laquelle l’artefact est une idée-norme, se heurte également à plusieurs objections, dont celle de la régression à l’infini : si l’idée de l’artefact doit être la norme du restaurateur, qu’est-ce qui garantit que ce soit cette idée-là de Notre-Dame et pas une autre ? R. Pouivet concède que sa thèse des continuants artefactuels à identité souple et transhistorique ne fournit pas de « critère opérationnel », mais elle rend au moins légitime l’intervention du restaurateur, à la différence d’Etienne Gilson[4] pour qui la restauration détruit inévitablement l’authenticité de l’œuvre d’art.
Dans le deuxième et troisième chapitre, R. Pouivet se livre alors à une « enquête ontologique » sur l’identité. Qu’est-ce qui fait notamment l’identité du bateau de Thésée dont toutes les parties ont peu à peu été changées ? Est-ce le même ou un autre bateau ? Or, le bateau est un artefact au sens aristotélicien, une chose qui n’a pas en soi le principe de son changement et qui est produite par l’intelligence humaine en vue de remplir une certaine fonction. Un artefact resterait dès lors le même, alors qu’il change, si et seulement s’il conserve l’identité fonctionnelle qui constitue toute son essence (ch.2). Mais d’un côté, si Notre-Dame ne remplit plus sa fonction, par exemple que la messe y soit dite, elle ne serait plus la même ; et d’un autre côté, Notre-Dame demeure bien numériquement la même. Or, si l’identité numérique de Notre-Dame tient à la composition de ses parties, resurgit à nouveau la difficulté du bateau de Thésée. Le concept sous-jacent d’identité, et a fortiori l’identité d’un artefact, est voué à l’incertitude, et prête ainsi à débattre de tout projet de restauration. Néanmoins, l’auteur cherche une solution dans un usage « souple » de l’identité (ch.3), tels que Leibniz, Reid, et Hume[2] ont chacun pu le penser, et qui permettrait de dire qu’une chose restaurée reste effectivement la même. Cet usage souple pourrait naturellement conduire à une « [thèse] pragmatiste, antiréaliste et fictionnaliste » (p.81) selon laquelle l’identité n’est qu’une fiction de l’esprit au gré des conventions sociales et pratiques d’identification, impliquant donc une ontologie instable ou évanescente des artefacts. Ce que récuse R. Pouivet, parce que l’antiréaliste tire une « conséquence indue » (p.71) de la dépendance ontologique de l’artefact à l’idée de son irréalité. Bien au contraire, l’artefact est un « continuant »[3] qui a une « souplesse réelle d’identité » (p.82) car c’est son mode d’existence d’avoir des propriétés constitutives et d’autres qui peuvent se perdre et s’acquérir. C’est pourquoi, un risque ontologique est inhérent à la restauration, qui est de supprimer les propriétés constitutives de l’artefact sans lesquelles celui-ci n’est plus le même. Si l’on considère que le continuant est une chose matérielle, qui reste le même tout en perdant et acquérant des propriétés, il s’agit d’une thèse « matérialiste » (p. 84) qui a certes l’avantage d’être « souple ». Mais il est difficile pour le restaurateur d’identifier les propriétés constitutives, parce qu’elles aussi sont dans le temps. L’auteur prend l’exemple de la patine d’un bronze qu’il serait inimaginable de retirer. Il y a aussi des propriétés acquises qui sont devenues constitutives, comme la flèche de Notre-Dame. Cependant, la thèse « idéaliste » (p. 92) pour laquelle l’artefact est une idée-norme, se heurte également à plusieurs objections, dont celle de la régression à l’infini : si l’idée de l’artefact doit être la norme du restaurateur, qu’est-ce qui garantit que ce soit cette idée-là de Notre-Dame et pas une autre ? R. Pouivet concède que sa thèse des continuants artefactuels à identité souple et transhistorique ne fournit pas de « critère opérationnel », mais elle rend au moins légitime l’intervention du restaurateur, à la différence d’Etienne Gilson[4] pour qui la restauration détruit inévitablement l’authenticité de l’œuvre d’art.
C’est le concept d’essence qui relance l’enquête ontologique au quatrième chapitre. Pour la plupart des gens, Notre-Dame est essentiellement une œuvre d’art, et ainsi « continuer à être ce qu’elle est, pour Notre-Dame, c’est être une œuvre d’art » (p.109). Cela signifie que l’essence de la chose détermine le projet de restauration de son mode d’existence. Du même coup, la pleine compréhension de l’essence de Notre-Dame requiert l’analyse de l’essence de l’œuvre d’art,. Notre-Dame a certes pour essence d’être une œuvre d’art, mais l’œuvre d’art a-t-elle une essence ? Contre l’anti-essentialisme actuel qui réduit l’art à un pur produit de conventions sociales, l’auteur étaie un « réalisme artistique » pour lequel « une œuvre d’art est une substance artefactuelle qui fonctionne symboliquement » (p.120). S’appropriant l’outillage conceptuel aristotélicien, R. Pouivet donne une explication que nous résumons ici : 1/ Une substance existe en réalisant son essence qui n’est autre que sa forme. 2/ Cette substance est une réalité hylémorphique, composé de matière et de forme. 3/ Dans le cas d’une substance artefactuelle, sa forme-essence consiste dans la fonction. 4/ L’artefact peut avoir une fonction symbolique (signifier quelque chose) 5/ Cette fonction symbolique peut s’opérer sur un mode sémiotique ou esthétique, selon que l’attention porte sur le signifié (de sorte que le symbole est transparent) ou sur le symbole lui-même (de sorte que le signifié adhère au symbole). 6/ Pour l’œuvre d’art, le bon fonctionnement esthétique dépend des conditions matérielles d’existence du symbole. Toute altération matérielle de l’œuvre prend ainsi le risque d’en changer ou détruire la signification adhérente. 7/ La réception d’une œuvre d’art, que l’on décrit souvent comme une contemplation esthétique, est une « opération intellectuelle sémiotique » (p.122) qui suppose des compétences cognitives et des vertus esthétiques du spectateur.
Par la suite, il s’agit d’expliciter le fonctionnement esthétique de Notre-Dame. L’œuvre d’art accomplit une fonction symbolique sous un mode esthétique qui est souvent celui de l’expressivité. Par exemple, le logo ne fait pas que dénoter une institution, mais il exprime la caractéristique de celle-ci, en la manifestant visuellement (p.149). A partir du cinquième chapitre, R. Pouivet mobilise la philosophie analytique de l’art. Le fonctionnement esthétique qui fait l’essence et l’identité de l’œuvre d’art a des « conditions sémiotiques » (p.155). En glosant la notion d’« activation » de Nelson Goodman[5], l’auteur explique que les œuvres d’art sont ce qu’elles font (ch.6). L’activation du fonctionnement esthétique, de la signification qui est exprimée, met en jeu l’existence de l’œuvre d’art. Or, la restauration ne doit surtout pas modifier ou supprimer ce que l’œuvre d’art exprime, afin qu’elle continue d’exister pour ce qu’elle est. Cela soulève un paradoxe : le critère tant recherché de la restauration est l’identité symbolique, mais l’identité matérielle en est la condition, car la signification de l’œuvre d’art adhère à ce qu’elle est matériellement. Une activation matérielle (conservation et restauration, comme l’éclairage de l’œuvre) est ainsi le support à l’activation symbolique (la signification adhérente). Et pourtant, R. Pouivet alerte du danger que la restauration matérielle à l’identique ne garantit pas non plus que l’œuvre d’art garde la même signification. Tel un animal « empaillé » (p.159), Notre-Dame pourrait sembler la même, alors qu’elle serait en réalité toute autre chose – non plus un édifice religieux mais culturel, rien qu’un monument du patrimoine français. Évoquant les cloisters[6]américains qu’il qualifie de « monstruosité ontologique » (p.167), l’auteur insiste sur une opposition peu habituelle entre religion et culture. En effet, le monde culturel est désacralisateur. La muséification, aussi louable soit-elle de démocratiser la culture ou intéressée d’offrir au tourisme de masse une expérience esthétique et culturelle, détruit cependant la signification adhérente de l’art sacré. Bien que Walter Benjamin[7] ne soit pas cité, on ne peut s’empêcher de songer à la perte d’aura des œuvres d’art, ainsi qu’à la substitution de la valeur d’exposition à la valeur cultuelle, tant liée à l’innovation technologique de l’art qu’à une société de masse qui consomme de la culture.
Dans un dernier chapitre intitulé « Notre-Dame ou l’intelligibilité de la foi », R. Pouivet clôt l’enquête ontologique sur sa « Thèse théologique » : ce qui fait de Notre-Dame ce qu’elle est, consiste dans sa signification religieuse (p.195) qui ne peut être vraiment comprise que si et seulement si elle est crue (p.212). C’est la fin de la thèse qui fait le plus polémique. Le bon fonctionnement esthétique de Notre-Dame ne demanderait pas que des capacités cognitives et des vertus esthétiques, mais d’avoir des croyances religieuses[8]. Seul le croyant comprendrait pleinement que Notre-Dame manifeste et exprime l’intelligibilité de la foi (p.199), qu’elle est un argument en faveur de l’existence de Dieu (p.220), qu’elle signifie l’existence et la Gloire de Dieu (p.226), qu’elle manifeste et présentifie architecturalement Dieu (p.230). Notons au passage que le lecteur attentif ne manquera pas de demander ou d’objecter s’il dépend de nous de croire et d’avoir la foi, et dans quelle mesure R. Pouivet semble tenir pour équivalentes les diverses formulations (ci-dessus) qu’il donne de la signification religieuse de Notre-Dame. Or, l’auteur répond ici à l’objection culturaliste et laïciste que nul ne conteste sa signification religieuse à Notre-Dame, mais que la médiation culturelle apporte justement des informations précieuses qui aident à la comprendre et que l’on peut tout à fait la comprendre sans la croire. Pour autant, on ne dirait pas que l’on comprend un poème écrit dans une langue que l’on ne connaît pas et sur lequel on disposerait seulement d’informations (p.219). R. Pouivet développe un autre contre-argument selon lequel la croyance est ici l’« attitude ontologiquement appropriée » à la compréhension. De même que « si la Bible est la parole de Dieu, la lire correctement suppose de croire qu’elle est la parole de Dieu », de même comprendre Notre-Dame suppose de croire qu’elle est un argument en faveur de l’existence de Dieu. Un « argument artistique » (p.221) selon lequel l’existence d’œuvres d’art, comme la musique de J-S Bach ou Notre Dame, constitue une bonne raison de croire en l’existence d’un Dieu. S’il faut croire pour comprendre, c’est parce que « comprendre veut alors dire : croire qu’elle est un argument » (p.220). C’est pourquoi, le culturaliste qui ne croit pas ce que signifie Notre-Dame ne la comprend en réalité pas du tout, et il est dès lors très périlleux de lui confier le projet de sa restauration.
En définitive, le mode d’existence de Notre-Dame est celui d’un artefact dont la signification religieuse doit être la norme de son projet de restauration. C’est le résultat d’une longue enquête ontologique. L’argumentation de R. Pouivet est technique, mais en même temps, la cathédrale est un objet concret et actuel qui aide à mieux saisir les enjeux de la restauration, ainsi qu’à comprendre le gain épistémique et l’intérêt pratique que nous avons à faire de l’ontologie, à réfléchir sur le mode d’être des choses. Le débat sur la restauration de Notre-Dame recelait une ontologie implicite, dont le livre de R. Pouivet s’est ainsi efforcé de nous faire prendre conscience, de questionner et de clarifier. L’autre résultat est la Thèse théologique, voire apologétique, de l’auteur. On peut regretter qu’elle n’ait fait l’objet que d’un chapitre, tant elle est discutable. Notre-Dame manifeste Dieu. Cette signification religieuse ne serait vraiment comprise que par celui qui croit. Le croyant serait donc seul en mesure d’apprécier la restauration de Notre-Dame à l’aune de sa signification religieuse. Mais nous pourrions encore demander à l’auteur : est-ce tout croyant ou l’homme d’Eglise dont les compétences en font un garant de l’orthodoxie ? Si la foi est nécessaire, elle ne suffit pas et il faut aussi des compétences cognitives et des vertus esthétiques. Derrière la restauration de Notre-Dame, ce pourrait être une autre restauration qui serait potentiellement en jeu, celle de l’autorité de l’Eglise.
[1] Roger Pouivet est professeur de philosophie à l’Université de Lorraine. Parmi ces publications, on peut citer : L’ontologie de l’œuvre d’art (1999), Qu’est-ce que croire ? (2003), Le réalisme esthétique (2006), Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? (2007), Philosophie du rock : une ontologie des artefacts et des enregistrements (2010), La philosophie de Nelson Goodman (2011), Epistémologie des croyances religieuses (2013), L’Art et le désir de Dieu, une enquête philosophique (2017), L’éthique intellectuelle. Une épistémologie des vertus (2020).
[2] Gottfried Willem Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Livre II, chap. XXVIII, §4 ; Thomas Reid, Essais sur les pouvoirs intellectuels de l’homme, III, chap.4 ; David Hume, Traité de la nature humaine, I, IV, 6.
[3] Il s’agit d’un concept de la métaphysique contemporaine. David Wiggins, Continuants, Oxford, Oxford University Press, 2016.
[4] Etienne Gilson, Peinture et réalité, Paris, Vrin, 1958, p.103.
[5] Nelson Goodman, « L’art en action », Esthétique contemporaine, Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet (dir.), Paris, Vrin, 2005, p.144.
[6] Il s’agit de cloîtres français transportés dans un musée d’art médiéval aux Etats-Unis.
[7] Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, Payot, 2013.
[8] L’auteur parle d’anticipations cognitives et de capacité d’usage des symboles, puis de qualités intellectuelles (humilité, courage intellectuel, impartialité, prudence) qui nous rendent disponibles à appréhender esthétiquement la chose, enfin la vertu de la foi.














