Recension – Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif.
Ninon Grangé est maîtresse de conférence et HDR en philosophie à l’Université Paris 8 au Nouveau Collège d’études politiques (NCEP). Elle est rattachée au Laboratoire d’études sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie (LLCP) et à l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM).
Jean-Michel DURAFOUR, Tchernobyliana. Esthétique et cosmologie de l’âge radioactif, Paris, Vrin, 2021, 220p., incluant un Lexique, une Bibliographie, 21 illustrations en couleurs, une Table des illustrations.
L’ouvrage est disponible ici.
Le projet esthétique et, comme l’espère son auteur, philosophique, s’appuie sur un préalable optimiste bien compris, à contre-courant des idéologies politiques et écologiques actuelles. La radioactivité, propulsée hyperobjet tel que Timothy Morton (Hyperobjects : Philosophy and Ecology after the End of the World, Londres-Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013) l’a défini, est la matière de notre monde tchernobylien : le monde ne se réduit pas à l’expérience humaine et l’écologie doit se faire sans la nature. La radioactivité relève à la fois de la nature et de la culture, elle rend insensé le concept de Nature, qui, selon Durafour d’accord avec Morton, est seulement une valeur censée protéger le capitalocène et qui tourne en catastrophe.
La thèse de Durafour se nourrit de ce qu’on pourrait appeler une nouvelle écologie, plus politique que les simples protections de la nature, et où l’art joue un rôle non seulement esthétique mais scientifique. Que l’art soit lié au domaine scientifique, écologique et politique, est un horizon crucial que l’auteur a raison de souligner, cela en dehors de toute théorie ou histoire de l’art. Le décloisonnement disciplinaire est particulièrement bienvenu, amené avec aisance au fil des pages, et respectueux des méthodes qui demeurent différentes. L’art est ainsi investi d’une tâche supplémentaire, celle de documenter la Terre autrement, par la « mesure » et la « mise en images » (p. 137), en essayant de combler le gouffre entre des représentations anciennes, basées sur ce que nous observons, et une temporalité nouvelle, aux échéances si lointaines que nous ne pouvons pas « voir ». Le projet s’élève donc avec cohérence contre l’anthropocentrisme et contre le primat du sujet.
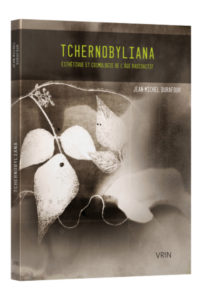 En débutant avec Günther Anders, et à rebours de celui-ci, Jean-Michel Durafour montre que se représenter la fin du monde est impossible, qui supposerait un observateur totalement extérieur au monde. Le monde est nécessairement façonné par un être depuis son intérieur. L’auteur s’oppose aux tenants de « l’environnement », il rejoint Bruno Latour abondamment cité (par exemple Politiques de la nature, Paris, La Découverte, 1999, et Face à Gaïa, Paris, La Découerte, 2015) qui se réjouit de la fin de la nature. À cet égard la catastrophe de Tchernobyl est la possibilité de penser la « défin » (p. 24) du monde, un monde et sa fin qui ne peuvent se représenter en images. Le projet, avant tout esthétique sans être révolutionnaire, est de faire place à un « nouvel œil » : Tchernobyl a modifié nos pratiques d’images et de regard à travers la représentation de la matière irradiée » (p. 25). Se réclamant de Jacques Rancière (Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000), Durafour lie étroitement le politique comme lieu du commun avec le partage du sensible ; l’art de Tchernobyl suppose donc une position intellectuelle et politique indéniable, de la part des artistes comme de la part de l’auteur. La fission du sensible engage ainsi, non pas un nouveau régime de l’art, mais une révision de la philosophie de la perception moderne, à partir de l’irradié et de l’invisible, arrimée à une nouvelle temporalité, non catastrophiste et non , qui renonce à une pensée de fin du monde. Cependant, la nouvelle temporalité ne sera pas définie, sinon qu’elle ne saurait être linéaire. Cet « écosystème unique au monde » est un lieu où, contrairement à Hiroshima reconstruite et toujours peuplée, aucun humain ne peut vivre pendant des milliers d’années (les seuls vivants sont occupés à contenir les effets radioactifs). Artistiquement, il s’agit de rendre visible l’invisible radioactif dans cette nouvelle temporalité.
En débutant avec Günther Anders, et à rebours de celui-ci, Jean-Michel Durafour montre que se représenter la fin du monde est impossible, qui supposerait un observateur totalement extérieur au monde. Le monde est nécessairement façonné par un être depuis son intérieur. L’auteur s’oppose aux tenants de « l’environnement », il rejoint Bruno Latour abondamment cité (par exemple Politiques de la nature, Paris, La Découverte, 1999, et Face à Gaïa, Paris, La Découerte, 2015) qui se réjouit de la fin de la nature. À cet égard la catastrophe de Tchernobyl est la possibilité de penser la « défin » (p. 24) du monde, un monde et sa fin qui ne peuvent se représenter en images. Le projet, avant tout esthétique sans être révolutionnaire, est de faire place à un « nouvel œil » : Tchernobyl a modifié nos pratiques d’images et de regard à travers la représentation de la matière irradiée » (p. 25). Se réclamant de Jacques Rancière (Le partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000), Durafour lie étroitement le politique comme lieu du commun avec le partage du sensible ; l’art de Tchernobyl suppose donc une position intellectuelle et politique indéniable, de la part des artistes comme de la part de l’auteur. La fission du sensible engage ainsi, non pas un nouveau régime de l’art, mais une révision de la philosophie de la perception moderne, à partir de l’irradié et de l’invisible, arrimée à une nouvelle temporalité, non catastrophiste et non , qui renonce à une pensée de fin du monde. Cependant, la nouvelle temporalité ne sera pas définie, sinon qu’elle ne saurait être linéaire. Cet « écosystème unique au monde » est un lieu où, contrairement à Hiroshima reconstruite et toujours peuplée, aucun humain ne peut vivre pendant des milliers d’années (les seuls vivants sont occupés à contenir les effets radioactifs). Artistiquement, il s’agit de rendre visible l’invisible radioactif dans cette nouvelle temporalité.
C’est là que le projet de Jean-Michel Durafour commence à se voir. En évoquant les photographies de Greg McNevin révélant la radioactivité aux abords des maisons, et les tumulus civilisationnels plutôt que mémoriels sur les lieux de stockage des déchets de Cécile Massart, Durafour fait ressortir la teneur politique de l’art. La nouveauté ne réside pas dans l’invisible rendu visible, mais dans la modification du temps que Tchernobyl a fait subir à notre monde. Tchernobyl échappe, dans ses effets, à notre capacité de nous représenter le temps comme linéaire, en interdisant des lieux entiers à toute habitation pendant des centaines de milliers d’années, compromettant que nous puissions seulement informer les hommes futurs du danger de ces lieux. Durafour définit l’ère post-accident de la centrale en ère tchernobylienne, où l’homme n’a plus la même place. À défaut de pouvoir avec certitude mesurer les effets sur la santé des hommes (Durafour rend assez rapidement les armes sur ce sujet), on peut analyser le renversement que Tchernobyl a fait subir à notre regard, « à l’homme qui habite notre regard » (p. 60). L’art n’est plus monstration, et en l’occurrence dé-monstration, puisque de monstres, selon Durafour, nous n’en trouvons pas de visibles dans la « zone d’exclusion », ni parmi les animaux, ni parmi les naissances. Durafour, en voulant tirer une esthétique « radieuse » de Tchernobyl, minimise le caractère numérique des malformations en arguant qu’il n’y a rien là que la nature n’a pas déjà produit ici et là, de temps à autres. Et c’est en récusant toute possibilité d’une contre-nature que l’argument quantitatif (nombre de cancers, nombre de malformations, nombre de maladies auto-immunes, etc., dépassant les statistiques des lieux non irradiés) est balayé. Tchernobyl donne donc naissance à un nouvel écosystème et à une Tchernonature (p. 61). Car la nature, comme une conception transcendante de l’Anthropocène, ne sont pas des concepts valides pour Durafour. Il n’y a pas de nature, opposée à la culture, il y a des systèmes corrélés d’où l’homme ne peut plus raisonnablement s’extraire. Ce constat de fait, et de bon sens, Durafour le prolonge, en estimant que l’art de l’âge de la radioactivité pourrait bien proposer une, parmi d’autres, « technonature d’émancipation » (p. 71). Les êtres vivants de Tchernobyl sont des mélanges de nature et de technologie. La technologie et la catastrophe nucléaire sont aussi susceptibles de produire de la nature.
Aux visions apocalyptiques et spectaculaires, Durafour préfère donc l’art minimal d’une Cornelia Hesse-Honegger (Cercopis vulnerata, 1990, Miridae sp, 1990…), qui depuis des années prélève des insectes aux abords de sites nucléaires, actifs ou sanctuarisé comme Tchernobyl. L’insecte peint par ses soins – le petit, le micro – révèle alors ses mutations et malformations. Science, puisque Hesse-Honegger reproduit la pratique de l’entomologiste que Durafour replace agréablement dans une perspective historique, et art se rencontrent, non sans conflits, puisque le prélèvement ne répond à aucun protocole expérimental préétabli, tout en fournissant aussi une part de statistiques. Durafour illustre ainsi l’une de ses trois thèses : « La radioactivité est moins, pour l’art, un objet de représentation qu’une manière de regarder » (p. 72). Comme nous ne voyons pas, c’est peindre, dessiner, qui nous fait voir le monde, dans l’individu insecte ainsi aquarellé. L’importance de la chimère est soulignée dans le sens de la vision de l’invisible par la peinture, ce qui permet à l’auteur de se situer discrètement par rapport au modèle darwinien. Tchernobyl invente d’autres espèces, toujours dans le cycle de l’évolution. Plus tard, lorsque l’auteur revendique son optimisme et une esthétique radieuse, il en vient à réhabiliter les néolamarckiens contre les néodarwinistes, reprenant à son compte les théories sur l’épigénétique (Waddington) distinguant entre contenu et expression du message génétique : ainsi peut se comprendre la transmission de certains caractères acquis dans l’interaction avec l’environnement. La symbiose est exemplaire de ces échanges au niveau génétique entre différentes espèces alors complémentaires.
En citant le beau travail d’Anaïs Tondeur (voir l’ouvrage de Michael Marder et Anaïs Tondeur, The Chernobyl Herbarium : Fragments of an Exploded Consciousness, Londres, Open Humanities Press, 2016), Durafour fait un pas de plus dans les « seuils de visibilité » (p. 97) : son herbier est constitué, sans appareil photographique, de « photogrammes », soient des feuilles de papier sur lesquelles des plantes de la zone d’exclusion ont été placées, puis éclairées ; la feuille brûlée devient noire, la forme de la plante est blanche puisque celle-ci a intercepté la lumière. C’est le « retournement d’un rayonnement (lumineux) contre un autre rayonnement (ionisant) » (p. 101). La radioactivité rendue visible remet en cause la conception moderne du sujet extérieur à la nature ; l’objet tire lui-même sa photographie. Durafour poursuit la démonstration que l’art de l’âge nucléaire renverse complètement la relation sujet-objet et, partant, le rapport homme-nature établi depuis la Renaissance. Si l’idée que la nature sans culture n’existe pas, si Durafour ne se fait pas faute de citer Viveiros de Castro et le perspectivisme (on pourra lire Le regard du jaguar. Introduction au perspectivisme amérindien, Paris, la Tempête, 2021, mais il ne cite pas Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005, dans une bibliographie pourtant pertinente et aiguë), pour qui un animal se vit comme un être d’une nature culturelle, il semble conférer une forme de priorité du vivant radioactif aux plantes. Ses autres ouvrages (notamment Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie, Paris-Milan, Mimésis, 2018) et articles démontraient que le végétal, dans sa vie organique et non consciente, est pareil aux images. L’enthousiasme optimiste de Durafour éclate lorsqu’il assimile les végétaux de Tchernobyl à la fois à des victimes à l’existence très précaire et à une énergie vitale qui se confirme par le fait que, loin d’être un désert, la zone autour de Tchernobyl est un refuge luxuriant pour bien des espèces en voie de disparition ailleurs. Il faut se souvenir que, dans son ouvrage Cinéma et cristaux. Traité d’éconologie, les images sont considérées comme des « formes de vie non organiques capables de modifier l’environnement culturel, politique, social, etc. » (p. 146). On le voit, l’homme a bien perdu sa place centrale d’être connaissant, percevant, réfléchissant.
Au fur et à mesure que nous progressons dans les seuils de visibilité, nous nous enfonçons dans ce qui est de plus en plus petit et de moins en moins conscient. En même temps, soutient Durafour, nous allons vers le simple qui est le plus à même de soutenir l’âge radioactif : les champignons du photographe David McMillan montrent un nouveau vitalisme qui rend l’homme davantage secondaire encore. Cette désanthropisation – idée abordée par les lectures de B. Woodward (Slime Dynamics : Generation, Mutation, and the Creep of life, Winchester-Washington, Zero Books, 2011) ou S. G. Gould (L’éventail du vivant. Le mythe du progrès, Paris, Seuil, 1997) – est révélée par Tchernobyl qui remettrait les champignons à leur place centrale.
La vidéo et les arts numériques sont particulièrement adaptés au désir de voir l’invisible, qu’il soit infiniment petit, non perceptible par les sens humains ou appelé à apparaître dans des milliers d’années. L’art se fait enquête et révélateur, les objets sont des témoins, on cherche des preuves de la présence de la radioactivité (voir l’œuvre de Susan Shuppli, dont le nom est correctement orthographié une fois sur deux). À ce titre, on sait gré à Durafour de donner un sens aux arts numériques qui travaillent l’image analogique, montrant que l’image telle que nous la recevons n’existe que de manière très éphémère dans les supports numériques qui échangent sous forme algorithmique. Il faut lire les ouvrages de Durafour sur le cinéma pour se convaincre de la pertinence de ce propos, qui, à l’instar de Bazin, reformule une définition de l’image. En passant par l’art de l’âge de Tchernobyl, Durafour nous place devant un fait : nous ne pouvons continuer de nous en remettre à notre regard pour comprendre scientifiquement et ontologiquement le monde. Tchernobyl nous contraint de, non pas regarder, mais voir autrement, ce dont l’im-présence de la radioactivité est la preuve paradoxale.
Le dernier chapitre de l’ouvrage était annoncé comme théorique, pour une « esthétique radieuse » (p. 151). La radicale hétérogénéité entre le sujet regardant et l’objet regardé n’a pas été complètement fissurée par l’art contemporain, selon Durafour. S’inspirant de Bruno Latour, l’auteur entend faire de Tchernobyl la rupture manifeste propre à une nouvelle conception esthétique, selon laquelle, cette fois classiquement, l’œuvre nous fait penser. Passant rapidement sur les possibilités de l’écoféminisme à faire voir l’invisible, Durafour tente de situer sa Tchernobyliana dans le conflit contemporain entre art et esthétique, entre jugement de goût obsolète et art contemporain autoréférentiel. De fait, les œuvres évoquées par Durafour ne se réclament pas d’un art post-moderne, mais d’un art qui serait « contemporain sans l’être » (p. 165). Quant à faire de Tchernobyl une esthétique mutante (p. 166), renversant l’extériorité sujet-objet pour basculer dans ce qu’il appelle un « regard énucléé », un regard qui se projette dans un objet, dans un insecte, c’est ce qui résulte d’une radioactivité qui mettrait clairement en avant que ce monde comme les œuvres sont des relations. Le rapport entre objet et sujet interne (ou sujet retourné), inspiré par Freeman J. Dyson et la sphère entourant son étoile, est prolongé par les lectures écologiques de Arne Næss (Écologie, communauté et style de vie, Bellevaux, Dehors, 2013) et James J. Gibson (Approche écologique de la perception visuelle, Bellevaux, Dehors, 2014), insistant sur une ontologie de l’interaction, une écologie de la perception. Tchernobyl, selon Durafour, est une nouvelle étape dans la fracture du rapport duel entre sujet et objet, comme si la radioactivité révélait la matière elle-même, à son tour matière des œuvres de l’âge nucléaire. Durafour saute le pas : Tchernobyl est le nom d’une esthétique au-delà de l’humain, « rayonnante » au sens propre (p. 178). L’angle de Tchernobyl par l’art, et l’esthétique « radieuse », empêchent peut-être l’auteur de se confronter vraiment à une esthétique de la destruction et de la dévastation, qui semble pourtant exister, chez Tarkovski avant même Tchernobyl, et maintenant avec les œuvres commençant à émerger de la catastrophe de Fukushima. Peut-être la temporalité propre à l’âge radioactif aurait-elle gagné en lumière, si Tchernobyl avait été mis en perspective, non seulement avec Hiroshima et Nagasaki, mais aussi et surtout avec Fukushima (par exemple les photographes Arai Takashi, Arkadiusz Podniesiński…).
L’esthétique tchernobylienne se termine par un plaidoyer sur le penser écologique, qui se veut en marge de la traditionnelle opposition, effectivement sans intérêt, entre sceptiques et catastrophistes. Le propos de Durafour est modeste : « l’art a fait de Tchernobyl un mode d’enquête pour interroger l’éco-détermination des temps présents » (p. 186). Mais, avec l’« éconologie », il est aussi plus ambitieux qu’il ne semble à première vue, qui prend au sérieux la relation entre l’homme et les objets et renverse toute théorie mimétique de la représentation. Nous ne sommes pas loin de la conversion du regard et du renversement des perspectives qui nous obligeraient à prendre le point de vue de la plante, de l’objet délaissé, du champignon, des ions eux-mêmes, pour comprendre nous-mêmes et le monde. Aux yeux de Durafour la nature est co-créatrice (mais n’est-ce pas réitérer le geste que critiquait cependant Durafour en ouverture de son livre : il est impossible de penser la privation et le non-être sans penser l’être, en ce sens la nature ne fait-elle pas retour sous cet aspect ?).
Si la critique de l’écologie actuelle, très inspirée par celle de Bruno Latour, peut parfois sembler réduite à l’idée que la nature est un concept forgé et non pas une réalité, si les concepts qu’il crée – « in-oculé », « immonde » (in-mundus) – peuvent laisser au lecteur un goût d’inachevé, si pouvait être attendue une comparaison entre Hiroshima-Nagasaki, Tchernobyl et Fukushima, il n’en reste pas moins que Durafour ouvre un grand champ non seulement en esthétique, mais aussi en philosophie. Rompant radicalement avec la critique kantienne et avec la phénoménologie, le projet articule savamment les champs scientifique, artistique et, comme annoncé dans le titre mais sans lendemain (un programme à venir ?), cosmologique. Cette cosmologie pourrait bien remplacer la métaphysique traditionnelle, incapable de décrire l’âge nucléaire. C’est ce qui évite une possible lecture relativiste de l’ouvrage : s’il est vrai que l’équilibre de la Terre n’est pas le même pour l’homme et pour la mésange bleue, et si l’auteur, cohérent avec lui-même, refuse de parler de catastrophe puisque nous sommes par définition dans un milieu perturbé, devons-nous seulement nous en remettre à l’idée que l’équilibre, ou la perturbation, dépend de qui les vit ? La conversion du regard – Durafour nous fait voir autrement l’art et le monde – induisant une nouvelle cosmologie, serait la première étape, tchernobylienne, vers une esthétique politique.














