Capitalisme, expérience, organisation
Capitalisme, expérience, organisation
Retour sur Socialisme ou Barbarie
Par Frédéric Monferrand. Agrégé et docteur en philosophie, post-doctorant à l’Université de Namur et chercheur associé au laboratoire Sophiapol de l’Université de Nanterre.
Résumé
L’objectif de ce texte est de proposer une vision synthétique du travail mené dans la revue Socialisme ou Barbarie. Il soutient que ce travail se structure autour de trois axes principaux : la théorie d’une nouvelle phase du capitalisme (le « capitalisme bureaucratique »), l’attention portée au contenu politique de l’expérience ouvrière et la question des formes organisationnelles susceptibles d’exprimer ce contenu. Sur cette base, l’article s’emploie à reconstruire les débats dont ces thèmes furent l’occasion entre Cornelius Castoriadis et Claude Lefort : l’expérience sociale doit-elle être conçue, à la manière phénoménologique, comme le sol originaire de toute élaboration théorique ou bien, à la manière hégélienne, comme un processus d’apprentissage collectif ? L’organisation politique doit-elle être abandonnée comme un frein ou au contraire réinventée comme un accélérateur de ce processus d’apprentissage collectif ? Par certains aspects, ces débats résonnent encore avec les questions politiques auxquelles se trouve confrontée la philosophie sociale contemporaine.
Mots clés
Capitalisme ; Cornélius Castoriadis ; Claude Lefort ; Expérience sociale ; Marxisme ; Phénoménologie.
Introduction
Au risque de schématiser à l’extrême, on peut dire que le marxisme des années 1950 dut faire face à trois types de défis : politique, économique et théorique. Parmi les défis politiques, il faut évidemment citer la révélation des « crimes de Staline » lors du xxe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS), l’insurrection hongroise de 1956 réprimée par les chars soviétiques et la crise qui suivit ces deux événements dans le mouvement ouvrier. Parmi les défis économiques, il faut mentionner la généralisation du taylorisme dans les usines et le développement du fordisme dans la société : recomposition du procès de travail en tâches parcellaires d’un côté, gestion étatique de la reproduction de la force du travail et du conflit de classe de l’autre. Parmi les défis théoriques, enfin, on peut souligner l’appropriation phénoménologique, par Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty, de thèmes traditionnellement associés au marxisme : la nature de la réalité sociale et son historicité, l’engagement politique et la subjectivité critique. Or, il est un groupe au moins qui sut relever ces défis et en faire l’occasion d’un renouvellement du marxisme : le groupe réuni autour de Claude Lefort et Cornelius Castoriadis dans la revue Socialisme ou Barbarie[1].
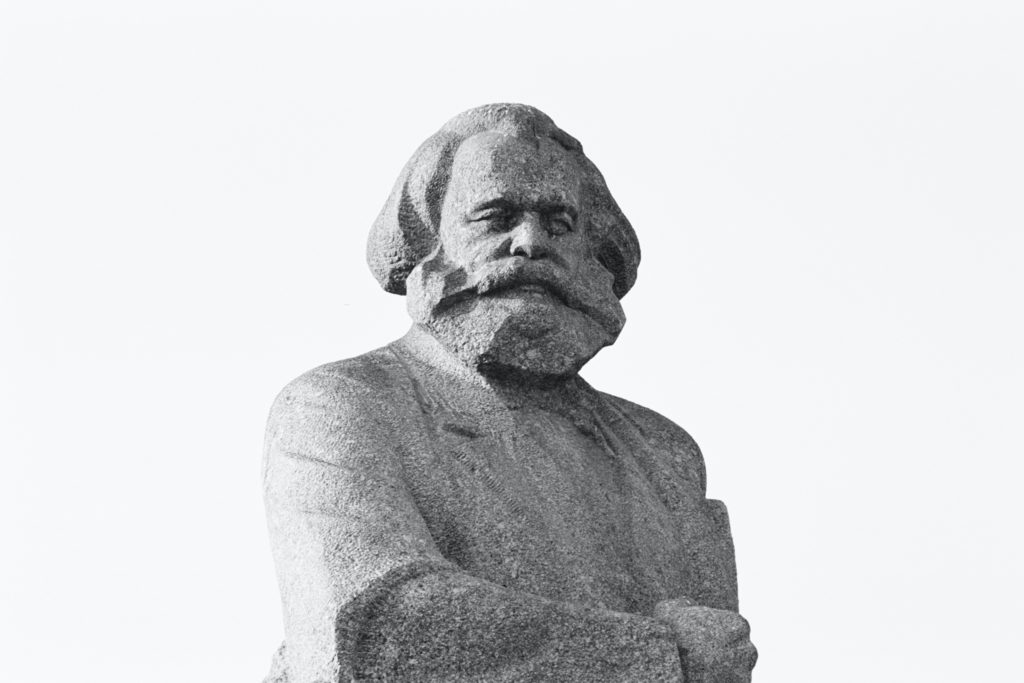
Dès 1949, dans le premier numéro de la revue, Cornelius Castoriadis soutient en effet que les travailleurs russes, polonais ou hongrois sont exploités par un « capitalisme bureaucratique d’État » face auquel la seule solution révolutionnaire est la gestion ouvrière de la production sociale. En conséquence, les membres de Socialisme ou Barbarie accueillent les revendications autogestionnaires du Conseil central ouvrier de Budapest comme une confirmation des thèses développées dans la revue et comme l’annonce d’une reprise internationale des luttes, non seulement contre la classe dirigeante, mais aussi contre les organisations officielles du mouvement ouvrier[2]. En France, cette reprise des luttes se manifeste de manière ouverte dans les grèves sauvages qui éclatent par exemple à Nantes et Saint-Nazaire en 1955, mais aussi de manière larvée dans les différentes stratégies informelles mises en œuvre par les travailleurs pour contrecarrer la taylorisation du procès de travail. Ce sont précisément ces stratégies informelles qu’au sein de Socialisme ou Barbarie, Claude Lefort vise à mettre au jour par la collecte de récits écrits à la première personne par les ouvriers. L’ancien élève de Maurice Merleau-Ponty entend ainsi politiser l’exigence phénoménologique du « retour aux choses mêmes », en lui donnant la forme d’une description de tout ce qui, dans l’expérience prolétarienne, annonce l’émergence de formes d’organisation politique autonomes par rapport aux partis et aux syndicats.
Le travail mené au sein de Socialisme ou Barbarie se développe ainsi selon trois axes principaux : la théorie d’une nouvelle phase du capitalisme, l’attention portée au contenu politique de l’expérience du travail et la question des formes organisationnelles susceptibles d’exprimer ce contenu. Capitalisme, expérience et organisation constituent donc les grands thèmes qui scanderont la progression de mon propos, dont l’objectif est à la fois de rendre compte de la cohérence du projet porté par Socialisme ou Barbarie et d’identifier les apories et les points de désaccords qui devaient provoquer la rupture au sein de la revue.
I. Capitalisme
On pourrait sans doute écrire l’histoire du marxisme des années 1950 du point de vue des positions adoptées par les différentes composantes du mouvement ouvrier à l’égard du régime soviétique[3]. Soutien résolu de la part des partis communistes d’un côté ; rejet complet de la part des différentes tendances bordiguistes, libertaires ou conseillistes de l’ultra-gauche, de l’autre. Entre ces deux extrêmes, on trouve le mouvement trotskyste, dont les multiples courants ont exploré l’intégralité du spectre allant du soutien critique à l’URSS, envisagé comme un « État ouvrier dégénéré », à la dénonciation radicale du régime soviétique analysé comme un « capitalisme d’État ». La première de ces positions peut être attribuée à Léon Trotsky lui-même[4] ; la seconde, à la tendance Johnson-Forest animée par Cyril Lionel Robert James et Raya Dunayevskaya aux États-Unis ou à la tendance Chaulieu-Montal en France[5]. C’est de cette tendance que devait émerger Socialisme ou Barbarie, après que Cornelius Castoriadis (Chaulieu) et Claude Lefort (Montal) eurent définitivement rompu avec le trotskysme[6].
C’est dans « Les rapports de production en Russie », un long article publié dans le premier numéro de Socialisme ou Barbarie, que Castoriadis expose son analyse de l’URSS comme capitalisme bureaucratique d’État[7]. Sa démonstration repose sur la distinction de deux concepts souvent identifiés dans le marxisme : le concept de « rapport de production », qui désigne les relations entre les classes qui organisent la reproduction matérielle de la société, et le concept de « rapport de propriété », qui renvoie quant à lui aux formes d’expression juridiques de ces relations[8]. Sur la base de cette distinction, Cornelius Castoriadis s’emploie à montrer qu’une modification des formes de propriété n’entraîne pas mécaniquement une transformation des rapports de production, de sorte que la nationalisation des moyens d’échange et de production accomplie en URSS ne suffit pas à supprimer le caractère capitaliste de l’exploitation inhérente aux rapports de production qui structurent la formation sociale soviétique.
L’idée selon laquelle l’économie soviétique repose sur l’exploitation n’est guère difficile à défendre. Par « exploitation », on entend en effet l’appropriation du surtravail d’une classe par une autre classe qui monopolise les moyens de production et dispose à ce titre du pouvoir d’organiser la production sociale. Or, c’est bien cette position de pouvoir qu’occupe la bureaucratie soviétique selon Cornelius Castoriadis, puisque l’État possède l’intégralité des moyens de production et qu’il organise par la planification l’ensemble du processus social de production[9]. Les raisons pour lesquelles cette exploitation devrait être qualifiée de « capitaliste » sont en revanche plus problématiques.
On définit en effet traditionnellement l’exploitation capitaliste par le fait que l’appropriation du surtravail y est médiatisée par l’échange marchand : le salaire rétribuant le temps consacré par le travailleur à la reproduction de la valeur de sa force de travail (travail nécessaire) et non l’intégralité du temps durant lequel cette dernière est dépensée dans l’entreprise (travail nécessaire et surtravail)[10]. Or, Cornelius Castoriadis souligne lui-même que dans la formation sociale soviétique, l’échange entre la force de travail et ce qu’il appelle parfois « l’État-patron »[11] n’est pas déterminé par les mécanismes économiques du marché (la « loi de la valeur »), mais par les décisions politiques qui président à la planification[12]. Deux solutions s’offrent alors à l’économiste : ou bien interpréter le régime soviétique comme un mode de production historiquement inédit, ce qui conduit logiquement à isoler les conflits sociaux qui s’y déroulent – ne fût-ce que sous les formes passives du vol, de l’absentéisme ou du ralentissement des cadences – des luttes de classe à l’œuvre dans les sociétés capitalistes. Ou bien transformer le concept même de capitalisme à la lumière de l’expérience soviétique, de manière à faire apparaître les sociétés « libérales » et « socialistes » comme deux fronts d’un même antagonisme global. C’est cette seconde voie qu’explore Cornelius Castoriadis à l’époque de Socialisme ou Barbarie.
Ce qui est caractéristique du capitalisme, explique-t-il en effet, ce n’est pas la fonction médiatrice qu’y remplit l’échange marchand, mais la séparation entre les producteurs et les moyens de production, la dépossession des savoirs ouvriers et du contrôle que les travailleurs pourraient exercer sur la production, et la contrainte à la production pour la production à laquelle ils sont soumis – trois conditions réalisée en URSS par la planification bureaucratique et la monopolisation étatique des conditions de la production. Séparation, dépossession, contrainte : à une époque où le marxisme hétérodoxe se nourrit des thèses défendues par le jeune Marx dans les Manuscrits de 1844, Castoriadis définit donc principalement le capitalisme par l’aliénation[13].
Cette redéfinition du capitalisme par l’aliénation remplit elle-même trois fonctions principales, qu’on peut énumérer « de l’abstrait au concret ». Une fonction socio-ontologique, d’abord, au sens où elle permet d’opposer la productivité qui irrigue l’être social à la captation dont elle fait l’objet par le capital[14]. Une fonction de diagnostic historique, ensuite, au sens où elle permet de faire apparaître le capitalisme soviétique comme « l’expression suprême et ultime »[15] d’une tendance à l’œuvre dans toutes les sociétés capitalistes. Pour Cornelius Castoriadis, en effet, l’aliénation des capacités humaines réalisées en URSS à l’échelle de la société par la planification se trouve réalisée en France, en Italie ou aux États-Unis à l’échelle du « despotisme de fabrique », de sorte que la formation sociale soviétique doit être analysée comme une vaste usine et que les usines occidentales doivent être analysées comme de petites sociétés bureaucratiques[16]. De ce diagnostic historique, il résulte enfin que la caractérisation du capitalisme par l’aliénation remplit essentiellement dans Socialisme ou Barbarie une fonction politique. Dire que l’État planificateur et ses relais partidaires ou syndicaux dépossèdent les travailleurs de tout contrôle sur la production, c’est en effet soutenir que les luttes de classes prennent de plus en plus la forme d’un antagonisme entre dirigeants et exécutants, de sorte que les conflits économiques sont poussés par une logique interne à dépasser leur stade revendicatif : lorsque les frontières entre exploitation capitaliste et domination étatique deviennent poreuses, la moindre grève peut prétendre à la radicalité d’une lutte pour l’exercice du pouvoir à l’échelle de toute la société[17]. Il devait alors revenir à Lefort de faire passer à cette hypothèse stratégique le test d’une confrontation avec l’expérience prolétarienne.
II. Expérience
C’est dans l’éditorial du numéro 11 de Socialisme ou Barbarie, paru en 1952, que Claude Lefort thématise pour elle-même « l’expérience prolétarienne »[18]. L’objectif de cet éditorial est de montrer que la classe ouvrière n’est ni le produit de sa position dans les rapports de production, ni l’objet de processus économiques anonymes, encore moins une masse au service d’intérêts partidaires. Pour Lefort, qui inaugure ainsi une véritable tradition intellectuelle et politique où se rencontrent aussi bien l’opéraïsme italien que l’histoire sociale britannique ou qu’un certain maoïsme français, le prolétariat est le sujet d’une expérience spécifique, inscrite dans une histoire qui lui est propre, impliquant un point de vue situé sur la société et enveloppant à ce titre des aspirations politiques autonomes. Exposant du point de vue subjectif du travail ce que Cornelius Castoriadis théorisait quant à lui du point de vue objectif du capital, Claude Lefort explique ainsi que la hiérarchie d’usine n’est pas telle qu’elle puisse effectivement réduire les travailleurs à de simples exécutants d’un développement économique planifié par en haut. Ce développement doit bien plutôt être interprété comme le produit d’une rationalisation seconde de l’ensemble des innovations spontanément apportées par les travailleurs à la machine productive[19]. Et c’est cette créativité qui autorise en premier lieu l’hypothèse autogestionnaire défendue dans les pages de Socialisme ou Barbarie.
Le statut de l’éditorial du numéro 11 de la revue révèle cependant son ambiguïté dès lors qu’on remarque que la logique interne à la construction du concept « d’expérience prolétarienne » pousse Claude Lefort à invalider ses propres élaborations, puisqu’il soutient finalement que seuls les ouvriers sont à même de parler de leur vécu à l’usine et dans la société[20]. Le texte se conclut ainsi par l’appel à la collecte de récits écrits par les travailleurs à la première personne, sur le modèle de « L’ouvrier américain » de Paul Romano, un membre de la tendance Johnson-Forest dont le témoignage sur l’expérience du travail dans les usines automobiles de Détroit est traduit et publié en feuilleton dans les premiers numéros de Socialisme ou Barbarie[21]. Par l’analyse comparée de ce type de documents, Claude Lefort espère franchir l’écart creusé par la société de classes entre l’intellectuel marxiste et l’ouvrier aliéné, accéder à une expérience prolétarienne non médiatisée par le discours des partis, des syndicats ou même des groupes minoritaires tels que Socialisme ou Barbarie. D’un côté, le retour aux choses mêmes de l’expérience prolétarienne est donc censé justifier la ligne antibureaucratique défendue dans la revue ; mais de l’autre, il doit révéler le fait que cette ligne émerge de manière organique de la vie interne à la classe ouvrière. La position de Claude Lefort est donc pour le moins inconfortable : producteur d’un discours théorique, il voudrait n’être que le transmetteur d’un vécu pré-théorique, la médiation évanouissante entre un vocabulaire militant structuré et une myriade de pratiques potentiellement politiques.
Sans doute cette situation instable est-elle propre à tout projet d’émancipation qui vise à dépasser l’opposition à laquelle il doit pourtant son existence : l’opposition entre travail intellectuel et travail manuel. Dans le cas particulier de Socialisme ou Barbarie, elle s’explique cependant plus précisément par les deux significations antinomiques que reçoit le concept « d’expérience » sous la plume de Claude Lefort. Dans une première perspective, qu’on peut qualifier à gros traits d’husserlienne, l’expérience prolétarienne désigne le vécu des ouvriers, envisagé comme sol originaire de tous leurs jugements et de toutes leurs évaluations spontanées :
Avant toute réflexion explicite, [écrit ainsi Lefort,] toute interprétation de leur sort ou de leur rôle, les ouvriers ont un comportement spontané en face du travail industriel, de l’exploitation, de l’organisation de la production, de la vie sociale à l’intérieur et en dehors de l’usine et c’est, de toute évidence, dans ce comportement que se manifeste le plus complètement leur personnalité.[22]
Cette première définition de l’expérience prolétarienne remplit fondamentalement une fonction critique : elle permet d’évaluer les discours théoriques et politiques qui prennent le prolétariat comme objet à l’aune du présent vivant de « la vie en usine », pour reprendre le titre d’un récit publié par Georges Vivier, ouvrier chez Citroën, dans Socialisme ou Barbarie[23]. Elle entre cependant en tension avec la seconde signification que reçoit le concept d’expérience dans l’éditorial du numéro 11 de la revue. Dans cette seconde perspective, qu’on peut qualifier cette fois d’hégélienne, l’expérience prolétarienne ne désigne en effet plus le vécu immédiat des ouvriers, mais l’ensemble des discours politiques, idéologiques ou théoriques qui médiatisent le rapport du prolétariat à sa situation et qu’il modifie activement en retour sous la poussée d’une dynamique interne à sa situation :
À ce niveau, [poursuit Claude Lefort juste après le passage précédemment cité,] les distinctions du subjectif et de l’objectif perdent leur sens : [le] comportement [des ouvriers] contient éminemment les idéologies qui en constituent en une certaine mesure la rationalisation, comme il suppose les conditions économiques dont il réalise lui-même l’intégration ou l’élaboration permanente.[24]
Cette seconde définition du concept d’expérience remplit une fonction plus directement politique. Dire que le comportement des ouvriers « réalise lui-même l’intégration ou l’élaboration permanente » des conditions idéologiques et économiques de leur expérience, c’est en effet aborder cette dernière comme un processus de Bildung, d’auto-éducation et de maturation. Pour Claude Lefort, les différentes formes d’organisation qu’invente le prolétariat au cours de son histoire constituent les moments d’un processus à travers lequel les ouvriers font l’épreuve du « sérieux, de la douleur, de la patience et du travail du négatif. »[25] Ils se posent comme sujet d’une expérience dans le mouvement même par lequel ils apprennent à ne plus déposer leur pouvoir dans les mains d’une forme de représentation quelconque et à s’opposer en conséquence aux capitalistes comme aux institutions bureaucratisées du mouvement ouvrier. Cette conception de l’expérience permet l’élaboration de ce que Claude Lefort appelle une « critique historique du prolétariat »[26] , au regard de laquelle l’avant-gardisme léninien et son involution bureaucratique dans l’appareil stalinien n’apparaissent ni comme des erreurs ni comme des trahisons, mais comme des configurations politiques de l’expérience prolétarienne qui furent tout aussi nécessaires à sa maturation qu’elles sont dorénavant caduques. Ce n’est alors plus la description phénoménologique du vécu ouvrier mais la reconstruction historique de son devenir qui permet de faire apparaître l’autogestion comme la seule perspective révolutionnaire praticable dans le contexte du capitalisme des années 1950. Le problème politique principal autour duquel devaient s’opposer Claude Lefort et Cornelius Castoriadis au sein de Socialisme ou Barbarie est dès lors le suivant : comment organiser l’aspiration à l’autonomie que les transformations du capitalisme comme l’histoire de la classe ouvrière ont inscrite au cœur de l’expérience prolétarienne ?
III. Organisation
On peut résumer le principe de la position castoriadienne comme suit : dans le capitalisme bureaucratique, la classe dirigeante exerce une domination non seulement économique, mais aussi politique et culturelle sur le prolétariat, ce qui place les révolutionnaires face à une contradiction. D’un côté, la domination que subit le prolétariat est telle que seule une organisation des fractions les plus « avancées » de la classe, développant un savoir totalisant de la société et une concentration de force au moins équivalente à celle que réalise l’État, peut espérer mener la classe ouvrière à la révolution. Mais, de l’autre côté, l’objectif de cette révolution est précisément l’abolition de la division entre direction « éclairée » et exécution passive des décisions prises par cette dernière. La résolution de cette contradiction, explique alors Cornelius Castoriadis, ne peut qu’être pratique. Elle dépend elle-même de la structure de l’organisation qui, en assurant l’autonomie de ses organismes de base, en promouvant la démocratie directe en son sein et en instituant l’élection et la révocabilité permanente des délégués, anticipe dans sa forme le contenu qu’elle vise à réaliser dans la société[27].
Pour Claude Lefort également, la politique révolutionnaire doit être organisation de l’autonomie prolétarienne. Mais cette exigence est selon lui contradictoire avec la forme-parti qu’entend lui imprimer Cornelius Castoriadis, à qui il oppose trois arguments. Le parti d’avant-garde, explique-t-il tout d’abord, appartient à un stade dépassé de l’expérience prolétarienne, durant lequel l’immaturité de la classe ouvrière la poussait non seulement à déléguer son pouvoir à des représentants, mais aussi à n’envisager la révolution que comme destruction des rapports de propriété et non comme production de nouveaux rapports sociaux favorisant l’autonomie de tous[28]. En conséquence, souligne-t-il ensuite, les obstacles statutaires que Cornelius Castoriadis entend opposer à la bureaucratisation de l’organisation relèvent d’une conception bourgeoise de la politique. L’élection et la révocabilité permanente des délégués est nécessairement formelle tant qu’elle reste fondée sur l’atomisation des individus qu’il s’agit de représenter[29]. Or, conclut-il, c’est bien cette atomisation que reproduit par principe la forme-parti, puisqu’elle est un « milieu artificiel »[30] qui ne réunit ses membres que par la médiation extérieure d’un programme conçu en amont par des dirigeants qui se trouvent par là même assurés d’être toujours réélus à la tête de l’organisation, aussi « démocratiques » que puissent en être les statuts.
De ces trois arguments, il résulte selon Claude Lefort que l’expérience prolétarienne exige l’invention d’une nouvelle pratique de la politique, qui ne soit plus importation extérieure d’un programme, mais auto-explicitation, par et pour la classe, des tendances révolutionnaires qui animent ses luttes et ses aspirations[31]. Au « milieu artificiel » que représente le parti, Claude Lefort oppose donc tout d’abord l’expérience partagée du travail productif qui, parce qu’elle relie positivement les individus entre eux, est seule à même de générer des prises de décisions égalitaires et concertées sur la meilleure manière de se libérer du travail productif. À la centralisation des forces réalisée par le parti, il oppose ensuite la dissémination des foyers de luttes, seule à même d’excéder les capacités de contrôle de l’État bureaucratique. À la concentration du savoir portant sur la totalité sociale entre les mains des membres du parti, il oppose enfin la multiplication des échanges entre des formes de savoirs situées, seules à même de propager une culture révolutionnaire parmi le prolétariat. Le modèle d’organisation autonome promu par Claude Lefort est dès lors celui d’un « réseau d’avant-garde » composé d’intellectuels et de militants d’entreprise, qui, par la diffusion d’un journal, la rédaction d’un bulletin et la pratique de « l’enquête sur l’expérience de vie et de travail » des ouvriers, s’efforcent d’assurer la communication des luttes et l’unification de la classe[32].
Ce modèle est assurément plus novateur que celui préconisé par Cornelius Castoriadis, mais il n’en présente pas moins certaines difficultés que s’emploie à relever ce dernier dans le texte qui consomme la rupture au sein de Socialisme ou Barbarie : « Prolétariat et organisation », paru en 1959 dans les numéros 27 et 28 de la revue. Dans ce texte, Cornelius Castoriadis ne se contente pas de relever la coexistence chez Claude Lefort de deux conceptions antinomiques de l’expérience prolétarienne, comme j’ai cru pouvoir le faire. Il soutient plus précisément que le modèle lefortien conjugue une « philosophie de l’immédiat » et une « nouvelle philosophie de l’histoire » qui se révèlent à l’examen contradictoires avec les fonctions politiques qu’elles sont censées assurer[33].
Sous l’expression de « philosophie de l’immédiat », Cornelius Castoriadis désigne le rapport de correspondance directe établi par Claude Lefort entre politique et production. Dans le vocabulaire léniniste qui se durcit sous la plume du premier à mesure que s’accentuent les divergences qui l’opposent au second, on dira que ce rapport de correspondance directe témoigne d’une tendance « économiciste » à réduire l’activité politique aux conflits qui émergent de la production et d’une tendance « spontanéiste » à considérer que l’expérience partagée du travail suffit à doter le prolétariat d’une conscience claire des enjeux, des moyens et de l’ampleur de sa lutte. Contre la tendance « économiciste », Cornelius Castoriadis rappelle ainsi que le prolétaire n’est pas que travailleur, mais aussi « consommateur, électeur, locataire, deuxième classe mobilisable, parent d’élève, lecteur de journal, spectateur de cinéma, etc. »[34], et souligne que c’est la totalité de cette expérience qui constitue le milieu de politisation de la classe ouvrière. Contre la tendance « spontanéiste », il soutient en conséquence que la politisation du rapport des travailleurs à la totalité sociale requière la construction d’une organisation que ne saurait suffire à faire émerger la seule expérience du travail en usine[35]. Dans cette perspective, réduire la politique à l’expérience immédiate de la production, c’est non seulement neutraliser le potentiel antagonique des luttes de classe en les enfermant dans l’espace de l’usine, mais c’est aussi renoncer par avance au projet socialiste d’auto-gouvernement de toutes les pratiques sociales par les « producteurs associés »[36]. Parce qu’il sépare abstraitement l’expérience particulière de la production de l’expérience générale de la société, conclut Cornelius Castoriadis, Claude Lefort est contraint de placer le socialisme à l’horizon d’une « nouvelle philosophie de l’histoire ».
Par « nouvelle philosophie de l’histoire », il faut cette fois entendre l’identification de l’expérience prolétarienne à un processus de Bildung qui mènerait organiquement les travailleurs de la minorité à l’autonomie. Or, de même que sa « philosophie de l’immédiat » contredit le contenu politique de l’expérience, cet optimisme téléologique contredit selon Castoriadis la forme de militantisme préconisée par Claude Lefort. S’il y a lieu de clarifier l’expérience prolétarienne, c’est bien en effet qu’elle n’est pas immédiatement claire à elle-même et qu’elle comporte des tendances contradictoires entre lesquelles il faut trancher. C’est que s’y affrontent l’aliénation et la lutte contre l’aliénation, la confiance dans le parti communiste et le refus des bureaucraties syndicales, le racisme envers les travailleurs immigrés et l’internationalisme prolétarien. Dans cette perspective, la « maturation » politique du prolétariat ne s’effectue pas contre ou malgré l’intervention extérieure des militants, comme le soutient Claude Lefort, mais grâce à cette intervention qui, toujours, vise à faire valoir une des tendances immanentes à l’expérience prolétarienne contre l’autre, même lorsqu’elle prend la forme minimale de l’enquête ouvrière[37]. Le fait même de pratiquer des enquêtes, remarque en effet Cornelius Castoriadis, est déjà prise de position à l’égard de l’expérience prolétarienne, car les militants qui s’y adonnent sont eux-mêmes animés de convictions qui s’expriment jusque dans le choix des subjectivités avec lesquelles ils prennent contact. Quant aux questions qu’ils leur posent, elles témoignent d’une certaine idée des conditions sociales qui pèsent sur l’expérience, du devenir possible de celle-ci et des moyens grâce auxquels peut être libéré son potentiel antagonique. Or, l’ensemble de ces idées constitue l’esquisse d’un programme de lutte dont les enquêteurs ne peuvent qu’espérer des enquêtés qu’ils le co-produisent, c’est-à-dire se l’approprient, le transforment et le réalisent. Et la mise en œuvre collective de ce programme n’est à son tour rien d’autre que ce qu’on appelle communément une organisation politique. S’il était cohérent avec lui-même, conclut Cornelius Castoriadis, Claude Lefort devrait donc reconnaître que le « réseau d’avant-garde » qu’il appelle de ses vœux n’est pas le contraire de la forme-parti, mais une forme renouvelée du parti.
Conclusion
J’ai tenté de montrer dans cette étude que l’analyse de l’expérience prolétarienne par laquelle Claude Lefort entendait concrétiser les conclusions politiques que Cornelius Castoriadis déduisait de sa théorie du capitalisme le menait finalement à s’opposer à ce dernier. Malgré la richesse des arguments échangés, force est de constater que le débat Lefort/Castoriadis sur la question de l’organisation a quelque chose d’un dialogue de sourds. À lire les contributions des deux hommes, tout se passe en effet comme si promouvoir l’auto-organisation du refus de l’aliénation revenait nécessairement à circonscrire cette dernière à l’expérience du travail et comme si la volonté de porter la lutte pour l’émancipation au-delà de l’entreprise, vers le tout de la société, impliquait nécessairement la médiation d’un parti centralisé. Jamais les membres de Socialisme ou Barbarie ne parvinrent à sortir de cette alternative : le parti envisagé par Cornelius Castoriadis ne verra pas le jour et Claude Lefort quitta rapidement le réseau « Information et Correspondance ouvrière » qu’il contribua à édifier après sa sortie de Socialisme ou Barbarie. Mais sans doute les limites de leur discussion étaient-elles celles de l’époque, qui conférait un sens à leurs positions respectives. C’est en tout cas ce que suggère l’émergence, dans l’Italie des années 1970, d’un projet politique qui peut rétrospectivement apparaître comme le dépassement des apories du débat Lefort/Castoriadis : le projet d’imprimer à la politisation du rapport que le prolétariat entretient non seulement au travail, mais aussi à la famille et à la consommation, aux transports et au logement, à l’école et aux loisirs – bref à la totalité sociale –, la forme d’une « enquête de masse sur l’autonomie ouvrière et prolétarienne»[38].
[1] Tous les numéros de la revue auxquels je renverrai sont disponibles en ligne à cette adresse : http://archivesautonomies.org/spip.php?article758.
[2] Voir la brochure « L’insurrection hongroise », publiée en supplément du numéro 20 de Socialisme ou Barbarie et rééditée dans Cornelius Castoriadis, La société bureaucratique, tome II, Paris, 10/18, 1973, p. 231-265.
[3] Voir sur ce point l’étude de Marcel van der Linden, Western Marxism and the Soviet Union, tr. fr. J. Bendien, Chicago, Haymarket, 2009.
[4] Voir Léon Trotsky, La révolution trahie, tr. fr., V. Serge, Paris, Minuit, 1963.
[5] Sur les positions des membres de la tendance Johnson-Forest à l’égard de l’URSS, voir Frédéric Monferrand, « Un marxisme de la libération », in Raya Dunayevskaya, Marxisme et liberté, tr. fr. M. Oliva, Paris, Syllepse, 2016, p. 11-16.
[6] Voir sur ce point Roland Simon, Histoire critique de l’ultra-gauche. Trajectoire d’une balle dans le pied, Marseille, Senonevero, 2009, p. 97-104.
[7] Cornelius Castoriadis, « Les rapports de production en Russie », in La société bureaucratique, tome I, Paris, 10/18, 1973, p. 205-282.
[8] Ibid., p. 216-229.
[9] Ibid., p. 236.
[10] C’est là, grossièrement restituée, la démonstration de Marx dans Le Capital. Voir Karl Marx, Le Capital, Livre I, tr. fr. J.-P. Lefebvre et al., Paris, PUF, 1996, p. 209-223.
[11] Cornelius Castoriadis, « Socialisme ou Barbarie », in La société bureaucratique, I, op. cit., p. 152.
[12] Cornelius Castoriadis, « Les rapports de production en Russie », art. cit., p. 228 et 253-254.
[13] Ibid., p. 236 ; ainsi que Cornelius Castoriadis, « La révolution prolétarienne contre la bureaucratie », in La société bureaucratique, tome II, op. cit, p. 268.
[14] Ibid., p. 273 : « La vie du monde moderne, faite des activités entrelacées et constamment changeantes de centaines de millions de producteurs conscients, échappe à l’emprise de toute couche dirigeante qui s’élève au-dessus de la société. »
[15] Cornelius Castoriadis, « Les rapports de production en Russie », art. cit., p. 227.
[16] Cornelius Castoriadis, « La révolution prolétarienne contre la bureaucratie », art. cit., p. 275 et 278.
[17] Voir notamment Cornelius Castoriadis, « Socialisme ou Barbarie », art. cit., p. 143.
[18] Claude Lefort, « L’expérience prolétarienne », Socialisme ou Barbarie, no 11, 1952, p. 1-19. Pour un commentaire complet de ce texte, voir Stephen Hastings-King, Looking for the proletariat. Socialisme ou Barbarie and the Problem of Worker Writing, Boston et Leyde, Brill, 2014, p. 105-134, ainsi que Frédéric Monferrand, « Politiser l’expérience. Merleau-Ponty, Socialisme ou Barbarie et l’expérience prolétarienne », Chiasmi international, no 19, 2018, p. 87-99.
[19] Claude Lefort, « L’expérience prolétarienne », art. cit.,p. 8 : « L’explication la plus profonde de [l’] apparente autonomie de la logique du développement technique est que celui-ci n’est pas l’œuvre de la seule direction capitaliste, qu’il est aussi l’expression du travail prolétarien. (…) La rationalisation qui s’opère au grand jour reprend à son compte, interprète et intègre à une perspective de classe, les innovations multiples, fragmentaires, dispersées et anonymes des hommes qui sont engagés dans le processus concret de la production. »
[20] Ibid., p. 15-16.
[21] Paul Romano, « L’ouvrier américain », Socialisme ou Barbarie, nos 1-6, 1949-1960.
[22] Claude Lefort, « L’expérience prolétarienne », art. cit., p. 10.
[23] Georges Vivier, « La vie en usine », Socialisme ou Barbarie, nos 11, 12, 14, 15-16 et 17, 1952-1955.
[24] Claude Lefort, « L’expérience prolétarienne », art. cit.,p. 10.
[25] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phénoménologie de l’esprit, tr. fr. B. Bourgeois, Paris, Vrin, 2006, p. 69.
[26] Claude Lefort, « Le prolétariat et le problème de la direction révolutionnaire », Socialisme ou Barbarie, no 10, 1952, p. 22.
[27] Cornelius Castoriadis, « La direction prolétarienne », ibid., p. 12-13.
[28] Claude Lefort, « Le prolétariat et le problème de la direction révolutionnaire », art. cit., p. 20-21.
[29] Claude Lefort, « Organisation et parti », Socialisme ou Barbarie, no 26, 1958, p. 125-127.
[30] Ibid., p. 128.
[31] Ibid., p. 133.
[32] Ibid., p. 132-134.
[33] Cornelius Castoriadis, « Prolétariat et organisation », Socialisme ou Barbarie, no 28, 1958, p. 59 et 61.
[34] Ibid., p. 67.
[35] Ibid., p. 66-68.
[36] Ibid., p. 71.
[37] Ibid., p.64-65.
[38] Antonio Negri, « Proletarians and the State » in Books for Burning, tr. ang. A. Bove, E. Emery, T. S. Murphy et F. Novello, Londres et New York, Verso, 2005, p. 169.














