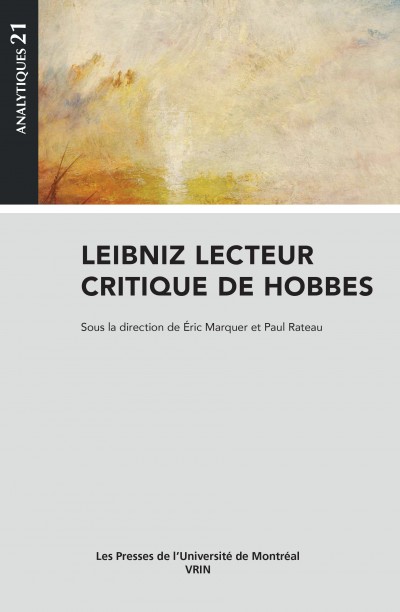Politique et affects chez Frédéric Lordon*
Julien CANAVERA et Juan Manuel ARAGÜÉS. Professeurs à l’Université de Saragosse, Espagne.
Résumé
Lordon a su montrer, via une réactualisation du spinozisme, en quoi les affects constituent les ressorts fondamentaux de l’action humaine, et notamment de la politique. Cette dernière, définie comme l’art de produire des idées affectantes, a pour vocation de « conduire la conduite » des hommes. Or, pour ce faire, encore est-il besoin que la complexion affective des individus les y prédispose. C’est pourquoi la subjectivité est appelée à devenir le nouveau champ de bataille politique ; terrain sur lequel excelle cette « machine affectante » qu’est le néolibéralisme, dont la capacité à modeler les subjectivités dans la direction opportune, en jouant sur les ressorts passionnels des hommes, frôle la perfection. Critiquer les structures de domination économique ne suffit donc pas : il faut également analyser ce par quoi ces dernières se rendent désirables.
Mots-clés : Lordon, Spinoza, affect, politique, néolibéralisme
Abstract
Lordon has shown, through a re-actualization of Spinozism, how affects are the fundamental drivers of human action, and particularly of politics. The latter, defined as the art of producing affecting ideas, has the vocation of « driving the conduct » of men. To do this, however, it is still necessary that the emotional complexion of individuals predisposes them to it. This is why subjectivity is destined to become the new political battlefield, the terrain on which the « affecting machine » of neoliberalism excels, whose ability to shape subjectivity in the suitable direction, by playing on the passionate potentials of human passions, touching perfection. Criticizing structures of economic domination is therefore not enough: it is also necessary to analyze what makes them desirable.
Keywords : Lordon, Spinoza, affect, politics, neoliberalism
Introduction
Une société aussi complexe que la société contemporaine ne saurait être analysée sous un seul angle ; bien au contraire, elle exige l’alliance, la mise en collaboration de diverses disciplines afin de mettre en lumière les rythmes, les flux, mais aussi les architectures structurelles qui la caractérisent. Ainsi pourrait-on succinctement résumer l’effort et l’orientation qui imprègnent l’œuvre de Lordon, économiste de formation qui a éprouvé le besoin de se doter de multiples outils théoriques afin de pouvoir mener à bien l’entreprise qu’il s’est proposée. C’est en effet à partir de l’économie que Lordon a promu une rencontre avec d’autres disciplines, comme la philosophie ou la sociologie, dans le but de construire ce que lui-même dénomme une « science sociale spinoziste »[1] ou, dans un autre registre terminologique, un « structuralisme des passions »[2]. Il n’est donc pas surprenant de constater que ses écrits débordent le seul champ économique et qu’ils s’emploient à esquisser une nouvelle science sociale où philosophie et sociologie y jouent un rôle central, comme l’atteste le fait que Lordon convoque à son banquet des auteurs tels que Marx, Althusser, Bourdieu, Durkheim, mais aussi et surtout, Spinoza, qui est appelé à être le pilier central de son œuvre.

Photo by Jon Tyson on Unsplash
Si Lordon est, à nos yeux, l’un des penseurs les plus puissants et intéressants du panorama théorique actuel, c’est, entre autres, parce que ses réflexions, qui s’appuient sur une profonde connaissance des dynamiques structurelles des sociétés contemporaines, constituent un outil d’une grande pertinence pour promouvoir de nouvelles modalités et manières d’envisager la politique. Et s’il y a bien quelque chose qui caractérise Lordon et qui le dote d’une importance politique, ce n’est autre que l’effort qu’il voue à comprendre la politique elle-même à partir et d’une nouvelle conception de la subjectivité, en vertu de laquelle cette dernière – une fois « débarrassée de tous les corrélats (cogito, libre arbitre, capacité d’autodétermination) qui nourrissent ses métaphysiques habituelles »[3] – apparaît comme « [marchant] aux désirs et aux affects »[4], et de la manière dont le néolibéralisme – notamment par le biais de cette « méta-machine affectante »[5] que sont les médias – parvient, en jouant sur les ressorts passionnels adéquats, à enrôler la subjectivité désirante, à la faire adhérer à son « utopie » marchande de la société, quand bien même cette adhésion, « dont le vrai nom est l’obéissance joyeuse »[6], est présentée en l’espèce d’un libre consentement.
En ce sens, si le combat politique contre le capitalisme néolibéral se joue avant tout sur le terrain de la subjectivité, c’est bien parce que celle-ci, en tant qu’elle est régie par l’inflexible « causalité passionnelle », ne saurait en aucun cas être le lieu de cette « liberté » – de ce saut hors de l’ordre causal – dont nous parle la métaphysique libérale du sujet, à laquelle s’adosse l’imaginaire néolibéral si profondément ancré en nos têtes. Aussi Lordon considère-t-il que le combat politique contre le néolibéralisme – et, plus généralement, la politique elle-même – doit prendre acte de l’élément passionnel dans lequel sont plongés les sujets, et que ce combat ne peut s’avérer efficace en pratique que s’il est capable d’affecter les individus autrement, c’est-à-dire que s’il parvient à réorienter le cours de la causalité passionnelle dans la direction souhaitée, celle de la défense des choses communes. Pour Lordon, le combat politique contre le néolibéralisme doit donc commencer par la déconstruction de son imaginaire sous-jacent, dont le propre est de présenter – et, ce faisant, d’occulter – l’enrôlement affectif des individus sous la forme d’une décision libre et raisonnée, émanant de subjecta (ou « sujets souverains »). Et de conclure :
[…] on ne lutte radicalement contre l’imaginaire néolibéral qu’en s’attaquant à son noyau dur métaphysique, c’est-à-dire à son idée d’homme. L’imaginaire antidote est donc un imaginaire anti-humaniste théorique, un imaginaire anti-subjectiviste[7].
I. La question du sujet
La réflexion sur le sujet occupe une place de choix au sein de la littérature philosophique contemporaine. Le modèle cartésien de la subjectivité, ancré comme il l’était dans l’essentialisme, entre manifestement en crise tout au long du XXe siècle, faisant l’objet de nombreuses remises en cause, et ce depuis les perspectives les plus variées, de l’existentialisme au post-structuralisme[8]. Mais en dépit de la diversité des angles d’attaque théoriques privilégiés ici et là, il est à noter que se fait jour un fil conducteur commun qui a trait à la considération de la subjectivité comme un effet, un produit, ou un pli, pour le dire en termes deleuziens. À cet égard, Lordon s’inscrit dans une tradition solidement établie au sein de la réflexion contemporaine, bien que pour ce faire il ait recours à un auteur chronologiquement éloigné, mais dont la présence dans la philosophie actuelle ne fait aucun doute : Baruch Spinoza.
Lordon s’approprie donc de la thèse spinozienne, inscrite en opposition aux idées cartésiennes, selon laquelle le sujet n’est pas « un empire dans un empire »[9]; thèse qui lui permet de battre en brèche la conception, héritée de la métaphysique subjectiviste, en vertu de laquelle l’homme serait à concevoir comme un subjectum. Face à la compréhension du sujet comme être autonome, capable de prendre librement ses propres décisions et responsable à tout moment de ses actes, Lordon s’appuie pour sa part sur une conception de la subjectivité où cette dernière – au même titre que ses actions et abstentions – est le résultat d’impulsions qui lui sont extérieures. En somme, Lordon conçoit l’homme comme un subditus, c’est-à-dire comme le « sujet d’un souverain », mais d’une souveraineté toute particulière puisque s’exerçant sur lui au travers de déterminations à la fois sociales (structures, institutions) et passionnelles (affects, désirs). Car s’il y a bien une efficacité des structures et des institutions sociales (en l’occurrence, celles du néolibéralisme) à déterminer les comportements individuels, celle-là – nous y reviendrons – tient fondamentalement à leur pouvoir d’affecter les individus, soit à leur capacité à déterminer ces individus, via des « affects communs », à agir (et à penser) conformément à ce qui est attendu d’eux.Toute action est donc toujours l’effet d’une cause extérieure qui l’engendre, ou pour faire usage d’un terme tout droit sorti de la philosophie spinoziste, et qui sera amené à devenir un mot-clé du lexique lordonien, d’un affect.
L’affect chez Spinoza est le nom le plus général donné à l’effet qui suit de l’exercice d’une puissance [d’un pouvoir d’affecter]. Une chose exerce sa puissance sur une autre, cette dernière s’en trouve modifiée : affect est le nom de cette modification[10].
Rappelons les principaux « moments » de ce que Lordon dénomme le « syllogisme spinoziste de l’action »[11] et, ce faisant, de la séquence conceptuelle au sein de laquelle le concept d’affect vient prendre place : l’homme, dont l’énergie motrice fondamentale a pour nom conatus[12] et désigne l’effort déployé pour « persévérer dans son être »[13], rencontre certaines choses au contact desquelles il s’expose – en vertu de leur puissance propre – à certaines affections qui produisent en lui certains effets, soit certains affects, lesquels affects, à leur tour, le déterminent à désirer entreprendre certaines actions. En d’autres termes, la rencontre de la subjectivité désirante avec une chose (affection) lui fait quelque chose (affect), qui consiste en une variation intensive de sa puissance d’agir[14] – soit à la hausse (joie), soit à la baisse (tristesse), selon que la chose rencontrée favorise ou entrave son effort de persévérer dans l’être – et qui, ce faisant, lui communique le désir de réaliser une certaine action[15], c’est-à-dire lui fait faire quelque chose – poursuivre ou fuir la chose rencontrée, selon que la subjectivité désirante se l’imagine être source de joie ou de tristesse. L’action, comme le montre donc Lordon dans le sillage de Spinoza, est nécessairement déterminée par des affects, et non par un prétendu libre arbitre dont l’exercice équivaudrait à une rupture d’avec l’ordre de la causalité passionnelle.
Cependant, le sujet – bien qu’il y soit enchaîné – ignore les causes affectives qui le poussent à agir, ce qui induit en lui l’illusion d’être libre ; illusion – souligne Deleuze – que Spinoza, comme chacun sait, attribue à la conscience dont « [la] nature est telle qu’elle recueille les effets, mais elle ignore les causes », et qui, du fait même de n’en obtenir que les effets, « va combler son ignorance en renversant l’ordre des choses, en prenant les effets pour les causes »[16]. C’est ainsi que le sujet, bien que conscient de ses appétences, n’en est pas moins incapable de se représenter adéquatement ce qui le détermine à se mouvoir dans telle ou telle direction, « les hommes se [croyant] libres par cela seul qu’ils sont conscients de leurs actions mais qu’ils ignorent les causes qui les déterminent »[17].
Lordon déploie donc la perspective spinozienne en développant une conception déterministe, mais non fataliste, du sujet ; en d’autres termes, pour Lordon, ce n’est pas parce que l’action du sujet, en tant qu’elle est déterminée par certains affects, demeure strictement soumise à l’inflexible causalité passionnelle, que s’impose aussitôt à elle un cours et une fin inéluctables, quels que soient les efforts entrepris par l’homme pour s’en écarter. Si l’on a tendance à croire que déterminisme et nouveauté s’excluent mutuellement, c’est bien parce que règne une confusion profonde : celle qui assimile fâcheusement le strict enchaînement des causes (déterminisme) à l’éternel retour du même et au même (fatalisme)[18]. Loin des schèmes habituels de pensée qui font de la nouveauté le corrélat de la liberté subjective, et de celle-ci, la rupture d’avec l’ordre causal compris erronément sous le prisme du fatalisme, Lordon se propose au contraire de montrer qu’il est possible de penser la nouveauté dans son rapport au déterminisme sans faire entrer en jeu ce terme intermédiaire qu’est la liberté subjective (conçue métaphysiquement comme pouvoir d’autodétermination).
Le raisonnement – spinoziste – de Lordon pourrait se résumer ainsi : l’homme, mû par son conatus, ne peut pas ne pas désirer faire certaines choses (qui lui sont suggérées par le monde social-humain, notamment par les structures et les institutions sociales au sein desquelles s’insère son agir) ; mais qu’il soit déterminé à désirer faire certaines choses, ne signifie pas qu’il ne puisse, à un moment donné, désirer autrement, c’est-à-dire désirer faire certaines choses plutôt que d’autres (avec tout ce que cela implique en termes d’entrave potentielle à la reproduction desdites structures et institutions). Or, ce désir de faire autrement et, par là, la nouveauté qui s’ensuit, loin d’être le marqueur de « quelque magnifique irruption de la “liberté”»[19], n’est autre que la conséquence de certains affects, jusqu’alors inconnus (et éprouvés à l’occasion d’une rencontre inattendue avec certaines choses), qui, en « se greffant » sur le conatus, lui imprime une nouvelle direction ; réorientation du désir de faire qui est simplement, dit Lordon, « la poursuite de la causalité passionnelle dans de nouvelles directions »[20].
Et c’est bien là – nous y reviendrons – que la raison peut avoir son rôle à jouer, en se substituant à l’imagination spontanée dont le propre, nous rappelle Spinoza, n’est de produire que des idées inadéquates, soit une connaissance des effets sans la connaissances des causes. En effet, en tant que pouvoir de connaître adéquatement, c’est-à-dire de connaître les causes passionnelles qui déterminent l’agir humain comme effet, la raison offre, notamment à l’art de gouverner, la possibilité – toujours limitée[21], mais la possibilité quand même – de comprendre quels sont les ressorts affectifs qui sont au fondement de l’agir humain afin de jouer de ceux susceptibles d’orienter la conduite des hommes dans la direction souhaitée.
C’est pourquoi Lordon comprend la politique comme un ars affectandi, c’est-à-dire comme une stratégie de production d’affects visant à faire en sorte que les sujets se meuvent dans la direction opportune. Pareille approche, qui invite à comprendre la politique au-delà du strict jeu des rationalités « pures » et à rompre notamment avec le « tournant délibératif » de la philosophie politique et son « idéal communicationnel » (Habermas, Rawls), au regard desquels la politique (démocratique) ne consisterait qu’en un processus rationnel de pacification des conflits et, par suite, d’extirpation des « distorsions émotionnelles » qui en sont la source ; une telle approche – disions-nous – nous apparaît sans aucun doute comme la proposition la plus intéressante de la réflexion lordonienne en ce sens qu’elle conçoit la politique comme un champ au sein duquel se déploie une myriade d’idées, mais dont toutes « baignent » dans l’élément – inextirpable – des passions, de sorte que, pour s’avérer efficaces, elles n’ont d’autre alternative que d’être « reliées » à des affects susceptibles de les empuissantiser. Car l’on sait combien « certaines idées nous parviennent qui nous laissent froids »[22]. D’où l’importance qu’il convient d’attacher – nous y reviendrons – au fait de trouver les mots « justes » et d’évoquer des images « marquantes ».
La politique, contrairement à la présentation complaisante qui en est souvent faite, n’est pas une affaire « d’idées », mais une affaire de production d’idées affectantes – ce qui suppose de leur adjoindre un supplément[23].
Ainsi, la politique cesse d’être une compétition pour le meilleur des arguments possibles et se mue en une stratégie de production d’affects. Pour cette raison, Lordon insiste sur le fait que la politique se développe fondamentalement dans le milieu passionnel, et qu’il en va de même pour les actions les plus rationnelles, lesquelles doivent être investies d’une charge affective et passionnelle si elles souhaitent être douées d’efficacité :
[…] lorsque « sous le coup d’une idée » – comme le dit l’expression courante – nous faisons quelque chose, par quoi nous devons comprendre que notre corps se met en mouvement – si, par exemple, une « idée » politique nous a scandalisés, ou mobilisés (le mot ici est parfaitement adéquat), nous sommes plus agités, notre tension monte, nous faisons du bruit avec la bouche (des phrases politiques, et nous discutons), éventuellement nous prenons la rue, ou nous allons au meeting –, si donc ce que nous appelons une « idée » nous fait faire des choses pareilles, c’est qu’elle ne nous ait pas arrivée à l’état de pur contenu idéel seulement, mais accompagnée d’affects[24].
Prenant Marx et Spinoza comme points de référence, Lordon propose en ce sens de « combiner un structuralisme des rapports et une anthropologie des passions. Marx et Spinoza »[25]. Ou comme il est dit dans La société des affects, en synthétisant les deux termes, de construire un « structuralisme des passions ». Les sujets, que la métaphysique présente comme des êtres libres, sont en réalité fortement déterminés par les structures sociales qui en constituent le terreau, à tel point qu’ils désirent et agissent ainsi que ces mêmes structures les incitent, par le truchement des affects communs, à désirer et à agir.
En effet, parmi les choses rencontrées, qui affectent les individus d’une certaine manière et leur communiquent le désir de faire certaines choses, les structures sociales (en l’occurrence, celles du capitalisme, dont l’ordre institutionnel néolibéral en est l’actualisation historique concrète, l’ « apparaître phénoménologique » – soit « très prosaïquement : ce qui ce donne à voir [de ces structures] lorsqu’on va “dans les institutions” »[26]), constituent la matrice principale à travers laquelle sont modelées les « complexions affectives » individuelles et promu un certain régime social d’affects et de désirs (matériels, symboliques, mais aussi vocationnels). En d’autres termes, s’il y a bien un modus operandi de l’efficacité des structures sociales et de l’ordre institutionnel correspondant, celui-ci tient à l’engendrement d’un « paysage passionnel »[27] capable de déterminer avec succès les comportements individuels à faire ceci plutôt que cela. Voilà la raison pour laquelle Lordon peut affirmer que « les structures s’expriment en les individus sous la forme de désirs, et Marx se prolonge avec Spinoza »[28]. Ce qui n’empêche nullement qu’il soit possible, dans ce cadre structurel, de générer des affects qui fassent se mouvoir le sujet dans une direction contraire aux intérêts des structures et de l’ordre institutionnel dominants – celle de la sédition.
Il y a des structures, et dans les structures il y a des hommes passionnés ; en première instance les hommes sont mus par leurs passions, en dernière analyse leurs passions sont largement déterminées par les structures ; ils sont mus le plus souvent dans une direction qui reproduit les structures, mais parfois dans une autre qui les renverse pour en créer de nouvelles[29].
II. Politique et production d’affects
Si c’est de production d’affects dont il est question, il ne fait aucun doute qu’à cet égard la société contemporaine, celle des médias de masse, accède au rang de machine politique frôlant la perfection. Aucune société comme la société actuelle n’a été capable de toucher les individus d’une manière aussi immédiate, de se loger au centre de leurs foyers, et notamment de leur transmettre d’une façon terriblement efficace des manières d’être, d’agir, et, en somme, de vivre.
Au sein de notre société capitaliste contemporaine, Lordon distingue deux moments décisifs en ce qui a trait aux stratégies de construction de la subjectivité. En premier lieu, le fordisme. Celui-ci se distingue nettement du capitalisme du XIXe siècle en ce sens que, contrairement à ce dernier, qui base sa domination des sujets sur des mécanismes répressifs tout en accentuant, au travers de la plus-value absolue, l’exploitation du travail, le fordisme produit, pour sa part, un nouvel imaginaire social où les individus, en raison d’une dynamique de consommation fomentée par l’augmentation du niveau de vie, sont mus, pour la première fois dans l’histoire, par des affects joyeux, éblouis par les promesses implicitement contenues dans les objets de consommation.
Affects de joie : voilà le point essentiel. En effet, la domination, telle que la comprend Lordon, peut s’effectuer, ou bien par le biais d’affects de tristesse – ceux-là mêmes qui prédominaient dans le capitalisme du XIXe siècle où les travailleurs étaient exclusivement mus par une logique de la survie –, ou bien au travers d’affects de joie, à l’instar de ceux que promeut le fordisme. Le capitalisme de consommation « est un régime authentiquement nouveau de désirs et d’affects et, comme on sait, sa contribution historique à la légitimation et à la stabilisation politique du capitalisme aura été considérable »[30].
De son côté, le néolibéralisme, en incorporant en son sein les pratiques consuméristes du fordisme, fait un pas de plus, en cela qu’il fomente résolument, chez les sujets, le développement de pratiques de construction de soi. Alors même que le fordisme possède un caractère transitif, dans la mesure où le désir se rabat sur l’objet de consommation, soit sur l’autre extérieur, le néolibéralisme fait montre, quant à lui, d’un caractère intransitif, étant donné qu’il invite le sujet à orienter son désir vers la construction de soi ; ou, plus précisément, vers l’instauration d’une nouvelle manière de conduire sa vie, de « gouvernementalité » (dirait Foucault), dont le modèle nous est fourni par l’entité capitaliste (entreprise) et la rationalité économique qui la sous-tend (valorisation du capital), et se concrétise individuellement comme suit : devenir l’ « entrepreneur de soi » en concevant – à commencer par lui – le travail comme une source immédiate de satisfaction, d’épanouissement personnel. Comme le soutiennent en ce sens Laval et Dardot, le néolibéralisme engendre donc une « “raison-monde” qui a pour caractéristique d’étendre et d’imposer la logique du capital à toutes les relations sociales jusqu’à en faire la forme même de nos vies »[31].
Ainsi, le néolibéralisme transforme directement le sujet en objet de production du sujet lui-même, lequel doit s’employer autant que faire se peut à se modeler à l’image de ce que la société néolibérale attend de lui : compétences, santé, goûts ou pratiques relèvent désormais de la responsabilité exclusive du sujet. Le self made man libéral poussé à son paroxysme.
Quoiqu’il en soit, le trait caractéristique du capitalisme contemporain, aussi bien dans sa version fordiste que néolibérale, est qu’il assoie globalement sa domination sur des affects de joie[32]. La domination par la peur, dont Machiavel disait qu’elle était l’une des stratégies fondamentales à la base de l’action du prince vertueux, se présente en fait comme un procédé d’une efficacité moindre que celle de la domination par l’acquiescement joyeux. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Lordon vient rejeter les concepts de « servitude volontaire », de « consentement » ou d’« aliénation », considérant qu’ils manquent de pertinence dès lors qu’il s’agit de décrire les dynamiques de contrôle propres aux sociétés contemporaines[33] ; dynamiques dont Aldous Huxley nous proposait déjà l’esquisse dans son roman d’anticipation Le meilleur des mondes. En effet, comme l’explique Jesús Ibáñez, « l’individu est l’objet le plus soigneusement fabriqué par le système capitaliste »[34], de telle sorte qu’il se reconnaît dans les pratiques que la société, de manière séduisante, lui impose.
Nous ne sommes pas très éloignés ici de l’idée marxienne de « subsomption réelle », qui, bien que citée par Lordon en certaines occasions[35], n’est pas développée autant qu’elle le mériterait, et qui rend pourtant parfaitement compte de l’ambition néolibérale à l’égard des sujets. Il est en effet possible d’identifier le mode de fonctionnement du capitalisme actuel comme un prolongement de ce que Marx, déjà, dans Le Capital, dénomme la « subsomption réelle du travail sous le capital », soit le processus d’extraction de la survaleur, caractéristique de la seconde époque de l’histoire de l’accumulation capitaliste, en vertu duquel sont mobilisés, afin d’augmenter la productivité du travail et, par suite, le surtravail (dont le capital soutire la plus-value), non seulement le travail réalisé au sein de l’entreprise, mais plus généralement, l’ensemble des sphères sociales et des activités correspondantes. Marx décrit donc bien le mode de fonctionnement capitaliste comme relevant d’un régime de mobilisation et de subordination totales (de la science, de la technologie, de la culture, de la politique, de la vie sociale, y compris de la subjectivité) au cycle du capital, qui trouve, à son tour, chez Lordon, un ultime prolongement lorsque ce dernier montre combien le néolibéralisme, en s’immisçant au plus profond des subjectivités désirantes, nourrit le projet ultime de « reconfigurer les désirs individuels pour les aligner sur le désir-maître du capital »[36].
III. Affecter d’une autre façon : pour une politique antagoniste
Mettre à découvert les mécanismes que les structures et les institutions du capitalisme néolibéral mobilisent dans le cadre de la production de subjectivité est donc une condition sine qua non pour engager le combat politique. Car la construction de subjectivité est devenue, de nos jours, le nouveau champ de bataille fondamental du politique. « Faire de la politique, c’est intervenir [directement] sur les processus de construction de subjectivité »[37], soit – en langage spinoziste et lordonien – essayer de comprendre au mieux quels sont les affects dont il faut savoir jouer – selon le contexte social et l’ « atmosphère » passionnelle – afin d’enrôler les puissances d’agir individuelles et les faire converger autant que faire se peut vers un projet collectif de transformation sociale dont l’objectif est, sinon la destitution du capitalisme lui-même, du moins celle de sa configuration néolibérale.
La thèse de Lordon, comme nous le disions, est que cette construction s’effectue essentiellement au travers des affects. Au regard de quoi il nous est permis de déduire qu’il s’avère indispensable de promouvoir un autre type d’affects si la fin recherchée n’est autre que l’élaboration de politiques nouvelles, et par suite, la construction d’une société différente. Quel que soit le nom que nous voulions bien lui donner, une politique radicale, antagoniste ou révolutionnaire – et donc, corrélativement, tout le corps d’idées (mais aussi de propositions, de valeurs, etc.) qu’elle entend incarner – doit avant tout être désirée, ce qui suppose d’engendrer un régime – contre-hégémonique – de désirs et d’affects capable de renverser le paysage passionnel en vigueur, pierre angulaire de la domination néolibérale. Car on ne (re)donne pas vie à (d’anciennes) de nouvelles idées, sans les empuissantiser, c’est-à-dire sans leur adjoindre une charge affective qui les rendent désirables et, si possible, massivement ; ce qui implique notamment tout un labeur et d’élaboration (ou de ré-élaboration) lexicale et de restitution des « images manquantes », dans la mesure où les « mots justes » et les « images évocatrices » opèrent comme des vecteurs d’empuissantisation des idées (dont on souhaite qu’elles soient partagées par le plus grand nombre). En somme, il s’agit de dire et de faire voir autrement pour faire sentir autrement.
C’est pourquoi, à titre d’exemple, il n’est pas sûr que le recours aux syntagmes « communisme » et « dictature du prolétariat », comme le fait pourtant Badiou[38] pour désigner le projet de démocratie radicale qu’il entend opposer à la démocratie parlementaire inféodée à l’ordre néolibéral, soit le meilleur moyen d’engendrer une adhésion de masse, étant donné le discrédit social-historique généralisé qu’ils accusent, à commencer par les images qu’ils évoquent généralement (surveillance généralisée, goulag, violation des droits de l’homme) et les passions qu’ils ont donc tendance à inspirer (méfiance, mépris, haine). Pour rendre désirable une politique antagoniste – et, par conséquent, le projet de société alternative dont elle est porteuse – il ne s’agit donc pas, comme l’a voulu la tradition, de convaincre à tout prix, de « se limiter » à avancer les meilleurs arguments qui soient, en croyant naïvement que leur seule rationalité serait à même de faire tomber les murailles argumentatives de l’adversaire, mais de promouvoir une affectivité, d’accompagner ces analyses raisonnées de stratégies de séduction qui les empuissantisent. En peu de mots, la consistance dialectique d’un discours n’est pas une condition suffisante pour que ce dernier parvienne à impacter les esprits et à faire en sorte que ceux-ci s’inclinent dans une direction plutôt que dans une autre ; il est également besoin que le discours soit doué d’un certain degré d’efficacité affective.
Dans le droit fil de ce qui précède, Lordon fait appel à l’exemple, surprenant à ses yeux, du réchauffement climatique, dont l’évidence scientifique, cependant, ne produit aucun effet sur les pratiques subjectives ni sur les politiques collectives. Il est là une idée à laquelle font défaut des affects susceptibles de l’empuissantiser (colère, indignation, révolte), et donc une idée, dont l’irruption dans (l’ordre de) l’esprit, précisément parce qu’elle laisse froid ou indifférent, ne saurait s’accompagner d’un quelconque effet pratique (se mobiliser pour la cause écologique, par exemple) – soit d’un quelconque mouvement (dans l’ordre) du corps visant à enrailler le phénomène dont elle est l’idée. De l’indifférence suscitée par l’irruption dans l’esprit de l’idée de réchauffement climatique s’ensuit corrélativement la détermination du corps à la passivité et à l’inaction. Et c’est qu’une idée, ou une « idée-affect », comme le dit parfois Lordon pour rappeler l’unité corps-esprit posée par Spinoza, ne nous fait quelque chose et ne nous fait faire quelque chose « qu’à la condition… de rencontrer [en nous] une complexion affectable »[39]. Ainsi, l’idée(-affect) du réchauffement climatique rencontre-t-elle une « complexion affectable » chez les scientifiques, « communauté » spécifique et restreinte qui, pour y être sensible, se trouve déterminée à (ré)agir en conséquence (appels, lettres ouvertes, recommandations), alors qu’elle demeure incapable de se nicher dans le spectre des susceptibilités affectives communes laissant froid le plus grand nombre, ainsi déterminé à l’inaction[40].
De ce constat s’ensuit aussitôt une interrogation sans nul doute cruciale : à quoi doit-on le fait de cesser d’être indifférent (ou contraire) à certaines idées et, par conséquent, de commencer à penser et à agir d’une autre façon si ce n’est, comme le dirait Deleuze en se faisant l’écho d’un thème nietzschéen, au fait primordial d’accoucher d’une nouvelle sensibilité ? « Dans la critique, il ne s’agit pas de justifier, mais de sentir autrement : une autre sensibilité »[41]. Et c’est que le « mode » humain, comme tout mode d’ailleurs selon Spinoza, est modifiable ; capacité de modification qui concerne notamment le « spectre de ses affectabilités » (ou l’étendue de sa sensibilité), toujours susceptible d’être élargi(e). Si l’effet que produit une idée(-affect) sur un sujet dépend donc du rapport de convenance qui s’établit entre sa complexion affective et cette idée(-affect), alors on comprend pourquoi Lordon conçoit la politique, l’ars affectandi, comme une construction – toujours incertaine et fragile – de « machines affectantes »[42], dont la mission est de reconfigurer les complexions affectives individuelles et, ce faisant, d’asseoir en les sujets les conditions d’une réceptivité, auparavant inexistante ou contraire, aux idées que l’on souhaite voir partagées. Marx avait coutume de dire que les romans de Dickens possédaient plus d’efficacité que ses propres analyses quand il était question de faire comprendre la dureté de la société capitaliste. Parce que ce dont il s’agit, en effet, c’est de faire voir pour faire sentir :
[…] je veux vous faire voir ce que je vois, avec la même intensité que celle avec laquelle je le vois. La politique est donc d’emblée en prise avec toute une économie de la visibilité, que chaque cause s’efforce de remanier ou de distordre à son profit pour rendre visible, ou plus visible, ce qui ne l’est pas ou pas assez, et ainsi diffuser par images réelles les visions que les partisans-voyants possèdent déjà à l’état d’images « mentales »[43].
Il est clair que les médias sont l’instrument le plus efficace lorsqu’il s’agit de produire des affects, ils sont la « méta-machine affectante ». Mais les médias aux ordres du pouvoir, du capital, orientent leurs stratégies dans la direction opposée à celle qui est ici attendue, soit vers la production d’affects favorables au régime établi du réel. Contrairement à ce qui, de prime abord, semblerait être le cas, il ressort que leur objectif premier consiste à occulter. La décontextualisation constitue à cet égard l’un des outils les plus efficaces dont ils disposent, et au moyen duquel ils s’emploient à nous faire voir des faits et des actions hors contexte, abstraits, séparés de tout récit.
Ainsi, les images de la violence perpétrée par des travailleurs en colère à l’encontre de leurs supérieurs hiérarchiques génèrent chez le public, au sein de la société en général, un affect d’empathie envers ceux qui en font l’objet. C’est pourquoi il s’avère indispensable, selon Lordon, de restituer les « images manquantes », de reconstruire la narration, le récit, pour replacer les faits dans une séquence globale. La bataille de la communication affectante, nous rappelle Lordon, et comme l’ont fait nombre d’auteurs au cours des dernières décennies, est nécessaire au développement d’une politique antagoniste, à la concrétion d’une « épidémiologie passionnelle de la sédition »[44], d’une lutte des classes au travers des affects. Car la sédition, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, n’est pas le fruit d’un saut miraculeux en dehors de l’ordre causal, mais bel et bien le résultat d’être déterminé à agir d’une autre façon – soit « la poursuite de la causalité passionnelle dans de nouvelles directions ».
Mais quel est le type d’affects qui doit promouvoir l’épidémie ? En fonction de quels objectifs doit-on encourager la sédition d’avec l’ordre néolibéral ? Pour répondre à ces questions, c’est vers Spinoza que Lordon, comme on pouvait s’y attendre, tourne une nouvelle fois le regard. Et il est ici un regard qui nous semble problématique. Il s’agit de promouvoir des « désirs communs […] vers des objets qui ne sont plus matière à captures unilatérales »[45], ce que Lordon comprend comme étant la plus authentique définition du communisme. Or, comment parvenir à la compréhension de ces désirs communs tout en proscrivant ceux teintés d’égoïsme subjectif ? En d’autres termes, comment substituer à une politique à la vue « idiote » (de idion, « particulier », « propre »), dont le trait caractéristique est de « fixer le désir des [sujets] à un certain nombre d’objets à l’exclusion d’autres »[46] et, ce faisant, de les enfermer dans des domaines prédéfinis du « légitimement » désirable, une « politique koinote »[47] (de koinon, « commun ») qui soit en mesure de conduire les sujets à opérer – métaphoriquement parlant – « la sortie de soi et [le] décentrement »[48], soit à « s’extirper » de leur complexion affective particulière afin d’embrasser des désirs (de choses) favorisant l’effort de tous pour persévérer dans l’être.
Car les sujets, qui demeurent soumis à la « servitude passionnelle », sont incapables de rencontre politique[49] ou ne sont capables, tout au plus, que de rencontres hasardeuses vouées à s’évanouir aussi vite qu’elles se sont produites. Puisque l’imagination, corrélat spirituel de la servitude passionnelle, n’a pas le pouvoir de faire comprendre aux sujets quels sont, parmi les êtres et les choses rencontrés, ceux dont les « rapports caractéristiques » – comme dirait Deleuze – se composent avec les leurs et accroissent donc leur puissance collective d’agir et de penser. Seul l’exercice de la raison, en tant qu’elle leur donne à voir – par le truchement des « notions communes » – les choses qui s’accordent nécessairement avec leur commune nature et favorisent ainsi leur conatus à tous, est en mesure de faire comprendre aux sujets pourquoi il est de leur intérêt de défendre et de revendiquer ces « choses communes », res communes ou communs, et, par là, comment ils doivent coordonner leurs puissances d’agir individuelles afin de faire front… commun face aux pouvoirs qui entendent se les approprier privativement, à commencer par ceux du capital. En d’autres termes, la raison est l’instrument qui peut permettre aux individus de « sortir » de leur complexion affective particulière, soit d’en étendre le spectre afin de trouver des points d’union à partir desquels construire ou composer une puissance d’agir collective aussi massive que possible.
[…] la Raison, au lieu d’en rester aux hasards des rencontres, cherche à nous unir aux choses et aux êtres dont le rapport se compose directement avec le nôtre. La Raison recherche donc le souverain bien ou l’ « utile propre », proprium utile, commun à tous les hommes[50].
Toutefois l’exercice de la raison, comme s’empressent de le préciser Spinoza et Lordon, n’implique certainement pas la suppression de tout conflit ni la fondation d’une cité absolument vertueuse. La différence n’est pas étouffée, de même qu’un certain degré de conflit. Mais la raison permet de fonder un horizon commun à travers un mécanisme de démocratie radicale qui fait son apparition depuis l’immanence de la multitude, selon la lecture que Lordon propose du Traité politique de Spinoza[51]. Et en effet, on pourrait dire que la raison, sous réserve de certaines précisions que nous serons amenés à apporter dans les lignes qui suivent, pourrait se convertir en l’instrument de ce qu’en d’autres occasions nous avons dénommé le « conatus de la multitude »[52].
Chez Spinoza, le concept de conatus fait d’abord référence à l’effort de persévérance dans l’être par lequel se définit tout individu. Lordon a souligné l’importance de ce concept comme base à partir de laquelle construire de nouvelles sciences sociales[53]. Et s’il existe bel et bien une certaine tendance à lire le conatus dans une optique individuelle, aussi nous faut-il rappeler que, chez Spinoza, tout individu est composé, qu’il est une multiplicité en acte[54]. De sorte que la multitude, en tant que sujet politique exprimant une majorité sociale guidée par l’exercice de la raison en vue de défendre le commun, est aussi un individu doué de conatus.
Or, c’est là que nous pouvons trouver la clé d’une politique antagoniste de type spinozien : à travers la définition d’un projet politique qui, « sous la conduite de la raison », soit capable, d’une part, de développer le conatus de la multitude, en le transitivisant ou concrétisant sous l’espèce d’un désir de commun(s) et, d’autre part, qui soit capable de s’appuyer sur la puissance collective ainsi composée pour garantir la persévérance dans l’être, la survie de la multitude, laquelle, en un sens, exprime les intérêts de l’humanité, bien qu’elle ne puisse les englober dans leur totalité. En effet, la multitude possède une vocation d’universalité, en ce sens précis qu’elle est le sujet politique antagoniste qui, adossé à un régime de désirs et d’affects communs toujours susceptible d’être élargi, entend faire valoir le droit de tous et toutes à user et jouir de tout ce qui est en mesure de concourir à l’effort collectif de persévérance dans l’être – soit les communs : environnement, culture, éducation, santé, logement, travail, réseaux de transport, de communication et d’assainissement, etc.
Mais cette vocation d’universalité ne s’en trouve pas moins entravée dans la pratique – et c’est notamment pourquoi nous évoquions l’incapacité de la multitude à subsumer de facto les intérêts de l’humanité en leur totalité – par les résistances que leur opposent les individus, les groupes et autres institutions, soucieux de défendre leurs intérêts particuliers, et qui, pour ce faire, conduisent une politique idiote d’appropriation exclusive des communs (dont les privatisations à répétition sont le nom). Le déploiement d’une politique koinote – et, par conséquent, le développement du conatus de la multitude, qui en rend possible la concrétion – débouche donc sur un conflit ouvert avec tous ceux qui œuvrent à pareille appropriation. En un mot, avec le pouvoir, cette « confiscation par les dirigeants[55] de la puissance collective de leurs propres sujets »[56], dont la subjectivation néolibérale, par nature « idiotisante », est devenue, à l’ère du capitalisme post-fordiste, l’un des mécanismes clés.
Pour contrer l’idiotie ambiante et le règne des « imbéciles heureux »[57], il est toujours possible, comme nous le disions déjà, d’avoir recours à la raison comme instrument au service du développement d’une politique du commun, d’une politique koinote. Aussi la raison est-elle bien ce qui pourrait nous porter à agir sous le signe d’une nouvelle sorte d’impératif catégorique de la multitude, et dont on pourrait en donner la formule suivante : « Agis de telle manière que tes actes rendent possible le conatus de la multitude, la persévérance dans l’être de l’humanité dans sa totalité ».
Mais, et c’est là que la précaution précitée fait son entrée en scène, il n’est pas ici question – nous l’aurons compris – de se valoir de la seule puissance de la raison, impuissante par nature à mettre les corps en mouvement. Car – pour paraphraser Bourdieu, qui lui-même se plaisait à citer Spinoza – « il n’y a pas de force intrinsèque de l’idée vraie ». En d’autres termes, si la raison est bien productrice d’idées adéquates, soit d’une connaissance des effets accompagnée de la connaissance des causes, reste que ces idées, cette connaissance, sont incapables de faire se mouvoir les corps tant que leur fait défaut la « force sociale » – et donc affective – susceptible de les empuissantiser. Ainsi, pour que la raison puisse servir au développement d’une politique du commun, encore est-il besoin de lui adjoindre, pour ainsi dire, un supplément affectif ou passionnel – très prosaïquement : de la « brancher » sur un nouveau régime de désirs (du commun). Opération de « branchement » qui revient, en dernière analyse, à accoucher d’une nouvelle rationalité, puisque la rationalité bien comprise n’est autre que le nom, comme le rappelle Lordon, « du désir poursuivi par d’autres moyens », soit le nom « [du] désir et [des] affects trempés par la méthode, par la poursuite organisée »[58] à laquelle peut (doit) contribuer la raison.
Expliquons-nous. Il n’existe pas une seule manière d’exercer la rationalité. Ou pour être plus précis, le jeu rationnel peut se développer à partir de présupposés, d’approches et d’objectifs forts différents. Ainsi existe-t-il une rationalité néolibérale, asservie notamment à ce désir – peu raisonnable – de l’accumulation monétaire ; rationalité dont Laval et Dardot nous brossent magnifiquement le tableau dans La nouvelle raison du monde[59], et que Lordon, pour sa part, ne cesse de remettre en question tout au long de son œuvre. Or, c’est précisément l’implacable développement de sa logique qui nous conduit vers un nouveau processus d’agression contre le commun d’une intensité similaire à ce que vécut l’Europe du XVIIe et du XVIIIe siècles lors du développement de la raison libérale. Par conséquent, ce n’est pas l’exercice de la raison in abstracto qui nous permettra de conduire la multitude à embrasser un désir du commun et, par suite, à se mobiliser politiquement pour défendre les « “utiles propres” […] communs à tous les hommes » ; bien au contraire, seule l’instauration d’une nouvelle rationalité, d’une rationalité contre-hégémonique faisant d’un tel désir du commun sa force motrice, et de la raison, l’instrument propre à sa poursuite méthodique, sera en mesure d’accroître et de restituer à la multitude sa puissance (que le pouvoir s’emploie à capturer) et, par là, son droit (sur les communs dont ce même pouvoir entend s’approprier privativement) – « tantum juris quantum potentiae (« autant de droit que de puissance »), comme dit Spinoza. C’est en ce sens-là qu’il nous est permis d’affirmer, conformément à la logique qui préside Les affects de la politique, que le combat contre la rationalité néoliberale hégémonique ne s’avèrera efficace qu’à la condition d’accoutumer les sujets à un autre exercice de rationalité, investi – quant à lui – par un désir du commun. À défaut de quoi les appels à la mobilisation, aussi argumentés soient-ils, seront condamnés à rester lettre morte. Et la multitude (multitudinis), à retourner derechef à son état de foule (plebs, vulgus) idiote et atomisée.
[…] ce qui fait reconnaître une argumentation rationnelle – reconnaître, c’est-à-dire, s’y plier – est, encore et toujours, de l’ordre des affects, les affects qui peuvent seuls donner force à la forme, par soi trop peu puissante, trop vulnérable à des forces contraires, de la rationalité. La politique rejoindrait-elle son idéal communicationnel de rationalité, elle n’en resterait pas moins entièrement prise dans la grammaire de la puissance et des affects[60].
Il est là, assurément, une tâche ardue, d’autant plus que l’ingenium des sujets, c’est-à-dire la réfraction individuelle des « affects communs » produits par les structures et les institutions sociales, ne cesse, malgré les sensibles variations dont il fait l’objet[61], d’engendrer des inerties chez ces mêmes sujets, lesquels sont tendanciellement prédisposés à se soumettre à la « dépendance au sentier » promue par le pouvoir. Car, comme nous le disions, nos vies n’ont eu de cesse d’être modelées par les flux qui émanent du discours et des pratiques hégémoniques.
L’ingenium est aussi la récapitulation de toute notre trajectoire socio-biographique telle qu’elle a laissé en nous des plis durables – quoique toujours modifiables en principe – au fil des affections – des rencontres – qui nous ont marqués. Ces marques ont formé nos manières : manières de sentir, de juger, de penser[62].
Inverser l’ingenium – et, par suite, les « manières de sentir, de juger, de penser » – revient pratiquement à renverser une vie, un monde. Et pour ce faire, au-delà des bons arguments, des constructions rationnelles impeccablement développées, il est besoin du désir. Désir de sortir des sentiers battus, désir d’explorer de nouveaux espaces et territoires, désir de partager des affects. Toute une « micro-politique » des affects dont Spinoza est l’instigateur, et Lordon, l’un des plus récents et suggestifs continuateurs aux côtés de Deleuze et Guattari.
Conclusion
À nos yeux, il ne fait aucun doute que l’œuvre de Lordon est appelée à se convertir en une référence obligée de la pensée contemporaine, et ce dans la mesure où Lordon a su mettre à découvert les ressorts fondamentaux de l’action humaine en général et de la politique en particulier : les affects. Et il y est parvenu tout en évitant ce « virage émotionnel » contemporain qu’il ne manque pas de dénoncer : « le tournant émotionnel porte-t-il à son comble le retour théorique à l´individu… » ; et qui plus est, « au risque de liquider définitivement tout ce qu’il y a de proprement social dans les sciences sociales, en voie de dissolution dans une sorte de psychologie étendue »[63]. L’une des stratégies politiques adoptées par le néolibéralisme consiste précisément à faire en sorte que le sujet tourne le regard vers son for intérieur, et corrélativement, qu’il se désintéresse de ce qu’il se passe autour de lui. Cependant, le défi propre à l’analyse des processus de subjectivation, exprimé de façon radicale, consiste au contraire à « garder les affects mais en se débarrassant du sujet »[64] ; tout du moins, dans sa conception libérale et cartésienne. Le structuralisme des passions se présente donc comme une nouvelle tentative de démêler les rapports entre le sujet et le monde, mais dont la vertu tient à ceci qu’il théorise un sujet qui est monde et un monde qui se fait sujet. Et tout cela dans le cadre de l’inéludable compromis avec la différence subjective, propre à une approche matérialiste conséquente.
Bibliographie
Juan Manuel Aragüés, Líneas de fuga. Filosofía contra la sociedad idiota, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2002.
Juan Manuel Aragüés, De la vanguardia al cyborg. Aproximaciones al paradigma posmoderno, Zaragoza, Eclipsados, 2012.
Juan Manuel Aragüés, Deseo de multitud. Diferencia, antagonismo y política materialista, Valencia, Pre-Textos, 2018.
Juan Manuel Aragüés, De idiotas a koinotas. Para una política de la multitud, Madrid, Arena Libros, 2020.
Alain Badiou, « L’emblème démocratique », in Ouvrage collectif, La démocratie, dans quel état ?, Paris, La Fabrique, 2009, p. 10-17.
Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1983.
Gilles Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 2003.
Jesús Ezquerra, Un claro laberinto. Lectura de Spinoza, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
Jesús Ibáñez, Más allá de la sociología, Madrid, Siglo XXI, 1986.
Christian Laval et Pierre Dardot, La nouvelle raison du monde, Paris, La Découverte, 2010.
Christian Laval et Pierre Dardot, Ce cauchemar qui n’en finit pas, Paris, La Découverte, 2016.
Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique, 2010.
Frédéric Lordon, « Le totalitarisme, stade ultime du capitalisme », Cités, 2010/1, nº 41, p. 127-142.
Frédéric Lordon, La société des affects. Pour un structuralisme des passions, Paris, Le Seuil, 2013.
Frédéric Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015.
Frédéric Lordon, « Il faut défendre le social », France Culture, 23 novembre 2015. En ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/frederic-lordon-il-faut-defendre-le-social>.
Frédéric Lordon, Les affects de la politique, Paris, Seuil, 2016.
Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1988.
Baruch Spinoza, Éthique, Paris, Éditions de l’Éclat, 2005.
* Travail réalisé dans le cadre du projet de recherche «Racionalidad económica, ecología política y globalización: hacia una nueva racionalidad cosmopolita» (PID2019-109252RB-I00) financé par le Ministère espagnol de l’Éducation et de l’Innovation.
[1] Frédéric Lordon, La société des affects. Pour un structuralisme des passions, Paris, Le Seuil, 2013, p. 24. Abrégé par la suite SA.
[2] SA, p. 11.
[3] Frédéric Lordon, « Le totalitarisme, stade ultime du capitalisme ? », Cités, 2010/1, nº 41, p. 128.
[4] SA, p. 7.
[5] Frédéric Lordon, Les affects de la politique, Paris, Le Seuil, 2016, p. 168. Abrégé par la suite AP.
[6] Frédéric Lordon, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique, 2010, p. 87. Abrégé par la suite CDS.
[7] SA, p. 296.
[8] Voir Juan Manuel Aragüés, De la vanguardia al cyborg. Aproximaciones al paradigma posmoderno, Zaragoza, Eclipsados, 2012.
[9] Baruch Spinoza, Éthique, Paris, Éditions de l’Éclat, 2005, Partie III, p. 195.
[10] AP, p. 16.
[11] SA, p. 16.
[12] Appétit dont le désir, à son tour, est l’une des modalités : le désir comme appétit conscient de soi.
[13] Baruch Spinoza, Éthique, op. cit., Partie III, Prop. 6, p. 205.
[14] Mais aussi de sa puissance de penser, en vertu de l’unité corps-esprit et de la thèse dite du parallélisme.
[15] Et, parallèlement, d’enchaîner ses idées d’une certaine façon.
[16] Gilles Deleuze, Spinoza. Philosophie pratique, Paris, Minuit, 2003, p. 29-30.
[17] Baruch Spinoza, Éthique, op. cit., Partie III, Prop. 2, Scolie, p. 202.
[18] Voir CDS, p. 174.
[19] SA, p. 13.
[20] Ibidem.
[21] En raison de la diversité des « complexions affectives » individuelles sur lesquelles l’intervention politique entend exercer sa puissance, et ce malgré le travail d’homogénéisation réalisé – via les affects communs – par les stuctures et les institutions, pareille intervention ne saurait relever d’une science du gouvernement, mais d’un art qui revêt la forme d’un « pari sur les passions » (AP, p. 39).
[22] AP, p. 23.
[23] Ibid., p. 57.
[24] Ibid., p. 22.
[25] CDS, p. 10.
[26] SA, p. 100.
[27] Voir CDS, p. 11.
[28] Ibid., p. 14-15.
[29] Ibid., p. 11-12.
[30] Ibid., p. 87.
[31] Christian Laval et Pierre Dardot, Ce cauchemar qui n’en finit pas, Paris, La Découverte, 2016, p. 10.
[32] Cela ne veut pas dire qu’il n’existe point d’affects de tristesse, comme celui de l’endettement, qui est supporté comme un moyen en vue de cette fin qu’est la consommation. Mais Lordon souligne, à notre avis, de façon pertinente, l’efficacité de la domination par les affects de joie au sein des sociétés capitalistes contemporaines.
[33] SA, p. 251.
[34] Jesús Ibáñez, Más allá de la sociología, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 58.
[35] CDS, p. 187.
[36] SA, p. 94.
[37] Juan Manuel Aragüés, Deseo de multitud. Diferencia, antagonismo y política materialista, Valencia, Pre-Textos, 2018, p. 117.
[38] Voir Alain Badiou, « L’emblème démocratique », in Ouvrage collectif, La démocratie, dans quel état ?, Paris, La Fabrique, 2009, p. 10-17.
[39] AP, p. 23.
[40] Pour ne pas parler du comportement réactionnel (réactionnaire) qu’une telle idée induit au contraire chez les climato-sceptiques.
[41] Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1983, p. 108.
[42] AP, p. 61.
[43] Ibid., p. 64-65.
[44] Ibid., p. 125.
[45] CDS, p. 196.
[46] Ibid., p. 140.
[47] Voir Juan Manuel Aragüés, De idiotas a koinotas. Para una política de la multitud, Madrid, Arena Libros, 2020.
[48] AP, p. 10.
[49] Frédéric Lordon, Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015, p. 23.
[50] Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, op. cit., p. 76.
[51] CDS, p. 201.
[52] Juan Manuel Aragüés, Líneas de fuga. Filosofía contra la sociedad idiota, Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 2002. Voir le chapitre intitulé « Deleuze et la genèse d’une éthique anti-capitaliste », p. 153-172.
[53] SA, p. 24.
[54] Jesús Ezquerra, Un claro laberinto. Lectura de Spinoza, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
[55] Qu’ils appartiennent ou non au gouvernement (comme institution), puisqu’il y a gouvernement (comme pratique) et, par suite, politique, dès lors que se manifeste – nous dit Lordon – la volonté de conduire la conduite des hommes, soit de composer leurs puissances d’agir afin de les déterminer à faire ceci plutôt cela.
[56] Alexandre Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1988, p. 20.
[57] SA, p. 265-298.
[58] Frédéric Lordon, « Il faut défendre le social », France Culture, 29 novembre 2015. En ligne : <https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-des-matins/frederic-lordon-il-faut-defendre-le-social>.
[59] Christian Laval et Pierre Dardot, La nouvelle raison du monde, Paris, La Découverte, 2010.
[60] AP, p. 33-34.
[61] Et qui s’expliquent en vertu de la trajectoire biographique et des caractéristiques sociales propres à chaque individu.
[62] Ibid., p. 24.
[63] SA,p. 9.
[64] Ibid., p. 11.