Recension – La couleur du goût, de Laurent Jaffro
Recension de l’ouvrage de Laurent Jaffro, La couleur du goût
Par Claire Etchegaray, MCF Paris Nanterre, IRePh.
Cet article est une recension du récent ouvrage de Laurent Jaffro, La couleur du goût, Paris, Vrin, 2019, 238p. Vous pouvez trouver l’ouvrage sur le site de l’éditeur en cliquant ici.
L’ouvrage est simplement mentionné comme La couleur du goût dans ce qui suit, et il n’est fait référence qu’aux pages de l’ouvrage.
Goûter la beauté, voir la couleur
La philosophie de l’art a son histoire. Elle peut certes prendre des formes différentes, aussi variées que les études critiques, l’analyse esthétique, l’enquête socio-historique ou la réflexion métaphysique ; mais elle paraîtra moins éclatée si l’on prend garde à la façon même ces approches, dîtes aujourd’hui « critiques », « esthétiques », « socio-historiques » ou « ontologiques », se sont affirmées et composées au sein de textes qui constituent les gestae de cette histoire. Dans La couleur du goût. Psychologie et esthétique au siècle de Hume, Laurent Jaffro nous offre une plongée dans l’un de ses moments historiques, souvent étiqueté par commodité « naissance de l’esthétique ». L’étiquette n’est pas sans raison puisque les auteurs du XVIIIe siècle britannique auxquels il s’intéresse ont souvent été lus en dialogue, en parallèle ou en continuité avec l’approche d’Alexandre Baumgarten et, au sein de l’entreprise identifiée comme « Critique du goût », comme les interlocuteurs privilégiés d’Emmanuel Kant. Sous cet angle, le corpus britannique a été saisi au prisme d’un débat sur la règle du goût, devenu celui de la norme du goût, débat qu’il a assurément contribué à forger, mais dont les termes et les principes sont indissociables, chez ces auteurs, de méthodologies et de cosmologies originales. Laissant hors de sa focale la Critique de la faculté de juger de Kant, Laurent Jaffro prend le parti de les lire par eux-mêmes. Il montre comment, en terre britannique, le projet d’une science de la nature humaine qui revendique une méthodologie expérimentale (lockéenne ou newtonienne), est le berceau de philosophies de l’art diversement fécondes. La théorie du goût n’y est pas toujours primordiale. Elle peut y être subordonnée ou combinée, comme c’est le cas chez James Harris, à une théorie de la production artistique, une poïétique en lien avec la pratique de l’art, que ce soit par la description ou la prescription[1].
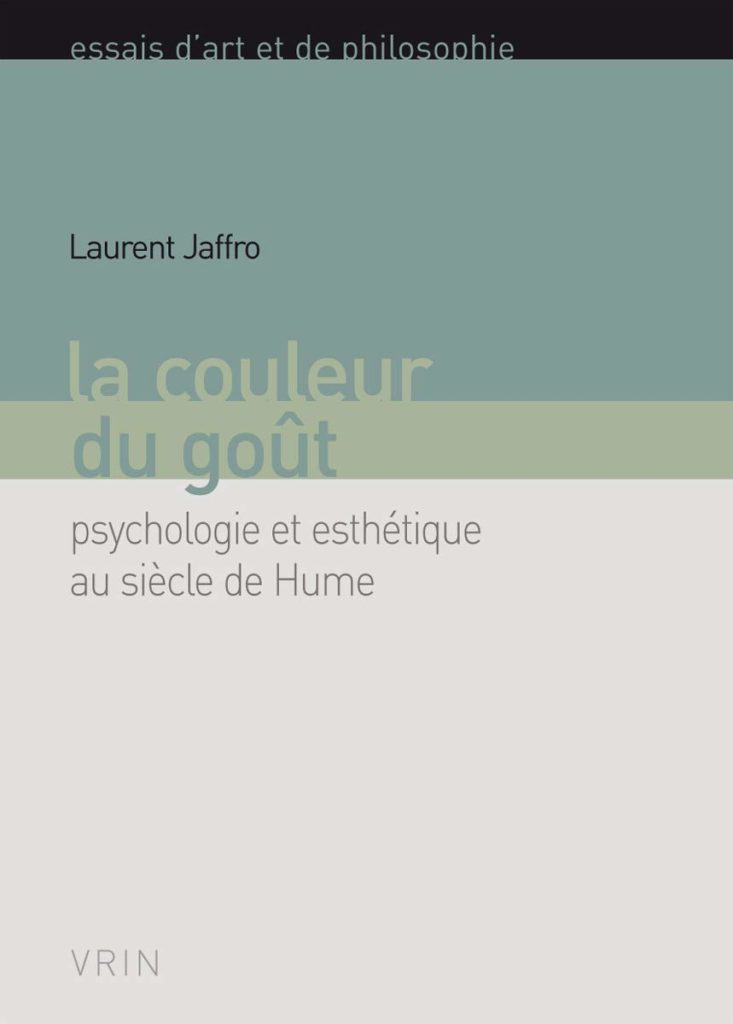 Mais l’intérêt de l’ouvrage de Laurent Jaffro n’est pas uniquement historique. Sa contribution à l’esthétique consiste à présenter différentes voies échappant à un subjectivisme total d’un côté, et à ce que l’auteur nomme un réalisme « outré » d’un autre côté. En effet, afin de défendre la possibilité que le jugement esthétique soit vrai ou faux, le réalisme esthétique contemporain a analysé les conditions épistémologiques dans lesquelles les propriétés esthétiques peuvent être dîtes « réelles » sur le modèle de ce qui vaut pour les « propriétés extrinsèques réelles » (R. Pouivet, 2006, et E. Zemach, 2005). Un tel réalisme fait valoir qu’une clé a la propriété extrinsèque d’ouvrir une serrure, propriété qui ne saurait être attribuée à la seule serrure et ne dépend pas même de la réalité de la seule serrure car elle est bien une propriété de la clé. La beauté pourrait être, de la même manière, une propriété réelle de l’œuvre qui dépend de la réponse adéquate d’un sujet esthétique, sans être pour autant une propriété subjective. Dans sa forme « outrée », telle que conçue par Laurent Jaffro, ce réalisme esthétique s’accompagne d’un fort cognitivisme. À l’inverse, une version radicale, antiréaliste, de la thèse qui réduit la beauté au seul plaisir subjectif rend compréhensible la diversité des goûts, sans postuler de réponses « adéquates », idéalement expertes. Mais elle doit faire face au problème de la « règle du goût », dont la formulation est apparue dans l’essai de Hume intitulé « Of the Standard of Taste », c’est-à-dire la question de savoir comment « réconcilier » ou tout au moins « hiérarchiser » des goûts différents face à une même œuvre.
Mais l’intérêt de l’ouvrage de Laurent Jaffro n’est pas uniquement historique. Sa contribution à l’esthétique consiste à présenter différentes voies échappant à un subjectivisme total d’un côté, et à ce que l’auteur nomme un réalisme « outré » d’un autre côté. En effet, afin de défendre la possibilité que le jugement esthétique soit vrai ou faux, le réalisme esthétique contemporain a analysé les conditions épistémologiques dans lesquelles les propriétés esthétiques peuvent être dîtes « réelles » sur le modèle de ce qui vaut pour les « propriétés extrinsèques réelles » (R. Pouivet, 2006, et E. Zemach, 2005). Un tel réalisme fait valoir qu’une clé a la propriété extrinsèque d’ouvrir une serrure, propriété qui ne saurait être attribuée à la seule serrure et ne dépend pas même de la réalité de la seule serrure car elle est bien une propriété de la clé. La beauté pourrait être, de la même manière, une propriété réelle de l’œuvre qui dépend de la réponse adéquate d’un sujet esthétique, sans être pour autant une propriété subjective. Dans sa forme « outrée », telle que conçue par Laurent Jaffro, ce réalisme esthétique s’accompagne d’un fort cognitivisme. À l’inverse, une version radicale, antiréaliste, de la thèse qui réduit la beauté au seul plaisir subjectif rend compréhensible la diversité des goûts, sans postuler de réponses « adéquates », idéalement expertes. Mais elle doit faire face au problème de la « règle du goût », dont la formulation est apparue dans l’essai de Hume intitulé « Of the Standard of Taste », c’est-à-dire la question de savoir comment « réconcilier » ou tout au moins « hiérarchiser » des goûts différents face à une même œuvre.
Pour retracer les voies esthétiques qui échappent, chez les Lumières britanniques, à cette opposition tranchée entre réalisme et subjectivisme, Laurent Jaffro prête une attention particulière à l’analogie entre le goût pour la beauté et la vision de la couleur – c’est-à-dire la perception d’une qualité seconde. Ainsi, l’analogie entre le goût esthétique et le goût gustatif, que Hume a fameusement illustrée par l’anecdote du tonneau de vin goûté empruntée au Don Quichotte, n’est pas négligée[2] mais est inscrite dans un cadre plus général où, afin de dresser le tableau des enjeux de l’esthétique des Lumières qui résonnent encore dans les débats contemporains, un autre fil rouge est suivi, qui donne son titre à l’ouvrage. L’enjeu de l’analogie entre le goût pour la beauté et la perception de la couleur, en effet, est plus directement lié au rapport entre perception et représentation. Elle a des significations opposées lorsqu’elle est prise dans l’alternative où le réalisme est associé avec un cognitivisme et un objectivisme contre le subjectivisme sentimentaliste et relativiste. Si la beauté est une qualité seconde, elle peut être identifiée à la disposition, voire à la base dispositionnelle, qui cause l’appréciation esthétique. L’analogie a alors une portée réaliste. Elle prend une signification contraire si toutes les qualités secondes se réduisent en fait à leurs idées, comme le disait Pierre Bayle, car alors la beauté n’est rien qu’une apparence ou une sensation subjective.
Ainsi la portée des analyses de Laurent Jaffro est souvent double, en esthétique et en histoire de la philosophie. On en trouvera un autre exemple frappant dans le préambule apparemment historique. Y sont retracées les origines néo-platoniciennes du parallèle entre le sentiment de beauté et la sensation visuelle, que les Lumières vont exploiter diversement. La mise au point est précieuse, là encore, à un double titre. D’une part, Laurent Jaffro montre comment chez Henry More, au XVIIe siècle, l’analogie avait une signification réaliste complètement différente du « réalisme outré » parce que dans l’expérience du Beau la vision de l’âme qui la réjouit est une manière de s’unir au Bien et au Bon (EnchiridiumEthicum, 1667). Le sens du feeling était alors haptique et expérientiel, plutôt qu’il ne s’identifiait à une perception ou une représentation. D’autre part, cette précision lui permet de poser les bases d’une suggestion qu’il fait plus loin lorsque, après avoir critiqué le « réalisme outré », il indique que ceux qui défendent la réalité des propriétés esthétiques au titre de propriétés « réponse-dépendantes » pourraient s’inspirer de cette tradition platonicienne où le beau se définit comme objet d’amour, pour « substituer au modèle perceptuel un modèle affectif » (La couleur du goût, p. 171). Dans cette version amendée du réalisme esthétique, la réalité de la propriété esthétique, réalité d’une valeur, ne peut manquer d’être « détectée » par l’émotion parce qu’elle est la réalité d’un « objet intentionnel de l’émotion » (Ibid., p. 171). Il n’appartient pas à l’ouvrage de développer ce point mais il esquisse ici de futures directions de recherche.
Sur le nuancier des visions du monde chez les Lumières britanniques
Le corpus étudié est quant à lui délimité par la référence à un prisme scientifique commun. Tous les auteurs partagent en effet la conviction que les recherches sur le goût relèvent d’une psychologie entendue au sens d’une étude « des opérations mentales ». Il faut expliquer le goût par la science de l’esprit qui, pour étudier toute opération mentale, s’inspire de la physique expérimentale, c’est-à-dire de la science de Boyle, Locke ou Newton. Néanmoins, dès l’introduction, Jaffro signale que cette commune référence ne saurait masquer une divergence importante dans les conceptions du monde auxquelles la source newtonienne peut mener. D’un côté, une image newtonienne du monde fera du plaisir esthétique une interaction entre les objets auxquels nous attribuons des qualités et nous, qui les sentons. Dans ce cas, une analogie entre les qualités esthétiques et les qualités secondes supposera que toutes résultent du rapport entre la structure interne des objets et la nature des hommes qui les rencontrent. Mais une conception rivale, tout aussi inspirée de la physique moderne, arguera que les lois scientifiques de l’univers sont la preuve d’une harmonie cosmique providentielle, de sorte que le plaisir du goût consistera à apprécier la perfection d’une chose ou d’une œuvre. La première approche, interactionniste, est celle de Joseph Addison (1672-1719) et de David Hume(1711-1776). Elle peut ouvrir la voie à une analogie entre le goût et un sens compris comme dispositif sensoriel. Elle a donc des versions sceptiques (qui n’attendent de l’interaction aucun savoir sur les choses) et empiristes (pour qui l’interaction est l’effet des qualités structurelles des choses). La seconde approche, platonicienne, voit dans le goût un amour pour la beauté, cette dernière se faisant sensible lorsque l’esprit informe la matière. C’est celle de Lord Shaftesbury (1671-1713), son neveu James Harris (1709-1780) et Thomas Reid (1710-1796).
Sur le nuancier de ces visions du monde, Laurent Jaffro commence par présenter deux pensées situées chacune à une extrémité du spectre. La teinte est clairement subjectiviste du côté de Addison, pour qui les « plaisirs de l’imagination », propres au spectateur, « colorent » d’un charme apparent ou d’une illusion plaisante (cela revient au même chez lui), un univers dépourvu en lui-même de valeurs et de signification (La couleur du goût, p. 50). Chez Shaftesbury au contraire, le goût est une faculté de l’artiste à saisir la perfection et la vérité morale des maîtres et une disposition à produire une œuvre dont l’harmonie est belle parce que bonne, au sens où elle est conforme à la téléologie inhérente à la création divine. Le goût, selon Shaftesbury, suppose d’ailleurs non seulement de se plaire aux belles formes mais de savoir pourquoi elles nous plaisent. Ainsi, les pensées de Addison et Shaftesbury indiquent deux directions fondamentales à partir desquelles le lecteur pourra situer, sur le nuancier des Lumières britanniques, les modifications de ces visions du monde.
Or, c’est de Addison que, contre toute attente, Laurent Jaffro rapproche Francis Hutcheson (1672-1719) quand il s’agit de caractériser son réalisme. Addison appliquait au goût une forme d’agnosticisme lockéen, concernant l’essence de l’esprit qui se plaît à la beauté, comme à l’égard des qualités des objets qui paraissent plaisants. Il y a un « je-ne-sais-quoi » dans l’objet qui cause ce plaisir. Or c’est une vision lockéenne du monde qui est à l’œuvre chez Hutcheson. En effet, là où Shaftesbury n’aurait jamais vu en l’amour et l’admiration les analogues d’un sens externe, Hutcheson affirme que le goût est, comme les facultés sensorielles, un pouvoir perceptif. Laurent Jaffro montre en outre que la notion de désintéressement est chez lui indissociable de la thèse selon laquelle nous n’avons pas besoin de savoir pourquoi une chose nous plaît pour qu’elle nous plaise. Contrairement à Shaftesbury, Hutcheson prend donc grand soin de dire que, psychologiquement, l’appréciation esthétique n’a aucunement pour condition la connaissance de ce qui le suscite. L’analogie avec les idées sensibles, causées par des qualités objectives, trouve ici sa place :
Le nom de beauté, comme celui des autres idées sensibles, désigne proprement la perception d’un esprit ; de même que les mots de chaud, froid, doux, amer, désignent les sensations dans nos esprits, auxquels les objets qui excitent ces idées en nous ne ressemblent peut-être aucunement, quoiqu’on s’imagine généralement le contraire. Les idées de beauté et d’harmonie, étant excitées par la perception de quelque qualité première et ayant rapport à la figure et au temps, peuvent en fait avoir une plus grande ressemblance aux objets que ces sensations qui ne paraissent pas tant être des images des objets que des modifications de l’esprit qui les perçoit ; et pourtant s’il existant aucun esprit possédant un sens de la beauté pour contempler ces objets, je ne vois pas comment on pourrait les dire beaux (Hutcheson, Recherche sur l’origine de nos idées de la beauté et de la vertu, I.i.16, p. 60, 2eme éd. de la tr. fr. modifiée par L. Jaffro, 2015, p. 69-70).
Sans pouvoir résumer le commentaire qui en est donné, citons la leçon qui en tirée : l’idée de beauté est « comme une idée sensible » dans la mesure où elle ne nous fait pas connaître une beauté objective qui existerait indépendamment de l’idée, mais « elle donne à penser, ou sans doute plus exactement à sentir, quelque chose de la structure des choses et du monde » (La couleur du goût, p. 78). Laurent Jaffro rectifie donc la lecture qui associe communément Shaftesbury et Hutcheson. Chez ce dernier, le sens de la perfection ne suppose pas un monisme ontologique identifiant le beau au bien ; la corrélation entre nos dispositions psychologiques et les dispositions objectives des objets est seulement contingente car elle est l’institution volontaire du créateur.
Vient alors la question de savoir comment situer Hume par rapport à Hutcheson. Tous deux adoptent une voie résolument psychologique mais Laurent Jaffro souligne combien la solution de Hume au problème de la règle du goût indiqué plus haut prête attention à la composition artistique. Car un même goût peut être plus ou moins délicat, c’est-à-dire savoir plus ou moins repérer dans une composition (un mélange) la qualité qui déclenche le plaisir esthétique. Et c’est la raison pour laquelle Hume pense que rien ne vaut la pratique d’un art pour affiner la délicatesse du goût. La capacité que nomme la « délicatesse du goût » n’est pas la connaissance d’une perfection ou d’une forme estimable par elle-même (comme Shaftesbury le pensait) mais un point de vue de l’imagination qui dégage un trait régulier de la composition.
Quelle teinte cette solution donne-elle à Hume sur le spectre esthétique des Lumières britanniques ? D’après Laurent Jaffro cette distinction entre bon goût (capacité évaluative) et délicatesse de goût (capacité de l’imagination) permet à Hume de proposer une solution qui est à la fois subjectiviste et non relativiste. Son interprétation se sépare donc de celle qui pense l’esthétique de Hume sur le modèle de Hutcheson (celle de Norman Kemp Smith), comme du projectivisme de P. J. Kail. Elle revient à une lecture subjectiviste, malgré la présence, dans « De la règle du goût », de formules hutchesoniennes frappantes. Il lui faut donc rendre raison de ce vocabulaire hutchesonien. Et c’est ce qu’elle fait en interprétant les « formes et qualités » qui suscitent le goût comme « les caractéristiques de la construction de l’objet ». L’artiste suit des principes d’association (au sens rigoureux de l’association des idées) ou se conforme à des règles (régularités) qui définissent un genre ou un style. Et ainsi, la philosophie de l’esprit naturaliste de Hume, qui pense les régularités comme des généralitésappréhendées par la nature humaine, vient à l’appui d’un non-relativisme : les caractéristiques de l’objets discernées par la délicatesse ne sont pas relatives à l’individu qui les goûte.
Il y a donc, selon Laurent Jaffro, un « réalisme humien » mais ce n’est « pas un réalisme de la valeur esthétique » puisque la beauté évaluée par le plaisir reste subjective (Ibid., p. 129). Plus loin encore, il dira que Hume souscrit « en métaphysique » à un subjectivisme fort (et donc que la beauté se réduit au plaisir) mais que la phénoménologie humienne du jugement esthétique tient compte d’une correction contrefactuelle. Selon le commentateur en effet, la description humienne de ce que nous voulons dire quand nous portons un jugement esthétique est bien rendue par une version du subjectivisme modéré : « lorsque je reconnais que O est beau, j’affirme non seulement que O me plaît mais que O devrait plaire à tout autre être humain » (Ibid., p. 132).
En contraste avec les approches psychologiques de Hume et Hutcheson, Jaffro étudie ensuite un tandem philotechnique : les Three Treatises publiés par James Harris en 1744 et l’essai « De la nature de l’imitation dans les arts qu’on appelle imitatifs » de Adam Smith (1723-1790). Harris considère uniquement le plaisir esthétique à partir de considérations sur la définition de l’art et la spécification de ses œuvres. Il définit l’art comme un pouvoir propre à l’homme de se faire cause « intentionnelle et habituelle » d’un changement dans la nature. Ainsi, l’objet de l’art est la nature (par définition contingente, susceptible de changement) et sa cause finale est un bien « qui n’est pas donné naturellement » : l’utilité ou l’élégance de la production (Ibid., p. 112). Or cette production peut être soit œuvre (work), soit énergie (energy). Le plaisir est alors l’effet de la production. Lorsque la production est une œuvre (work), le plaisir est contemplatif. Lorsque la production est une réalisation en train de se faire, comme dans la danse, la musique ou la poésie, le plaisir est actif, de sorte que le plaisir esthétique suppose de faire l’expérience de la production. Pour une telle pensée de la performance, comme le montre Laurent Jaffro, la notion d’imitation devient problématique : Harris a « perçu que les arts de la performance (…) son bridés et malhabiles tant qu’ils sont subordonnés à l’imitation » (Ibid., p. 116).
Les analyses de Smith raffinent sous un autre biais la notion d’imitation. Elles sont là encore philotechniques parce qu’elles donnent « priorité aux considérations sur la structure des productions de l’art » (Ibid., p. 128). L’intérêt de son essai sur l’imitation est notamment de montrer que le caractère « admirable » de l’art tient à la façon dont il surmonte les difficultés de l’imitation qui tiennent à la disparité entre la représentation et le représenté. Par exemple, la difficulté de la peinture d’histoire est que le tableau est instantané[3] ; celle de la sculpture est qu’elle se fait sans couleur.
Enfin, à côté du réalisme causal d’un Hutcheson et à côté de l’attention philotechnique centrée sur l’objet, Laurent Jaffro envisage d’autres nuances réalistes, relevant d’une tout autre teinte.
Pour un réalisme chamarré
Les chapitres 4 et 5 sont consacrés à deux auteurs qu’il considère comme les représentants d’un réalisme esthétique « gradualiste » et « contextuel », Thomas Reid et Alexander Gerard. Il établit que le premier défend un réalisme de « pedigree » (sic) shaftesburien. Quant au second, mal connu du public français, il est comme Hume et Smith intéressé par les propriétés objectives que sont les régularités de composition repérées par l’imagination ; mais Gerard, comme Reid, soutient que le goût comprend à la fois un jugement et un plaisir.
Nous nous bornerons à reprendre ici les ressources essentielles que Jaffro trouve chez Reid, et renverrons le lecteur à l’ouvrage lui-même pour découvrir comment la pensée de Gerard rend à la fois raison de la justesse du goût et de ses variations culturelles.
C’est en analysant et en défendant la théorie reidienne du goût que Laurent Jaffro déploie toute sa critique du réalisme esthétique des « nouveaux reidiens », car ils l’ont, selon lui, réduit à une théorie de la propriété extrinsèque réelle. La critique, serrée, ne saurait être reprise ici dans ses détails. Elle fait valoir que la réponse du sujet esthétique est ni toujours épistémique ni toujours infaillible. Jaffro pense que la théorie de Reid en tient parfaitement compte, puisque ce dernier accepte la possibilité d’un goût animal aussi bien que rationnel. Le goût animal se laisse décrire dans une « version très modérée du réalisme causal, indiscernable d’un subjectivisme symétriquement modéré » : c’est un plaisir qui fait dire que x a des qualités esthétiques (nommées « excellence ») qui causent ce plaisir, même si on ne les connaît pas. Ces qualités sont donc descriptibles en analogie avec les qualités secondes. Mais lorsque le goût est plus rationnel, il dépend d’une croyance épistémiquement robuste. Reid pense en effet que le goût est composé par la croyance en une « excellence » de l’objet (par quoi il faut entendre toutes les propriétés structurelles et fonctionnelles de l’objet) et un plaisir qui est produit dans le sujet à l’occasion de cette croyance. Jaffro souligne que le sujet n’a pas nécessairement à connaître cette qualité. C’est pourquoi l’analogie entre les qualités secondes et les valeurs esthétiques peut valoir, dans le cas d’un goût « ignorant » (p. 136), ce qui, d’ailleurs peut ouvrir à différentes thèses sur la signification de l’affirmation x est beau. Quand je dis « x est beau », je peux vouloir dire :
- x a certaines qualités susceptibles d’occasionner (de causer) un plaisir. Bref, x a des qualités qui causent le plaisir. C’est un sens hutchesonien.
- x produit habituellement ou actuellement un plaisir tel que les qualités (appelées « excellence ») en produisent.
- x possède certaines qualités telles que celles qui tendent à produire ce plaisir. En d’autres termes, x est excellent et il peut susciter du plaisir mais ce n’est pas le plaisir qui est essentiel.
Laurent Jaffro soutient qu’il n’y a aucune raison d’écarter par principe ces nuances sémantiques, car elles peuvent toutes parfaitement être pertinentes selon le contexte. En conséquence, tout l’intérêt de la théorie à deux composantes de Reid est de fournir une phénoménologie du jugement de goût contextuelle, qui admet que la signification se concentre plus ou moins sur les propriétés de l’objet et plus ou moins sur le plaisir.
La conclusion qu’il en tire relève pleinement de l’esthétique et non de son histoire : « le degré auquel la prétention à l’objectivité prime (ou non) sur l’acceptation de la subjectivité du plaisir esthétique est variable et doit être déterminé de façon phénoménologique et non théorique » (Ibid., p. 152). C’est dire que la phénoménologie du jugement esthétique doit n’embrasser ni réalisme exclusif ni subjectivisme absolu, mais se donner – comme Reid – les moyens conceptuels de décrire les nuances possibles du jugement de goût.
De La couleur du goût, on en discute
Parce que les analyses de Jaffro sont acérées et engagées, elles sont propres à susciter de nombreuses questions et discussions, dont nous ne retiendrons que les suivantes. D’abord, on pourrait avoir besoin de poursuivre l’élucidation des significations des adjectifs « objectif », « réel » et « factuel », appliqués aux propriétés qui sont le corrélat du goût dans l’objet. Il n’est pas sûr, par ailleurs, qu’elles se recouvrent parfaitement. On pourrait se demander par exemple en quel sens les traits de compositions, chez Hume, sont « objectifs » puisque ce sont des régularités établies par l’imagination – et ce, que l’on soutienne un projectivisme (par où l’esprit les attribue à l’objet) ou un subjectivisme (où l’esprit construit l’objet au travers elles). « Réel » peut s’entendre en deux sens : au sens où elles existent indépendamment de toute représentation, ou bien au sens où elles appartiennent à ce que nous nous représentons comme réel. En outre, lorsque Jaffro parle d’un « réalisme de Hume », c’est une forme de concession à un label qui est peut-être mal adapté à Hume. La portée de la correction contrefactuelle des sentiments vient complexifier ce point. La correction contrefactuelle permet-elle de découvrir la valeur « réelle » des choses ? Smith dira, dans la Théorie des sentiments moraux, que Laurent Jaffro n’exploite pas ici, qu’elle fait percevoir la grandeur ou la petitesse « réelle ». Chez Hume au contraire, si, comme il le souligne, elle n’a qu’un rôle psychologique et phénoménale, elle ne saurait permettre d’accéder à la beauté réelle.
D’autres discussions pourront s’engager sur le terrain de l’interprétation historique. On pourra, par exemple, se demander si l’insistance novatrice mise sur la distinction entre Shaftesbury et Hutcheson ne doit pas tolérer, aussi, une attention à la proximité que Hutcheson reconnaît entre le sens moral et le goût, entre les idées de vertu et celles beauté, proximité qu’on ne retrouve pas chez Addison.
Des questions à la croisée de l’exégèse et de l’esthétique pourront toucher à la notion humienne de délicatesse du goût et à la séparation qu’elle suppose, selon Laurent Jaffro, entre l’appréhension factuelle (cognitive) et l’évaluation normative (affective). Indiquons seulement une objection possible à la dichotomie faits/valeurs dans ce contexte : être ordonné c’est toujours être plus ou moins bien ordonné. Si, chez Hume, la composition d’une œuvre est un « degré de qualité » et que cette qualité est toujours déjà évaluative, peut-être faut-il déjà avoir du bon goût, pour détecter un (bon) ordre[4].
Enfin, concernant le corpus, et tout en soulignant que l’étude de Laurent Jaffro ne se prétendait pas exhaustive et que sa sélection fait son intérêt, on pourra s’interroger sur la quasi-absence de la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith, peut-être la « missing shade of blue » du nuancier présenté par Laurent Jaffro. Smith emploie une notion de nicety fort proche de la delicacy humienne dans la troisième partie (III. 8), et discute d’autres thèses humiennes dans la quatrième partie de cette œuvre résolument psychologique, dont l’approche est donc fort différente de l’étude philotechnique analysée par Jaffro ici. On peut aussi noter que la place périphérique de Burke, compréhensible à l’aune du fil rouge qu’est l’analogie avec la couleur, appelle à mesurer sa distance à l’égard du projet délimité par cette étude puisque la science du plaisir et de la terreur que Burke déploie s’appuie sur les recherches de Locke, mais sur un plan plus affectif et avec des enjeux sans doute moins métaphysiques que politiques.
En somme, en raison des distinctions qu’il établit et des outils conceptuels qu’il procure, en raison des interprétations novatrices qu’il propose et des questions qu’il soulève, pour les prolongements et les discussions qu’il appelle, La couleur du goût est un livre de référence, lumineux et passionnant, pour le plus grand profit d’un public d’étudiants comme des historiens des Lumières et des philosophes de l’art.
[1] Un exemple de prescription est donné par Laurent Jaffro lorsqu’il mentionne les consignes données par Shaftesbury intitulées Notion du Jugement d’Hercule en 1712.
[2] L’analogie est néanmoins commentée dès son apparition chez Addison, qui fait lui-même référence à Baltasar Gracián (La couleur du goût, p. 32-33).
[3] Harris disait que le tableau est un « punctum temporis or instant ». Shaftesbury y avait vu le problème suivant : soit la peinture concurrence la poésie et elle se fait narrative, soit elle doit abandonner toute narration – Voir Laurent Jaffro, « Le choix d’Hercule : le problème artistique de l’expression du moral dans la tradition shaftesburienne », DoisPontos, 11, 1, 2014, p. 39-65 et 205-211 et La couleur du goût, p. 119.
[4] Que l’ordre soit un degré de qualité est un point souligné, par exemple, par Michel Malherbe dans son introduction au Dialogue sur la religion naturelle.














