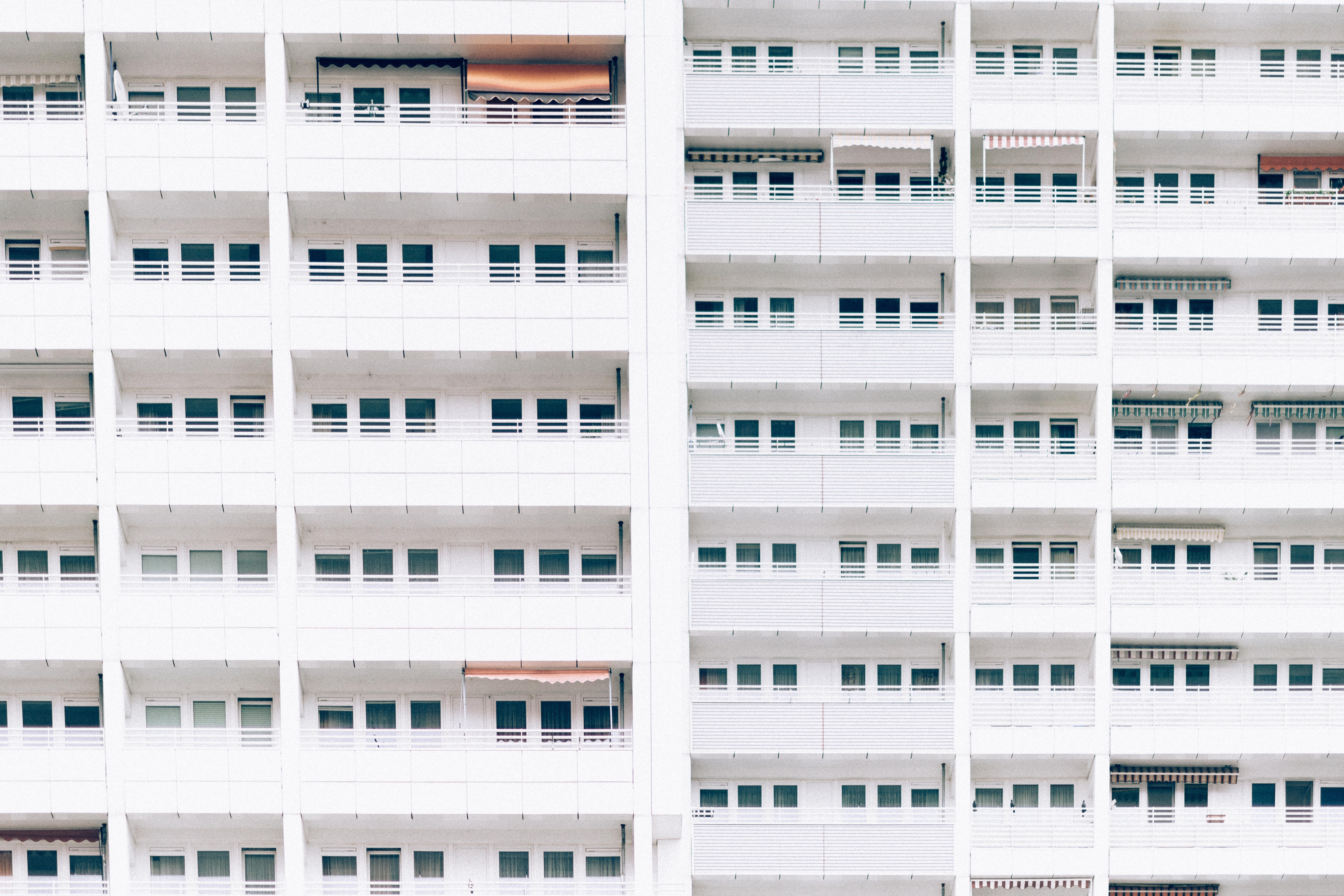Emotions et « communauté des êtres raisonnables »
Quand les émotions révèlent les contours de la « communauté des êtres raisonnables »
Enquête dans une unité psychiatrique de réhabilitation
Audrey LINDER, Doctorante en sociologie, Laboratoire Théorie sociale, Enquête critique, Médiations, Action publique (THEMA). Université de Lausanne. Adjointe scientifique, Unité de Recherche en Santé, Haute École de Santé Vaud (HESAV), Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).
Résumé
Cet article propose une analyse des façons dont le fait de ressentir ou non une émotion, de l’exprimer, mais aussi de justifier ce ressenti ou son absence, modifie les contours d’une communauté concrète – en l’occurrence une communauté de patients en psychiatrie – ou symbolique, à savoir la communauté des êtres raisonnables. L’analyse s’appuie sur des données d’observations dans une unité psychiatrique de réhabilitation suite à l’annonce du suicide de l’un des patients.
Mots-clés : psychiatrie, communauté, collectif, émotions, altérité
Abstract
This article proposes an analysis of the ways in which feeling an emotion or not, expressing it, but also justifying this feeling or its absence, modifies the contours of a real community – in this case a community of patients in psychiatry – or a symbolic community, namely the community of reasonable beings. The analysis is based on observation data from a psychiatric rehabilitation unit following the announcement of the suicide of one of the patients.
Keywords: psychiatry, community, collective, emotions, otherness
Ma gratitude va à Laurence Kaufmann, Thomas Jammet et Kim Lê Van pour les échanges et relectures qui ont contribué à donner à cet article sa forme finale. Je remercie également les soignants et patients de l’unité psychiatrique de réhabilitation qui m’ont accueillie et ont partagé leur quotidien avec moi pendant deux ans.
I. Introduction
En se saisissant des émotions comme objet d’étude, la sociologie a largement démontré que celles-ci sont loin d’être individuelles, spontanées, privées, mais qu’au contraire elles répondent à des logiques sociales et morales[1]. Ce sont les circonstances qui permettent « une application pertinente de concepts d’émotions particulières », ce faisant le lien entre une situation et une émotion est un lien logique, comme l’affirme Paperman, et non psychologique[2]. De plus, l’individu ne se contente pas de gérer l’expression de ses émotions pour qu’elles soient conformes à la définition de la situation sociale, il entreprend également un travail pour essayer de ressentir l’émotion appropriée à la situation, tel que le fait d’être heureux lors d’une fête ou triste lors de funérailles, ce que Hochschild a nommé le « travail des émotions » (emotion work)[3]. L’individu s’engage alors dans une activité permanente qui consiste à « contrôler l’écart entre ce qu’il ressent (“vraiment”) et ce qu’il devrait “normalement” ressentir au vu de la définition “officielle” de la situation »[4]. Ce travail est d’autant plus important que l’expression de certaines émotions « rend publique l’adoption d’un point de vue évaluatif comme appréciation pertinente d’une situation »[5]. Il en découle que le fait de ne pas exprimer l’émotion qui est socialement attendue ou, à l’inverse, d’exprimer une émotion alors qu’elle est socialement incongrue peut non seulement être vécu comme une offense sociale, mais encore contribuer à redessiner les contours de la « communauté des êtres raisonnables »[6] en en excluant celui qui n’a pas su montrer l’émotion appropriée et qui ne peut pas en donner une explication convaincante. Dans les termes de Paperman, le fait de ressentir soi-même ou d’attribuer à une tierce personne une émotion qui est inadaptée aux circonstances « conduit (…) à mettre en doute la rationalité de la personne (ou son équilibre mental) »[7].
 Je me propose d’adopter la démarche de Paperman[8], pour qui l’étude des situations de perception sociale des émotions constitue un levier pour interroger les notions de rationalité, de morale et de justice. Il s’agit plus précisément de situations dans lesquelles les émotions et les sentiments « se donnent à l’attention et deviennent remarquables par leur absence, ou par leur perception comme des conduites irrationnelles »[9]. Je m’attache à décrire les liens qui existent entre la perception sociale des émotions au sein d’une communauté et la (re)définition des contours de celle-ci. Pour ce faire, je me concentre sur une communauté de patients pris en charge dans une unité psychiatrique et sur un événement particulier, à savoir le suicide de l’un des patients de l’unité. J’analyse la façon dont le fait de ressentir ou non une émotion suite à l’annonce du suicide, de l’exprimer, mais aussi de justifier ce ressenti ou son absence, modifie à la fois les contours de la communauté des patients, mais aussi ceux de la « communauté des êtres raisonnables ».
Je me propose d’adopter la démarche de Paperman[8], pour qui l’étude des situations de perception sociale des émotions constitue un levier pour interroger les notions de rationalité, de morale et de justice. Il s’agit plus précisément de situations dans lesquelles les émotions et les sentiments « se donnent à l’attention et deviennent remarquables par leur absence, ou par leur perception comme des conduites irrationnelles »[9]. Je m’attache à décrire les liens qui existent entre la perception sociale des émotions au sein d’une communauté et la (re)définition des contours de celle-ci. Pour ce faire, je me concentre sur une communauté de patients pris en charge dans une unité psychiatrique et sur un événement particulier, à savoir le suicide de l’un des patients de l’unité. J’analyse la façon dont le fait de ressentir ou non une émotion suite à l’annonce du suicide, de l’exprimer, mais aussi de justifier ce ressenti ou son absence, modifie à la fois les contours de la communauté des patients, mais aussi ceux de la « communauté des êtres raisonnables ».
Les données mobilisées dans cet article ont été récoltées au cours d’une observation participante de deux ans (2013-2015) dans une unité psychiatrique de réhabilitation en Suisse romande, ainsi qu’au travers d’entretiens avec quinze anciens patients de l’unité (2016-2018). Au moment de l’observation, l’unité accueille une trentaine de patients, sortis de la phase aiguë de la maladie et engagés dans un processus de réinsertion. L’équipe soignante est composée de six infirmiers, d’un psychiatre et d’une psychologue, tous deux également psychothérapeutes. La prise en charge s’articule autour du fait de retrouver un logement et/ou de réapprendre à y vivre de manière autonome, ainsi que de retourner à une activité professionnelle ou occupationnelle. L’organisation de l’unité est de type communautaire, les patients comme les infirmiers effectuant chaque jour, ensemble, les tâches nécessaires au fonctionnement de l’unité (achat des denrées alimentaires, préparation des repas, etc.). Chaque mardi, pendant une heure, a lieu le « grand colloque », qui rassemble l’ensemble de l’équipe soignante (infirmiers et psychothérapeutes) et les patients afin de discuter de la vie en communauté et des problèmes que celle-ci soulève. Je développe mon propos à partir d’un événement particulier, soit l’annonce du suicide de l’un des patients (Monsieur A.) lors d’un « grand colloque ».
Il faut encore donner ici quelques précisions sur trois termes relativement proches employés dans cet article, à savoir ceux de groupe, de communauté et de collectif. Le terme de groupe renvoie au vocabulaire utilisé par les soignants de l’unité, et fait référence à la thérapie de groupe à laquelle une partie d’entre eux est formée. Ce terme est mobilisé uniquement lorsque je rapporte directement les propos des soignants. Le terme de communauté, comme le rappelle Stavo-Debauge[10], renvoie nominalement à « ce qui est fait ou est vécu en commun (…). Il ne fait rien d’autre (et c’est déjà beaucoup) que de ratifier le partage d’une situation ». Ce partage de la situation peut être concret, inscrit dans le hic et nunc de l’unité psychiatrique, ou davantage symbolique, comme dans la « communauté des êtres raisonnables » qui rassemble des personnes qui n’ont en commun que le fait d’être doués de raison mais qui ne s’inscrit pas forcément dans un temps et un espace communs. Enfin, le collectif est à entendre au sens fort du terme, au moment où les membres de la communauté ne se contentent plus de partager le hic et nunc de la vie quotidienne de la communauté, mais se sentent réellement appartenir à un « Nous » qui à la fois les rassemble et les dépasse[11].
II. Être affectés ensemble. Quand l’émotion renforce le sentiment d’appartenance
C’est par un appel téléphonique de la police que l’équipe soignante apprend que Monsieur A. s’est suicidé. Cette annonce constitue un choc pour l’équipe : Monsieur A. était en traitement dans l’unité depuis plusieurs années, il entretenait de bons liens avec les infirmiers et occupait une place importante dans la communauté de patients. L’équipe soignante s’organise à la fois pour prendre contact avec les parents de Monsieur A. et pour préparer l’annonce qui sera faite à l’ensemble des patients après le repas de midi. Elle passe notamment en revue la liste des patients de l’unité afin d’identifier ceux qui étaient particulièrement proches de Monsieur A. et risquent d’être grandement affectés, ainsi que ceux pour lesquels existe une inquiétude quant à leurs idées suicidaires. À la fin du repas, l’équipe soignante rassemble tous les patients de l’unité dans la salle commune et c’est Yvan, l’infirmier-chef, qui annonce la nouvelle :
Notes d’observation
Yvan dit qu’il a malheureusement une triste nouvelle à annoncer, et précise qu’il ne va pas tourner autour du pot : Monsieur A. est décédé. Au moment où il dit ça, un grand « Han ! » de stupéfaction collective parcourt le groupe de patients et me prend aux tripes. Trois patientes se mettent immédiatement à pleurer à chaudes larmes. Un patient demande à l’une des infirmières de répéter, un autre demande si Monsieur A. est à l’hôpital ou s’il est vraiment décédé. Une patiente, en pleurs, se lève en disant qu’elle aimerait qu’on allume des bougies pour Monsieur A. Elle va en chercher et les distribue pour que chacun en allume une. Les patients restent assis un long moment, dans un silence entrecoupé par les sanglots de certains d’entre eux. Puis Yvan explique que, pour sa part, il va rester un peu dans le groupe jusqu’au colloque[12], que l’équipe soignante est disponible s’ils ont besoin de parler, mais qu’ils ne sont pas obligés de rester là (personne n’a bougé de sa chaise depuis l’annonce). (…) Une partie de l’équipe soignante et moi nous rendons finalement dans la salle de réunion. Contrairement à nos habitudes, nous laissons la porte grande ouverte, pour être disponibles pour les patients, jusqu’à l’heure du grand colloque.
Le colloque est entièrement consacré à Monsieur A. Il y a beaucoup d’interrogations sur la question du suicide. Les patients rappellent plusieurs bons souvenirs qu’ils gardent de Monsieur A. et insistent sur la nécessité de « lui rendre hommage » au cours de ce colloque, notamment au travers d’une minute de silence. (…) L’équipe soignante demande qui était proche de Monsieur A. et de nombreux patients lèvent la main. Une patiente dit qu’il est « difficile de ne pas se sentir proche de quelqu’un lorsqu’on vit avec cette personne ». Yvan confirme que certains patients lui ont dit que « parfois, ça les touche davantage lorsque c’est quelqu’un de la communauté qui décède, que lorsque c’est quelqu’un de leur propre famille ». (…) Il explique que ce type de situation peut « réveiller leurs propres idées noires » et il rappelle qu’il est important d’en parler à l’équipe si c’est le cas.
À la fin du colloque, les patients remercient l’équipe pour ce moment de partage – chose rarissime dans la mesure où, généralement, ils n’apprécient pas ces « grands colloques » – et plusieurs d’entre eux restent encore un long moment ensemble dans la salle commune – alors qu’après le colloque ils sont libres de quitter l’unité et que, généralement, ils le font.
Comme l’a montré Kaufmann[13] à partir des travaux de Simmel[14], la constitution et la maintenance d’un collectif reposent « sur une logique triadique, celle de l’attention et de l’émotion conjointes »[15]. Dans le cas présent, la tristesse est une émotion conjointe qui porte sur un même objet de concernement, à savoir la perte de l’un des membres de la communauté. Ainsi, chacun vit cette émotion tout en percevant l’émotion de l’autre, ce qui fait que le partage de l’émotion se double de ce que Livet appelle une « émotion collective de partage »[16] et entraîne un alignement émotionnel du collectif[17]. Ainsi, dit Livet[18], les consignes données dans les rituels « ont (…) pour fonction de donner des repères de synchronisation pour les résonances émotionnelles ». Dans le cas présent, les rituels qui suivent l’annonce du décès de Monsieur A. (allumer des bougies, faire une minute de silence), mais également le fait que les patients et les soignants restent longtemps assis ensemble dans le silence ou partagent de bons souvenirs qu’ils ont en commun de Monsieur A., illustrent bien la façon dont une émotion conjointe vécue au sein d’un collectif tend à le renforcer.
Les patients de l’unité sont affectés à double titre par ce décès : à la fois parce que c’est un ami qui est mort (membre de la communauté concrète), mais aussi parce que c’est un membre de la communauté (symbolique) des personnes souffrant de troubles psychiques, un « comme Moi », qui se suicide. Or, ce constat ouvre nécessairement un questionnement sur la communauté de destin des personnes souffrant de troubles psychiques, puisque le suicide de l’un d’entre eux vient rappeler que, parfois, continuer à vivre avec la maladie n’est plus possible. Corrélativement, cela entraîne chez les soignants la crainte d’un risque de « contagion », suivant le principe que les idées suicidaires d’un patient peuvent se communiquer aux autres. Enfin, sur le plan institutionnel, l’émotion partagée contribue à dé-rigidifier momentanément les séparations spatiales entre soignants et patients. Alors que, pendant leur pause, les soignants se retirent habituellement dans la salle de réunion dont ils ferment la porte, ce jour-là seule une partie des soignants s’y rend et la porte reste ouverte, offrant une certaine perméabilité à des lieux qui sont d’ordinaire clairement séparés.
III. Ne pas se montrer affecté : de l’offense sociale à la justification
Nous l’avons vu, l’annonce du décès de Monsieur A. provoque une grande émotion chez les patients, qui est vécue collectivement. Pourtant, l’un d’entre eux, Monsieur B., manque de s’aligner sur l’état émotionnel collectif. Nouveau venu dans l’unité, il donne à voir puis fait savoir, au cours du « grand colloque », qu’il n’est pas affecté par ce décès :
Notes d’observation
Pendant le colloque, un colis adressé à Monsieur B. est déposé par le facteur. Monsieur B. se lève alors, va chercher son paquet, puis revient s’asseoir dans la salle où a lieu le colloque et le déballe bruyamment. Il est vivement pris à partie par les autres patients, qui lui font savoir que son comportement est inadmissible, qu’ils sont en train de « parler d’un copain qui est mort » et qu’il pourrait « montrer un peu plus de respect ». Monsieur B. réplique alors qu’il ne se sent pas du tout touché par cette mort, qu’il ne connaissait pas Monsieur A. et qu’il « s’en fiche ». Yvan lui répond que c’est son droit, mais qu’il n’a pas à perturber le colloque en faisant du bruit. Monsieur B. dit qu’il ne voulait pas couper la discussion, sur quoi Yvan rétorque que c’est pourtant ce qu’il a réussi à faire.
Pour Pharo[19], « l’accomplissement de l’action est (…) lié au moment ultérieur de la description ». Plus précisément,
C’est parce qu’il est de l’ordre de l’action sensée de pouvoir anticiper sur la description dans laquelle l’action sera prise et interrogée sur ses raisons (bonnes ou mauvaises), que l’action est contrainte à la fois moralement et cognitivement. Moralement, parce que la possibilité d’une description ultérieure rend l’action justifiable ou injustifiable, et donc responsable. Cognitivement, parce que les bases morales de la description à venir rendent impensable d’ignorer certains aspects de l’action en cours[20].
Dans cette optique, Monsieur B. ne peut pas ignorer la description morale ultérieure qui sera faite de son acte, à savoir un manque de respect à la fois à la personne qui est décédée, mais aussi aux membres de la communauté (concrète et symbolique) à laquelle appartenait cette personne.
L’interprétation du comportement de Monsieur B. par le reste des patients révèle que le fait de ne pas se montrer affecté constitue dans certains cas une offense sociale[21]. Ceux-ci expriment en commun une indignation partagée à destination de Monsieur B., une émotion qui « rappell[e], incarn[e] et manifest[e] la priorité de l’évaluation morale pour définir une situation sociale »[22]. Interpellé, Monsieur B. est contraint d’expliciter les raisons de son attitude. C’est par la non-appartenance à la communauté des patients que celui-ci justifie dans un premier temps le fait de ne pas ressentir l’émotion partagée, c’est-à-dire par son statut de nouvel arrivant, qui ne connaissait pas ou peu Monsieur A. Or, si cette auto-exclusion peut justifier le fait de ne pas ressentir l’émotion, elle ne peut excuser le fait de ne pas s’aligner sur l’état émotionnel collectif, ne serait-ce qu’a minima, c’est-à-dire en montrant de la sympathie pour ceux qui sont affectés par la perte et du respect face à leur chagrin. La réponse de l’infirmier-chef va dans ce sens, lorsqu’il explique à Monsieur B. qu’il a le droit de ne pas se sentir affecté mais pas de perturber le colloque.
Dans un précédent article[23], j’ai montré comment, face à des comportements problématiques de la part de personnes souffrant de troubles psychiques, la responsabilité de l’action peut être attribuée soit à la personne, avec comme conséquence de l’exclure de la communauté (concrète) des patients, soit à sa maladie, ce qui entraîne son exclusion au moins momentanée de la communauté (symbolique) des « êtres raisonnables ». Dans la justification initiale que donne Monsieur B. de son comportement, c’est la première option qui est retenue. Pourtant, au cours du « grand colloque » de la semaine suivante, cette absence d’émotion est réinterprétée à l’aune de la maladie :
Notes d’observation
Pendant le colloque, Yvan interpelle Monsieur B. et lui demande s’il n’a pas « quelque chose à dire au groupe ». Monsieur B. prend alors la parole pour s’excuser de son comportement de la semaine précédente, lors du « grand colloque » qui a suivi l’annonce du décès de Monsieur A. Il explique qu’il prend actuellement [un neuroleptique] qui le « shoote » et que, dès lors, même s’il est « capable intellectuellement » de répondre et d’avoir une conversation, « émotionnellement » il ne se rend « pas très bien compte des choses », et que c’est ce qui s’est passé la semaine précédente lorsqu’il a fait du bruit – « visiblement pendant une minute de silence mais je ne m’en souviens même pas ». Il conclut en présentant ses excuses aux autres patients. Yvan le remercie et dit qu’il est important que cette précision ait été faite pour le groupe.
Cet échange clôt ce que Goffman[24] nomme un « processus réparateur » qu’il décompose en quatre phases. La première phase est la sommation – qui consiste à signifier qu’un événement « par ce qu’il exprime, est incompatible avec les valeurs sociales défendues, et sur lequel il est difficile de fermer les yeux »[25], en l’occurrence le fait que Monsieur B. fait savoir qu’il n’est pas affecté par la mort de Monsieur A. À ce moment-là, Monsieur B. se trouve « ouvertement en déséquilibre, en disgrâce » et il est nécessaire qu’il rétablisse « un état rituel satisfaisant ». C’est alors qu’intervient la seconde phase du processus réparateur, à savoir l’offre « qui donne à un participant, généralement l’offenseur, une chance de réparer l’offense et de réétablir [sic] l’ordre expressif »[26]. Cette offre est faite par Yvan, lorsqu’il interpelle Monsieur B. pour lui demander s’il « n’a pas quelque chose à dire au groupe ». Ce dernier a alors, théoriquement, deux possibilités de réparation : soit « s’efforcer de montrer que le danger apparent n’était en fait qu’un événement insignifiant, ou un acte sans intention, ou une plaisanterie »[27], ce qui est pragmatiquement impossible dans le cas présent, soit « essayer de montrer que [l’offenseur] était sous une influence quelconque et hors de lui-même, ou qu’il agissait sous l’autorité et au profit de quelqu’un d’autre »[28]. C’est bien cette seconde option que saisit Monsieur B.
En reconnaissant sa faute et en présentant ses excuses, Monsieur B. exprime alors une forme de culpabilité, feinte ou réelle[29]. Cette dernière a été définie comme une « émotion morale » qui surgit en réponse à une autoréflexion (self-reflection) et une auto-évaluation (self-evaluation)[30]. Le sentiment de culpabilité est déclenché non seulement par la reconnaissance que l’on a causé du mal, mais plus encore parce que cette action néfaste menace sa relation avec les autres[31]. La culpabilité encourage donc des actions réparatrices telles que des aveux ou des excuses afin de restaurer ou d’améliorer les relations[32].
Enfin, les deux dernières phases de clôture du processus réparateur sont l’acceptation de l’explication et des excuses par les personnes offensées et enfin les remerciements de la part de l’un des offensés. Ici, l’acceptation est encore une fois portée par Yvan, qui remercie Monsieur B. pour ses explications, en en soulignant l’importance « pour le groupe ». L’acceptation et les remerciements renvoient donc à l’émotion du pardon[33] qui répond à celle de culpabilité exprimée par Monsieur B. et permet la réconciliation. De fait, le pardon est une émotion qui « réagit à la réparation des fautes » et qui « fonde un devoir de réintégration » en succédant à l’indignation ou au mépris[34]. Ainsi, l’offenseur qui s’excuse « doit être pardonné et réintégré dans le collectif »[35].
Au cours de cet échange réparateur, la nouvelle explication donnée par Monsieur B. à ses actes entraîne une « réattribution de responsabilité »[36]. Il passe ainsi d’une première justification qui lui fait conserver la responsabilité de son acte mais l’exclut, de fait, de la communauté de patients – il n’est pas concerné par le décès de Monsieur A. car il vient d’arriver et ne fait pas partie de cette communauté – à une attribution de responsabilité à sa maladie, ou plus précisément à sa médication. Le registre de justification se situe dès lors du côté de la non-appartenance (momentanée) à la « communauté des êtres raisonnables » – ceux qui sont capables d’émotions ou du moins d’un « travail des émotions » pour s’ajuster à la situation –, lui permettant de se réaffilier à la communauté formée par les patients de l’unité.
IV. L’absence d’affect comme construction d’une altérité radicale
Dans le cas de Monsieur B., le fait de ne pas être affecté par le suicide d’un patient et de le manifester l’oblige à se justifier. Le choix de la justification donnée a pour conséquence de l’exclure soit de la communauté (concrète) des patients, soit de la communauté (symbolique) des êtres raisonnables. Un an et demi après le suicide de Monsieur A., j’ai effectué un entretien avec une patiente sortie de l’unité depuis un an, Madame C. Celle-ci m’a rapporté les difficultés qu’elle rencontre quant au fait que sa famille se montre indifférente lorsque certains de ses amis – qui sont également des personnes souffrant de troubles psychiques et qui sont ou ont été soignés dans l’unité de réhabilitation – se suicident. Pourtant, il apparaît que l’absence d’émotions dont témoigne la famille de Madame C. a des conséquences très différentes de celles qu’a eu le manque d’affect de Monsieur B. :
Entretien
Madame C. : Y a des trucs durs, typiquement ma meilleure amie[37] […] s’est ouvert les veines la semaine passée pour la Xème fois. C’est dur, parce que, là aussi, quand on parle de ça à sa famille, eux quand ils perdent un ami, d’un cancer ou je sais pas quoi, c’est un drame pendant une semaine. Moi, maintenant, avec tout ce que j’ai eu, ils font plus cas parce que c’est tellement habituel. Et pis ça c’est difficile quoi. Parce que j’ai pas grand monde avec qui partager ça. […] À l’unité de réhabilitation je crois que y a eu huit suicides en six ans. Euh… ben c’est pas facile quoi ! Et pas des vieux, quoi ! Notamment [Monsieur A], vous l’avez connu ? Ouais c’est rude ça. Pis c’est chiant que ça devienne habituel. « Oh mais de toutes façons ils ont choisi leur style de vie tes amis ! »
Enquêtrice : C’est votre famille qui vous dit ça ?
Madame C. : Ouais ouais. C’est pas facile ça. Tout est hyper relativisé parce que c’est banal, entre guillemets, hein ! Ben pour moi c’est pas banal, pis c’est des trucs trash. Eux [ndlr : les membres de ma famille] ils voient les gens, les cancers, ok, ils les voient baisser, mais là, quand on a le colloque pis tout à coup y a un truc comme ça ben merci la baffe !
Dans les propos de Madame C., l’on peut distinguer trois éléments qui expliquent l’absence d’affect de sa famille. Premièrement, les membres de celle-ci ne connaissent pas les personnes qui se sont suicidées, il n’est donc pas attendu d’eux qu’ils éclatent en sanglots comme l’ont fait certains patients de l’unité. En effet, être trop affecté peut être tout aussi socialement inadapté que n’être pas assez affecté[38]. Toutefois, on l’a vu avec Monsieur B., ne pas connaître la personne décédée ne suffit à justifier ni l’absence de tristesse vis-à-vis du décès, ni l’absence de sympathie pour ceux qui sont affectés par celui-ci. Le second élément explicatif touche à la question de la responsabilité. Selon Madame C., les membres de sa famille considèrent que ses amis ont « choisi leur style de vie », ils doivent donc en assumer la responsabilité et il n’y a pas à s’émouvoir des conséquences de ce choix. Enfin, de par le nombre de cas de suicides parmi les amis de Madame C., une certaine habitude s’instaure, qui va de pair avec l’idée que le suicide est une issue fort probable pour les personnes souffrant de troubles psychiques, atténuant dès lors le choc émotionnel qu’il constitue pour une personne extérieure à cette communauté de destin. En ne se montrant pas affectée, la famille de Madame C. redessine en creux l’altérité des personnes souffrant de troubles psychiques qui sont de fait exclues de la « communauté des êtres raisonnables ». À l’inverse des patients de l’unité qui voient dans Monsieur A. un « comme Moi », la famille de Madame C. voit en lui la figure d’une double altérité, à la fois quelqu’un qu’ils ne connaissent pas mais aussi un « comme Eux », un Autre, dont le décès ne provoque donc pas d’émotion. Tout se passe comme si seule la vie des « Mêmes » avait de la valeur.
Dans un chapitre où elle se penche plus particulièrement sur le deuil, Hochschild[39] explique :
Habituellement, on s’attend à ce que l’endeuillé soit choqué et surpris par la mort ; nous ne sommes pas censés nous attendre à la mort, du moins pas de manière trop confiante. Pourtant, beaucoup de morts – de cancer, d’accident vasculaire-cérébral, ou d’autres maladies mortelles – surviennent progressivement, et ne sont finalement pas une surprise. Ne pas se sentir choqué et surpris peut montrer que, même avant qu’une personne ne meure physiquement, il ou elle peut mourir socialement.
Ici, l’absence d’affect de la famille de Madame C. envers le décès brutal de personnes souffrant de troubles psychiques peut être mise en lien avec la « mort sociale » préalable de ces personnes aux yeux des membres de la « communauté des êtres raisonnables ». Ainsi, l’absence d’émotions, alors qu’elle paraît « socialement illogique » (Paperman, 1992), peut également constituer une source ultime de discrimination, entre les personnes issues de la « communauté des êtres raisonnables » dont le décès doit causer la tristesse, et les personnes souffrant de troubles psychiques dont le décès, étant considéré comme une issue probable, n’est plus vécu comme un choc.
V. Conclusion
Le point de départ de cet article est l’affirmation selon laquelle les émotions répondent à des logiques sociales. Les données et l’analyse présentées dans cet article tendent à montrer que, loin de seulement « répondre » à des logiques sociales, les émotions et leur expression y contribuent sur au moins deux points.
Tout d’abord, les émotions conjointes, qui portent sur un même objet de concernement et sont vécues en commun, contribuent à renforcer les collectifs. Dans le présent article, je me suis attardée sur une émotion négative, à savoir la tristesse qui suit l’annonce d’un décès, au sein d’une petite communauté d’une trentaine de personnes. Toutefois, d’autres types d’émotions vécues en commun à grande échelle produisent le même effet ; on peut notamment penser aux victoires sportives ou aux attentats terroristes qui engendrent de grands mouvements de rassemblement, et exacerbent le sentiment d’appartenance à une Nation.
La seconde contribution des émotions aux logiques sociales est le fait de mettre en visibilité, par leur expression ou son absence, des lignes de partage dans la société, entre ceux qui sont considérés comme des « Mêmes » et ceux qui constituent des « Autres ». Hochschild[40] a mis en évidence qu’il existe des règles de sentiments (feeling rules), qui définissent le type d’émotions devant être éprouvé, qui doit être affecté, comment, pour combien de temps, avec quelle intensité. Imprégnés de ces règles, les individus effectuent un « travail des émotions » pour accorder ce qu’ils ressentent – ou du moins ce qu’ils montrent de ce qu’ils ressentent – à la définition sociale de la situation. Ne pas faire ce « travail des émotions » rend alors prégnantes les lignes de partage sociales : se montrer non-affecté par une émotion collective, c’est en effet affirmer ne pas faire partie de ce collectif et, parfois, indiquer que le collectif en question ne mérite pas que l’on soit affecté par la destinée de ses membres, contribuant ce faisant à la construction d’une altérité radicale.
Bibliographie
Goffman Erving, Les rites d’interaction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974
Haidt Jonathan, « The moral emotions », in Davidson R. J., Scherer K. R. & Goldsmith H. H. (éd.), Handbook of affective sciences, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 852-870.
Hochschild Arlie Russell, « Emotion work, feeling rules, and social structure », American Journal of Sociology, 85, no 1, 1979, p. 551-575.
Hochschild Arlie Russell, The managed heart. Commercialization of human feeling, Berkeley, University of California Press, 2003, 1983.
Kaufmann Laurence, « Faire “collectif” : de la constitution à la maintenance », In L. Kaufmann et D. Trom (éd.), Qu’est-ce qu’un collectif ? Du commun à la politique, Paris, Éditions de l’EHESS, 2010, p. 331-372.
Kaufmann Laurence, « Émotions collectives », in Origgi G., Dictionnaires des passions sociales, Paris, PUF, 2019, à paraître.
Linder Audrey, « Maladie psychique et sujet : les attributions de responsabilité dans une unité psychiatrique de réhabilitation », SociologieS [En Ligne], 2016, https://journals.openedition.org/sociologies/5338
Livet Pierre, Émotions et rationalité morale, Paris, PUF, 2002.
Livet Pierre, « Émotions collectives et virtualité du collectif », Journée d’études « Émotions », Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 24 mai 2016.
Minner Frédéric, « L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du “cadre légal” d’”Occupy Geneva” », Revue européenne des sciences sociales, 2, no 56, 2018, p. 133-159.
Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », Quaderni, 18 (Automne), 1992, p. 93-107.
Paperman Patricia, « La question des émotions : du physique au social », L’Homme et la société, 116, 1995, p. 7-17.
Paperman Patricia, « Émotions privées, émotions publiques », Multitudes, no 52, 2013, p. 164-170.
Pharo Patrick, « La question du pourquoi », In P. Pharo & L. Quéré (éd.), Raisons pratiques, no 1, Les formes de l’action, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, p. 267-311.
Simmel Georg, Sociologie : études sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999.
Szigeti Andras, « Focusing forgiveness », Journal of Value Inquiry, 48, 2014, p. 217-234.
Tangney June Price, Stuewig Jeff, Mashek Debra J., « Moral emotions and moral behavior », Annual Review of Psychology, 58, 2007, p. 345-372.
[1] Hochschild Arlie Russell, « Emotion work, feeling rules, and social structure », American Journal of Sociology, 85, no 1, 1979, p. 551-575.
[2] Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », Quaderni, 18 (Automne), 1992, p. 103.
[3] Hochschild Arlie Russell, « Emotion work, feeling rules, and social structure », op. cit.
[4] Paperman Patricia, « La question des émotions : du physique au social », L’Homme et la société, 116, 1995, p. 16.
[5] Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit., p. 105.
[6] Pharo Patrick, « La question du pourquoi », in P. Pharo & L. Quéré (éd.), Raisons pratiques, no 1, Les formes de l’action, Paris, Éditions de l’EHESS, 1990, p. 267-311.
[7] Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit., p. 103.
[8] Paperman Patricia, « Émotions privées, émotions publiques », Multitudes, no 52, 2013, p. 164.
[9] Ibid.
[10] Stavo-Debauge Joan, Venir à la communauté. Une sociologie de l’hospitalité et de l’appartenance, thèse de doctorat, EHESS, Paris, 2009, p. 13.
[11] Kaufmann Laurence, « Faire “collectif” : de la constitution à la maintenance », In L. Kaufmann et D. Trom (éd.), Qu’est-ce qu’un collectif ? Du commun à la politique, Paris, Éditions de l’EHESS, 2010, p. 331-372.
[12] Entre la fin du repas et le « grand colloque », c’est habituellement le moment de pause des soignants, durant lequel ils vont boire le café dans la salle de réunion qui leur est réservée ; les patients n’ont pas le droit d’y entrer et savent que, sauf en cas d’urgence, ils ne sont pas censés déranger l’équipe à ce moment-là.
[13] Kaufmann Laurence, « Faire “collectif” : de la constitution à la maintenance », op. cit.
[14] Simmel Georg, Sociologie : études sur les formes de la socialisation, Paris, PUF, 1999.
[15] Kaufmann Laurence, « Émotions collectives », in Origgi G., Dictionnaires des passions sociales, Paris, PUF, 2019, à paraître.
[16] Livet Pierre, Émotions et rationalité morale, Paris, PUF, 2002.
[17] Kaufmann Laurence, « Émotions collectives », op. cit.
[18] Livet Pierre, « Émotions collectives et virtualité du collectif », Journée d’études « Émotions », Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 24 mai 2016.
[19] Pharo Patrick, « La question du pourquoi », op. cit.
[20] Ibid.
[21] Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit. ; Paperman Patricia, « La question des émotions : du physique au social », op. cit.
[22] Paperman Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit., p. 105.
[23] Linder Audrey, « Maladie psychique et sujet : les attributions de responsabilité dans une unité psychiatrique de réhabilitation », SociologieS [En Ligne], 2016, https://journals.openedition.org/sociologies/5338
[24] Goffman Erving, Les rites d’interaction, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974.
[25] Ibid., p. 20.
[26] Ibid., p. 22.
[27] Ibid., p. 22.
[28] Ibid., p. 22.
[29] Au moment de cet échange, Monsieur B. n’a pas de logement autre que l’unité de réhabilitation et n’a donc pas d’autre choix que de rester dans l’unité et de réparer ses relations aux autres patients. Il est donc difficile de savoir si ses excuses interviennent en réponse à un réel sentiment de culpabilité, ou s’il feint la culpabilité qui constitue sa seule possibilité d’être réintégré comme membre de la communauté.
[30] Tangney June Price, Stuewig Jeff, Mashek Debra J., « Moral emotions and moral behavior », Annual Review of Psychology, 58, 2007, p. 345-372.
[31] Haidt Jonathan, « The moral emotions », In Davidson R. J., Scherer K. R. & Goldsmith H. H. (éd.), Handbook of affective sciences, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 852-870.
[32] Ibid.
[33] Szigeti Andras, « Focusing forgiveness », Journal of Value Inquiry, 48, 2014, p. 217-234.
[34] Minner Frédéric, « L’indignation, le mépris et le pardon dans l’émergence du “cadre légal” d’“Occupy Geneva” », Revue européenne des sciences sociales, 2, no 56, 2018, p. 148.
[35] Ibid.
[36] Linder Audrey, « Maladie psychique et sujet : les attributions de responsabilité dans une unité psychiatrique de réhabilitation », op. cit.
[37] Qui est également une ancienne patiente de l’unité.
[38] Hochschild Arlie Russell, The managed heart. Commercialization of human feeling, Berkeley, University of California Press, 2003, 1983.
[39] Hochschild Arlie Russell, The managed heart, op. cit., p. 65 ; notre traduction.
[40] Hochschild Arlie Russell, « Emotion work, feeling rules, and social structure », op. cit.