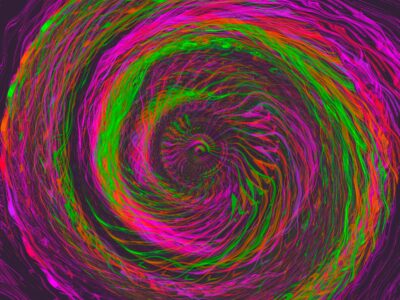Magie de la discontinuité. Quelques interrogations sur l’émergence
Biographie
Jeanne-Marie Roux est professeure invitée à l’Université Saint-Louis et chercheuse au centre Prospéro. Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris, titulaire de l’agrégation de philosophie, elle a obtenu en novembre 2015 un doctorat de philosophie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches post-doctorales, s’inscrivent, comme sa thèse, par-delà la frontière qui sépare traditionnellement philosophie du langage ordinaire et phénoménologie. Elle a notamment publié Le corps. De Platon à Jean-Luc Nancy (2011, Eyrolles) et Les degrés du silence. Du sens chez Austin et Merleau-Ponty(2019, Peeters, « Bibliothèque Philosophique de Louvain »), co-dirigé un numéro thématique des Cahiers philosophiques sur « Les limites du langage » (2019, n°158) ainsi qu’un ouvrage collectif sur Le performatif. Sens et usages (à paraître aux Éditions de la Sorbonne).
Résumé
Refusant le modèle de la théorie comme celui du mythe, Émergence constitue une « narration », une suite de « récits », comme autant d’images d’un album relatant « sous forme approximative et à travers des exemples » l’histoire naturelle du monde. Il nous semble cependant légitime de lire l’ouvrage comme un livre de philosophie classique, où la part laissée au récit, à la narration, l’association des chapitres à des dates de l’histoire du monde ne nous interdit pas d’évaluer comme telle la métaphysique qui s’y déploie. Nous proposons dans ce texte une lecture rationaliste de l’ouvrage, et nous nous interrogeons sur la légitimité de ses présupposés, la cohérence de ses propositions, la validité de ses conséquences.
Mots-clés : métaphysique ; ontologie ; épistémologie ; éthique ; politique
Summary
Rejecting both the theoretical and the mythical models, Émergence is a « narrative », a series of « stories », like so many images in an album recounting « in approximate form and through examples » the natural history of the world. However, we feel that it is legitimate to read the work as a book of classical philosophy, in which the emphasis on narrative, the association of chapters with dates in the history of then this paper, we propose a rationalist reading of the work, and question the legitimacy of its presuppositions, the coherence of its propositions, and the validity of its consequences.
Keywords : metaphysics; ontology; epistemology; ethics; politics
Émergence, de Maurizio Ferraris, est un objet philosophique singulier, dont le caractère argumentatif est hybride, les inspirations multiples. Il assume une très grande ambition théorique, qui est celle de son auteur, dont les ouvrages relèvent de domaines de la philosophie très hétérogènes. Ce dont il s’agit dans Émergence touche à la métaphysique, et relie ontologie, épistémologie, éthique et politique en une pensée dont on peut considérer qu’elle possède un caractère systématique. Pourtant, ce n’est qu’en l’assortissant d’importantes précautions que Maurizio Ferraris reconnaît le caractère « spéculatif » de son ouvrage. Pointant le risque de la « difficulté » et, plus grave sans doute, de l’ « inconsistance », l’auteur offre au lecteur un guide en la personne de Schelling et de ses étonnants Âges du monde[1], par lesquels il voulut en son temps unir spéculation et réalisme. Refusant le modèle de la théorie comme celui du mythe, Émergence constituerait une « narration »[2], une suite de « récits », comme autant d’images d’un album relatant « sous forme approximative et à travers des exemples » l’histoire naturelle du monde.
I. Émergence, un « récit rationnel » ?
Nécessairement s’impose au lecteur contemporain une première interrogation, de méthode : quel est le statut philosophique de ce récit, de ces « images », de ces inventions conceptuelles et narratives ? De la réponse procède le sens que l’on doit accorder aux concepts dont l’auteur fait usage, et aux propositions théoriques qu’il défend à leur égard. Pour en venir immédiatement au cœur de cette contribution : qu’est-ce qui justifie, en particulier, que Maurizio Ferraris fasse un usage extrêmement extensif du concept d’enregistrement, repoussant très loin (infiniment loin, en réalité) les limites de l’usage ordinaire du concept ? L’auteur s’interroge lui-même, à la suite à une objection qu’il attribue à Alberto Romele : « l’universalisation du concept d’enregistrement n’est-elle pas risquée ? »[3]
 De manière très frappante, la suite immédiate du texte va entreprendre de justifier cette universalisation, mais pas le principe même de l’universalisation d’un concept, qui semble relever d’une forme d’évidence, à l’inspiration évidemment multiple, qui l’inscrit dans l’ordre de la philosophie spéculative la plus décomplexée. De ce point de vue, le concept d’enregistrement paraît avoir à l’égard de sa filiation derridienne – le concept de « différance » en est l’une des sources auto-proclamées – une relation de forte fidélité.
De manière très frappante, la suite immédiate du texte va entreprendre de justifier cette universalisation, mais pas le principe même de l’universalisation d’un concept, qui semble relever d’une forme d’évidence, à l’inspiration évidemment multiple, qui l’inscrit dans l’ordre de la philosophie spéculative la plus décomplexée. De ce point de vue, le concept d’enregistrement paraît avoir à l’égard de sa filiation derridienne – le concept de « différance » en est l’une des sources auto-proclamées – une relation de forte fidélité.
Dans un cas comme dans l’autre, il est clair en tout cas que l’universalisation du concept sert des fins polémiques ou, pour le moins, critiques : en ce qui concerne Maurizio Ferraris, il s’agit de dénoncer une certaine manière de poser des discontinuités dans le monde, et en particulier d’établir une discontinuité « entre les origines de la vie et les constructions de la culture »[4]. Là contre, l’émergentisme, qui est chez ce nouveau-réaliste un « enregistrementisme », est une proposition qui assume d’être « métaphysique », et qui veut constituer une nouvelle manière de penser ce qui est par-delà l’opposition de la vie et de la culture, de l’esprit et du corps, des faits et des valeurs.
Comme le définit Maurizio Ferraris, « une propriété est dite émergente à partir d’une certaine base de faits lorsque, bien qu’elle en dépende, elle ne peut être entièrement expliquée dans les termes des faits en question – par exemple, l’esprit émerge du cerveau »[5]. Contre la fable que les philosophes se racontent souvent – ce seraient « les humains […] qui construisent le monde », sa thèse est que « le monde entier, c’est-à-dire la totalité des individus, est le résultat d’une émergence qui ne dépend pas de la pensée ni des schèmes conceptuels »[6].
De ce point de vue, il est légitime à nos yeux de situer Émergence dans la lignée, classique, de ceux qui ont voulu proposer une ontologie qui évite les impasses du cartésianisme. De ce point de vue, il nous semble légitime de lire l’ouvrage comme un livre de philosophie classique, où la part laissée au récit, à la narration, l’association des chapitres à des dates de l’histoire du monde ne nous interdit pas d’évaluer comme telle la métaphysique qui s’y déploie. En clair, dès lors que le propos développé dans Émergence dénonce des contradictions, use d’arguments, se soucie de la justification de ses thèses, sa forme narrative remarquable n’exclut pas qu’elle revendique une forme de justesse, et même de vérité, qui entend bien « expliquer » les choses[7], proposer une « solution »[8] à un problème. Fâcheusement rétive peut-être à la singularité de son récit, nous proposerons dans ce texte une lecture rationaliste de l’ouvrage, et nous nous interrogerons sur la légitimité de ses présupposés, la cohérence de ses propositions, la validité de ses conséquences.
Et c’est donc à partir de cette hypothèse de lecture que nous donnerons sens à notre première observation relative au style singulier de l’ouvrage. Dès lors qu’Émergence déploie des propositions théoriques, pourquoi les expose-t-il sous la forme d’un récit ? Maurizio Ferraris s’en explique rapidement, nous l’avons évoqué : il veut éviter le double écueil que constituent la difficulté et l’inconsistance, et trouve du secours dans l’œuvre de Schelling. Se trouve ainsi disqualifiée toute interprétation qui accorderait un statut incident ou cosmétique au style de son récit, pourvu au contraire par son auteur d’un rôle substantiel, révélateur de ce qu’est la métaphysique pour lui et du statut véritatif qu’il lui accorde.
On sait l’importance de l’usage platonicien de l’« eikôs muthos » dans le Timée. Luc Brisson nous l’a enseigné, le recours au « mythe vraisemblable » doit être lié au fait que, pour Platon, dès lors que l’on s’exprime sur le monde sensible, l’on ne peut formuler un discours vrai à proprement parler, mais uniquement un discours vraisemblable, semblable au vrai, dont la vertu serait de persuader de choses vraies, mais qui ne tirerait sa légitimité que du discours vrai sur lequel il s’adosse intellectuellement et qu’il soutient rhétoriquement[9]. Ne pouvant être l’objet d’un discours purement rationnel, qui prendrait une forme argumentative plus rigide, la cosmologie serait incapable de se fonder elle-même rigoureusement, et devrait se parer d’atours poétiques pour persuader le lecteur.
La différence du type de discours adopté dans Émergence avec ce mythe vraisemblable est riche d’enseignements. Car le mythe vraisemblable platonicien présuppose un discours vrai qui serait possible sur un autre plan, et auquel le discours métaphysique poétique serait subordonné. Or, loin de disqualifier le recours au style, le propos de Maurizio Ferraris, en défend un usage de plein droit ! Alors même que Schelling lui-même fait des références positives (c’est le cas de le dire) au Timée[10], le mythe n’est évoqué dans Émergence que pour s’en distancier. Maurizio Ferraris caractérise résolument la forme de son ouvrage comme étant de « l’histoire », et non du « mythe », c’est-à-dire un « récit d’individus qui, à la différence du mythe, ne vise pas à l’universel et au nécessaire, mais au particulier et au contingent. »[11]
Autrement dit, pour l’auteur, la métaphysique ne peut être fondée apodictiquement, mais cela n’est pas un défaut – relativement à d’autres discours qui, eux, le pourraient – car ce dont il est question dans le monde, c’est d’individus. Ainsi, c’est cette position théorique fondamentale qui motive le sort (stylistique, métaphilosophique) que Maurizio Ferraris réserve à la métaphysique. Il est très important de bien comprendre le caractère crucial de cette thèse.
Elle est fondée, croyons-nous (car elle n’est pas justifiée en tant que telle dans l’ouvrage), sur le refus de l’idéalisme, qui nous apparaît par conséquent comme le véritable ressort de la pensée de Maurizio Ferraris. L’idéalisme, nous dit-il, est l’idée selon laquelle il y a « dépendance de l’être à l’égard de la pensée »[12]. Or, il nous semble que c’est la même chose pour l’auteur que de dire que l’être ne dépend pas de la pensée et de soutenir que le monde est fait d’individus. À ce titre, la condamnation de l’idéalisme, c’est-à-dire l’idée que l’être ne dépend pas de la pensée, constituerait le véritable point de départ théorique de l’ouvrage, son motto essentiel.
En effet, en soutenant que le monde est fait d’individus, Maurizio Ferraris réalise une affirmation qui constitue une thèse (non évidente) si on la comprend dans le cadre de la querelle des universaux, et comme signifiant, donc, que le monde ne contient pas d’universaux, ou en tout cas aucun universel qui serait pensable indépendamment des individus. Aucune pensée – générale par définition – n’est concevable sans l’être dont elle est la pensée, et qui, en tant qu’il est un être et non une pensée, ne peut être général, mais s’inscrit dans l’ordre du particulier. Refuser l’idéalisme, l’existence d’universaux et la dépendance de l’être à l’égard de la pensée constituent un seul et même geste.
Or, ce geste aboutit chez Maurizio Ferraris à une conséquence métaphilosophique très importante. Car il nous semble que c’est bien parce qu’il est anti-idéaliste-« anti-universaliste » (si l’on peut dire) qu’il considère aussi que la philosophie ne peut en aucun cas prétendre à une vérité universelle et nécessaire. Une telle prétention est intenable, injustifiable. Comme l’écrit on ne peut plus clairement l’auteur : « l’épistémologie parfaite est donc l’histoire, en tant que définition, non pas de lois, mais d’individus. »[13] La radicalité de la critique que Maurizio Ferraris adresse à l’idéalisme le conduit donc à ne reconnaître de légitimité qu’au récit philosophique, en tant qu’il constitue la seule forme légitime pour traiter des individus, et non des universaux. Mais alors aucun désaccord ne peut opposer des théories que l’on pourrait départager de manière purement rationnelle : toute position philosophique se trouve inscrite dans un récit, tout débat semblant devoir prendre la forme d’une concurrence de récits.
C’est à une telle interprétation que nous invite du reste très explicitement la quatrième de couverture de l’ouvrage : ce qui nous est proposé est une « autre histoire », une histoire qui ne soit ni « déprimante » ni « triste », ni « conservatrice » : contre l’idée que le monde serait « tout entier à l’intérieur de nous », Maurizio Ferraris veut défendre que le monde « émerge indépendamment du moi et de ses claustrophobies ».
La difficulté est évidente : dès lors que le mode du discours théorique est discrédité, de même que celui du mythe, le récit demeure le seul mode d’exposition philosophique légitime. L’inconvénient est que le récit ne semble plus pouvoir se prévaloir d’une véridicité purement rationnelle – c’est une prise de position politique, en l’occurrence une prise de position ouverte et libérale, qui se retrouve à devoir jouer le rôle de ressort profond du récit métaphysique qui nous est proposé.
Il n’en demeure pas moins que – nous avons commencé par le dire – le cœur théorique de l’ouvrage est évaluable rationnellement. Car à défaut de pouvoir être fondé démonstrativement, l’émergentisme, ou plutôt la forme singulière que Maurizio Ferraris lui donne, doit être solide argumentativement. Comme le mythe rationnel platonicien – mais à sa manière comme on l’a vu –, le récit de Maurizio Ferraris est rationnel, et c’est sur ce plan que nous allons déployer notre propos. Car l’ouvrage propose une conception théorique du monde qui se veut plus heureuse, mais aussi plus consistante que nombre de systèmes métaphysiques (qu’ils se revendiquent comme tels ou non) concurrents.
II. Le problème des sens du sens dans l’« enregistrementisme » ferrarien
Comment caractériser la conception théorique défendue dans l’ouvrage ? Nous l’avons résumée rapidement : il s’agit d’une forme d’émergentisme d’inspiration derridienne[14]. L’émergentisme ferrarien est en effet modelé par la thèse centrale selon laquelle « émerger c’est être enregistré »[15]. Cela signifie que « la lente accumulation d’enregistrements […] finit par produire quelque chose de qualitativement différent »[16], l’enregistrement étant défini comme « la capacité à garder la trace ».
Ainsi, le cœur de l’ouvrage consiste à soutenir, contre la primauté de l’ordre de la pensée, que « la conscience, le savoir, les valeurs et les philosophes transcendantaux » (l’ouvrage est drôle, et c’est bien agréable) « émergent de la réalité à la façon dont poussent les champignons ». L’une des grandes vertus de l’ouvrage, qui justifie son inscription dans le mouvement réaliste contemporain, tient indubitablement à sa dénonciation vigoureuse des travers idéalistes de nombreuses thèses en vogue. Le talent de caricaturiste mobilisé par Maurizio Ferraris lui permet de dénoncer avec une grande force critique nombre d’inconsistances philosophiques (post)modernes.
Formulée génériquement, l’« idéalisme » est défini comme la « dépendance de l’être à l’égard de la pensée »[17]. Sa critique se déploie selon deux modalités distinctes. Tout d’abord, Maurizio Ferraris critique les incohérences théoriques qui invalident différentes formes possibles de cette thèse, ce qui est éclairant mais relève d’un procédé parcellaire par définition, dès lors que la typologie construite est rapide et non exhaustive. Plus significativement à nos yeux, son ouvrage met en évidence les conséquences délétères de l’idéalisme, au sens métaphysique du terme, en termes politiques et moraux.
Cette mise en évidence prend la forme d’une dénonciation du « pharisaïsme », qui désigne « l’attitude qui veut que la valeur morale de ce que nous faisons dépende des idées que nous professons, et qui part de la présupposition d’un sujet libre et constructeur du monde »[18]. En un geste polémique fort, Maurizio Ferraris trace un lien entre le moralisme bienpensant contemporain, Robespierre et Kant : « l’homme naît libre, donc il peut être libre, ergo il doit l’être. »[19]Dans ce cadre, l’autonomie de l’homme, par la force de sa pensée, est posée comme un postulat indépassable.
Mais alors, si la pensée est première, qu’elle prime, la responsabilité du sujet envers les choses est immense, totale, et, par là même – c’est à nos yeux l’un des grands mérites de l’ouvrage que de le montrer – totalement diluée. L’idéalisme politique se trouve ainsi corrélée à une « immense responsabilité, dans une large mesure imaginaire, et sans liens ni sanctions »[20]. Puisque ce qui domine est l’idée que l’homme est responsable de tout, la question du partage entre ce dont on n’est pas responsable et ce dont on est responsable, et à l’égard duquel on doit donc se porter garant, assumer des conséquences, perd toute pertinence. Maurizio Ferraris nous montre ainsi qu’une véritable responsabilité ne peut être totale, sans limites, puisqu’une telle caractérisation a pour conséquence de la diluer totalement ; il suggère par contraste que ce qui fait le fond de toute véritable responsabilité est une hiérarchie, un étagement des pouvoirs et des devoirs.
Contre l’idéalisme-constructivisme-pharisaïsme, l’auteur entend donc défendre une conception « réaliste » pour laquelle ce qui prime n’est pas la liberté, mais la soumission – elle prime, parce que littéralement elle est première –, et que c’est de cette soumission elle-même que va naître la possibilité de la transformation, de l’émancipation, de la révolution. S’affirme là une véritable dialectique, pour laquelle l’être ne dépend pas de la pensée, mais au contraire « est résistance »[21] et permet par là même l’émergence d’une pensée neuve, transformatrice. Contre le primat du sujet (libre), de la pensée, de la volonté, de l’intentionnalité spontanée, tout l’enjeu est donc de concevoir, c’est-à-dire également de raconter, comment la pensée émerge de la réalité, c’est-à-dire la manière dont la réalité est première sans être en discontinuité avec la pensée.
À cette fin, Maurizio Ferraris déploie une tentative très intéressante pour penser ensemble les différents sens du sens,c’est-à-dire le sens comme direction, ou comme mouvement, le sens comme modalité de présentation et le sens comme compréhension et comme signification – il s’agit de la deuxième partie de l’ouvrage, consacrée à l’épistémologie. Il s’y oppose à un modèle dit « pentecôtiste », où le sens est « antérieur et indépendant à l’égard des formes dans lesquelles il s’exprime »[22], et veut défendre l’idée que le sens comme signification dépend, découle, émerge en réalité, du sens comme direction, immanent selon lui à la matière ou, comme il le dit aussi, à la vie.
Or, cette réflexion s’insère dans les débats qui portent actuellement sur la nature du contenu de la perception, et sur la relation qu’il entretient avec le contenu conceptuel, Maurizio Ferraris faisant partie de ceux qui veulent penser une continuité entre le sens comme direction et le sens comme compréhension. Il fonde sa pensée sur une base empirique, extraite d’Uexküll et de Wertheimer, qui lui permet de soutenir qu’il y a une « série de déterminations du schéma corporel qui nous permet de reconnaître les objets »[23], que le monde est donc « riche en directions, invitations, interactions et institutions »[24], que l’environnement, en somme, est « riche, accueillant et doué de sens ».
Or, de telles analyses, couplées à l’idée que les autres individus peuvent être eux aussi la source de riches « invitations »[25], lui permettent de soutenir qu’il y a « un sens qui est dans le monde »[26]. Mais on ne peut qu’être frappé sur ce point de la tonalité éminemment phénoménologique, et plus précisément merleau-pontienne de la pensée de Maurizio Ferraris sur le sujet du sens du monde. L’« inconscient géologique »[27] dont il est question dans ce passage consonne étrangement avec la « signification originaire » dont il est question dans l’ensemble de la Phénoménologie de la perception[28].
Un problème évident se pose alors ; c’est du reste l’un des écueils que l’auteur essaye de contourner explicitement. Une telle conception ne confond-elle pas les différents sens du sens ? L’écueil serait de ne pas décrire chaque niveau de sens selon les modalités qui lui sont propres, et de ne pas être fidèle pour cette raison à la juste description des phénomènes. Cette trahison peut se faire de deux façons : soit en réalisant une mauvaise description du niveau de la compréhension, soit en réalisant une mauvaise description du niveau de la direction. C’est typiquement un problème merleau-pontien, qui se demande après la Phénoménologie de la perception : comment penser authentiquement le niveau de la compréhension (du sens linguistique, de la pensée, de la vérité) sans perdre la relation de continuité avec le niveau de la direction ? La proximité avec le problème qui se pose à Maurizio Ferraris lorsqu’il entreprend d’expliquer-raconter comment « le logos »[29] émerge de la direction est frappante.
Pour ces deux auteurs, la difficulté se pose selon ces termes. Si le sens du monde procède des déterminations de notre schéma corporel, ce sens est moteur, corporel, mais il est strictement déterminé. Or, pour rendre compte de ce que Maurizio Ferraris appelle le « sens comme compréhension », il faut une place pour ce qu’il appelle de « l’imprévu »[30], de « la surprise »[31], bref, pour de l’indétermination. Chez Merleau-Ponty, l’écueil était d’en rester à une compréhension naturaliste, causale, du sens linguistique mais aussi de l’ensemble du comportement humain. Il est clair que le philosophe italien comme le phénoménologue français en son temps refusent tout à fait ce déterminisme, même corporel et moteur. Plus loin dans l’ouvrage, Maurizio Ferraris parle de « la spontanéité et de la créativité que nous découvrons en nous »[32]– il ne nie aucunement ces dimensions de l’existence humaine !
Dans Émergence, la sortie hors du régime de la détermination matérielle doit être expliquée par le biais de l’« itération », elle-même permise et fondée sur « l’inscription ». La référence à Hegel, et à l’image de la pyramide, joue un rôle important.
[L]a thèse de Hegel est que la simple conservation du matériel, qui le rend disponible aux itérations, engendre précisément le processus d’altération qui garantit le passage du matériel au spirituel, de la passivité à l’activité, de la pyramide à la conscience. [33]
La succession des arguments est la suivante : le sens comme direction est enregistré, et cela lui permet d’être itéré. Cette itération lui permet elle-même, parfois, mais pas toujours, d’être altéré, et de donner lieu à autre chose qu’à la simple répétition du même, ou à la simple prolongation de ce qui était déjà en cours. Dans ce cadre, la possibilité de l’altération est évidemment « crucial[e] »[34]. Maurizio Ferraris l’écrit nettement : « l’altération est la genèse de la signification consciente »[35]. Or, cette possibilité est inscrite dans l’itération elle-même, pour la raison que « l’unicité ontologique de l’individu est redoublée, de sorte que l’itération (parfaite ou non) est aussi altération »[36].
Nous atteignons le point sur lequel porte notre deuxième grande question : avons-nous vraiment affaire ici à une authentique altération ? En somme, y a t-il quelque chose ici comme une authentique émergence, qui suppose la sortie d’un régime d’immanence simple ? Avons-nous bien affaire à une authentique discontinuité ?
III. Émergera ? Émergera pas ? Le problème de la discontinuité en régime émergentiste
Critique du dualisme, et en particulier de son expression idéaliste, Maurizio Ferraris dénonce, à bon droit semble-t-il, tous ceux pour qui l’apparition de la pensée dans la vie est conçue comme un « saut qualitatif », qui ne peut être que magique dès lors que la relation de discontinuité initiale entre les deux est telle qu’elle ne peut être comblée que par un acte du Saint Esprit (ou assimilé). Mais, en contrepartie, il s’agit de réussir à penser l’émergence de la pensée à partir de la vie, c’est-à-dire que la caractérisation de la vie doit être telle qu’elle permette d’expliquer l’apparition d’une véritable pensée. Cela nous conduit à l’un des nœuds argumentatifs cruciaux de sa philosophie, qui porte précisément sur cette altérité qui devrait être permise et même constituée par l’itération. C’est elle que nous voudrions discuter pour finir.
L’argument problématique a déjà été cité : « l’unicité ontologique de l’individu est redoublée, de sorte que l’itération (parfaite ou non) est aussi altération ». Mais s’agit-il vraiment d’une altération ? Le problème est le suivant. Toute inscription est itérée, et donc toute inscription se trouve altérée. Mais cet argument implique que l’altération dont il est question ne se distingue d’aucune identité possible. L’altération est de droit et elle est par là même indistincte, indiscriminée ou in-discriminante. Il semble que nous sommes ici dans un cas très similaire à celui que Maurizio Ferraris dénonce au sujet de « l’immense responsabilité » sans limites et sans sanctions pensée par l’idéalisme-pharisaïsme.
Pour qu’une véritable altération soit conçue, il faut que cette altération s’oppose, ou du moins se distingue, d’une identité possible, d’une continuité possible, qu’elle ne soit pas de principe. De ce point de vue, il y aurait deux possibilités. Premier cas : soit l’altération n’en est pas vraiment une, et il manque précisément la discontinuité qui devait permettre d’expliquer l’émergence du sens comme signification à partir du sens comme direction. On en resterait, en somme, à une forme d’immanence vitale, à une continuité matérielle. Second cas : soit l’altération est permanente, mais alors l’on ne voit pas bien pourquoi toutes les choses du monde ne seraient pas dotées d’un sens comme signification. On aurait donc affaire à une forme de prolifération, et même d’universalisation de la signification, de la compréhension, de l’idée.
Dans le premier cas comme dans le second, il paraît difficile de préserver les deux concepts de sens dans leur distinction, de ne pas les fusionner, de leur accorder à chacun une place distincte. À ce titre, le concept ferrarien de discontinuité serait assez similaire au « saut qualitatif magique » qu’il critique par ailleurs, au sens où il constituerait davantage une déclaration d’intention qu’un concept consistant.
Du reste, lorsqu’au début de l’ouvrage, l’histoire qui va nous être racontée est présentée synthétiquement, le passage de l’itération à l’altération est commentée à l’aide du concept de « miracle » : « le miracle réside dans le fait que la persistance des inscriptions comme itération puisse, même si ce n’est pas nécessairement le cas, se transformer en positivité, c’est-à-dire donner lieu, en l’occurrence, à l’évolution de la vie. »[37]
Cette citation pose deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce parfois « le cas », mais « pas nécessairement », dès lors que toute itération est altération ? Deuxièmement, la différence entre ces deux cas de figure n’est-elle pas déterminante et n’est-elle pas surtout ce qu’il faut expliquer ? Ou, pour formuler les choses différemment, que se passe-t-il de différent quand la sédimentation suscite des transformations et quand elle n’en suscite pas ?
Il nous semble que l’argumentation déployée dans l’ouvrage montre bien qu’il n’y a pas de miracle dans l’émergence des transformations depuis la sédimentation, dès lors que celle-ci est source intrinsèque d’altération. Mais alors il manque l’explication, ou du moins elle nous manque à nous (en tant qu’individu…), du fait que cette altération ne se produise pas toujours, et corrélativement de ce qui se passe de différent quand elle en produit. Ce point constitue un inconnu qui est un lieu possible pour une intervention du miracle.
Dans la dernière partie du texte, la difficulté prend une forme politique – ou, pour le dure plus précisément, nous voyons apparaître les difficultés politiques que pose ce problème. Maurizio Ferraris s’interroge sur ce qui rend possible l’émancipation. Il répond, et c’est logique : la soumission. De même que l’altération émerge de l’itération, l’émancipation émerge de la soumission. Dans les termes du texte, « c’est justement de la résistance du réel, de son inamendabilité que dérive la possibilité de la libération »[38]. Que la libération soit possible, il nous semble indispensable, et très précieux, d’en rendre compte. Mais qu’est-ce qui fait qu’elle a, parfois, effectivement lieu ? L’auteur emploie dans ce chapitre des formules de temporalisation intéressantes. Quand Maurizio Ferraris écrit « lorsque la simple résistance se transforme en positivité », il prend en compte le caractère empirique, et contingent, de cette altération. De surcroît, le dernier chapitre est précisément consacré à ces cas, exemplaires, d’émancipation, à ces actions individuelles qui « prouv(ent) le discontinu »[39]. Il y a alors « l’introduction d’un discontinu »[40]. Mais par quelle voie, ou quel procédé ? Il s’agit, nécessairement, d’une action individuelle, qui constitue une réaction. Ne retrouve-t-on pas là le recours un peu miraculeux à une spontanéité, certes non totale, mais hétérogène a priori à l’égard de l’ordre de la vie ?
L’agir moral dérive de la documentalité, nous dit Maurizio Ferraris. Mais en quel sens ? Pourquoi la résistance suscite-t-elle à un moment donné (c’est-à-dire pas systématiquement) une réaction émancipatrice ? Cela ne constitue pas un problème pour l’auteur, puisqu’il assume que parfois l’itération crée la transformation, et parfois non. Mais nous ne parvenons pas à comprendre comment il est possible qu’elle n’en crée pas toujours, dès lors que – c’est son argument – la même chose ne réapparaît jamais identiquement, que l’itération est toujours une transformation. Dans la logique de l’ouvrage, l’identité n’est jamais évidente, mais alors il manque un argument qui permettrait de faire valoir un contraste (même relatif, comme il doit évidemment l’être) entre identité et différence.
C’est la même interrogation qui anime notre objection relative à la manière dont Maurizio Ferraris interprète (raconte !) ce qu’il en est de notre perception et du sens du monde. Peut-on concevoir qu’il existe un sens du monde, de même qu’il existerait des individus ? Dans les deux cas, il nous semble qu’on néglige la nécessaire intervention du concept, et donc du jugement, et donc de décisions théoriques toujours circonstanciées, dans la détermination des identités des choses, et donc, indissociablement, de leur permanence comme de leur transformation. À ce titre, l’idée même qu’il n’y aurait « que des individus » nous semble aussi vaine que celle selon laquelle il y aurait aussi des universels – dans un cas comme dans l’autre, ce qui nous semble surtout important est de comprendre pourquoi certains individus peuvent être parfois considérés comme étant du même type, et parfois non.
C’est notre interrogation métaphilosophique initiale que nous retrouvons enfin. Quid du statut du discours métaphysique déployé dans l’ouvrage ? Et, en particulier, quid des généralisations qu’il s’autorise ? Par de telles généralisations, ne rend-on pas un certain nombre de concepts, partiellement du moins, inintelligibles dès lors qu’on les sort du jeu où ils prennent sens par contraste avec d’autres concepts ? La critique de l’idéalisme semble difficilement compatible avec le maintien d’un style « spéculatif », aussi « positivé » soit-il.
[1] Friedrich Schelling, Les âges du monde, Paris, P.U.F., 2014.
[2] Maurizio Ferraris, Émergence, tr.fr. S. Plaud, Paris, Le Cerf, 2018, p. 15.
[3] Ibid., p. 34.
[4] Ibid., p. 36, nous soulignons.
[5] Ibid., p. 8.
[7] Ibid., p. 41.
[8] Ibid., p. 44.
[9] Luc Brisson, Platon, les mots et les mythes. Comment et pourquoi Platon nomma le mythe ?, Paris, La découverte, 1994.
[10] Par exemple Friedrich Schelling, Philosophie de la révélation, Livre I, Paris, PUF, 1989, tr. fr. J.F. Marquet et J.F. Courtine, p. 123. Ces références ne vont pas sans distanciation critique, évidemment. Mais, comme le note Gerard Bensussan, « Platon est très présent dans les Âges » (G. Bensussan, Les âges du monde de Schelling, Paris, Vrin, 2015, p. 27).
[11] Maurizio Ferraris, Émergence, op.cit., p. 13.
[12] Ibid., p. 129.
[13] Ibid., p. 13.
[14] En réalité, les inspirations de l’ouvrage, pour ne parler que de celles qui sont explicites, sont nombreuses et variées, ce qui lui donne la qualité appréciable, à nos yeux, d’éviter toute apparence de « texte providentiel », sorti du chapeau, ex nihilo. Kant, Hegel, Leibniz bien sûr, dont la célèbre vague est évoquée sur la couverture de l’édition française du livre, sont d’autres références importantes de l’auteur.
[15] Maurizio Ferraris, Émergence, op.cit., p. 31.
[16] Ibid., p. 12.
[17] Ibid., p. 129.
[18] Ibid., pp. 119-120.
[19] Ibid.
[20] Ibid., p. 135.
[21] Ibid., p. 122.
[22] Ibid., p. 63.
[23] Ibid., p. 74.
[24] Ibid., p. 75.
[25] Ibid., p. 78.
[26] Ibid., p. 79.
[27] Ibid., p. 80.
[28] Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945.
[29] Maurizio Ferraris, Émergence, op.cit., p. 93.
[30] Ibid., p. 80.
[31] Ibid., p. 86.
[32] Ibid., p. 112.
[33] Ibid., p 94.
[34] Ibid., p. 96.
[35] Ibid., p. 96.
[36] Ibid., p. 97.
[37] Ibid., p. 39.
[38] Ibid., p. 158.
[39] Ibid., p. 166.
[40] Ibid., p. 169.