« Civilisade » et intervention chez les peuples barbares selon John Stuart Mill
« Supposer que les mêmes coutumes internationales (international customs) et que les mêmes règles de moralité internationales puissent avoir cours entre deux nations civilisées comme entre une nation civilisée et des nations barbares (barbarians), est une grave erreur, erreur en laquelle aucun homme d’État ne doit tomber, même si c’est avec ceux qui, d’une position confortable et irresponsable, jugent les hommes d’État. »[1]
Les « Quelques mots sur la non-intervention », article de John Stuart Mill publié en 1859 et qui constitue la première formulation d’une théorie de l’intervention, sont divisés en deux moments. Le premier est consacré à l’intervention chez les peuples « barbares », intervention légitime et même parfois moralement requise. Le second traite de l’intervention chez les peuples « civilisés », ou plutôt de son interdiction, puisque chez ceux-là, sauf exception, il n’est ni légitime ni souhaitable d’intervenir, l’immixtion dans les affaires d’un peuple étranger, aussi bienveillante soit-elle, risquant de faire obstacle à l’effort qu’un peuple doit faire pour acquérir de lui-même sa liberté.
 Une telle division de la théorie de l’intervention a amené certains commentateurs, sans doute à juste titre, à poser la question de « l’impérialisme » de John Stuart Mill[2]. Cette question semble en fait en recouvrir deux distinctes. La première, de nature doxographique, consiste à se demander si John Stuart Mill était un défenseur du colonialisme ou de l’impérialisme, et comment ce soutien peut se lire dans l’ensemble de ses textes. La seconde, de nature plus conceptuelle, pose la question de savoir si la théorie de l’intervention, que formule de manière paradigmatique John Stuart Mill, mais qu’on retrouverait encore aujourd’hui, pratiquement inchangée, chez nombre de penseurs libéraux, repose nécessairement sur la distinction entre peuples barbares et peuples civilisés. Autrement dit, le problème serait de savoir si le geste qui consiste à séparer l’humanité en deux catégories est la structure impensée des théories de l’intervention, et si cette séparation est de nature « impérialiste ».
Une telle division de la théorie de l’intervention a amené certains commentateurs, sans doute à juste titre, à poser la question de « l’impérialisme » de John Stuart Mill[2]. Cette question semble en fait en recouvrir deux distinctes. La première, de nature doxographique, consiste à se demander si John Stuart Mill était un défenseur du colonialisme ou de l’impérialisme, et comment ce soutien peut se lire dans l’ensemble de ses textes. La seconde, de nature plus conceptuelle, pose la question de savoir si la théorie de l’intervention, que formule de manière paradigmatique John Stuart Mill, mais qu’on retrouverait encore aujourd’hui, pratiquement inchangée, chez nombre de penseurs libéraux, repose nécessairement sur la distinction entre peuples barbares et peuples civilisés. Autrement dit, le problème serait de savoir si le geste qui consiste à séparer l’humanité en deux catégories est la structure impensée des théories de l’intervention, et si cette séparation est de nature « impérialiste ».
Ces deux problèmes nous paraissent pertinents et ils appellent des développements approfondis. Dans le cadre d’une histoire du libéralisme, d’abord, pour lequel le concept d’intervention joue un rôle fondamental – que l’intervention soit comprise comme l’ingérence de l’État dans la vie et les choix d’un individu, ou comme l’interférence d’un peuple dans les affaires d’un autre. Mais aussi lorsque nous abordons l’abondante littérature politique, éthique ou philosophique contemporaine consacrée à la question de la guerre juste et de l’intervention militaire : une grande partie de ces textes citent en effet l’article fameux de John Stuart Mill, de première ou de seconde main, en passant sous silence, la plupart du temps, le premier moment du texte consacré aux guerres contre les « barbares »[3].
Notre ambition n’est pas de répondre ici à l’ensemble de ces questions – ce qui supposerait d’ailleurs d’avoir résolu la question de savoir ce qu’est « l’impérialisme » – mais plutôt d’esquisser quelques pistes de recherche, à partir de la lecture de deux textes de John Stuart Mill. Le premier se situe à la fin du quatrième chapitre de De La Liberté[4]. Le second est celui que nous avons évoqué en commençant, à savoir la première partie des « Quelques mots sur la non-intervention ». Ces deux textes, publiés la même année, semblent énoncer des thèses contradictoires. Tandis que dans De la Liberté, Mill s’élève contre l’idée d’une intervention ou d’une « civilisade » entreprise pour lutter contre la polygamie chez les Mormons, communauté « barbare », dans les « Quelques mots sur la non-intervention », il s’attache à montrer en quoi le principe de non-intervention ne peut s’appliquer aux peuples « barbares ».
Ainsi, ce que la lecture de ces textes nous semble révéler, c’est que la théorie de l’intervention militaire de John Stuart Mill est travaillée par un concept de « barbarie », qui, loin de renvoyer seulement à l’idée d’un ennemi de la civilisation qu’elle devrait subjuguer, subordonner, c’est-à-dire, au fond, civiliser, signifie également l’altérité nécessaire à son maintien – ou encore ce sans quoi elle ne pourrait que dégénérer.
*
* *
A la fin du chapitre IV de De La Liberté, Mill donne quelques exemples « d’empiètement illégitimes sur la liberté légitime de l’individu » (p. 200). Le premier est celui de l’intolérance dont font preuve certains individus à l’égard de ceux qui travaillent le dimanche. Le second, est celui du « langage de franche persécution » des Anglais à l’encontre des Mormons, et du projet des premiers « d’envoyer une expédition contre les Mormons et de les contraindre par la force à se conformer aux opinions des autres » (p. 203). Dans son article, Beate Jahn affirme que la contradiction entre ces lignes et la thèse défendue dans les « Quelques mots sur la non-intervention », repose sur une différence de point de vue. C’est de politique intérieure qu’il serait question avec les Mormons, et de politique extérieure dans les « Quelques mots » (p. 615). Une telle interprétation ne résiste pas à la lecture du premier texte, puisqu’il apparaît clairement que la communauté mormone, en dépit d’une certaine proximité culturelle avec ses persécuteurs – ils « parlent anglais » et « se disent chrétiens » (p. 203-4) – constituent une communauté séparée, avec laquelle les Anglais n’ont pas de « rapport » et qui vit « à quelques milliers de miles » (p. 205). Il n’est donc pas possible de rendre compte de la contradiction entre nos deux textes de cette manière, puisqu’il s’agit dans les deux cas de savoir si l’intervention chez les peuples barbares est légitime. Notons d’ailleurs qu’entre la manière dont Mill pense l’intervention « intérieure » et l’intervention « extérieure », il ne semble pas y avoir de rupture. Ici, la question de l’intervention de l’autorité dans les affaires individuelles et dans les affaires des communautés étrangères sont mises sur le même plan, et Mill passe sans solution de continuité de l’une à l’autre. En outre, on peut remarquer que dans l’Introduction de De La Liberté, lorsque Mill énonce son principe de non-intervention dans les affaires individuelles, il donne aussitôt des limites à ce principe : celui-ci ne vaudrait ni pour les enfants, ni pour les fous, ni pour les « barbares » (pp. 74-6). L’Introduction de De la Liberté, et les « Quelques mots » reposent donc sur un même geste : celui qui consiste à distinguer ceux à qui s’applique le principe des autres.
Or, les dernières lignes du chapitre IV semblent ne pas obéir à la même structure. En effet, ici, l’interdiction de l’intervention s’applique bien aux « barbares ». Il nous faut ici citer longuement le texte :
Un écrivain moderne, de grand mérite à certains égards, proposait récemment (pour reprendre ses propres termes) non pas une croisade, mais une civilisade (« civilizade ») contre cette communauté polygame, et cela pour mettre fin à ce qui semblait être un pas en arrière dans la marche de la civilisation. Je vois la chose de même ; mais je ne sache pas qu’aucune communauté ait le droit d’en forcer une autre à être civilisée. Tant que les victimes de la mauvaise loi ne demandent pas l’aide des autres communautés, je ne puis admettre que des personnes sans rapport avec elles, puissent intervenir et exiger la cessation d’un état de choses qui semble satisfaire toutes les parties intéressées, sous prétexte que c’est un scandale pour des gens vivant à quelques milliers de miles de là, et qui n’y ont aucune part et aucun intérêt. Qu’ils envoient des missionnaires, si bon leur semble, pour prêcher contre elle ; et qu’ils opposent au progrès de telles doctrines dans leur propre pays des moyens équitables (or imposer le silence aux novateurs n’en n’est pas un). Si la civilisation a vaincu la barbarie quand la barbarie dominait le monde, il est excessif de craindre qu’elle puisse revivre et conquérir la civilisation après avoir été défaite. Pour qu’une civilisation succombe ainsi à son ennemi vaincu, elle doit d’abord avoir dégénéré au point que ni ses prêtres, ni ses maîtres officiels, ni personne n’aient la capacité ou ne veuillent prendre la peine de la défendre. Si tel est le cas, plus vite on se débarrassera d’une telle civilisation, mieux ce sera. Elle ne pourra aller que de mal en pis, jusqu’à ce qu’elle soit détruite et régénérée (comme l’Empire romain d’Occident) par d’énergiques Barbares.[5]
Ce texte mériterait un commentaire approfondi. Nous nous contenterons ici de trois remarques. Premièrement, c’est la parenthèse qui doit retenir notre attention. Lorsque Mill affirme qu’ « imposer le silence aux novateurs » n’est pas un « moyen équitable » pour empêcher que la doctrine mormone ne progresse en Angleterre, il ne veut évidemment pas dire que les Mormons sont des « novateurs » : « personne ne désapprouve plus profondément que moi cette institution », écrit-il quelques lignes plus haut (p. 204). Pour comprendre cette incise, il faut se référer au Chapitre II de De La Liberté, où Mill défend le principe de la libre discussion. Il y montre qu’il n’est pas possible d’empêcher l’expression des doctrines fausses, d’un côté parce qu’ « il se peut que l’opinion qu’on cherche à supprimer soit vraie » (pp. 85-6) et qu’on ne peut prétendre à l’infaillibilité, et de l’autre parce que, même si cette opinion est effectivement fausse, la confrontation de la vérité à la fausseté est nécessaire pour maintenir la vérité « vivante » (p. 113). Une des raisons pour lesquelles une « civilisade »[6] n’est pas légitime consiste donc dans le fait qu’il est possible que les Mormons soient des « novateurs », autrement dit, que les barbares ne soient pas des barbares. On pourrait même aller plus loin, et se demander si, de même que Mill appelle de ses vœux le retour à la « logique négative », c’est-à-dire à la dialectique, comme moyen d’éprouver la vérité et de « parvenir à une connaissance digne de ce nom » (p. 129), les institutions « barbares », comme la polygamie, ne pourraient pas avoir pour fonction de redonner de la vitalité à nos doctrines morales. Tout se passe donc comme si Mill mettait ici en doute – certes de manière très discrète – la distinction entre les peuples « barbares » et les peuples « civilisés ». Comment maintenir cette distinction, en effet, lorsqu’on affirme par ailleurs l’impossibilité de rejeter une doctrine sous prétexte qu’elle nous paraît fausse, et qu’on fait preuve, à l’égard de ses opinions, d’une forme de scepticisme ? Il semblerait donc ici que ce soit sa conception de la vérité qui empêche Mill d’affirmer la légitimité de l’intervention contre les « barbares ».
Deuxièmement, il apparaît ici que les « barbares » ne sont pas à craindre. La « barbarie » aurait en effet déjà été vaincue par la civilisation, et si les peuples « barbares » peuvent toujours triompher localement des peuples civilisés, ceci ne constitue pas un danger pour la civilisation elle-même – à savoir le mouvement général de progrès qui affecte l’humanité. On est donc loin d’une figure de « l’autre » qui constituerait une menace militaire ou morale pour l’Occident. Contrairement à ce qu’affirme Beate Jahn, il n’est pas possible de faire remonter à Mill les théories de certains libéraux américains contemporains, pour qui « les immigrants, et les communautés musulmanes en particulier, représentent une menace potentielle pour le mode de vie libéral. », ce qui donnerait à l’Occident le droit d’intervenir pour défaire ces communautés (pp. 615-6).
Notons par ailleurs que la barbarie ne se définit pas pour Mill par sa violence ou son caractère belliqueux. Dans un article de 1836, « Civilization », Mill montrait que même si, pour les « sauvages » et les « barbares », la guerre était l’occupation « la plus sérieuse », ils ne pouvaient cependant triompher de la civilisation, étant incapables d’une action concertée et disciplinée :
Considérez même la guerre, l’occupation la plus sérieuse d’un peuple barbare ; voyez quel sort ont subi les nations primitives, demi-civilisées, ou esclaves, devant les nations civilisées depuis la bataille de Marathon. Pourquoi ? Parce que la discipline est plus puissante que le nombre, et que la discipline, c’est-à-dire la coopération parfaite, est un attribut de la civilisation.[7]
Dans les « Quelques mots », la barbarie ne représente pas davantage un danger. Si un gouvernement civilisé peut et doit parfois intervenir chez un peuple barbare, c’est uniquement lorsque ce peuple est un « voisin » et que ce voisinage est cause pour lui d’insécurité :
Un gouvernement civilisé n’est pas à l’abri d’avoir des voisins barbares (« barbarous neighbours ») : quand il en a, il ne peut pas toujours se contenter d’une position défensive, d’une position de pure résistance à l’agression. Après une période plus ou moins longue d’indulgence, il se trouve obligé, soit de les conquérir, soit de leur imposer une telle autorité, et par là de briser leur caractère à tel point qu’ils plongent progressivement dans un état de dépendance envers lui (…)[8]
Il ne s’agit donc pas, pour les peuples civilisés, de se lancer dans une « civilisade » contre la barbarie en général – mais plutôt d’attaquer préventivement des voisins barbares qui, parce qu’ils sont incapables d’adopter et de suivre des règles, sont imprévisibles et ne « jouent pas la réciprocité » (p. 276). On voit donc ici que dire que le principe de non-intervention ne s’applique pas aux peuples barbares, ne signifie pas que la civilisation aurait pour devoir de se lancer dans des croisades civilisatrices, mais plutôt que dans certaines circonstances, à savoir lorsque la proximité géographique est telle que les voisins barbares peuvent les priver de sécurité, les peuples civilisés peuvent les conquérir et les soumettre pour un temps. Depuis De la Liberté jusqu’aux « Quelques mots », il y a donc, sur ce point, continuité. Ce qui distingue les Mormons des peuples Indiens, dont il est question dans les « Quelques mots », et qui fait que l’intervention est interdite d’un côté et autorisée de l’autre, ce n’est pas un degré plus ou moins élevé de barbarie, mais simplement le nombre de « miles » qui les séparent chacun de l’Angleterre.
Troisièmement, nous avons dit plus haut que les institutions barbares, comme la polygamie, apparaissaient comme ce qui pouvait mettre à l’épreuve la vérité des institutions civilisées. Or, Mill franchit un pas de plus à la fin de notre texte, en affectant à la barbarie une véritable positivité : la barbarie est en effet présentée comme ce qui pourrait régénérer les peuples civilisés. L’idée d’une « dégénérescence » de la civilisation est présente dès l’article de 1836 que nous avons déjà cité, et elle appartient pleinement à la problématique de De La Liberté. Cette « dégénérescence », ou plutôt la menace de stagnation qui pèse sur les peuples civilisés, résulte de la disparition progressive de l’individu dans la « masse », ou encore de l’avènement du règne de l’opinion publique. Or, si la barbarie peut régénérer les peuples civilisés, et si elle l’a déjà fait dans l’histoire, c’est précisément parce qu’en elle le principe individuel est dominant. Sur ce point, il faut dire que la lecture de l’Histoire de la civilisation en Europe de Guizot[9], a été pour Mill déterminante[10]. Radicalement étrangers à la civilisation, par leurs mœurs ou par leur absence de vie politique, les Barbares apparaissent dès la seconde leçon de cette Histoire comme un élément essentiel du progrès. Pour Guizot, la civilisation européenne, succédant à la civilisation romaine, se distingue par la pluralité de ses principes. C’est la « diversité agitée » de ses principes, luttant sans cesse les uns contre les autres sans jamais parvenir à l’hégémonie, qui explique son progrès lent mais régulier. Les « Barbares » ont joué dans cette mutation historique, ou encore dans ce recommencement de l’histoire, un rôle essentiel : ils font partie, avec le principe « romain » et le principe « chrétien », de cette diversité qui tient la civilisation en éveil. Les « invasions barbares », qui se poursuivent jusqu’au Xème siècle (p. 79), sont la condition de possibilité du progrès de la civilisation.
Mais ce n’est pas le simple fait de leur différence qui constitue leur apport historique. Autrement dit, ce n’est pas parce qu’ils introduisent de la pluralité dans la civilisation qu’ils en sont le moteur. Ce qu’ils ont apporté à la civilisation, c’est le « sentiment de l’indépendance personnelle » :
Mais le sentiment de l’indépendance personnelle, le goût de la liberté se déployant à tout hasard, sans autre but presque que de se satisfaire, ce sentiment, je le répète, était inconnu à la société romaine, à la société chrétienne. C’est par les Barbares qu’il a été importé et déposé dans le berceau de la civilisation moderne. Il y a joué un si grand rôle, il y a produit de si beaux résultats, qu’il est impossible de ne pas le mettre en lumière comme un de ces éléments fondamentaux.[11]
C’est donc un principe d’individualité que les « énergiques Barbares » pourraient exporter et offrir à la civilisation. Tandis que la « civilisade », c’est-à-dire l’intervention des peuples civilisés chez les peuples barbares doit être prohibée, les invasions barbares, qui constituent bien une forme d’immixtion ou d’intervention chez les peuples civilisées, apparaissent comme ce qui rend possible le progrès de la civilisation, ou du moins ce qui empêche sa régression… Singulier renversement dont les « Quelques mots » ne conservent pas de trace, mais qui prouve que le rapport de la civilisation à la barbarie demeure pour Mill une question ouverte, ou équivoque.
*
* *
Qu’en est-il, dès lors, de la contradiction ou de la tension entre les deux textes que nous avons évoquée en commençant ? Et que nous apprend cette tension au regard de la question que nous avions posée au sujet de l’ « impérialisme » supposé de John Stuart Mill ?
Comme nous l’avons dit, il semble que les « Quelques mots » n’aient pas pour fonction d’appeler à une « civilisade », mais plutôt d’autoriser l’intervention dans quelques cas particuliers : lorsque nos « voisins barbares » menacent notre sécurité. En ce sens, il n’y a pas de contradiction entre les deux textes, mais bien plutôt une complémentarité. Ainsi, les « Quelques mots » ne formulent pas une autorisation générale à la colonisation, mais ils rendent possible une guerre qu’on pourrait dire « préventive » à l’égard de certains peuples, ceux qui sont géographiquement proches de nous, et avec lesquels nous avons quelques « rapports ».
Il reste bien sûr que la distinction entre peuples barbares et peuples civilisés, qui fonde cette exception au principe de non-intervention, est fortement problématique. Et, même si les nations barbares sont bien un des moteurs de la civilisation, il n’en reste pas moins qu’il leur serait « plus profitable d’être conquises et assujetties », ce qui leur permettrait de rentrer dans l’histoire (p. 276). Il semble que si l’anéantissement des peuples barbares n’est pas souhaitable, au sens où elle priverait la civilisation de la diversité qui est la condition de possibilité de son progrès, il vaut mieux pour une nation barbare d’être conquise et civilisée. Ainsi, dans les « Quelques mots », Mill renverse l’exemple de l’Empire romain, qui apparaissait dans De la Liberté, montrant peut-être par là une certaine résistance à penser jusqu’au bout les bienfaits des interventions barbares, mais aussi la réversibilité de l’idée selon laquelle les conquêtes barbares ont constitué un bienfait pour la civilisation. Autrement dit, loin de penser que l’âge des conquêtes est révolu, Mill leur assigne une fonction primordiale dans le progrès de la civilisation. Il écrit en effet : « Les Romains n’étaient pas des conquérants aux mains propres, et pourtant eut-il mieux valu pour la Gaule et pour l’Espagne, la Numidie et la Dacie, n’avoir jamais fait partie de l’Empire ? » (p. 277).
Il demeure également que si les « Quelques mots » visent simplement à affirmer qu’on peut légitimement prévenir les attaques barbares en s’immisçant dans leurs affaires intérieures, la question qu’ils ne posent pas est celle de savoir comment les barbares sont devenus nos voisins. L’exemple que donne John Stuart Mill dans l’article de 1859 est à ce titre assez éloquent. En effet, les « voisins » chez lesquels le Gouvernement britannique aurait le droit d’intervenir ne sont autres que les États indiens autochtones. Pour assurer sa sécurité, explique Mill, le Gouvernement des Indes britanniques aurait été amené à intervenir contre ces États et à leur retirer progressivement leur autonomie. Mill cherche en fait ici à légitimer la théorie du « lapse » généralisée par Dalhousie, gouverneur des Indes britanniques de 1848 à 1856[12]. Or, il ne peut le faire qu’en passant sous silence le fait de la conquête, par lequel les Anglais sont devenus les voisins des princes indiens. Il nous semble que c’est sur ce point, plutôt que sur la distinction entre peuples barbares et peuples civilisés, qu’il faudrait se pencher si on cherchait à sonder la nature « impérialiste » de la théorie de John Stuart Mill – à savoir sur le geste par lequel il néglige ou dénie la question de l’origine. Tout se passe en effet comme si l’origine de la présence en Inde n’avait pas à être interrogée et comme si la conquête pouvait être le fondement légitime d’un gouvernement. En ce sens, on peut dire qu’il refuse la thèse lockéenne selon laquelle « les conquêtes sont aussi éloignées d’être l’origine et le fondement des États, que la démolition d’une maison est éloignée d’être la vraie cause de la construction d’une autre en la même place » (p. 274).
Certes, Mill ne dit pas que les nations civilisées, c’est-à-dire européennes, ont le droit d’exporter la civilisation où bon leur semble, dans une « civilisade » universelle. Cependant, en faisant comme si la présence anglaise en Inde ou la présence française en Algérie allait de soi, et autorisait les gouvernements à se prémunir de la menace de leurs voisins barbares, il rend possible, par voie de conséquence, l’expansion territoriale européenne.
Aurélie Knüfer
[1] John Stuart Mill, « Quelques mots sur la non-intervention », trad. N. Dubos, in Le Mal extrême, La guerre civile vue par les philosophes, Paris, CNRS Editions, 2010, p. 276. Une autre traduction est disponible en français : celle de P. Alexandre, in Commentaire, n°74, 1996, pp. 423-433
[2] Nous nous réfèrerons principalement ici à l’article de Beate Jahn, “Barbarian thoughts : imperialism in the philosophy of John Stuart Mill”, in Review of International Studies, Vol. 31, 2005, pp. 599-617. Cette question est également abordée dans un article de Mark Tunick, “Tolerant imperialism: John Stuart Mill’s Defense of Brithish Rule in India”, in The Review of politics, Vol. 68, 2006, pp. 586-611. Dans une autre perspective, on pourra lire Arthur Isaak Applbaum, “Forcing a People to be free”, in Philosophy and Public Affairs, vol. 35, 2007, pp. 359-400
[3] Michael Walzer, par exemple, qui consacre plusieurs pages à « l’argument de John Stuart Mill » dans Guerres justes et injustes, passe sous silence ce premier moment. (trad. S. Chambon et A. Wicke, Paris, Gallimard, 2006, pp. 183-190). Il en est de même dans un article plus récent, « The Moral standing of the state : A response to four critics », Philosophy and Public Affairs, 9, 1980, pp. 209-29.
Dans un entretien avec D. Barsamian, Noam Chomsky évoque l’article de John Stuart Mill et il affirme qu’aux États-Unis « tout le monde l’étudie dans les facultés de droit » (in La Doctrine des bonnes intentions, trad. P. Chemla, Paris, Fayard, 2006, p. 69). Or, si cet article est bien connu, c’est le contexte de sa rédaction qui le serait moins : « Le moment où John Stuart Mill fait ces remarques est très intéressant. Il a écrit cet essai vers 1859, juste après la Révolte indienne (…). Les barbares ont osé relever la tête. Les Indiens se sont révoltés contre la domination de la Grande-Bretagne, et les Britanniques ont écrasé leur soulèvement avec la plus extrême violence, la dernière brutalité (…). Mais John Stuart Mill, au plus fort de la répression du soulèvement, a décrit la Grande-Bretagne comme une puissance angélique. » (pp. 69-70)
[4] John Stuart Mill, De la Liberté, trad. L. Lenglet, Paris, Gallimard, 1990, pp. 202-6
[5] John Stuart Mill, Op. Cit., pp. 205-6
[6] Nous n’avons pas réussi à déterminer quel est « l’écrivain moderne de grand mérite » à l’origine de ce néologisme. C’est à notre connaissance la seule occurrence de ce terme dans l’œuvre de John Stuart Mill.
[7] John Stuart Mill, « Civilization », in Essays on politics ans Society, Collected works, vol. XVIII, P. 122 (nous traduisons)
[8] John Stuart Mill, Op. Cit., pp. 276-7
[9] François Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, Paris, Librairie académique, 1863 [1830]
[10] Mill a rédigé deux recensions de ce texte. La première en 1836 : « Guizot’s lectures on European civilization » ; la seconde en 1845: « Guizot’s essays and lectures on history », in Essays on French History and Historians, Collected works, vol. XX
[11] François Guizot, Op. Cit., pp. 61-2
[12] On peut lire dans l’article que Roland Marx consacre à Dalhousie dans l’Encyclopédie Universalis : « (…) il cherche à supprimer l’écran que constitue pour l’administration de la Compagnie le pouvoir de certains princes autonomes : sans en être l’inventeur il recourt systématiquement à la doctrine du lapse qui permet de faire tomber dans le giron anglais tout territoire dont le souverain serait mort sans héritier ; il la complète en ne reconnaissant pas l’adoption comme procédé de succession et en déclarant nul tout héritage d’un prince adopté : ainsi peut-être annexé l’État de Nagpour peuplé de 4 millions d’habitants, et du coup l’inquiétude gagne de très nombreux princes sans enfant. Parfois aussi on invoque la mauvaise gestion d’un territoire, c’est le cas en 1856 pour l’État encore plus grand d’Oudh et sa capitale Lucknow. »



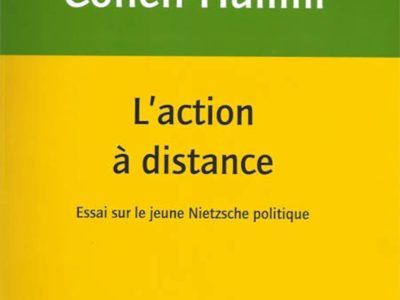











Bonjour,
Merci pour ton article qui m’a fait découvrir ce texte sur la non-intervention de Mill que je ne connaissais pas.
Je suis comme toi doctorant à Paris 1 et je travaille sur A. Comte.
Pour abonder dans ton sens, j’ajouterais que le dernier chapitre sur le gouvernement représentatif reprend la distinction entre peuples barbares et civilisés dont tu traites.
Cordialement,
Tonatiuh USECHE