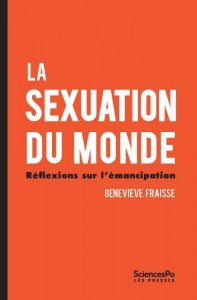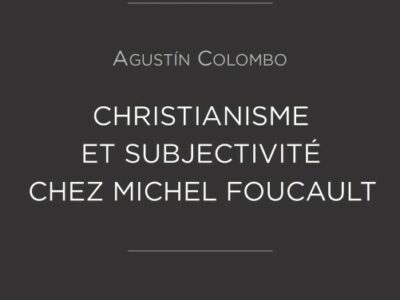Geneviève Fraisse, La sexuation du monde
Recension de l’ouvrage de Geneviève Fraisse, La Sexuation du monde. Réflexions sur l’émancipation, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, par Nathalie Rubel, professeure certifiée de philosophie.
L’ouvrage réunit onze contributions que Geneviève Fraisse a produites entre 2010 et 2013 : quatre communications, six articles, ainsi qu’une conversation avec l’artiste libanaise Marwa Arsanios. L’ensemble, ainsi que chacune des deux parties de l’ouvrage, font l’objet d’introductions successivement intitulées « Toutes et chacune », « Pour toutes », « Pour chacune ». C’est explicite : il est question de l’articulation de l’un, l’une, et du multiple ; du statut des femmes singulières, intellectuelles ou artistes, et de celles unies par les liens de l’amitié ou de l’engagement politique, dans des sociétés qui, tout en les mettant parfois sur un piédestal, peinent – encore – à les reconnaître comme des sujets et des citoyennes à part entière. Or s’il est une idée qui a fait son temps, c’est bien que les préjugés quant au sexe n’étaient qu’une anomalie marginale qui ne comptait pas, car à l’ère démocratique les femmes comptent. Et elles savent (se) compter, d’autant plus qu’elles ont accédé à l’instruction. Et elles s’étonnent que la modernité ait fait droit à l’égalité des hommes, mais pas à l’émancipation des femmes qui n’ont pas fini de se défaire des rapports de domination. « L’universel ment souvent »[1].
Un terrain de recherche original
Fraisse aborde cette question de la place des femmes dans la société d’une façon originale. Elle a depuis toujours choisi un autre terrain que celui des sciences sociales. Il ne sera donc pas question des obstacles à l’accès au pouvoir, des représentations culturelles et de la re/production des normes de genre, ni même du débat différentialisme vs universalisme, sinon pour s’en démarquer. Sans nier la fécondité du mot « genre », qui contribue à dénaturaliser le sexe, G. Fraisse préfère conserver le mot de « sexe », qui dit mieux la chose et ouvre sur la puissance de l’éros. L’historicisation de la notion permet par ailleurs de faire tomber le préjugé qui veut que de tout temps, les femmes et les hommes, c’est « comme ça ». Le titre de l’ouvrage, La Sexuation du monde, renvoie ainsi à la production au cours de l’histoire (non linéaire) des rapports de sexe publics et privés, car le sexe n’échappe pas à l’historicité, même s’il échappe à nombre d’historiens.
Quant au sous-titre, Réflexions sur l’émancipation, il balise aussi ce terrain de recherche que G. Fraisse a depuis longtemps choisi, et peut-être même produit, étant tout à la fois philosophe et historienne de la pensée féministe mais également historienne de la création artistique. Créer, quand on est femme, amène à réfléchir sur sa condition. Elle se préoccupe de nommer, de valider des concepts et de problématiser le champ de recherche du féminisme, trop souvent réduit en philosophie à l’affect et à l’opinion. Ainsi, le mot « émancipation » dit le travail pour identifier la domination et l’effort pour s’en défaire, les finalités et les stratégies de l’engagement, le rapport subversif à l’ordre. Il dit aussi le désir de changement et la jouissance à se faire exister, la créativité à l’œuvre, seul-e ou avec les autres. Mais pour dénoncer l’idéologie mensongère de l’universalité des droits, G. Fraisse a produit deux concepts originaux qu’elle développe successivement dans ses deux parties : le contretemps et le dérèglement. Le contretemps, ou : comment penser la prétendue – mais persistante – inactualité de la question féministe ? Le dérèglement, ou : comment penser le surgissement d’expressions originales ? « Pour toutes », le contretemps. « Pour chacune », le dérèglement.
En outre, l’ouvrage a ceci d’intéressant que plusieurs entrées de lecture en sont possibles. Elles témoignent de la variété des recherches de G. Fraisse et réfléchissent toujours les conditions pratiques et théoriques de l’existence. En effet, en dérangeant l’ordre éditorial, on pourrait distinguer une première entrée d’histoire des idées dans un dialogue avec les philosophes Poulain de la Barre (chapitre 1), Rousseau (chapitre 2) ou Jacques Rancière (chapitre 4), autour de la difficulté de penser la domination masculine. Une deuxième entrée concerne certains débats récurrents de l’histoire de la pensée féministe, comme les partitions privé/public ou sexe/genre, dans lesquels G. Fraisse assume une position assez minoritaire (chapitres 2, 3 et 5). Une troisième entrée est d’ordre épistémologique et porte sur la méthode de Poulain de la Barre (chapitre 1) ou la question de l’« intersectionnalité des catégories » et le choix des mots pour dire les choses (chapitre 3). Enfin, une quatrième entrée est esthétique : il est question de la jouissance (chapitres 6, 9 et 10) et de la représentation plastique ou théâtrale du sexe (chapitres 6 et 7), des liens (chapitre 8), de la violence et du crime (chapitres 10 et 11). Par ailleurs, à cette variété d’approches, s’ajoute l’audace des deux chapitres discutant les thèses de « familiers », comme le fut bien sûr sa mère Simone Fraisse et comme l’est toujours Jacques Rancière. Les chapitres seront cependant présentés ici selon l’ordre de leur publication et le sens qu’il leur confère.
« Pour toutes », le contretemps
Dans le premier chapitre, G. Fraisse montre la manière dont la modernité de la méthode de Poulain de la Barre dans De l’égalité des sexes (1673) le conduit à mettre en procès le préjugé de sexe. Intitulée « Poulain de la Barre, un logicien de l’égalité. Temps du préjugé et sexe de l’esprit », cette communication de 2012 relie la rupture épistémologique du cartésianisme, qui introduit l’analyse rationnelle et critique des préjugés traditionnels, à la rupture politique de la pensée de l’égalité. Il fallait n’être d’aucun temps pour penser dans l’universel et se défaire des préjugés (sous-titre du livre). « L’esprit est de tous sexes » disait déjà Fléchier en 1665, Poulain de la Barre renchérit : « L’esprit n’a point de sexe », et les femmes, comme les hommes, doivent avoir accès au savoir, à l’exercice non borné et à l’expression de leur raison. On ne comprit pas son rationalisme féministe. Beaucoup n’y virent que la galanterie d’un honnête homme, incapables qu’ils étaient de penser au-delà de leur temps et de leur sexe.
Le chapitre 2, consacré à Rousseau, reprend Les Deux gouvernements : la famille et la cité (2000) pour un hors-série du Monde de 2012 intitulé « Rousseau, et les “moitiés” de la République ». G. Fraisse y interroge un paradoxe apparent. Comment le philosophe du Contrat social, texte fondateur de l’État moderne, en rupture avec la tradition patriarcale et toutes les servitudes, a-t-il pu cautionner un statut à part pour les femmes ? La séparation du civil et du domestique permettait d’imaginer l’égalité républicaine de tous les citoyens. Mais en retour, elle donnait aussi à interroger l’inégalité des petites sociétés privées que sont les couples et les familles. Or « la précieuse moitié de la République » devait y rester à sa place. G. Fraisse suggère que Rousseau était conscient des conséquences de son régime de séparation et qu’il a volontairement semé le trouble (et éparpillé ses propos sur les sexes) pour retarder le progrès de l’égalité des sexes dans les espaces publics et privés. Contretemps de la démocratie universelle et néanmoins exclusive.
Dans « Voir et savoir. La contradiction des égalités », publié en 2013 par la revue internationale d’études féministes Labrys, G. Fraisse produit un texte épistémologique assez normatif. Puisque l’obstacle majeur que rencontre le féminisme est la tradition prétendument anhistorique, elle soutient que la voie de recherche la plus féconde est la mise au jour de l’expérience et de l’histoire de l’émancipation : « Ma seule ambition philosophique est de convaincre de l’historicité des sexes »[2]. En conséquence, elle propose l’abandon épistémologique d’autres axes de recherche comme la déconstruction de la différence des sexes et la définition du sujet de l’émancipation, axes qui maintiennent dans l’ornière de la domination. La critique des stéréotypes de genre peut conduire à asexuer ce qui est sexué (par exemple le travail du care) ; les logiques catégorielles, inspirées de l’anthropologie kantienne, produisent quant à elles des assignations identitaires qui contraignent à une intersectionnalité croissante qui empêche en dernière instance de comprendre le mouvement si singulier de l’histoire des femmes. L’enjeu théorique est toujours en même temps pratique et politique pour Fraisse.
Le chapitre 4 est un texte vraiment singulier, tout à la fois hommage à Jacques Rancière, le philosophe, l’ami, et disputes intellectuelles, malgré la proximité. Fraisse et Rancière se connaissent depuis longtemps, ils ont cofondé Les Révoltes logiques en 1975, comme une forme d’engagement auprès des dominés en lutte pour leur émancipation. Mais G. Fraisse rapporte une dispute autour de la parution du volume IV de l’Histoire des femmes en Occident où, en faisant le reproche de s’intéresser au mouvement général du XIXe siècle, « Rancière paraissait contourner la confrontation entre émancipation et domination »[3] qui y était à l’œuvre. Surtout, sa dépolitisation des affaires de foulard islamique et sa dénonciation d’une laïcité républicaine crispée, ont paru incompréhensibles à G. Fraisse qui dénonce a contrario la domination masculine à l’œuvre dans les religions et la nécessité pour les filles de s’émanciper grâce à l’école et aussi par les activités physiques et sportives qui y sont dispensées. Elle conclut sur le double, ou même triple, terrain intellectuel (théorique et pratique) et amical : « ‘‘Connaître’’ la domination, c’est accepter la contradiction, avec le plus proche »[4].
Le dernier chapitre de la première partie est la transcription de l’intervention conclusive au Congrès international féministe de Paris, qui s’est tenu en décembre 2010. Il est intitulé « La commune mesure : le MLF a 40 ans », afin de rendre concrète l’idée du féminisme, dans la pluralité de ses approches et sans nier les conflits politiques et épistémologiques qui le traversent. G. Fraisse relève trois axes problématiques dans le Congrès : la question de la radicalité et de la subversion, la question du rapport entre domination et émancipation, la question de la pratique des concepts de liberté et d’égalité. Cela lui donne l’occasion de critiquer certains usages des termes et locutions : « genre », « patriarcat » et surtout « instrumentalisation des femmes » qui nie leur subjectivité tout autant que leur puissance d’émancipation. G. Fraisse préfère parler de « monnaie d’échange »[5] dans un système dominé par les hommes. Elle réexplicite aussi son concept de « contretemps », quand les revendications de disposer de son corps font écho à l’Habeas corpus du XVIIe siècle ou que la revendication d’égalité face à l’instruction et à la citoyenneté n’est pas entendue au siècle qui la fonde dans l’universel.
« Pour chacune », le dérèglement
La deuxième partie de l’ouvrage est consacrée à ces femmes singulières, artistes et intellectuelles, qui depuis deux cents ans ont été capables de « dérégler la tradition »[6]. Par leur puissance de création, elles ont déjoué les mécanismes de l’ordre établi, franchi des frontières, sans pour autant être toujours conscientes de la portée féministe et donc politique de leur génie.
Le chapitre 6, intitulé « Le dérèglement des représentations » et publié dans les actes du colloque Le genre à l’œuvre de septembre 2011, analyse ainsi quatre disputes des deux derniers siècles. Il s’agit d’abord du droit à être poète et non seulement muse, à l’image de Constance de Salm déclarant « Les arts sont à tous ainsi que le bonheur »[7]. Ensuite, le droit de copier le nu (masculin), supposant la capacité à « voir le vrai » par elles-mêmes, le droit de s’expliquer rationnellement sans être ramenée à des considérations psychologiques ou hystériques. C’est enfin l’enjeu de l’engendrement et de l’identification de la production à la reproduction qui est soulevé, par un retour sur l’accusation de « plagiat psychique » de Marie Darrieussecq par Camille Laurens autour (du récit) de l’enfant mort. L’histoire des femmes peut toujours être lue comme l’histoire des dérèglements infligés à l’ordre dominant.
Les deux chapitres suivants peuvent être rapprochés en ce qu’ils sont une réflexion sur la représentation plastique des activités des femmes. Dans l’article publié pour le catalogue de l’exposition Sculpture’ELLES, Fraisse interroge plutôt la représentation des femmes artistes. Le tableau éponyme de Layraud (1890) comme la Femme sculpteur au travail (1905) de Bourdelle, montrent une sculptrice tenant la masse ou le marteau et accomplissant un travail de force d’ordinaire dévolu aux hommes. Même au repos, contrairement aux modèles féminins objectivés et assignés à la passivité, elles témoignent de leur puissance créative, en ressourcement. Peu à peu, les femmes artistes gagnent du terrain dans les représentations et les institutions (avec l’autorisation d’entrer aux beaux-arts).
Dans l’article « Causer ou bavarder, à deux ou à plusieurs, à propos d’un tableau de Vuillard », Fraisse présente une autre exposition imaginaire, faite de tableaux où des femmes sont ensemble et se parlent. De Vuillard, elle étudie La causette (1893), Deux ouvrières dans l’atelier de couture (1893), de Pissaro une Étude pour la causette (v. 1892), de Vallotton La maîtresse et la servante (1897), et enfin de Camille Claudel, la sculpture Les bavardes (ou Les causeuses). On regrettera la reproduction en noir et blanc de tableaux de si grands coloristes. Comme les titres l’indiquent, les femmes ici représentées ont en général délaissé les activités utilitaires et honorables à l’exemple des travaux de couture. Elles ne semblent rien faire d’autre que bavarder. Mais qu’on ne s’y trompe pas. Quand les femmes se parlent, même sur le mode de la causette, peut naître le monde commun de demain. Souvenons-nous que les mots font les liens et que de la causette à la causerie, de la conversation à la discussion, « la sexuation du monde passe aussi par le partage des mots »[8].
Le chapitre 9 s’intitule « Simone de Beauvoir : Étude, souffrance, jouissance » et a été publié en 2011 dans un numéro de L’Homme et la Société consacré à « Simone de Beauvoir et la psychanalyse ». G. Fraisse s’aventure sur ce terrain moins familier avec ses propres ressources : l’enquête historique et l’analyse philosophique et politique. Elle met en évidence l’originalité de Beauvoir, qui tient au moins à deux aspects : elle part du général et non du singulier (ses Mémoires suivent Le Deuxième sexe), et elle part de la jouissance et non de la souffrance intellectuelle, de l’ascèse. Beauvoir jouit de vivre, jouit de lire et d’écrire, ce qui n’est pas sans rappeler Constance de Salm et l’étude est pour elle la vie même. Cela ne manque pas de bouleverser certains repères habituels à la psychanalyse. Selon G. Fraisse, on ne trouvera chez Beauvoir ni manque ou désir transgressif, ni limite ou crainte d’éventuels dangers, ni attente ou espérance conquérante ou consolatrice. L’éros s’exprime unifié et en grande liberté.
La communication intitulé « Simone de Beauvoir, Simone Weil, Simone Fraisse. Le temps historique de la pensée des femmes », publiée dans les Cahiers Simone Weil en 2010, prolonge cet étonnement, et cette fascination aussi, devant des figures d’exception dans l’histoire, dont la propre mère de l’auteur. Plus encore, ces femmes ont fait l’histoire car elles incarnent une génération pionnière, parmi les premières bachelières, les premières agrégées, les premières intellectuelles qui ne sont pas sommées de se justifier. G. Fraisse remarque qu’elles ont non seulement conquis cette place jusqu’alors refusée aux femmes, mais ont entrepris sans tarder de la réfléchir par exemple en questionnant leur privilège. Elle souligne néanmoins l’écart entre l’évidence de leur ambition intellectuelle et l’inévidence de leur statut au regard de l’histoire. Notamment, elle pointe que l’article consacré par Simone Fraisse à « Simone Weil vue par Simone de Beauvoir » (1985) est centré sur la question métaphysique du crime et du mal et non sur la question féministe de l’histoire des femmes. G. Fraisse conclut : « Mon hypothèse est que cet écart est tellement grand qu’il passe quasiment inaperçu. La rupture historique est insue, impensée »[9].
Le dernier chapitre transcrit une conversation tenue en décembre 2013 avec Marwa Arsanios (et parue dans Suspended spaces #3) autour de la question de la représentation des femmes combattantes et ce que cela dit de l’égalité des sexes. L’artiste libanaise évoque un premier étonnement à la lecture du magazine Al-Hilal alors publié en Égypte (sous Nasser) : la combattante algérienne Djamila Bouhired, en treillis et fusil, y était devenue une icône de la libération non seulement des peuples colonisés, mais des femmes. Arsanios évoque ensuite les obstacles contemporains à mettre en scène sa performance Have you ever killed a bear?, faute de combattante pourrait-on dire, c’est-à-dire faute de comédienne capable d’assumer le rôle d’une femme violente. Fraisse s’intéresse au dérèglement produit par les combattantes, elles aussi « hors catégories », et rappelle que par un décret de 1793 interdiction est faite aux femmes d’aller à la guerre, tandis qu’on ferme les clubs de femmes et les clubs de citoyennes. Penser l’émancipation des femmes, c’est aussi penser leur droit à faire l’histoire, éventuellement par la violence, et être capable de voir et d’écouter – comme a su si bien le faire Svetlana Alexievitch – celles qui ont pris les armes.
La Sexuation du monde aide à comprendre pourquoi l’émancipation des femmes, contrairement à celles des esclaves ou des colonisés, n’est toujours pas accomplie. C’est que les femmes sont prises dans une historicité particulière, faite depuis deux siècles de contretemps liées à leur assignation réitérée au privé. G. Fraisse insiste sur la fécondité politique des dérèglements produits par les femmes de génie. Si, en effet, elles n’ont pas toujours une conscience féministe, elles sont la preuve vivante de la contingence du monde et donc de la possibilité de l’émancipation. Cela désigne tout autant un projet existentiel et politique qu’un programme féministe de recherches : portant sur les femmes, mais hors catégories.
G. Fraisse choisit par conséquent un positionnement original en se décalant d’autres approches politiques et féministes ici simplifiées à l’extrême : essentialistes ou naturalistes (« naître – en – femme »), universalistes formalistes (« naître Homme »), ultralibérales (« n’être que soi »), mais aussi, et c’est alors plus explicite et polémique : socialistes (« être utilisées en femmes », comme classe sexuelle) ou surtout déconstructionnistes et artificialistes (« se défaire femme », comme genre sexuel). Geneviève Fraisse pense au contraire que l’histoire des femmes nous apprend que chacune est un sujet sexué, toujours déjà en lien avec les autres, femmes et hommes, d’abord par les mots, et assez puissante pour affirmer son éros contre toutes les formes de domination.
[1] Geneviève Fraisse, La sexuation du monde, Paris, Presses de Sciences Po, 2016, p. 46. Des formulations équivalentes se retrouvent deux fois dans l’introduction, p. 7 et p. 11.
[2] Ibid., p. 36.
[3] Ibid., p. 58.
[4] Ibid., p. 67.
[5] Ibid., p. 73.
[6] Ibid., p. 81.
[7] Ibid., p. 90. Voir aussi les nombreuses occurrences dans Fraisse, Muse de la raison, Aix-en-Provence, Alinéa, 1989.
[8] Ibid., p. 125.
[9] Ibid., p. 143.