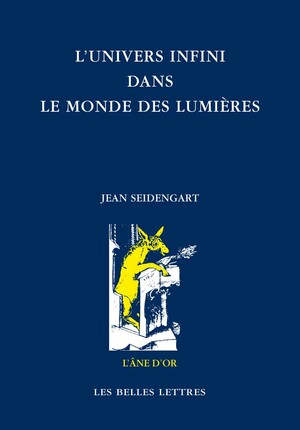Le libre-arbitre à la croisée des neurosciences et de la psychanalyse.

Le problème du libre-arbitre se trouve aujourd’hui réactualisé par les découvertes faites dans le domaine des « neurosciences ». Ce terme fut inventé au début des années soixante-dix pour permettre un échange multidisciplinaire entre divers champs du savoir s’attachant à l’étude du cerveau: physiologie, génétique, pharmacologie, chimie, biophysique, psychologie. Des expériences telles que celles de Benjamin Libet[1] ont ainsi prétendu donner une réponse à la question que les philosophes se posent depuis l’Antiquité: sommes-nous libres ou bien déterminés? Libet et ses collaborateurs ont mis en place un protocole expérimental permettant d’étudier, grâce à des électrodes implantées dans le cerveau des sujets, les corrélats neuronaux d’un acte volontaire simple, tel que la flexion d’un doigt. Ils ont ainsi comparé l’instant où le sujet rapporte verbalement son intention d’agir, avec l’instant où un événement cérébral se produit pour préparer au mouvement. Or, ces expériences ont montré que le processus cérébral (appelé « readiness-potential ») se produit quelques centaines de millisecondes avant la prise de conscience du sujet. D’où la conclusion, formulée par Libet et ses collaborateurs, que le libre-arbitre, en tant que capacité d’initier une nouvelle chaîne causale, n’existe pas. La cause de l’acte serait en réalité le processus cérébral en lui-même, et non la prise de conscience, qui apparaît plus tardivement. Néanmoins, Libet fait l’hypothèse d’un « droit de veto » qui permettrait au sujet d’empêcher la production de l’acte. Dans l’intervalle de temps qui sépare la prise de conscience de l’intention d’agir, de l’acte lui-même, le sujet pourrait ainsi à tout moment décider de « ne pas » agir. Ce droit de veto serait-il tout ce que nous pouvons sauvegarder de notre « libre-arbitre », au vu des expériences neuroscientifiques?
Ces expériences ont été vivement débattues et sont loin de prêter à consensus. Elles laissent entrevoir toutefois le fond du problème, à savoir les rapports qu’entretiennent le cerveau et l’esprit, si tant est que nous puissions admettre l’existence de ces deux entités distinctes. Le matérialisme scientifique[2] ambiant semble plutôt nous inciter à réduire entièrement l’esprit aux mécanismes cérébraux qui le sous-tendent, en faisant de la conscience réflexive un simple épiphénomène de la réalité matérielle qui compose notre cerveau. Or, même si l’on admet ce présupposé matérialiste, ne peut-on néanmoins invoquer le rôle causal que pourrait avoir cette conscience « émergeant » de la matière sur des mécanismes neuronaux plus fondamentaux? La complexité de l’objet-cerveau permet en effet d’entrevoir la possibilité de se situer à différents niveaux d’étude, et de laisser ainsi la place à des phénomènes émergents qui pourraient jouer par eux-mêmes un rôle causal, c’est-à-dire rétroagir sur les niveaux inférieurs. Loin d’ « éliminer » le statut propre de la conscience, elle pourrait dès lors subsister sous la forme d’un niveau de complexité supérieur, tout aussi digne d’étude que les mécanismes neuronaux qui sont à la base du fonctionnement cérébral.
Pour éclairer cette question du réductionnisme de l’esprit au cerveau, ou « réductionnisme psychophysiologique », qui semble être au cœur du problème du libre-arbitre, il est aujourd’hui particulièrement intéressant de mettre en parallèle les disciplines regroupées sous le nom de neurosciences avec la théorie psychanalytique, dans ses diverses acceptions contemporaines. Cette dernière semble en effet s’opposer aux neurosciences en ce qu’elle traite le fonctionnement psychique dans son versant subjectif, en première personne. L’objet d’étude y est davantage le « mental » que le « cérébral », et l’importance y est accordée aux événements psychiques et aux interprétations que peut en faire le sujet lui-même, avec l’aide de son thérapeute. A première vue, il semblerait donc que la psychanalyse ne soit pas réductionniste, et conserve non seulement toute leur réalité aux événements mentaux, mais leur attribue également un rôle causal, sans lequel toute la théorie psychanalytique s’effondrerait. Néanmoins, il est intéressant de voir que cette position non-réductionniste n’implique pas la reconnaissance du libre-arbitre, bien au contraire. Un déterminisme strict y était pleinement assumé chez Freud, avec l’importance accordée à l’instance psychique qu’il nommait Inconscient, et la théorie de son influence sur nos états mentaux conscients.
Ainsi, et paradoxalement, psychanalyse et neurosciences se rejoignent sur la question du libre-arbitre, malgré leurs divergences d’approches. Que l’on étudie les phénomènes « mentaux » ou bien les processus « cérébraux », l’homme semble être entièrement déterminé par des événements sur lesquels il n’a aucune prise. Toutefois, et peut-être doit-on profiter de cette brèche ouverte au sein du déterminisme, la psychanalyse ne vise-t-elle pas, à terme, un changement de comportement, un mieux-être, une meilleure conformité à soi qui seraient le signe de l’existence, in fine, d’une forme de libre-arbitre? Au sein d’un univers régi par des lois déterministes strictes, toute forme de changement ou d’amélioration seraient impossibles. D’où vient donc que la psychanalyse prétend opérer une telle modification? Doit-on la penser désormais à l’aune des sciences physiques contemporaines, à l’image du chaos déterministe qui par une modification infime des conditions initiales provoquerait une réorganisation en profondeur de la vie psychique ?[3] Quelle serait alors la place de notre libre-arbitre au sein de cet univers qui réintègre l’aléatoire ?
L’enjeu d’une confrontation entre ces deux disciplines aux méthodologies opposées est bien une refonte du concept de libre-arbitre qui tiendrait compte à la fois des prétentions de la psychanalyse à induire un changement psychique et des découvertes récentes faites dans le domaine des neurosciences. A travers la notion de plasticité synaptique, ces dernières ont d’ores et déjà pris leurs distances vis-à-vis d’un déterminisme strict, et ouvert le champ des possibles. Reste à savoir qui de l’organe matériel ou du « soi » psychique tient en dernière instance les rênes. Mais à trop vouloir plaquer les distinctions conceptuelles propres à nos divers champs de savoir sur notre être même, ne risquons-nous pas de sombrer dans la schizophrénie ?
Krystèle Appourchaux
Cet article reprend les axes de recherche d’une thèse de doctorat menée actuellement par l’auteur
[1] Voir Benjamin Libet et al., Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential), Brain 1983 ; 106 ; 623-642.
[2] Pour un aperçu de cette posture poussée à son extrême, sous la forme du « matérialisme éliminativiste », voir : CHURCHLAND, Patricia S. Neurophilosophie. L’esprit-cerveau. Paris, PUF, 1999.
[3] FAURE-PRAGIER, Sylvie et PRAGIER, Georges. Repenser la psychanalyse avec les sciences. Paris, PUF, 2007