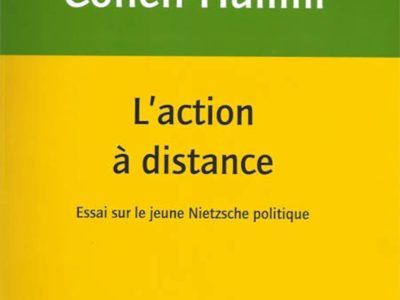La constitution des hiérarchies culturelles
le projet de démocratisation de la culture en question à la lumière de l’ouvrage de Lawrence Levine :
Culture d’en haut, culture d’en bas.
« Nous avons tendance à oublier facilement l’idée selon laquelle les mêmes formes de culture peuvent remplir des fonctions manifestement différentes dans des périodes ou des groupes différents. »
Levine Lawrence, Culture d’en haut, culture d’en bas, p.251.
« A rebours de la pente « mainstream » de Times Square, la direction des affaires culturelles de New York, comme des centaines d’agences artistiques publiques dans tous les Etats américains et toutes les villes, finance donc la culture de qualité, les films exigeants plutôt que les productions grand public (« movies »), le théâtre littéraire plutôt que le théâtre commercial, les comédiens plutôt que les acteurs, et tout ce qu’on préfère appeler, aux Etats unis, les « arts » plutôt que la « culture ». »
Martel Frédéric, De la culture en Amérique, p.10
Comme nous l’explique Frédéric Martel dans son imposant et riche ouvrage De la culture en Amérique les Etats-Unis possédent leurs politiques en matière d’art et de culture. Et « l’exception culturelle » consistant à soustraire certains biens culturels aux règles classiques du marché, ne serait en réalité pas propriété exclusive de la France. Un important secteur culturel non marchand, fonctionnant grâce à de riches mécènes, des agences artistiques, existe aux Etats-Unis et prend en charge ce qu’il est convenu l’art :
« A rebours de la pente « mainstream » de Times Square, la direction des affaires culturelles de New York, comme des centaines d’agences artistiques publiques dans tous les Etats américains et toutes les villes, finance donc la culture de qualité, les films exigeants plutôt que les productions grand public (« movies »), le théâtre littéraire plutôt que le théâtre commercial, les comédiens plutôt que les acteurs, et tout ce qu’on préfère appeler, aux Etats unis, les « arts » plutôt que la « culture[1] ».
La première politique culturelle américaine d’ampleur fédérale date de 1964 ; date de création du NEA (National Endowment of the Arts) première agence artistique (de nombreuses existent aujourd’hui au niveau des Etats). Alors même que l’Etat français, à cette époque, entame une planification culturelle, l’objectif du NEA est au contraire d’éviter toute intervention étatique, tout choix en matière culturelle. Cette agence fut cependant plus volontariste sous la présidence de Nixon ; lorsqu’elle fut dirigée par Nancy Hanks qui inscrivit dans ses priorités l’éducation artistique. « Presque toute l’action du NEA sous Nancy Hanks a (…) visé à élargir le public de la culture. On estime que 50 % du budget global de l’agence de cette époque sont consacrés à la démocratisation culturelle. » Cela s’est alors traduit par de l’aide donnée aux artistes afin qu’ils se rendent dans les écoles, un soutien apporté aux projets culturels diffusables à la radio ou à la télévision, de l’aide aux tournées et, relativement aux musées, une aide accordée prioritairement aux institutions inscrivant l’éducation et la formation artistique au rang de priorités.
Par exemple de ce souci d’éducation, avec l’initiative airtrain ou train des arts. Musée roulant qui effectua un trajet du Colorado vers la Floride avec à son bord de célèbres œuvres de peinture classique, des sculptures ainsi qu’une troupe d’artistes travaillant à bord et proposant, à chaque étape, des ateliers de création dans les écoles et les villages.
Cette agence se mit également à financer et à protéger le folk art, des ateliers de poterie, des clubs de blues, du théâtre folklorique régional, de l’artisanat fabriqué par les tribus apaches et cheyennes, l’art de tailler du bois au couteau.
A ce souci d’éducation et d’élargissement des publics s’est donc ajouté celui de reconnaître la culture américaine dite moyenne. C’est là un point fondamental sur lequel nous reviendrons souvent. En effet ces initiatives ne furent pas du goût de tous et suscitèrent de nombreuses critiques « de la part des grandes institutions artistiques de le côte Est, (d)es administrateurs des grands musées se demandant par exemple s’il ne serait pas plus judicieux que le NEA se concentre sur le financement de leurs prochaines expositions dédiées à Rembrandt et Goya, plutôt que de tenter de protéger les « old cow-boy rock drawiings » du Wyoming (les dessins des cow-boys sur les rochers), enseigner l’art des paniers tressés dans les Appalaches ou entretenir la technique de fabrication des patchworks des indiens du Nouveau Mexique. Hier réticentes devant l’engagement de l’Etat dans la culture, voici les grandes institutions culturelles élitistes de la côte Est soucieuses maintenant de protéger leur pré carré. [2]»
Cette citation illustre bien la puissance des hiérarchies aux Etats-Unis. Il n’en fut pas toujours ainsi : tel est l’objet du livre de Levine.
Que comprendre de ces expositions dédiées à Rembrandt ou à Goya (artistes européens) ? Selon quelles modalités donnent-elles un accès à l’art, aux grandes œuvres capitales de l’humanité ? Selon quelle ritualité ? Pour quelle finalité ?
A l’inverse, l’initiative étatique en matière de démocratisation de la culture pose de sérieuses questions : s’agit-il d’éduquer des populations adultes ? Selon quelle conception de l’art et de ce qui fait sa valeur ? Sous quelles modalités ? S’agit-il d’une éducation passant par l’école ? Selon quel type d’enseignement alors ? En transmettant des leçons d’histoire de l’art ? Pour quelles finalités ?
L’objectif de démocratisation de la culture s’insère dans des soubassements idéologiques souvent peu explicités. Nous tenterons de les mettre en lumière grâce aux informations acquises par la lecture du livre de Lawrence Levine qui, dans une perspective historique renouvelée nous invite à redéfinir la fonction d’historien. Celui-ci a pour tâche d’être à « (…) l’écoute des voix réduites au silence » et de comprendre « les pratiques culturelles censurées, ignorées ou méprisées par les dominants.[3] »
Ainsi de ces spectateurs de Shakespeare, qui, dans l’Amérique du XIXe siècle se sont vus imposer, par les élites et les nouvelles classes moyennes issues de l’industrialisation croissante des Etats-Unis, une modalité particulière dans le rapport aux œuvres et aux lieux culturels.
Si de nos jours il s’agit d’élargir les publics, à cette époque en revanche « le débat principal portait moins sur qui pouvait entrer dans l’enceinte du musée d’art, de la salle de concerts, de l’opéra que sur ce qu’on devait ressentir une fois à l’intérieur, et sur l’objectif principal de ces temples de la culture.[4] »
Une fois devenus temples ces lieux culturels (théâtre, musée, opéra, et même cinéma) se sont tournés vers certaines œuvres, qui furent alors jouées d’une certaine manière : plus question de mêler des airs d’opéra à des chansons populaires, de lancer des potirons et des cucurbites sur la scène, plus question non plus de manifester son enthousiasme ou son désaccord profond face à la représentation de telle œuvre. Le public, devint passif, domestiqué.
Or, si les classes populaires allaient à l’opéra, au théâtre, connaissaient vraisemblablement les œuvres représentées au point de corriger parfois les acteurs lorsque ceux-ci en venaient à manquer leur réplique, leur rapport à l’art était en tout point différent du nôtre, toutes « classes » confondues. Un processus d’homogénéisation du rapport à l’œuvre s’est instauré et nous semble devenu comme naturel. Le risque est alors de transformer cette configuration historique en vérité : il n’y aurait qu’un seul type possible de rapport à l’œuvre ; on parle alors de légitimisme.
Aurions-nous hérité de ces représentations ? Comment alors les déceler, s’en prémunir ?
« il est nécessaire de porter attention aux fonctions, usages et significations de ces pratiques pour les hommes et les femmes qui, grâce à elles, donnent sens au monde qui est le leur. L’important réside donc moins dans la littéralité des paroles énoncées ou imprimées que dans les circonstances dans lesquelles elles sont entendues, lues, partagées et appropriées.[5] ».
Cela se traduit par un livre très informatif, exhaustif, touffu, dont les thèses, – souvent diluées dans un important travail d’archives s’attachant à retranscrire et donner sens, par leur contextualisation, aux discours des acteurs sociaux – n’apparaissent pas toujours clairement identifiables ; un livre parfois défaillant par son manque de systématisme et de théorisation, par son manque d’inscriptions théoriques (très peu d’auteurs sont citées, peu également de courants de pensées). On peut cependant ranger cet auteur dans l’actuel mouvement des Cultural Studies. Comme beaucoup d’intellectuel de cette « tradition » Gramschi est l’auteur de référence ; ici les nombreuses occurrences du terme « hégémonique » inscrivent sans doute Levine dans cette lignée.
Un dernier travers : ce livre parfois s’avère défaillant par ses aspects quelques peu redondants.
Mais son grand mérite repose dans son projet même consistant à « rendre compte du processus de sélection des œuvres ou des genres qui transforment les contextes sociaux de leur consommation et qui produisent de nouvelle configuration de sens[6] » ; cela permet de reposer à nouveau le débat critique relatif à la légitimité culturelle et de penser à nouveaux frais les objectifs de démocratisation de la culture.
L’ambition de Levine est d’effectuer la genèse de la sacralisation des œuvres et des attitudes provoquées par ce procédé : l’ordre, la hiérarchie, la constitution d’une culture légitime devant être goutée par les individus, au risque de n’être sinon pas considérés comme civilisés, selon une certaine ritualité nécessaire à toute élévation de l’esprit et à tout raffinement des mœurs.
Levine s’attache à souligner l’importance de l’ethos d’une époque, d’un peuple ; s’attache à mettre au jour son caractère fondamentalement déterminant dans nos rapports à l’art. D’autant plus déterminant que cet ethos s’incarne dans des institutions culturelles dont l’objectif est qu’elles soient fréquentées par le plus grand nombre.
Le premier chapitre analyse les modifications dans la réception du théâtre shakespearien. Elles tiendraient à deux phénomènes socioculturels : le déclin de la rhétorique et le processus visant à séparer et à discriminer les publics.
« Au tournant du siècle ; Shakespeare avait subi une transformation : il n’était plus un auteur dramatique populaire dont les pièces étaient la propriété de ceux qui affluaient pour les voir, mais un auteur sacré qui devait être protégé des publics ignorants et des acteurs dominateurs menaçant l’intégrité de ses créations.[7] »
Populaire, parodié, joué au milieu des divertissements populaires comme le jonglage, l’acrobatie, la magie, et faisant partie intégrante de ceux-ci, le théâtre de Shakespeare pouvait se voir mêlé à de la poésie populaire comme voir ses fins modifiées – les tragédies devenant alors comédies – autant de marque d’une propriété commune de l’auteur.
En un mot ce théâtre, grâce au contexte dans lequel il se trouvait représenté, était rendu intime et familier ; car à en croire Levine « le(s) public(s) » savai(en)t pertinemment faire les différences entre Shakespeare, le jonglage et la magie. Mais le rapport aux œuvres pouvait alors être compris comme relevant du spectaculaire. Là encore, préviens Levine, ce raisonnement est une construction historique :
« Historiens et critiques ont maintes fois séparé arbitrairement dans les pièces de Shakespeare, « l’action et l’éloquence » d’un côté, « l’art dramatique et poétique » de l’autre, alors qu’ils sont inextricablement liés, en réalité. On nous demande de croire que le spectateur moyen ne voyait que de la violence, de l’obscénité, du sensationnalisme dans les pièces telles que Richard II, Hamlet, Le Roi Lear, Othello, Macbeth, et était incapable de comprendre les dilemmes moraux et éthiques, les tensions générationnelles entre parents et enfants, l’ambition brute de Richard III ou de Lady Macbeth (…). On nous demande de croire que de telles conditions et situations humaines étaient au delà des capacités de compréhension de la majorité du public, et ne touchaient que les « personnes cultivées », seules à même de saisir les « subtilités de l’art de Shakespeare[8]. »
Or, nous explique Levine, l’une des causes importantes du succès de cet auteur reposait justement en ce qu’il incarnait ou correspondait avec l’ethos de la culture américaine pour qui l’individu est responsable quant à son destin. Le théâtre de Shakespeare véhiculait une morale de la responsabilité individuelle si importante dans l’Amérique du XIXe siècle que « le(s) public(s) » en venai(en)t à ne pas séparer la représentation de la réalité ; cela occasionna des troubles des interventions directes du public, des émeutes parfois.
Le deuxième chapitre rend compte de la progression, lente mais certaine, du processus visant à séparer et à opposer l’art au spectacle.
« L’opéra en Amérique, tout comme Shakespeare en Amérique, n’était pas présenté comme un texte sacré. Il était joué par des artistes qui se sentaient libres d’embellir et de changer, d’ajouter ou d’enlever[9]. »
Ainsi donc « représenter des extraits plutôt que l’opéra en entier c’était avilir l’intégrité même de l’opéra comme forme d’art[10]. »
Déjà amorcé dans le monde du théâtre, ce processus s’applique maintenant à la musique. De nouvelles institutions dédiées à l’art lyrique voient le jour, sous l’influence de riches mécènes incarnant le nouvel ethos américain visant à sacraliser les œuvres, (Academy of Music, Metropolitan Opera House)
Tout comme pour Shakespeare, l’opéra pouvait être parodié, joué au milieu de divertissements populaires, se trouver mêlé à des airs populaires, ou encore voir sa partition modifiée.
« Bien que l’opéra n’ait jamais été, même aujourd’hui, complètement séparé de la culture populaire (…), tout comme le théâtre de Shakespeare, il ne faisait plus partie intégrante du mélange culturel éclectique qui avait caractérisé les Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. »
Ce processus, s’est aussi vu appliqué à la musique symphonique. Levine revient sur certaines initiatives (comme celle de Thomas qui essaya de jouer de la musique symphonique dans des conditions approchant celle d’un concert dans une brasserie dans le but louable d’élever progressivement les individus et de participer à leur lente élévation ; ce fut un échec). Des orchestres symphoniques professionnels et permanents se mettent en place. Le premier naquit à Boston (temple de la culture européenne et lettrée) en 1881. Là encore sous l’impulsion d’un mécène philanthrope (Higginson) qui se désintéressait de l’argent (il connut un déficit de 900 000 dollars qu’il a tenu à rembourser seul) mais possédant une grande autorité sur ses musiciens (situation de monopole) comme sur les représentations et le choix du répertoire. Le refus du mélange des genres et la purification furent deux de ses principaux axes d’actions. Ce mécène « se voyait moins comme un prosélyte pour les masses que comme un défenseur de la foi : un bâtisseur du temple et un gardien de flamme.[11] »
La musique, investie alors de propriétés spirituelles la rendant inviolée et inviolable, exclusive et éternelle, ne pouvait être appropriée par son public (devenu socialement plus homogène) de manières différenciées. L’esthétique des riches mécènes pouvait alors se diffuser pour enfin parvenir à nous apparaître comme une donnée naturelle.
Cette « création du premier orchestre discipliné, indépendant et permanent, qui avait des musiciens entièrement à son service et avait la liberté et le pouvoir de présenter de la musique artistique européenne selon ses propres choix[12] » fut une étape importante dans la constitution progressive d’un public discipliné, passif, s’appropriant l’œuvre musicale selon une esthétique bien définie insistant sur les compositeurs (au dépend des interprètes), rejetant le rythme (« sa valeur musicale est nulle, et sa capacité de nuire est grande[13] »), méprisant l’opéra italien, valorisant Wagner en tant que facteur d’élévation de l’âme et facteur de civilisation.
Lawrence Levine s’intéresse ensuite aux musées. Au processus de sacralisation des œuvres, à ce nouvel ethos, et à son incarnation dans les institutions muséales : il y aurait eu dans les salles d’expositions un passage du général et de l’éclectique à l’exclusif et au spécifique. Nous serions passés de musées mêlant lithographie, copies, photographies, moulages, Beaux Arts … à des institutions isolant de plus en plus les Beaux Arts des autres formes d’expression culturelle et refusant les copies et toutes créations issues de procédures de reproduction technique (photographies…) :
« Dans ces années, de nombreux arbitres de la culture considéraient que tout ce qui était reproduit mécaniquement – toute forme d’expression dans laquelle un procédé mécanique séparait le créateur de sa production – n’était pas authentique et ne méritait donc pas le statut d’œuvre d’art.[14] »
Cette époque vit aussi se structurer d’importants débats relatifs aux fonctions de ces institutions muséales. Ceux-ci débouchèrent sur l’opposition désormais bien connue entre la mission de création et celle de diffusion : notamment autour de la Smithsonian Institution : qui a n’a finalement pu optée pour une collection tournée vers l’étude et n’étant pas là « pour satisfaire une curiosité non éclairée.[15] »
Le dernier chapitre cherche à raccrocher toutes ces mutations dans l’esthétique aux importantes transformations que le Etats-Unis ont traversées au fil du XIXe siècle : l’urbanisation, l’industrialisation, l’immigration… Transformations exposant ce jeune pays à d’importantes vagues migratoires (afro-américaines, allemandes…) venant, sinon fragiliser, du moins modifier en profondeur la culture américaine. Transformations voyant émerger une nouvelle catégorie sociale, une classe moyenne, liée à l’industrialisation qui, loin de remettre en cause les mécanismes de distinction dans les rapports aux arts et à la culture et de critiquer ces nouvelles hiérarchies opposant le savant et le populaire, a au contraire contribué à leur renforcement.
Avec ces mutations de nouvelles règles, de nouvelles normes régissant le rapport aux arts et à la culture se mettent en place ; que cet art soit réputé savant ou populaire (cinéma, vaudeville etc.). La culture s’apparente alors « à un canot de sauvetage sur une mer imprévisible et turbulente.[16] »
Levine explique l’importance, pour que de tels changements deviennent réalité, de jouer sur les représentations des individus. A cette fin « l’invention de la tradition » s’est avéré un processus particulièrement efficace. Instaurant un « ensemble de pratiques rituelles symbolique » il permit « d’inculquer des valeurs et des schèmes de comportement signifiant une continuité avec le passé[17] ». Cela afin d’activer ce que l’on pourrait appeler, à la suite de Norbert Elias, un processus de civilisation compris comme séparation entre la sphère publique et la sphère privée.
La culture devint synonyme de raffinement. Et les opéras, les salles de concerts, les galeries d’art, tout comme les salles de vaudeville « jouaient un rôle actif pour enseigner aux spectateurs à séparer le comportement public des sentiments privés et à maintenir un contrôle strict sur leurs réactions émotionnelles et physiques.[18] »
L’idée d’ordre, de domestication des corps prend forme, se diffuse, en entrainant avec elle la mise en place et le maintient de critères légitimes d’appréciation de la culture :
« une culture libre d’intrusion, échappant à la dilution et aux exigences pressantes des gens et du marché ; une culture qui ennoblirait, élèverait, et purifierait ; une culture qui fournirait un refuge loin de l’agitation, des sentiments d’aliénation, de l’impression d’impuissance qui devenaient si courants.[19] »
La culture prend alors une dimension politique et devient un outil privilégié de rétablissement d’un certain ordre moral passant par la diffusion des formes les plus pures de l’art.
Ces mutations considérables provoquèrent trois types de réaction du côté des élites : la première a consisté à se retirer dans l’espace privé, vécu alors comme lieu d’apaisement ; la deuxième à transformer les espaces publics par des règles, des systèmes de goût et des canons de comportement choisis par l’élite ; et enfin il s’est agit de convertir les étrangers afin de rendre leurs attitudes et leurs comportements conformes à ceux des élites.
Qu’il s’agisse de culture populaire ou savante il fallait accepter les produits culturels dans les termes définis par ceux qui contrôlaient les instituions culturelles. Tout le monde devant « expérimenter » l’art de la même manière. Il s’agissait moins de contrôler l’accès des individus aux institutions que de réglementer les modalités d’accès à l’art.
François Carrière
[1] Martel, Frédéric, De la culture en Amérique, p.10.
[2] Ibid.,, p.159.
[3] Chartier Roger, préface Culture d’en haut culture d’en bas.
[4] Levine Lawrence, Culture d’en haut culture d’en bas, p.176.
[5] Chartier Roger préface Culture d’en haut culture d’en bas.
[6] Fabiani Jean Louis, « Peut- on encore parler de légitimité culturelle ? » In. Le(s) public(s) de la culture, p. 316.
[7] Levine, Lawrence, culture d’en haut culture d’en bas, p. 86
[8] ibid., p.50.
[9] ibid., p.101
[10] ibid., p.114.
[11] ibid., p.136.
[12] ibid., p.137.
[13] ibid., p.230
[14] ibid., p.172.
[15] ibid., p.165.
[16] ibid., p.214
[17] ibid., p.238
[18] ibid., p.210
[19] ibid.,p.215.
Comme nous l’explique Frédéric Martel dans son imposant et riche ouvrage De la culture en Amérique les Etats-Unis possédent leurs politiques en matière d’art et de culture. Et « l’exception culturelle » consistant à soustraire certains biens culturels aux règles classiques du marché, ne serait en réalité pas propriété exclusive de la France. Un important secteur culturel non marchand, fonctionnant grâce à de riches mécènes, des agences artistiques, existe aux Etats-Unis et prend en charge ce qu’il est convenu l’art :
« A rebours de la pente « mainstream » de Times Square, la direction des affaires culturelles de New York, comme des centaines d’agences artistiques publiques dans tous les Etats américains et toutes les villes, finance donc la culture de qualité, les films exigeants plutôt que les productions grand public (« movies »), le théâtre littéraire plutôt que le théâtre commercial, les comédiens plutôt que les acteurs, et tout ce qu’on préfère appeler, aux Etats unis, les « arts » plutôt que la « culture[1] ».
La première politique culturelle américaine d’ampleur fédérale date de 1964 ; date de création du NEA (National Endowment of the Arts) première agence artistique (de nombreuses existent aujourd’hui au niveau des Etats). Alors même que l’Etat français, à cette époque, entame une planification culturelle, l’objectif du NEA est au contraire d’éviter toute intervention étatique, tout choix en matière culturelle. Cette agence fut cependant plus volontariste sous la présidence de Nixon ; lorsqu’elle fut dirigée par Nancy Hanks qui inscrivit dans ses priorités l’éducation artistique. « Presque toute l’action du NEA sous Nancy Hanks a (…) visé à élargir le public de la culture. On estime que 50 % du budget global de l’agence de cette époque sont consacrés à la démocratisation culturelle. » Cela s’est alors traduit par de l’aide donnée aux artistes afin qu’ils se rendent dans les écoles, un soutien apporté aux projets culturels diffusables à la radio ou à la télévision, de l’aide aux tournées et, relativement aux musées, une aide accordée prioritairement aux institutions inscrivant l’éducation et la formation artistique au rang de priorités.
Ainsi par exemple de ce souci d’éducation, avec l’initiative airtrain ou train des arts. Musée roulant qui effectua un trajet du Colorado vers la Floride avec à son bord de célèbres œuvres de peinture classique, des sculptures ainsi qu’une troupe d’artistes travaillant à bord et proposant, à chaque étape, des ateliers de création dans les écoles et les villages.
Cette agence se mit également à financer et à protéger le folk art, des ateliers de poterie, des clubs de blues, du théâtre folklorique régional, de l’artisanat fabriqué par les tribus apaches et cheyennes, l’art de tailler du bois au couteau.
A ce souci d’éducation et d’élargissement des publics s’est donc ajouté celui de reconnaître la culture américaine dite moyenne. C’est là un point fondamental sur lequel nous reviendrons souvent. En effet ces initiatives ne furent pas du goût de tous et suscitèrent de nombreuses critiques « de la part des grandes institutions artistiques de le côte Est, (d)es administrateurs des grands musées se demandant par exemple s’il ne serait pas plus judicieux que le NEA se concentre sur le financement de leurs prochaines expositions dédiées à Rembrandt et Goya, plutôt que de tenter de protéger les « old cow-boy rock drawiings » du Wyoming (les dessins des cow-boys sur les rochers), enseigner l’art des paniers tressés dans les Appalaches ou entretenir la technique de fabrication des patchworks des indiens du Nouveau Mexique. Hier réticentes devant l’engagement de l’Etat dans la culture, voici les grandes institutions culturelles élitistes de la côte Est soucieuses maintenant de protéger leur pré carré. [2]»
Cette citation illustre bien la puissance des hiérarchies aux Etats-Unis. Il n’en fut pas toujours ainsi : tel est l’objet du livre de Levine.
Que comprendre de ces expositions dédiées à Rembrandt ou à Goya (artistes européens) ? Selon quelles modalités donnent-elles un accès à l’art, aux grandes œuvres capitales de l’humanité ? Selon quelle ritualité ? Pour quelle finalité ?
A l’inverse, l’initiative étatique en matière de démocratisation de la culture pose de sérieuses questions : s’agit-il d’éduquer des populations adultes ? Selon quelle conception de l’art et de ce qui fait sa valeur ? Sous quelles modalités ? S’agit-il d’une éducation passant par l’école ? Selon quel type d’enseignement alors ? En transmettant des leçons d’histoire de l’art ? Pour quelles finalités ?
L’objectif de démocratisation de la culture s’insère dans des soubassements idéologiques souvent peu explicités. Nous tenterons de les mettre en lumière grâce aux informations acquises par la lecture du livre de Lawrence Levine qui, dans une perspective historique renouvelée nous invite à redéfinir la fonction d’historien. Celui-ci a pour tâche d’être à « (…) l’écoute des voix réduites au silence » et de comprendre « les pratiques culturelles censurées, ignorées ou méprisées par les dominants.[3] »
Ainsi de ces spectateurs de Shakespeare, qui, dans l’Amérique du XIXe siècle se sont vus imposer, par les élites et les nouvelles classes moyennes issues de l’industrialisation croissante des Etats-Unis, une modalité particulière dans le rapport aux œuvres et aux lieux culturels.
Si de nos jours il s’agit d’élargir les publics, à cette époque en revanche « le débat principal portait moins sur qui pouvait entrer dans l’enceinte du musée d’art, de la salle de concerts, de l’opéra que sur ce qu’on devait ressentir une fois à l’intérieur, et sur l’objectif principal de ces temples de la culture.[4] »
Une fois devenus temples ces lieux culturels (théâtre, musée, opéra, et même cinéma) se sont tournés vers certaines œuvres, qui furent alors jouées d’une certaine manière : plus question de mêler des airs d’opéra à des chansons populaires, de lancer des potirons et des cucurbites sur la scène, plus question non plus de manifester son enthousiasme ou son désaccord profond face à la représentation de telle œuvre. Le public, devint passif, domestiqué.
Or, si les classes populaires allaient à l’opéra, au théâtre, connaissaient vraisemblablement les œuvres représentées au point de corriger parfois les acteurs lorsque ceux-ci en venaient à manquer leur réplique, leur rapport à l’art était en tout point différent du nôtre, toutes « classes » confondues. Un processus d’homogénéisation du rapport à l’œuvre s’est instauré et nous semble devenu comme naturel. Le risque est alors de transformer cette configuration historique en vérité : il n’y aurait qu’un seul type possible de rapport à l’œuvre ; on parle alors de légitimisme.
Aurions-nous hérité de ces représentations ? Comment alors les déceler, s’en prémunir ?
« il est nécessaire de porter attention aux fonctions, usages et significations de ces pratiques pour les hommes et les femmes qui, grâce à elles, donnent sens au monde qui est le leur. L’important réside donc moins dans la littéralité des paroles énoncées ou imprimées que dans les circonstances dans lesquelles elles sont entendues, lues, partagées et appropriées.[5] ».
Cela se traduit par un livre très informatif, exhaustif, touffu, dont les thèses, – souvent diluées dans un important travail d’archives s’attachant à retranscrire et donner sens, par leur contextualisation, aux discours des acteurs sociaux – n’apparaissent pas toujours clairement identifiables ; un livre parfois défaillant par son manque de systématisme et de théorisation, par son manque d’inscriptions théoriques (très peu d’auteurs sont citées, peu également de courants de pensées). On peut cependant ranger cet auteur dans l’actuel mouvement des Cultural Studies. Comme beaucoup d’intellectuel de cette « tradition » Gramschi est l’auteur de référence ; ici les nombreuses occurrences du terme « hégémonique » inscrivent sans doute Levine dans cette lignée.
Un dernier travers : ce livre parfois s’avère défaillant par ses aspects quelques peu redondants.
Mais son grand mérite repose dans son projet même consistant à « rendre compte du processus de sélection des œuvres ou des genres qui transforment les contextes sociaux de leur consommation et qui produisent de nouvelle configuration de sens[6] » ; cela permet de reposer à nouveau le débat critique relatif à la légitimité culturelle et de penser à nouveaux frais les objectifs de démocratisation de la culture.
L’ambition de Levine est d’effectuer la genèse de la sacralisation des œuvres et des attitudes provoquées par ce procédé : l’ordre, la hiérarchie, la constitution d’une culture légitime devant être goutée par les individus, au risque de n’être sinon pas considérés comme civilisés, selon une certaine ritualité nécessaire à toute élévation de l’esprit et à tout raffinement des mœurs.
Levine s’attache à souligner l’importance de l’ethos d’une époque, d’un peuple ; s’attache à mettre au jour son caractère fondamentalement déterminant dans nos rapports à l’art. D’autant plus déterminant que cet ethos s’incarne dans des institutions culturelles dont l’objectif est qu’elles soient fréquentées par le plus grand nombre.
Le premier chapitre analyse les modifications dans la réception du théâtre shakespearien. Elles tiendraient à deux phénomènes socioculturels : le déclin de la rhétorique et le processus visant à séparer et à discriminer les publics.
« Au tournant du siècle ; Shakespeare avait subi une transformation : il n’était plus un auteur dramatique populaire dont les pièces étaient la propriété de ceux qui affluaient pour les voir, mais un auteur sacré qui devait être protégé des publics ignorants et des acteurs dominateurs menaçant l’intégrité de ses créations.[7] »
Populaire, parodié, joué au milieu des divertissements populaires comme le jonglage, l’acrobatie, la magie, et faisant partie intégrante de ceux-ci, le théâtre de Shakespeare pouvait se voir mêlé à de la poésie populaire comme voir ses fins modifiées – les tragédies devenant alors comédies – autant de marque d’une propriété commune de l’auteur.
En un mot ce théâtre, grâce au contexte dans lequel il se trouvait représenté, était rendu intime et familier ; car à en croire Levine « le(s) public(s) » savai(en)t pertinemment faire les différences entre Shakespeare, le jonglage et la magie. Mais le rapport aux œuvres pouvait alors être compris comme relevant du spectaculaire. Là encore, préviens Levine, ce raisonnement est une construction historique :
« Historiens et critiques ont maintes fois séparé arbitrairement dans les pièces de Shakespeare, « l’action et l’éloquence » d’un côté, « l’art dramatique et poétique » de l’autre, alors qu’ils sont inextricablement liés, en réalité. On nous demande de croire que le spectateur moyen ne voyait que de la violence, de l’obscénité, du sensationnalisme dans les pièces telles que Richard II, Hamlet, Le Roi Lear, Othello, Macbeth, et était incapable de comprendre les dilemmes moraux et éthiques, les tensions générationnelles entre parents et enfants, l’ambition brute de Richard III ou de Lady Macbeth (…). On nous demande de croire que de telles conditions et situations humaines étaient au delà des capacités de compréhension de la majorité du public, et ne touchaient que les « personnes cultivées », seules à même de saisir les « subtilités de l’art de Shakespeare[8]. »
Or, nous explique Levine, l’une des causes importantes du succès de cet auteur reposait justement en ce qu’il incarnait ou correspondait avec l’ethos de la culture américaine pour qui l’individu est responsable quant à son destin. Le théâtre de Shakespeare véhiculait une morale de la responsabilité individuelle si importante dans l’Amérique du XIXe siècle que « le(s) public(s) » en venai(en)t à ne pas séparer la représentation de la réalité ; cela occasionna des troubles des interventions directes du public, des émeutes parfois.
Le deuxième chapitre rend compte de la progression, lente mais certaine, du processus visant à séparer et à opposer l’art au spectacle.
« L’opéra en Amérique, tout comme Shakespeare en Amérique, n’était pas présenté comme un texte sacré. Il était joué par des artistes qui se sentaient libres d’embellir et de changer, d’ajouter ou d’enlever[9]. »
Ainsi donc « représenter des extraits plutôt que l’opéra en entier c’était avilir l’intégrité même de l’opéra comme forme d’art[10]. »
Déjà amorcé dans le monde du théâtre, ce processus s’applique maintenant à la musique. De nouvelles institutions dédiées à l’art lyrique voient le jour, sous l’influence de riches mécènes incarnant le nouvel ethos américain visant à sacraliser les œuvres, (Academy of Music, Metropolitan Opera House)
Tout comme pour Shakespeare, l’opéra pouvait être parodié, joué au milieu de divertissements populaires, se trouver mêlé à des airs populaires, ou encore voir sa partition modifiée.
« Bien que l’opéra n’ait jamais été, même aujourd’hui, complètement séparé de la culture populaire (…), tout comme le théâtre de Shakespeare, il ne faisait plus partie intégrante du mélange culturel éclectique qui avait caractérisé les Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. »
Ce processus, s’est aussi vu appliqué à la musique symphonique. Levine revient sur certaines initiatives (comme celle de Thomas qui essaya de jouer de la musique symphonique dans des conditions approchant celle d’un concert dans une brasserie dans le but louable d’élever progressivement les individus et de participer à leur lente élévation ; ce fut un échec). Des orchestres symphoniques professionnels et permanents se mettent en place. Le premier naquit à Boston (temple de la culture européenne et lettrée) en 1881. Là encore sous l’impulsion d’un mécène philanthrope (Higginson) qui se désintéressait de l’argent (il connut un déficit de 900 000 dollars qu’il a tenu à rembourser seul) mais possédant une grande autorité sur ses musiciens (situation de monopole) comme sur les représentations et le choix du répertoire. Le refus du mélange des genres et la purification furent deux de ses principaux axes d’actions. Ce mécène « se voyait moins comme un prosélyte pour les masses que comme un défenseur de la foi : un bâtisseur du temple et un gardien de flamme.[11] »
La musique, investie alors de propriétés spirituelles la rendant inviolée et inviolable, exclusive et éternelle, ne pouvait être appropriée par son public (devenu socialement plus homogène) de manières différenciées. L’esthétique des riches mécènes pouvait alors se diffuser pour enfin parvenir à nous apparaître comme une donnée naturelle.
Cette « création du premier orchestre discipliné, indépendant et permanent, qui avait des musiciens entièrement à son service et avait la liberté et le pouvoir de présenter de la musique artistique européenne selon ses propres choix[12] » fut une étape importante dans la constitution progressive d’un public discipliné, passif, s’appropriant l’œuvre musicale selon une esthétique bien définie insistant sur les compositeurs (au dépend des interprètes), rejetant le rythme (« sa valeur musicale est nulle, et sa capacité de nuire est grande[13] »), méprisant l’opéra italien, valorisant Wagner en tant que facteur d’élévation de l’âme et facteur de civilisation.
Lawrence Levine s’intéresse ensuite aux musées. Au processus de sacralisation des œuvres, à ce nouvel ethos, et à son incarnation dans les institutions muséales : il y aurait eu dans les salles d’expositions un passage du général et de l’éclectique à l’exclusif et au spécifique. Nous serions passés de musées mêlant lithographie, copies, photographies, moulages, Beaux Arts … à des institutions isolant de plus en plus les Beaux Arts des autres formes d’expression culturelle et refusant les copies et toutes créations issues de procédures de reproduction technique (photographies…) :
« Dans ces années, de nombreux arbitres de la culture considéraient que tout ce qui était reproduit mécaniquement – toute forme d’expression dans laquelle un procédé mécanique séparait le créateur de sa production – n’était pas authentique et ne méritait donc pas le statut d’œuvre d’art.[14] »
Cette époque vit aussi se structurer d’importants débats relatifs aux fonctions de ces institutions muséales. Ceux-ci débouchèrent sur l’opposition désormais bien connue entre la mission de création et celle de diffusion : notamment autour de la Smithsonian Institution : qui a n’a finalement pu optée pour une collection tournée vers l’étude et n’étant pas là « pour satisfaire une curiosité non éclairée.[15] »
Le dernier chapitre cherche à raccrocher toutes ces mutations dans l’esthétique aux importantes transformations que le Etats-Unis ont traversées au fil du XIXe siècle : l’urbanisation, l’industrialisation, l’immigration… Transformations exposant ce jeune pays à d’importantes vagues migratoires (afro-américaines, allemandes…) venant, sinon fragiliser, du moins modifier en profondeur la culture américaine. Transformations voyant émerger une nouvelle catégorie sociale, une classe moyenne, liée à l’industrialisation qui, loin de remettre en cause les mécanismes de distinction dans les rapports aux arts et à la culture et de critiquer ces nouvelles hiérarchies opposant le savant et le populaire, a au contraire contribué à leur renforcement.
Avec ces mutations de nouvelles règles, de nouvelles normes régissant le rapport aux arts et à la culture se mettent en place ; que cet art soit réputé savant ou populaire (cinéma, vaudeville etc.). La culture s’apparente alors « à un canot de sauvetage sur une mer imprévisible et turbulente.[16] »
Levine explique l’importance, pour que de tels changements deviennent réalité, de jouer sur les représentations des individus. A cette fin « l’invention de la tradition » s’est avéré un processus particulièrement efficace. Instaurant un « ensemble de pratiques rituelles symbolique » il permit « d’inculquer des valeurs et des schèmes de comportement signifiant une continuité avec le passé[17] ». Cela afin d’activer ce que l’on pourrait appeler, à la suite de Norbert Elias, un processus de civilisation compris comme séparation entre la sphère publique et la sphère privée.
La culture devint synonyme de raffinement. Et les opéras, les salles de concerts, les galeries d’art, tout comme les salles de vaudeville « jouaient un rôle actif pour enseigner aux spectateurs à séparer le comportement public des sentiments privés et à maintenir un contrôle strict sur leurs réactions émotionnelles et physiques.[18] »
L’idée d’ordre, de domestication des corps prend forme, se diffuse, en entrainant avec elle la mise en place et le maintient de critères légitimes d’appréciation de la culture : « une culture libre d’intrusion, échappant à la dilution et aux exigences pressantes des gens et du marché ; une culture qui ennoblirait, élèverait, et purifierait ; une culture qui fournirait un refuge loin de l’agitation, des sentiments d’aliénation, de l’impression d’impuissance qui devenaient si courants.[19] »
La culture prend alors une dimension politique et devient un outil privilégié de rétablissement d’un certain ordre moral passant par la diffusion des formes les plus pures de l’art.
Ces mutations considérables provoquèrent trois types de réaction du côté des élites : la première a consisté à se retirer dans l’espace privé, vécu alors comme lieu d’apaisement ; la deuxième à transformer les espaces publics par des règles, des systèmes de goût et des canons de comportement choisis par l’élite ; et enfin il s’est agit de convertir les étrangers afin de rendre leurs attitudes et leurs comportements conformes à ceux des élites.
Qu’il s’agisse de culture populaire ou savante il fallait accepter les produits culturels dans les termes définis par ceux qui contrôlaient les instituions culturelles. Tout le monde devant « expérimenter » l’art de la même manière. Il s’agissait moins de contrôler l’accès des individus aux institutions que de réglementer les modalités d’accès à l’art.
[1] Martel, Frédéric, De la culture en Amérique, p.10.
[2] Martel Frédéric, De la Culture en Amérique, p.159.
[3] Chartier Roger, préface Culture d’en haut culture d’en bas.
[4] Levine Lawrence, Culture d’en haut culture d’en bas, p.176.
[5] Chartier Roger préface Culture d’en haut culture d’en bas.
[6] Fabiani Jean Louis, « Peut- on encore parler de légitimité culturelle ? » In. Le(s) public(s) de la culture, p. 316.
[7] Levine, Lawrence, culture d’en haut culture d’en bas, p. 86
[8] ibid., p.50.
[9] ibid., p.101
[10] ibid., p.114.
[11] ibid., p.136.
[12] ibid., p.137.
[13] ibid., p.230
[14] ibid., p.172.
[15] ibid., p.165.
[16] ibid., p.214
[17] ibid., p.238
[18] ibid., p.210
[19] ibid.,p.215.