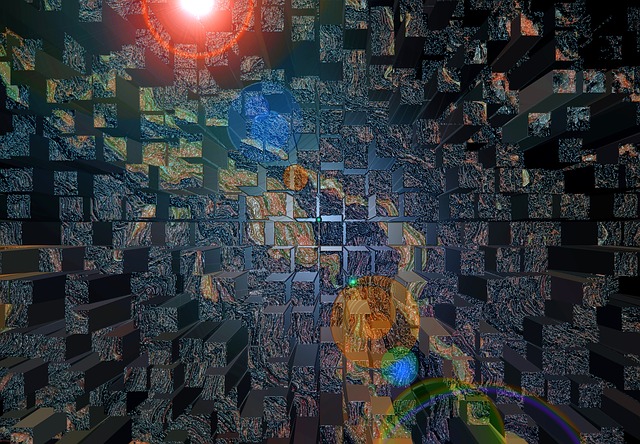Et si c’était bien…
Précis de L’imagination en morale
Martin Gibert – Groupe de recherche universitaire sur la normativité, Université de Montréal
Résumé : Cet article en psychologie morale présente la thèse centrale du livre L’imagination en morale (Hermann, 2014). L’imagination peut, dans certaines conditions, enrichir notre connaissance morale, à travers la prise de perspective, le cadrage et la comparaison contrefactuelle. Par sa capacité à se détacher de ce qui est cru ou perçu, l’imagination offre un accès épistémique privilégié aux caractéristiques d’une situation qui sont moralement pertinentes sans être perceptuellement saillantes.
Abstract: This paper in moral psychology presents the main thesis of the book L’imagination en morale (Hermann, 2014). In certain conditions, imagination can improve our moral knowledge – through perspective taking, framing and counterfactual comparison. Its ability to move away from what is believed or perceived enables imagination to provide privileged epistemic access to the morally relevant while not perceptually salient characteristics of a given situation.
La morale relève d’un certain type de réflexion sur l’action humaine. Il ne s’agit pas de décrire l’effet de nos actions sur le monde, mais de se demander ce que ces actions devraient être. En ce sens, la réflexion morale ne cesse de se demander : et si c’était bien d’agir de telle ou telle manière… Il s’ensuit qu’évaluer moralement une action n’est pas, comme on pourrait le croire, seulement une affaire de raison. Cela engage aussi l’imagination.
C’est, du moins, ce que j’ai essayé de montrer dans L’imagination en morale[1]. J’y défends l’idée que l’imagination a une fonction épistémique : elle peut enrichir notre connaissance morale. Or, cette thèse métaéthique s’appuie sur un certain nombre d’informations empiriques et de résultats expérimentaux quant au rôle de l’imagination dans notre psychologie morale. Voici comment et pourquoi.
Les moines, la couleur des privilèges et la pause pipi
Imaginez un monastère. Imaginez trente moines dans le monastère. Les règles y sont strictes et nul ne peut communiquer avec quiconque. La seule rencontre quotidienne est le repas (silencieux) de midi – et il est interdit de se lever durant toute l’heure qu’il dure. Par ailleurs, un obscur point théologique impose un iconoclasme radical : aucun miroir ni aucune surface réfléchissante ne détourneront les moines de la seule contemplation de Dieu. Même les cuillères sont en bois.
Un beau dimanche d’octobre, un haut membre de l’ordre monastique rend visite aux moines et leur annonce, durant le repas, que certains d’entre eux sont atteints d’une maladie non évolutive et non contagieuse. L’unique symptôme est une tache rouge au milieu du front. Il demande alors aux malades de quitter le monastère au plus tôt. Le samedi suivant, après le repas, tous les moines malades sortent ensemble du monastère. Combien étaient-ils?
Cette énigme, attribuée à Henri Poincaré, est des plus difficiles. On peut approcher la solution avec un raisonnement par récurrence. Si un seul moine était malade (x=1), il aurait dû sortir le dimanche, après l’allocution du supérieur. En effet, ne voyant aucune tache rouge sur ses compères, il aurait facilement pu déduire qu’il était le seul malade. Qu’en aurait-il été si deux moines (x=2) avaient été malades?
Le dimanche, chacun d’eux voyant une tache rouge et 28 fronts immaculés, se dit que l’infortuné devra partir (ils font chacun le raisonnement pour x=1). Le lundi, au repas, chacun des deux constatant que le moine malade n’est pas parti la veille, ils doivent se rendre à l’évidence : la seule explication à la présence de l’autre vient de ce qu’il a fait le même raisonnement que lui. Et qu’ils sont donc deux à être malades. Les autres moines qui ne savent pas si x=2 ou si x=3 découvrent avec soulagement le mardi que les deux moines sont partis. Si l’on poursuit le raisonnement, on peut montrer qu’un départ le samedi signifie que x=7.
Cette énigme suppose une capacité au raisonnement par récurrence. Mais pas uniquement. Chacun des moines doit aussi être capable de considérer la situation du point de vue de ses compères. Il doit être capable de cet exercice d’imagination qui consiste à prendre la perspective des autres. Cette capacité au mindreading (la « lecture » des pensées de l’autre) est une pièce centrale de notre vie sociale. Elle est aussi cruciale pour la perception morale.
La prise de perspective peut être très intellectuelle ou « froide » (comme dans le cas des moines) : elle permet alors d’accéder à un point de vue plus universel, à des raisons d’agir qui tiennent compte de la pluralité des expériences. C’est un point qui n’a pas échappé à la tradition dite rationaliste en psychologie morale (Jean Piaget, Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan). Mais la prise de perspective peut aussi être plus « chaude », c’est-à-dire accompagnée d’émotions (comme le montre Martha Nussbaum dans sa lecture d’Aristote). C’est précisément ce qui se passe lorsque nous faisons preuve d’empathie : nous ressentons des émotions semblables à celles de l’autre. Qu’elle soit chaude ou froide, on peut dire que la prise de perspective enrichit notre connaissance.
Pourquoi les pansements médicaux sont-ils de couleur chair? Et pourquoi appelle-t-on le rose pâle la « couleur chair »? Ces questions ne sont pas également étranges pour tout le monde. Dans son fameux article de 1988, « White Privilege and Male Privilege », l’Américaine Peggy McIntosh identifie les privilèges dont elle jouit en tant que blanche. Elle explique qu’on lui a « appris à voir le racisme uniquement dans des actes individuels méchants, et pas dans des systèmes conférant une prédominance sur un groupe[2] ». Dès lors, prendre conscience du privilège blanc, c’est percevoir ce racisme systémique et diffus, mais non moins réel.
Dans son article McIntosh identifie cinquante privilèges depuis « Je peux allumer la TV ou regarder la première page du journal et voir les gens de ma race largement représentés » à « Je n’ai pas à éduquer mes enfants à être conscients du racisme systémique pour leur protection physique quotidienne. » C’est un exercice de prise de perspective, mais pas seulement. Il y a aussi ce qu’on peut nommer un recadrage imaginatif.
Ainsi, une personne blanche pourrait voir sa peau comme étant noire : de quoi aurait l’air le pansement sur son avant-bras? Le cadrage, ou le « voir comme », est quelque chose d’extrêmement présent dans notre perception morale. En effet, comme l’ont notamment montré Erving Goffman (Les cadres de l’expérience) ou Marc Johnson et George Lakoff (Les métaphores dans la vie quotidienne), nous percevons généralement la réalité à travers des cadres ou des métaphores conceptuelles.
Cela vaut aussi pour la réalité morale. Dans les débats sur l’avortement, on peut voir un fœtus comme une petite personne qui crie ou comme une excroissance indésirable. Un steak peut être vu comme un met appétissant ou comme un morceau de cadavre. Et, comme le remarque le psychologue Jonathan Haidt, le cadrage détermine des actions : « Si Saddam Hussein est Hitler, il faut l’arrêter. Mais si l’Irak est le Vietnam, les États-Unis ne devraient pas intervenir[3]. »
De quoi a-t-on besoin pour écrire un article ou un livre de philosophie? D’un thème, d’une thèse et de la capacité de communiquer. Mais ce n’est pas tout. Dans leur petit livre La juste part, les philosophes québécois David Robichaud et Patrick Turmel ont un exemple magnifique : lorsqu’ils travaillent dans un café, il leur arrive d’aller aux toilettes. Et quand ils reviennent, ils reprennent leur travail sur leur ordinateur qui n’a pas été volé. Pour les auteurs, cela montre l’importance de la coopération sociale dans la production de richesse.
Pour moi, cela illustre un troisième usage de l’imagination : la comparaison contrefactuelle. Il s’agit de se représenter un monde possible dans lequel les cafés de Québec sont pleins de voleurs. C’est un outil précieux pour évaluer le passé et le présent au regard de ce qu’ils auraient pu être, mais aussi pour planifier le futur. John Dewey avait d’ailleurs développé une théorie de l’imagination comme « répétition mentale de l’action » qui s’appuyait sur ce type de comparaisons entre différentes possibilités futures. L’usage moral ou politique des utopies s’inscrit également dans cette lignée.
Comment l’imagination enrichit la connaissance morale
Comme le suggèrent les trois exemples précédents, la prise de perspective, le recadrage et la comparaison contrefactuelle peuvent, dans certains contextes, enrichir notre connaissance morale. Ils peuvent nous rendre « sensibles » à ce qui importe. Il s’ensuit que l’imagination a une fonction épistémique.
Cela peut surprendre. On conçoit souvent l’imagination comme une « folle du logis » que tout oppose à la raison. De plus, l’imagination est sous le contrôle de la volonté : je peux imaginer ce que je veux[4], de la couleur de ma peau à des fourmis de dix-huit mètres. Dès lors, croire ce que l’on imagine n’est-ce pas simplement croire ce que l’on veut? Comment l’imagination peut-elle être épistémiquement fiable? Que sait-on aujourd’hui de l’imagination?
En philosophie de la psychologie, les auteurs qui, à l’instar de Tamar Gendler, Gregory Currie ou Amy Kind, s’intéressent à l’imagination s’accordent pour dire que c’est une faculté cognitive distincte. Dans la perspective « simulationniste » aujourd’hui dominante, les imaginations seraient des pseudo croyances ou des pseudo perceptions. Dans le premier cas, on parlera d’imagination propositionnelle (j’imagine/suppose que je m’appelle Marc Levy), dans le second cas, d’imagination perceptuelle (j’imagine/visualise une scène d’un roman de Marc Levy).
Pour ma part, je suggère qu’on peut aussi distinguer l’imagination des désirs et des croyances à l’aide du concept de direction d’ajustement. Pour Élisabeth Anscombe, lorsque j’ai une croyance, ma pensée s’ajuste sur le monde tandis que lorsque j’ai un désir, c’est en quelque sorte le monde qui est censé s’y ajuster. Je propose de dire que l’imagination est, comme la croyance, un ajustement de la pensée sur le monde, mais c’est un ajustement sur un monde possible, c’est-à-dire un monde que je peux imaginer selon mon désir. On peut donc reformuler la question : comment la simple imagination d’un monde possible peut-elle nous apprendre quoi que ce soit sur notre monde actuel?
Il faut d’abord voir que l’imagination est assez fiable pour prédire ou anticiper les émotions. Si telle chose m’effraie ou m’attriste lorsque je l’imagine, il y a de bonnes chances qu’elle m’effraie ou m’attriste lorsque je la percevrai. Je sais que j’aurai le vertige si je grimpe en haut de l’arbre parce que j’ai mal au ventre en l’imaginant.
De plus, nous n’imaginons pas n’importe quoi ni n’importe comment. Pour Timothy Williamson, qui s’intéresse de près à l’épistémologie modale, il est clair que nous exerçons un contrôle lorsque nous imaginons. En respectant les lois de la physique dans la représentation imaginée d’un événement naturel, par exemple, nous pouvons avoir une idée assez juste de ce qui adviendrait « pour de vrai ». Ainsi, en tant qu’elle est une capacité de simuler (des croyances et des perceptions : MAJ le 6/5/15), l’imagination s’avère modestement fiable, mais pratiquement indispensable.
Du côté de la psychologie empirique, on a aussi découvert que l’imagination respecte certaines règles. Nous imaginons, par exemple, plus facilement une alternative à une action qu’à une omission. Nous avons aussi du mal à imaginer que des évènements passés auraient pu se produire différemment – c’est ce qu’on nomme le biais rétrospectif. De plus, l’étude des mécanismes de la pensée contrefactuelle permet d’expliquer pourquoi le médaillé de bronze (« j’aurais pu ne pas être sur le podium ») est en général plus heureux que le médaillé d’argent (« j’aurai pu avoir l’or »)[5].
On peut illustrer l’apport de l’imagination à la connaissance morale avec l’exemple des expériences de pensée. Cet « outil » des philosophes moraux consiste à tester l’intuition morale des gens dans des situations contrefactuelles afin d’en tirer des informations. Ainsi, dans une expérience de pensée célèbre, Judith Thomson nous demande d’imaginer que nous nous réveillons un beau matin dans une chambre d’hôpital branché à un inconnu. On nous explique alors que nous sommes la seule personne compatible avec ce célèbre violoniste atteint d’une maladie rare. Si nous décidons de nous débrancher, il mourra en quelques minutes. Si nous restons à ses côtés, alité pendant neuf mois, il sera sauvé et nous retrouverons une vie normale.
La plupart des gens ont l’intuition qu’il serait moralement acceptable de se débrancher (et tant pis pour le violoniste). Pour Judith Thomson, cela nous rappelle que la valeur de l’autonomie peut, dans certains contextes, peser plus lourd que celle de la vie humaine. Il s’ensuit un argument en faveur du droit à l’avortement : l’autonomie de la mère qui ne veut pas d’enfant pourrait prévaloir sur le droit à la vie du fœtus (quand bien même on supposerait que le fœtus est une personne).
Que fait cette expérience de pensée? En comparant une situation réelle (l’avortement) avec une autre purement imaginaire (le violoniste), elle rend saillante la valeur de l’autonomie, c’est-à-dire une caractéristique moralement pertinente[6]. Elle nous aide à envisager avec un peu de recul – ou de « distance psychologique » – les valeurs morales en conflit dans une situation d’avortement.
On dira que la perception morale d’une situation est appropriée lorsque les éléments pertinents sont aussi saillants. Mais il arrive malheureusement qu’un élément soit « sous-exposé ». Ainsi, jusqu’à une date récente, le harcèlement de rue subi par de nombreuses femmes n’était, pour moi, pas du tout saillant – bien que pertinent d’un point de vue moral. À l’inverse, il arrive que des éléments soient « surexposés » et captent indument l’attention. On peut ainsi considérer que certains biais cognitifs détournent la perception morale par des « détails » saillants, mais non pertinents.
Bref, à travers la prise de perspective, le recadrage et la comparaison contrefactuelle, l’imagination nous donne un accès épistémique à des caractéristiques sous-exposées : le point de vue d’autrui, le privilège blanc ou l’importance de la coopération sociale pendant la pause pipi. Voilà, en définitive, comment notre perception morale peut s’élargir.
Et si c’était bien d’imaginer…
L’essentiel de mon propos relève de la psychologie morale, c’est-à-dire d’une étude descriptive et scientifiquement informée de la moralité. Il est toutefois légitime de se poser une question normative : faut-il promouvoir l’imagination? Devrions-nous imaginer davantage lorsque nous essayons de délibérer ou de percevoir un problème moral?
Il s’agit en quelque sorte de se demander, dans le cadre d’une théorie normative de la délibération morale, si l’imagination est bonne ou mauvaise conseillère. On peut facilement concevoir des situations où l’imagination ne ferait qu’empirer les choses. Le bourreau peut exercer son imagination pour être encore plus cruel. Et les nazis mobilisaient le cadrage pour présenter les juifs comme de la vermine. Que faut-il en conclure?
Ce que je soutiens, c’est que l’imagination n’est pas – comme la générosité ou le sens de la justice – une vertu morale. C’est plutôt – comme la curiosité ou l’honnêteté intellectuelle – une vertu épistémique. Dès lors, si l’imagination contribue à une meilleure délibération, c’est indirectement : c’est dans la mesure où elle enrichit la connaissance morale. Il convient donc de promouvoir l’imagination si l’on a des raisons de penser que la connaissance morale est désirable.
Or, je crois que l’ignorance – davantage que la bêtise ou la méchanceté – explique beaucoup de violences et d’injustices. On ignore, par exemple, nos biais racistes, on sous-estime le privilège mâle. Dès lors, il se pourrait que développer cette vertu épistémique qu’est l’imagination contribue à lutter contre la violence et l’injustice. C’est, du moins, ce que croient Amos Oz et Susan Sontag.
Dans sa conférence Comment guérir un fanatique? Amos Oz soutient que le fanatique est « totalement dénué d’imagination[7] ». On pourrait dire que le fanatique croit ce qu’il croit et qu’il perçoit ce qu’il perçoit. Mais il n’imagine pas. Il ne prend pas de perspective, il n’essaye pas de voir les choses autrement. Lui insuffler un peu d’imagination, conclut l’écrivain, pourrait être efficace pour le guérir de son fanatisme.
Susan Sontag, pour sa part, estime que nous avons besoin de fiction « pour étendre notre monde ». La littérature, en particulier, permet de se « rappeler constamment la simultanéité de ce qui arrive dans le monde[8] ». Et qu’est-ce qu’un roman sinon une longue expérience de pensée? Qu’est-ce que l’immersion narrative sinon un exercice qui mêle la prise de perspective, le « voir comme » et la comparaison contrefactuelle?
Une expérience récente suggère en tout cas que la littérature permet de garder l’esprit ouvert[9]. Après avoir demandé à des étudiants de l’Université de Toronto de lire, soit un essai, soit une nouvelle, on a mesuré leur besoin de « clôture cognitive ». On entend par là une forme de rigidité intellectuelle qui se traduit notamment par une aversion pour l’ambigüité, un besoin d’aboutir rapidement à un jugement définitif et une imperméabilité aux informations qui impliqueraient de réviser son jugement.
Que constate-t-on? Ceux qui ont lu une nouvelle cherchent moins la clôture cognitive que ceux qui ont lu un essai. Ils sont plus ouverts. Ils sont plus sensibles à la complexité du monde. Voilà qui semble plutôt une bonne nouvelle. Reste, toutefois, au moins une question empirique : et si l’essai lu par les étudiants portait sur l’imagination en morale…
[1] Mon livre est publié aux Éditions Hermann, dans la collection dirigée par Charles Girard, l’Avocat du diable.
[2] http://www.millebabords.org/spip.php?article8087
[3] J. Haidt, The Emotional Dog and its Rational Tail : A Social Intuitionnist Approach to Moral Judgment, Psychological Review, vol. 108, 2001, p. 825.
[4] Il existe toutefois certaines exceptions pour lesquelles on parle de « résistance imaginative » : on pourra ainsi avoir du mal à imaginer un monde où il serait moralement acceptable de torturer des innocents pour le plaisir.
[5] V. Medvec et al. When Less is More : Counterfactual Thinking and Satisfaction among Olympic Athletes, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 69, 1995, pp. 603-610.
[6] Un élément d’une situation est moralement pertinent au regard d’une théorie normative : par exemple, on considère habituellement que la différence entre tuer et laisser mourir n’est pas pertinente pour l’utilitarisme de l’acte.
[7] A. Oz, Comment guérir un fanatique, Paris, Gallimard, 2006, p. 39
[8] S. Sontag, The Truth of Fiction Evokes our Common Humanity, Discours prononcé le 7 avril 2004 à la bibliothèque publique de Los Angeles Sorensen, http://www.latimes.com/local/obituaries/la-122804sontag_archives-story.html#page=2
[9] M. Djikic et al., Opening the Closed Mind: The Effect of Exposure to Literature on the Need for Closure, Creativity Research Journal, vol. 25, n° 2, 2013, pp. 149–154.