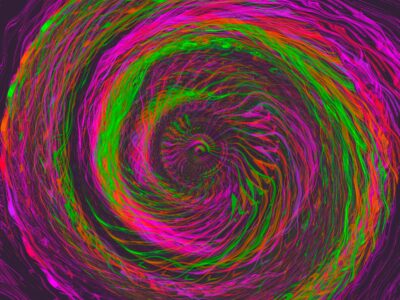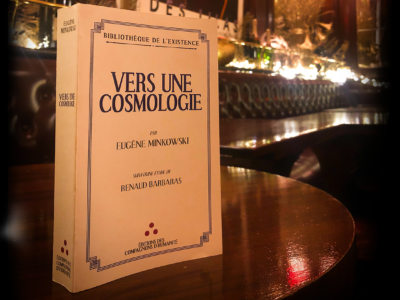Empirisme et théorie de la connaissance – Recension
André Charrak, Empirisme et théorie de la connaissance, réflexion et fondement des sciences au XVIIIe siècle, 2009, Vrin. 180 pages – 18 euros.
Empirisme et théorie de la connaissance, réflexion et fondement des sciences au XVIIIe siècle, 2009, Vrin. 180 pages – 18 euros.
Empirisme et théorie de la connaissance peut se concevoir comme un premier jalon dans la production philosophique d’André Charrak, comme une étape à laquelle l’auteur opèrerait une sorte de retour, synthétique et critique, sur un ensemble de recherches consacrées à l’âge classique.
Les résultats de ces recherches ont bénéficié d’une exposition détaillée dans deux précédents livres : Empirisme et métaphysique, l’Essai sur l’origine des connaissances humaines de Condillac (2003, Vrin) et Contingence et nécessité des lois de la nature au XVIIIe siècle (2006, Vrin). Citer ces deux précédents ouvrages n’a rien de convenu, dans la mesure où cette dernière parution permet de convoquer l’ensemble du champ philosophique qui avait été engagé précédemment, c’est-à-dire aussi bien la tradition empiriste, comme le titre le laisse évidemment présager, que le corpus leibnizien. C’est toucher là à ce qui constitue certainement le cœur de l’ouvrage d’André Charrak, à savoir que la tradition empiriste s’y trouve analysée dans son rapport à un corpus qui ne comprend pas seulement des auteurs de sa propre tradition mais qui implique une tradition rationaliste, non pas tant, de manière prévisible, sous le mode de l’opposition, que sous celui de la reprise. Cette intrication des doctrines dans un corpus complexe fait la densité de l’ouvrage, qui, dans sa technicité et par un style caractérisé par un certain effacement du sujet, peut contribuer, par sa qualité même, à voiler les enjeux majeurs qu’il porte non seulement pour l’histoire de la philosophie, mais, pensons-nous, pour la possibilité même d’un empirisme aujourd’hui.
Ce sont ces enjeux que nous souhaitons mettre ici en évidence en les présentant sous la considération cardinale qui nous semble déterminer l’ouvrage dans son ensemble, celle d’une réhabilitation de l’image de l’empirisme, passant par une histoire détaillée de ce dernier, et, comme l’auteur le rappelle dans la conclusion, par le traitement d’auteurs trop peu convoqués comme Maupertuis, Mérian ou d’Alembert. Le cœur de cette réhabilitation tient dans une critique, celle de la trop grande importance marquée en histoire de la philosophie à l’égard de l’entreprise réductionniste, laquelle ne saurait, pour André Charrak, faire oublier la capacité des empiristes eux-mêmes à « faire réflexion » sur leur démarche en en remarquant les limites. C’est sur ces zones de tension, où les auteurs empiristes deviennent conscients des difficultés posées par leurs choix théoriques, que l’ouvrage décide donc de se concentrer, en se réservant la tâche difficile de montrer que de telles tensions ne rendent aucunement caduque la possibilité même de l’empirisme, mais en redéfinissent les lignes théoriques fondamentales comme la méthode (voire proposent une certaine méthode comme ligne théorique fondamentale). Cette redéfinition, déterminée par ce souci cardinal de mise au point, s’opère au sujet de deux concepts principaux qui constituent les deux volets de l’ouvrage, selon une ligne de partage qui recoupe une distinction entre empirisme des genèses et empirisme de la constitution : la réflexion et l’application.
L’empirisme de la genèse. Le problème de la réflexion à l’âge classique
La thèse exposée dans cette première partie peut être résumée sous l’affirmation suivante : c’est à l’initiative de la tradition empiriste que la tradition rationaliste a tâché de définir les compétences de la réflexion. La thèse peut sembler paradoxale, au sens propre du terme. Or la démarche d’André Charrak consiste précisément à montrer comment une doxa au sujet de l’empirisme s’est constituée en passant sur les considérations qui sont l’objet de ce premier volet, et qui consistent en une analyse précise du dialogue Locke-Leibniz ouvert par les Nouveaux Essais sur l’entendement humain. Par delà l’héritage cartésien, l’auteur estime en effet que la réflexion en son sens propre doit son acte de naissance à un empirisme qui ne peut manquer d’être embarrassé par une telle notion. La réflexion fonctionnerait comme un crible à partir duquel s’organisent des alternatives architectoniques pour l’histoire de la philosophie classique. Deux positions, internes à la tradition empiriste, se dessinent en effet : une approche où la réflexion accomplit un simple perfectionnement des opérations de l’âme engagées avant elle, où elle relève ainsi de la simple constitution du donné (Condillac) ou une approche qui comprend la réflexion dans son originalité irréductible (Rousseau).
La thèse centrale de cette première partie est cependant moins dans cette distinction que dans la mise en évidence de ce qu’elle doit à la critique leibnizienne de Locke, critique opérée à l’initiative de l’auteur de l’Essai. C’est donc moins à une histoire interne à l’empirisme que nous sommes confrontés qu’à un « bloc Locke-Leibniz ». Cette thèse est étayée notamment par la réception de certains arguments leibniziens, répondant à Locke, chez Condillac via l’héritage wolffien. Mais elle s’illustre de manière exemplaire chez Rousseau, qui répète une double attitude héritée de Leibniz, en soutenant, dans la Profession de foi, l’irréductibilité des actes réflexifs, qui nous dévoilent quelque chose de la nature de l’esprit.
L’attitude courante, revenant à assigner Condillac à Locke et Wolff à Leibniz, manque ainsi la subtilité d’une distribution complexe. C’est donc à un travail de redistribution que l’auteur s’emploie ici, redistribution dont le sens philosophique transparaît dans la remarque suivante :
C’est l’histoire de la réception d’un passage, plus que son élucidation internaliste, qui permet d’en tirer une leçon philosophique générale – non point sous la forme d’une thèse pourvue d’une actualité intemporelle, (…), mais comme une alternative décrivant les possibilités pensables sous certaines conditions en théorie de la connaissance. [1]
Ce retour sur un corpus plus complexe qu’il n’y paraît, tant ses échos internes sont nombreux, permet ainsi à l’auteur, sur le thème de la réflexion, d’opérer une première brèche dans une compréhension qui ne penserait l’empirisme que sous les traits d’un réductionnisme naïf. C’est que les problèmes posés par le concept de réflexion mettent à la question l’hypothèse, au fondement du réductionnisme, selon laquelle il existe une solidarité entre les opérations de l’âme et le matériau auquel elles s’appliquent. La question de la réflexion place ainsi l’empirisme face à la possibilité problématique d’une constitution totalisée des opérations de l’esprit.
Cette première partie contribue ainsi à critiquer une vision simpliste de l’empirisme, laquelle considérerait « l’analyse génétique comme [une] succession d’étapes étrangères qui s’empilent ou s’agrègent pour constituer expérience ou idées générales »[2]. Elle contribue également à proposer un nouveau regard sur le concept de réflexion, le replaçant en son site propre, tout en rendant justice, réciproquement, à la prégnance des thèses leibniziennes chez les empiristes des Lumières.
La thèse selon laquelle la tradition empiriste doit plus qu’il ne paraît à l’héritage leibnizien ne saurait cependant occulter une différence fondamentale : dans les Nouveaux Essais, la réflexion permettait d’apercevoir des vérités nécessaires. Si la réflexion, chez les empiristes, donne bien accès aux opérations de la pensée, ces dernières se voient ôtées de leur valeur modale. C’est poser la question qui domine la deuxième partie de l’ouvrage : comment la tradition empiriste parvient-elle à penser la nécessité ? Cette question permet à l’auteur d’en venir à un traitement du problème du réductionnisme, introduit cependant dans une perspective critique initiée par les empiristes eux-mêmes.
L’empirisme de la constitution : fonder les sciences
Le premier moment d’Empirisme et théorie de la connaissance s’attachait à une analyse doxographique de laquelle découlait une thèse proprement philosophique : il s’agissait, à travers l’analyse des échos internes à un corpus, de redessiner le visage d’un empirisme initiateur de concepts et de débats que l’on n’a pas coutume de lui attribuer. Le deuxième moment de l’ouvrage adopte une méthode semblable, en partant non pas tant des textes que des champs précis où les principes de l’empirisme s’appliquent. L’auteur passe ainsi du corpus au champ déterminé des sciences et, en premier lieu, à l’exemple de la théorie harmonique. Le concept d’application est en effet fondamental pour une saisie renouvelée de la tradition emprise, et ce pour deux raisons.
Comme nous l’avons noté, l’empirisme se pose à lui-même le problème des limites de la constitution, de la difficulté qu’il y aurait à vouloir reconduire l’ensemble des notions et des opérations de l’esprit à l’expérience sensible : c’est ici la possibilité même du réductionnisme qui se trouve vivement débattue, par les empiristes eux-mêmes, comme d’Alembert. Il s’agit de monter que l’empirisme lui-même prend acte d’une « solution de continuité dans la chaîne des connaissances », « entre le rationnel et l’empirique »[3]. Ce regard critique de l’empirisme sur lui-même est présenté par le biais du problème de la mathesis universalis. André Charrak revient ici sur le concept foucaldien d’épistémè et, via l’exemple de la théorie musicale ramiste[4], le révèle dans sa pertinence comme dans son insuffisance. En effet, la tradition empiriste participe bien de la pensée de l’ordre que met en évidence l’auteur des Mots et les Choses, mais elle relève avant tout de la mathesis universalis en ce qu’elle tente de penser l’application des sciences les unes aux autres.
C’est là que se manifeste toute l’originalité de la thèse de l’auteur concernant le concept d’application. En effet, si l’application fonctionne comme la pierre de touche de l’empirisme de la constitution, ce concept se voit en creux doté d’une positivité théorique fondamentale : la question sera moins pour la tradition empiriste de comprendre comment penser la constitution de vérités générales à partir de la simple expérience particulière que de mener une enquête sur les progrès positifs des sciences. C’est répondre au problème de la méthode analytique convoquée par l’empirisme.
L’empirisme de la constitution serait donc cohérent dans sa démarche, par delà les critiques que l’on peut opposer à la voie de l’invention. La méthode de l’empirisme, telle qu’elle s’exprime chez un Maupertuis, se donnerait plutôt comme une enquête dont l’objet consiste dans les théories scientifiques elles-mêmes, comprises dans leur développement positif. La voie analytique apparaît comme une histoire raisonnée de la constitution, laquelle n’est plus comprise dans une perspective individuelle, mais à l’échelle des théories. Cette compréhension de l’analyse, si elle ne règle certes pas définitivement la tension que l’auteur relève entre l’exigence modale d’universalité et la particularité de l’expérience, permet cependant de mettre en évidence l’horizon sous lequel l’empirisme a pu penser de manière cohérente la constitution des sciences. André Charrak, tout en ménageant une voie pour une pensée renouvelée de l’empirisme, montre ici combien l’histoire des théories est essentielle à une philosophie empiriste et, de manière dérivée, combien une tradition philosophique est toujours solidaire d’une méthode philosophique.
Une généalogie de l’empirisme
C’est sur ce dernier point que l’ouvrage d’André Charrak semble le plus explicitement déterminant dans le paysage actuel de l’histoire de la philosophie, en ce qu’il donne à cette dernière une portée proprement philosophique, non pas au sens courant d’une histoire téléologique[5], mais au sens où c’est in fine comme analyse historique que se comprend la démarche empiriste elle-même.
Cette prégnance du thème historique se révèle à travers la présence dans cet ouvrage de deux penseurs de la philosophie dans son histoire, Kant et Foucault, lesquels semblent dessiner une alternative dans laquelle André Charrak refuse de se placer. Kant, convoqué dans la perspective de l’ « Amphibologie des concepts de la réflexion », présente de manière typique une histoire de la philosophie qui systématise des oppositions qu’André Charrak s’emploie à redessiner dans leur subtilité, mettant en évidence le legs leibnizien dans l’empirisme, comme le legs de la réflexion par l’empirisme. Le « massif kantien »[6] met bien en évidence des tensions et des problèmes cernés par les empiristes mais négligerait ce qu’André Charrak qualifie par ailleurs de « micro-analyses »[7], donnant une lisibilité à l’histoire certes structurante, mais qui semble requise a posteriori par les besoins de la critique. La voie foucaldienne, celle du paradigme de l’épistémè est autrement problématique et fait, comme nous l’avons vu, l’objet d’une critique détaillée dans le deuxième volet de l’ouvrage. C’est ici la question de la continuité de l’histoire qui nous semble au cœur de la critique menée par André Charrak. En effet, la notion paradigmatique d’ « épistémè » ne permettrait pas de comprendre qu’un « héritage concerne non seulement un paradigme positif, mais aussi des oppositions »[8]. André Charrak se révèlerait, en un sens, soucieux de penser cette discontinuité dont traite précisément Foucault dans les premières pages de l’Archéologie du savoir. [9]
C’est un terme voisin que l’auteur d’Empirisme et théorie de la connaissance décide d’ailleurs d’employer pour caractériser sa propre démarche historique, celui de généalogie, terme qui prend en compte non seulement l’analyse historique, soucieuse donc de la différenciation des strates du corpus qu’elle étudie, mais attentive surtout à la mise en évidence des valeurs qui s’attachent à ces strates, au poids dont sont lestés les concepts en question. Ainsi le premier moment de l’ouvrage peut-il être considéré comme une véritable généalogie du concept de réflexion à l’âge classique, ressaisissant son origine empiriste « “contrariée”, ou recouverte »[10]. Cette méthode généalogique permet de conjuguer deux démarches, structurale et génétique, de remarquer des oppositions constitutives mais également des échos inattendus. Comment ne pas voir combien cette méthode est elle-même inspirée par la tradition étudiée dans cet ouvrage ? On notera ici qu’il n’est nullement anodin que l’auteur revienne à plusieurs reprises à Jean-Baptiste Mérian, penseur empiriste de l’histoire de l’empirisme, et qui traite très précisément ce thème de l’application des sciences les unes aux autres.
Il semble dès lors que la démarche même de cet ouvrage témoigne de cette sorte d’empirisme dont André Charrak s’emploie à justifier la possibilité comme la pertinence pour un lecteur contemporain. Un empirisme qu’il qualifie, dans une conclusion dont la lecture est essentielle pour qui veut prendre clairement conscience des enjeux philosophiques de cet ouvrage, de « conscient de lui-même et des limites de ses postulats réductionnistes ». Un empirisme « au long duquel l’esprit (…) se reflète, plutôt que dans la réflexion du sujet sur lui-même, dans l’analyse du développement historique des concepts »[11], comme en témoignent de nombreux passages de ce livre – le travail opéré sur le concept de réflexion, mais également les passages détaillés consacrés au concept d’harmonie en théorie musicale. Empirisme et théorie de la connaissance, par-delà l’effacement apparent de son auteur, participe ainsi de manière exemplaire de la tradition qu’il se donne pour tâche de décrire et de rétablir dans sa densité théorique. L’ouvrage témoigne en cela d’une cohérence remarquable entre une méthode et l’objet auquel elle s’applique et prouve par le fait qu’une philosophie empiriste contemporaine est possible.
Pauline Nadrigny
[1] Empirisme et théorie de la connaissance, p. 43. Nous soulignons
[2] Ibid., p. 69.
[3] Ibid., p. 145.
[4] André Charrak mobilise ici de manière synthétique des considérations exposées dans son ouvrage Raison et perception, fonder l’harmonie au XVIIIe siècle, 2001, Vrin
[5] « L’effort développé dans ce livre pour appréhender dans un même site l’origine des problèmes et les termes de ces problèmes (la réflexion et le statut des faits ; le réductionnisme et les normes spécifiques des sciences mathématiques) exprime un refus de la simplification qui se trouve au principe de toute histoire téléologique de la philosophie. », Ibid., p. 160.
[6] Ibid., p. 162.
[7] « Entretien avec André Charrak », Revue Labyrinthe, n°34, propos recueillis par Élodie Cassan, p. 19
[8] Ibid., p. 105.
[9] M. Foucault, L’Archéologie du savoir, tel gallimard, pp. 20-2.
[10] « Entretien avec André Charrak », p. 18
[11] Ibid., p. 163.